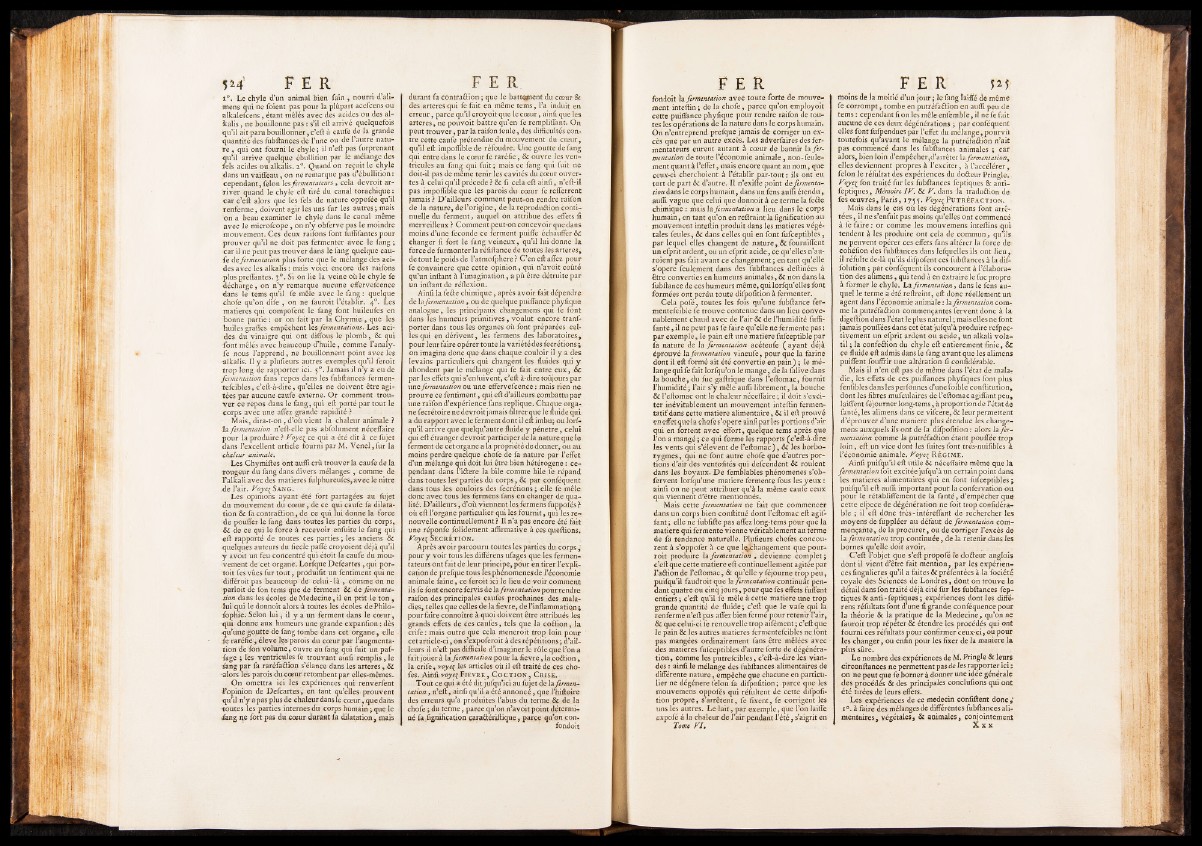
1°. Le chyle d’un animal bien fain , nourri d’ali-
•mens qui ne foient pas pour la plupart acefcens ou
alkalefcens, étant mêlés avec des acides ou des al-
Italis, ne bouillonne pas : s’il eft arrivé quelquefois
qu’il ait paru bouillonner, c’eft à caufe de la grande
quantité des fubftances de l’une ou de l’autre nature
, qui ont fourni le chyle ; il n’eft pas furprenant
qu’il arrive quelque ébullition par le mélange des
iels acides ou alkalis. z°. Quand on reçoit le chyle
dans un vaiffeau, on ne remarque pas d’ébullition:
cependant, félon 1 esfermentateurs, cela devroit arriver
quand le chyle, eft tiré du canal torachique :
car c’eft alors que les fels de nature oppofée qu’il
renferme, doivent agir les uns fur les autres ; mais
on a beau examiner le chyle dans le canal même
avec le microfcope , on n’y obferve pas le moindre
mouvement. Ces deux raifons font fuffifantes pour
prouver qu’il ne doit pas fermenter avec le fang ;
car il ne peut pas trouver dans le fang quelque caufe
de fermentation plus forte que le mélange des acides
avec les alkalis : mais voici encore des raifons
plus greffantes. 30. Si on lie la veine oii le chyle fe
décharge, on n’y remarque aucune effervelcence
dans le tems qu’il fe mêle avec le fang : quelque
chofe qu’on dife , oh ne fauroit l’établir. 40. Les
matières qui compofent le fang font huileufes en
bonne partie : or on fait par la Chymie , que les
huiles graffes empêchent les fermentations. Les acides
du vinaigre qui ont diffous le plomb, ôc qui
font mêlés avec beaucoup d’huile, comme l’analy-
fe nous l’apprend, ne bouillonnent point avec les
alkalis. Il y a plufieurs autres exemples qu’il feroit
trop long de rapporter ici. 50. Jamais il n’y a eu de
fermentation fans repos dans les fubftances fermen-
tefcibles, c’eft-à-dire, qu’elles ne doivent être agitées
par aucune caufe externe. Or comment trouver
ce repos dans le fang, qui eft porté par tout le
corps avec une affez grande rapidité ?
Mais, dira-t-on, d’où vient la chaleur animale ?
la fermentation n’eft-elle pas abfolument néceffaire
pour la produire ? Voye[ ce qui a été dit à ce fujet
dans l’excellent article fourni par M. Venel,fur la
chaleur animale.
Les Chymiftes ont auffi crû trouver la caufe de la
rougeur du fang dans divers mélanges , comme de
l’alkali avec des matières fulphureufes,avec le nitre
.de l’air. Voye^ Sa n g .
Les opinions ayant été fort partagées au fujet
du mouvement du coeur, de ce qui caufe fa dilatation
ôc fa contraction, de ce qui lui donne la force
de pouffer le fang dans toutes les parties du corps,
ôc de ce qui le force à recevoir enfuite le fang qiti
eft rapporté de toutes ces parties ; les anciens ôc
quelques auteurs du fiecle paffé croyoient déjà qu’il
y avoit un feu concentré qui étoit la caufe du mouvement
de cet organe. Lorfque Defcartes, qui por-
toit fes vues fur tout, produilit un fentiment qui ne
différait pas beaucoup de celui-là , comme on ne
parloit de fon tems que de ferment ôc de fermenta*
tion dans les écoles de Medecine, il en prit le ton ,
lui qui le donnoit alors à toutes les écoles de Philo-
fophie. Selon lui , il y a un ferment dans le coeur,
qui donne aux humeurs une grande expanfion: dès
qu’une goutte de fang tombe dans cet organe, elle
le raréfie, éleve les parois du coeur par l’augmentation
de fon volume, ouvre au fang qui fuit un paf-
fage ; lés ventricules fe trouvant ainfi remplis, le
fang par fa raréfaction s’élance dans les’ arteres, &
-alors les parois du coeur retombent par elles-mêmes.
On omettra ici les expériences qui renverfent
l’opinion de Defcartes , en tant qu’elles prouvent
qu’il n’y a pas plus de chaleur dans le coeur, que dans
toutes les parties internes du corps humain ; que le
<fang ne fort pas du coeur durant fa dilatation , mais
durant fa contraction ; que le battaient du coeur &
des arteres qui fe fait en même tems, l’a induit en
erreur, parce qu’il croyoit que le coeur, ainfi que les
arteres, ne pouvoit battre qu’en fe rempliffant. On
peut trouver, par la raifon feule, des difficultés contre
cette caufe prétendue du mouvement du coeur,
qu’il eft impoffible de réfoudre. Une goutte de fang
qui entre dans le coeur fe raréfie, Ôc ouvre les ventricules
au fang qui fuit ; mais ce fang qui fuit ne
doit-il pas de même tenir les cavités du coeur ouvertes
à celui qu’il précédé ? & fi cela eft ainfi, n’eft-il
pas impoffible que les parois du coeur fe refferrent
jamais ? D ’ailleurs comment peut-on rendre raifon
de la nature, de l’origine, de la reproduction continuelle
du ferment, auquel on attribue des effets fi
merveilleux ? Comment peut-on concevoir que dans
moins d’une fécondé ce ferment puiffe échauffer ôc
changer fi fort le fang veineux, qu’il lui donne la
force de furmonter la réfiftance de toutes les arteres*
de tout le poids de l’atmofphere ? C ’en eft affez pour
fe convaincre que cette opinion, qui n’avoit coûté
qu’un inftant à l’imagination, a pû être détruite par
un inftant de réflexion.
Ainfi la feôe chimique, après avoir fait dépendre
de la fermentation, ou de quelque puiffance phyfique
analogue, les principaux changemens qui fe font
dans les humeurs primitives, voulut encore tranf*
porter dans tous les organes où font préparées celles
qui en dérivent, les fermens des laboratoires,
pour leur faire opérer toute la variété des fecrétions ;
on imagina donc que dans chaque couloir il y a des
levains particuliers qui changent les fluides qui y
abondent par le mélange qui fe fait entre eux, ôc
par les effets qui s’enfuivent, c’eft à-dire toûjours par
une fermentation ou une effervefcence : mais rien ne
prouve ce fentiment, qui eft d’ailleurs combattu par
une raifon d’expérience fans répliqué. Chaque organe
fecrétoire ne devroit jamais filtrer que le fluide qui
a du rapport avec le ferment dont il eft imbuj ou lorsqu’il
arrive que quelqu’autre fluide y pénétré, celui
qui eft étranger devroit participer de la nature que le
ferment de cet organe a la propriété de donner, ou au
moins perdre quelque chofe de fa nature par l’effet
d’un mélange qui doit lui être bien hétérogène : cependant
dans l’i&ere la bile comme bile le répand
dans toutes les1 parties dti corps, ôc par conféqüent
dans tous les couloirs des fecrétions ; elle fe mêle
donc avec tous les fermens fans en changer de qualité.
D ’ailleurs, d’où viennent les. fermens fuppolés ?
où eft l’organe particulier qui les fournit, qui les renouvelle
continuellement ? Il n’a pas encore été fait
une réponfe folidement affirmative à ces queftions.
V o y e ^ Se c r é t io n .
Après avoir parcouru toutes les parties du corps ,
pour y voir tous les différens ufages que les fermen-
tateurs ont fait de leur principe, pour en tirer l’explication
de prefque tous les phénomènes'de l’économie
animale faine, ce feroit ici le lieu d evoir comment
ils fe font encore fervis de la fermentation pour rendre
raifon des principales caufes prochaines des maladies,
telles que celles de la fievre, de l’inflammation ;
pour faire connoître à quoi doivent être attribués les
grands effets de ces caiifes, tels que la coCtion, la
crife : mais outre que cela meneroit trop loin pour
cet article-ci, on s’expoferoit à des répétitions ; d’ailleurs
il n’eft pas difficile d’imaginer le rôle que l’on a
fait joiier à la fermentation pour la fievre, la coftion ,
la crife, voye^ les articles où il eft traité de ces cho-
fes. Ainfi voye{ Fie v r e , C o c t i o n , C r is e .
Tout ce qui a été dit jufqu’ici au fujet de la fermentation
, n’eft, ainfi qu’il a été annoncé, que l’hiftoire
des erreurs qu’a produites l’abus du terme ôc de la
chofe ; du terme, parce qu’on n’avoit point déterminé
fa fignifiçation caraftériftique, parce qu’on confondait
F E R
foridoît la fermentation avec toute forte de mouvement
inteftin ; de la chofe, parce qu’on employoit
cette puiffance phyfique polir rendre raifon de toutes
les opérations ae la nature dans le corps humain.
On n’entreprend prefque jamais de corriger un excès
que par un autre excès. Les adverfaires des fer-
mentateurs eurent autant à coeur de bannir la fermentation
de toute l’écOnomie animale, non-feulement
quant à l’effet, mais encore quant au nom, que
ceux-ci cherchoient à l’établir par-tout : ils ont eu
tort de part ôc d’autre. Il n’exifte point de fermentation
dans le corps humain, dans un fens auffi étendu,
auffi vague que celui que donnoit à ce terme la fede
chimique : mais la fermentation a lieu dans le corps
humain, en tant qu’on en reftraint la fignifiçation au
mouvement inteftin produit dans les matières végétales
feules, ôc dans celles qui en font fufceptibles,
par lequel elles changent de nature, ôc fourniffent
un efprit ardent, ou un efprit acide, ce qu’elles n’au-
roient pas fait avant ce changement ; en tant qu’elle
s’opère feulement dans des fubftances deftinées à
être converties en humeurs animales, Ôc non dans la
fubftance de ces humeurs même, qui lorfqu’elles font
formées ont perdu toute difpofition à fermenter.
Cela pofé, toutes les fois qu’une fubftance fef-
mentefcible fe trouve contenue dans un lieu convenablement
chaud avec de l’air ôc de l’hümidité fuffi-
fante, il ne peut pas fe faire qu’elle ne fermente pas :
par exemple, le pain eft une matière fufceptible par
la nature de la fermentation acéteufe ( ayant déjà
épïouvé la fermentation vineufe, pour que la farine
dont il eft formé ait été convertie en pain) ; le mélange
qui fe fait lorfqu’on le mange, de la falive dans
la bouche, du fuc gaftrique dans l’eftomac, fournit
l’humidité; l’air s’y mêle auffi librement, la bouche
ÔC l’eftomac ont la chaleur néceffaire ; il doit s’exciter
inévitablement un mouvement inteftin fermen-
tatif dans cette matière alimentaire, ôc il eft prouvé
en effet que la chofe s’opère ainfi par les portions d’air
qui en lortent avec éffort, quelque tems après que
l’on a mangé ; Ce qui forme les rapports (c’eft-à-dire
les vents qui s’élèvent de l’eftomac ) , ôc les borbo-
rygmes, qui ne font autre chofe que d’autres portions
d’air des ventofités qui defcendent ôc roulent
dans les boyaux. De femblables phénomènes s’ob-
fervent lorfqu’une matière fermente fous les yeux :
ainfi on ne peut attribuer qu’à la même caufe ceux
qui viennent d’être mentionnés.
Mais cette fermentation ne fait que commencer
dans un corps bien conftitué dont l’eftomac eft agif-
fant ; elle ne fubfifte pas affez lortg-tems pour que la
matière qui fermente vienne véritablement au terme
de fa tendance naturelle. Plufieurs chofes concourent
à s’oppofer à ce que lq^changement que pour-
roit produire la fermentation , devienne complet ;
c’eft que cette matière eft continuellement agitée par
l’aétionde l’eftomac, & qu’elle y féjourne trop peu,
puifqu’il faudrait que la fermentation continuât pendant
quatre ou cinq jours, pour que fes effets fuffent
entiers ; c’eft qu’il fe mêle à cètte matière une trop
grande quantité de fluide; c’eft que le vafe qui la
renferme n’eft pas affez bien fermé pour retenir l’air,
ôc que celui-ci fe renouvelle trop aifément ; c’eft que
le pain ôc les autres matières fermentefcibles ne font
pas mangées ordinairement fans être mêlées avec
des matières fufceptibles d’autre forte de dégénération,
comme les putrelcibles, c’eft-à-dire les viandes
: ainfi le mélange des fubftances alimentaires de
différente nature, empêche que chacune en particulier
ne dégénéré félon fa difpofition; parce que les
mouvemens oppofés qui réfultent de cette difpofition
propre, s'arrêtent, fe fixent, fe corrigent les
uns les autres. Le lait, par exemple, que l’on laiffe
gxpofé à la chaleur de l’air pendant l’été, s’aigrit en
Tome f l .
F E R w
moins de la moitié d’un jour ; le fartg îaiffé de même
fe corrompt, tombe en putréfaCtion en auffi peu de
tems : cependant fi on les mêle enfemble, il ne fe fait
aucune de ces deux dégénérations ; par conféqüent
elles font fufpendues par l’effet du mélangé, pourvû
toutefois qu’avant le mélange la putréfaction n’ait
pas commencé dans les fubftances animales ; car
alors, bien loin d’empêcher,d’arrêter la fermentation,
elles deviennent propres à l’exciter, à l’accélérer,
félon le réfultat des expériences du doCteur Pringle..
yiye{ fon traité fur les fubftances feptiques & anti-
feptiques , Mémoire iy . ôc y . dans la traduction de
fes oeuvres, Paris, 1755. Voyeç Putréfaction.
Mais dans le cas où les dégénérations font arrêtées
, il ne s’enfuit pas moins qu’elles ont commencé
à fe faire : or comme les mouvemens inteftins qui
tendent à les produire ont cela de commun, qu’ils
ne peuvent opérer ces effets fans altérer la force de
cohéfion des fubftances dans lefquelles ils ont lieu,
il réfulte de-là qu’ils difpofent ces fubftances à la dif-
folution ; par conféqüent ils concourent à l’élaborai
tion des alimens, qui tend à en extraire le fuc propre
à former le chyle. La fermentation, dans le fens auquel
le terme a été reftreint, eft donc réellement un
agent dans l’économie animale : la fermentation comme
la putréfaCtion commençantes fervent donc à la
digeftion dans l’état le plus naturel ; mais elles ne font
jamais pouffées dans cet état jufqu’à produire refpec-
tivement un efprit ardent ou acide, un alkali volatil
; la confection du chyle eft entièrement finie, ôc
ce fluide eft admis dans le fang avant que les alimens
puiffent foufirir line altération fi confidérable.
Mais il n’en eft pas de même dans l’état de malar
die, les effets de ces puiffances phyfiques font plus
fenfibles dans les perfonnes d’une foible conftitution,
dont les fibres mufcülaiires de l’eftomac agiflànt peu,
laiffent féjoufner long-tems, à proportion de l’état de
fanté, les alimens dans ce vifcere, ôc leur permettent
d’éprouver d’une maniéré plus étendue les change*
mens auxquels ils ont de la difpofition : alors la fermentation
comme la putréfaCtion étant pouffée trop
loin, eft. un vice dont les fuites font très-nuifibles à
l’économie animale. Voye{ Régime.
Ainfi puifqu’il eft utile ôc néceffaire même que la
fermentation {oit excitée jufqu’ à un certain point dans
les matières alimentaires qui en font fufceptibles ;
puifqu’il eft auffi important pour la confervation oit
pour le rétabliffement de la fanté, d’empêcher qué
cette efpece de dégénération ne foit trop confidérable
; il eft donc très - intéreffant de rechercher les
moyens de fuppléer au défaut de fermentation commençante,
de la procurer, ou de corriger l’excès de
la fermentation trop continuée, de la retenir dans les
bornes qu’elle doit avoir.
C ’eft l’objet que s’eft propofé le doCleur anglois
dont il vient d’être fait mention, par les expériences
fingulieres qu’il a faites ôc préfentées à la fociété
royale des Sciences de Londres, dont on trouve le
détail dans fon traité déjà cité fur les fubftances feptiques
& anti-feptiques ; expériences dont les diffé-
rens réfultats font d’une fi grande conféquence pour
la théorie & la pratique de la Medecine > qu’on ne
fauroit trop répéter ôc étendre les procédés qui ont
fourni ces réfultats pour confirmer ceux-ci, ou pour
les changer, ou enfin pour les fixer de la maniéré la
plus sûre.
Le nombre des expériences de M. Pringle & leurs
circonftances ne permettent pas de les rapporter ici :
on ne peut que fe borner à donner une idée générale
des procédés & des principales condufions qui ont
été tirées de leurs effets.
Les expériences de ce médecin confiftent donc
i° . à faire des mélanges de différentes fubftances alimentaires,
végétales, ôc animales, conjointement
X x x