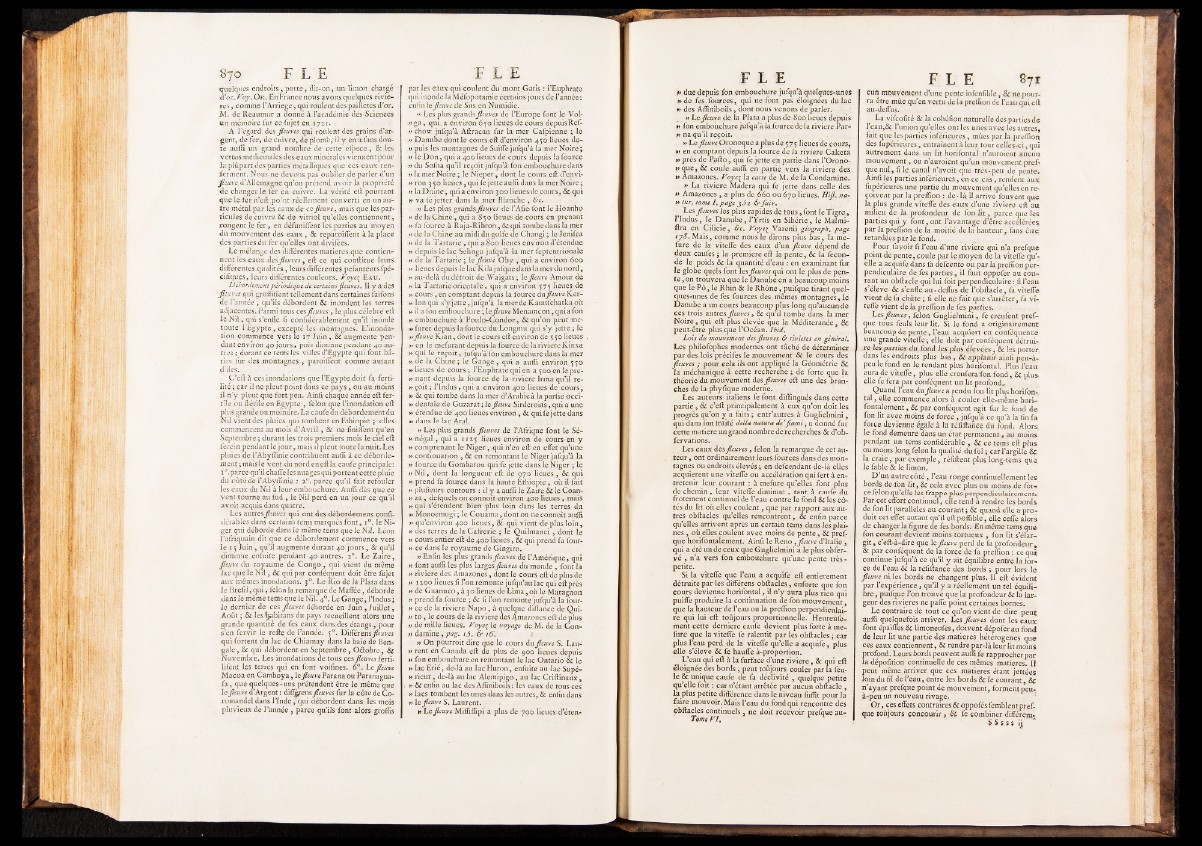
quelques endroits, porte, dit-on, un limon chargé
d’or. Voy,.Or . En France nous avons quelques rivières
, comme l’Arriege, qui roulent des pailletés d’or.
M. de Reaumur a donné à l’académie des Sciences
un mémoire fur ce fujet en 1711.
A l ’égard des fleuves qui roulent des grains d’argent,
de fer, de cuivre, de plomb, il y en a fans doute
auffi un grand nombre de cette efpece, & les
vertus médicinales des eauxminérales viennent pour
la plupart des parties métalliques que ces eaux renferment.
Nous ne devons pas oublier de parler d’un
fleuve d’Allemagne qu’on prétend.avoir la propriété
de changer le fer en cuivre. La vérité eft pourtant
que le fer n’eft point réellement converti en un autre
métal par les eaux de ce fleuve, mais que les particules
de cuivre ôc de vitriol qu’elles contiennent,
rongent le fer , en défunifl'ent les parties au moyen
du mouvement des eaux, & reparoiffent à la place
des parties du fer qu’elles ont divifées.
Le mélange des différentes matières que contiennent
les. eaux des fleuves, eft ce qui conftitue leurs
différentes qualités, leurs différentes pefanteurs fpé-
cificjiies, leurs différentes couleurs. Voyeç E a u .
Débordement périodique de certains fleuves. Il y a des
fleuves .qui grofliffent tellement dans certaines faifons
de l’année, qu’ils débordent 8c inondent les terres
adjacentes'. Parmi tous ces fleuves , le plus célébré eft
le Nil, qui s’enfle fi confidérablement qu’il inonde
toute l ’Egypte , excepté les montagnes. L’inondation
commence vers le 17 Juin, ôc augmente pendant
environ 40 jo ur s , puis diminue pendant 40 autres
; durant ce teins les villes d’Egypte qui font bâties
fur des montagnes , paroiffent comme autant
d’iles. . ,.
C’eft à ces inondations que l’Egypte doit fa fertilité
; car il ne pleut point dans ce pays , ou au moins
il n’y pleut que fort peu. Ainfi chaque année eft fertile
ou ftérile en Egypte , félon que l’inondation eft
plus grande ou moindre. La caufedu débordement du
Nil vient des pluies qui tombent en Ethiopie ; elles
commencent au mois d’Avril, & ne finiffent qu’en
Septembre ; durant les trois premiers mois le ciel eft
ferein pendant le jour, mais il pleut toute la nuit. Les
pluies de l’Abyflinie contribuent aulîi à ce débordement
; mais le vent du nord en eft la caufe principale:
i°.parce qu’il chaffe les nuages qui portent cette pluie
du côté dé TAbyffiniè : 20. parce qu’il fait refouler
les eaux du Nil à leur embouchure. Aufli dès que ce
vent tourne au fud , le Nil perd en un jour ce qu’il
avoit acquis dans quatre.
Les autres fleuves qui ont des débordemens confi-
dérables dans certains teqis marqués font, i°. le Niger
qui déborde dans le même tems que le Nil. Léon
l ’afriquain dit que ce débordement commence vers
le 15 Juin, qu’il augmente durant 40 jours, & qu’il
diminue enluite pendant 40 autres. 20. Le Zaire,
fleuve du royaume de Congo , qui vient du même
lac que le N il, & qui par conféquent doit être fujet
aux mêmes inondations. 30. Le Rio de la Plata dans
le Brefil, qui, félon la remarque de Maffée, déborde
dans le même tems que le Nil. 40. Le Gange, l’Indus ;
le dernier de ces fleuves déborde en Juin, Juillet,
Août ; 8c les ^abitans du pays recueillent alors une
grande quantité de fes eaux dans des étangs, pour
s’en fervir le refte de l’année. 50. Tfifiér eus fleuves
qui fortent du lac de Chiamay dans la baie de Bengale
, 8c qui débordent en Septembre, Octobre, 8c
Novembre. Les inondations de tous ces fleuves ferti-
lifent les terres qui en font voifines. 6°. Le fleuve
Macoa en Camboya, le fleuve Parana ou Paranagua-
fa, que quelques-uns prétendent être le même que
\efleuve d’Argent : diffjyrens fleuves fur la côte de Coromandel
dans l’Inde J *qui débordent dans les mois
pluvieux de l ’année , parce qu’ils font alors grolfis
par les eaux qui coulent du mont Gatis : l’Euphrate
qui inonde la Méfopotamie certains jours de l’année :
enfin le fleuve de Sus en Numidie..
« Les plus grands fleuves de l’Europe font .le Vôl-
»ga , qui. a environ 6 *o lieues de cours depuis Ref-
» chow jufqu’à Aftracan fur la mer Cafpienne ; le
» Danube dont le cours eft d’environ 450 lieues de-
» puis les montagnes de Suiffe jufqu’à la mer Noire ;
» le Don, qui a 400lieues dè.cpurs depuis la fource
» du Sofiia qu’il reçoit jufqu’à fon embouchure dans
»la mer Noire; le Nieper., dont, le cours eft d’envi-
» ron 350, lieues, qui le j ette aufli dans la mer Noire ;
» la Duine ; qui a environ 300 lieues de cours, 8t qui
» va fe jetter dans la mer Blanche , &c<
» Les plus grands fleuves dé.l’Afiei font le Hoanho
»de la Chine, qui a 850 lieues de cours em prenant
» fa four ce à Raja-Rihron., ôc.qui tombe dans la mér
» de la Chine au midi du golfe de Changi ; le .Jenifca
» de la Tartane , qui a 8oo:iienes environ d’étendue
» depuis le lac Selinga jufqu’à La mer feptentrionale
» de la Tartane ; leflèuye Oby , qui a environ 600
» lieues depuis le lac Kila jufquerdans la mer du nord ,
» au-delà du détroit deWaigàts ; le fleuve Amour de
» la Tartarie Orientale, qui a environ 575 lieues de
» cours, en comptant.depuis la fource du fleuve Ker-
» Ion qui s’y jette, jufqu’à la merde Kamtfchatka oii
» il a fon embouchureyXefleuve Menamcon, qui a fon
» embouchure à Poulo-Condor * 8c qu’on peut me-
» furer depuis la fource.du Longmu qui s’y jette ; le
»Jleuve Kian , dont le coufs eftienviron de. 5 50 lieues
» en le mefurant depuis.la fource de la riviere Kinxa
» qui le reçoit, jufqu’à fôn embouchure dans la mer
» de la Chine ; le Gange , qui a aufli environ 550
»lieues de cours ; l’Euphrate qui en a 5.00 en le pre-
» nant depuis la fource de la riviere Irma qu’il re-
» çoit ; l’Indus, qui a environ: 400 lieues de cours,
» & qui tombe dans la mer d’Arabie à la partie ôcci-
» dentale de Guzarat ; le fleuve Sirderoias, qui a une
» étendue de 400 lieues environ, & qui fe jette dans
» dans le lac Aral.
» Les plus grands fleuves de l’Afrique font le Sé-
» négal, qui a 1125 lieues environ de cours en y
» comprenant le Niger, qui n’en eft en effet qu’une
» continuation , 8c en remontant le Niger jufqu’à la
» fource du Gombarou qui fe jette dans le Niger ; le
» Nil, dont la longueur eft de 970 lieues , 8c qui
» prend fa fource dans la haute Ethiopie, où i l fait
» plufieurs contours : il y a aufli le Zaire & le Coan-
» za, defquels on connoît environ 400 lieues , mais
» qui s’étendent bien plus loin dans les terres du
» Monoemugi ; le Couama, dont on ne connoît aufli
» qu’environ 400 lieues, 8c qui vient -de plus loin,
» des terres de la Cafrerie ; le Quilmanci, dont le
» cours entier eft de 400 lieues, 8c qui prend fa four-
» ce dans le royaume de Gingiro.
» Enfin les plus grands fleuves de l’Amérique, qui
» font aufli les plus larges fleuves du monde , font la
» riviere des Amazones, dont le cours eft de plus de
» 1200 lieues fi l’on remonte jufqu’au lac qui eft près
» de Guanuco, à 30 lieues de Lima, où le Maragnon
» prend fa fource ; 8c fi l’on remonte jufqu’à la four-
» ce de la riviere Napo, à quelque diftance de Qui-
» to , le cours de la riviere des ^mazones eft de plus
» de mille lieues. Voye[ le voyage de M. de là Con-
» damine , pag. /5 . & / <f.
» On pourroit dire que le cours du fleuve S. Lau-
» rent en Canada eft de plus de 900 lieues depuis
» fon embouchure en remontant le lac Ontario 8c le
» lac Erié, de-là au lac Huron, enfuite au lac Supé-
» rieur, de-là au lac Alemipigo, au lac Criftinaux,
» 8c enfin au lac des Affiniboils : les eaux de tous ces
» lacs tombent les unes dans les autres, 8c enfin dans
» le fleuve S. Laurent. -
» Le fleuve Miffiffipi a plus de 700 lieues d’éten-
H due depuis Tön embouchure jufqü’à quelques-unes
»de fes.fources, qui ne font pas éloignées du lac
» des Affiniboils, dont nous venons de parler.
» Le fleuye\fle la Plata a plus de 8oo lieues depuis
» fon embouchure jufqu’à la fource de la riviere Par-
>> na qu’il reçoit.
. » Le fleuve, Oronoque a plus de 57 <j lieues de cours.,
»> en comptant depuis la fource de la rivière Caketa
» près de Pâfto, qui fe jette en partie dans l’Orono-
»que, 8c coule auffi en .partie vers la riviere des
» Amazones. Voyeç la carte de M. de la Condamine.
» La, riviere Madera qui fe jette dans celle des
» Amazones , a plus de 660 ou 670 lieues. H iß . na-
p tur. tome I . page j S z & fü iv .
L e s fleuves les plus rapides de tous, font le Tigre,
l’Indus, le Danube, l’Yrtis en Sibérie, le Malmi-
ftra en Cilicie, &c. Voye£ Varenii géograph. page
ty 8 . Mais, comme nous le dirons plus bas, la mesure
de la vîteffe des eaux d’un fleuve dépend de
deux caufes ; la première eft la pente, 8c la fécondé
le poids 8c la quantité d’eau : en examinant fur
le globe quels font les fleuves qui ont le plus de pente
, on trouvera que le Danube en a beaucoup moins
que le Pô, le Rhin 8c le Rhône, puifque tirant quelques
unes de fes fources des mêmes montagnes, le
Danube a un cours beaucoup plus long qu’aucun de
ces trois autres fleuves, & qu’il tombe dans la mer
Noire , qui eft plus élevée que la Méditeranée, 8c
peut-être plus.que l’Océan. Ibid.
Lois du mouvement des fleuves & rivières en général.
Les philofophes modernes ont tâché de déterminer
par des lois précifes le mouvement & le cours des
fleuves ; pour cela ils ont appliqué la Géométrie 8c
la méchanique à cette recherche; de forte que la
théorie du mouvement des fleuves eft une des branches
de la phyfique moderne.
Les auteurs italiens fe font diftingués dans cette
partie, & c’eft principalement à eux qu’on doit les
progrès qu’on y a faits ; entr’autres à Guglielmini,
qui dans fon traité délia natura de''fium i, a donné fur
cette matière un grand nombre de recherches 8c d’ob-
fervations.
Les eaux, des fleuves, félon la remarque de cet auteur
, ont ordinairement Ieurs fources dans des montagnes
ou endroits élevés ; en defeendant de-là elles
acquièrent une vîteffe ou accélération qui fert à entretenir
leur courant : à mefure qu’elles font plus
de chemin, leur vîteffe diminue , tant à caufe du
frotement continuel de l’eau contre le fond & les côtés
du lit où elles coulent, que par rapport aux autres
obftacles qu’elles rencontrent, & enfin parce
qu’elles arrivent après un certain tems dans les plaines
, où elles coulent avec moins de pente, & pref-
que horifontalement. Ainfi le Reno , fleuve d’Italie ,
qui a été un de ceux que Guglielmini a le plus obfer-
yé , n’a vers fon embouchure qu’une pente très-
petite.
Si la vîteffe que l’eau a acquife eft entièrement
détruite par les différens obftacles, enforte que fon
cours devienne horifontal, il n’y aura plus rien qui
puiffe produire la continuation de fon mouvement
que la hauteur de l’eau ou la preffion perpendiculaire
qui lui eft toûjpurs proportionnelle. Heureufe-
ment cette derniere caufe devient plus forte à mefure
que la vîteffe fe ralentit par les obftacles ; car
plus l’eau perd de la vîtefle qu’elle a acquife, plus
elle s’élève & fe häufte à-proportion.
L’eau qui eft à la furface d’une riviere, & qui eft
éloignée des bords, peut toujours couler par la feule
& unique caufe de fa déclivité , quelque petite
qu’elle foit : car n’étant arrêtée par aucun obftacle ,
la plus petite différence dans le niveau fiiffit pour la
faire mouvoir. Mais l’eau du fond qui rencontre des
obftacles continuels a ne doit recevoir prefque au-
Tome VI»
cun mouvement d’une pente infenfible, & ne pourra
être mûe qu’en vertu de la preffion de l’eau qui eft
au-deffus.
La vifçofité & la cohéfion naturelle des parties de
l’eau,& l’union qu’elles ont les unes avec les autres,
fait que les parties inférieures, mues par la preffion
des uipérieures, entraînent à leur tour celles-ci, qui
autrement dans un lit horifontal n’auroiént aucun
mouvement, ou n’auroient qu’un mouvement prefque
nul, fi le canal n’a voit que très-peu de pente.
Ainfi les parties inférieures, en ce cas, rendent aux
fupérieures une partie du mouvement qu’elles en reçoivent
par la preffion : de -^ il arrive fouvent que
la plus grande vîteffe des eaux d’une riviere eft au
milieu de la profondeur de fon li t , parce que les
parties qui y font, ont l’avantage d’être accélérées
par la preffion de la moitié de la hauteur, fans être
retardées par le fond.
Pour favoir fi l’eau d’une riviere qui n’a prefque
point de pente, coule par le moyen de la vîteffe qu’elle
a acquife dans fa defeente ou par la preffion perpendiculaire
de fes parties , il faut oppofer au courant
un obftacle qui lui foit perpendiculaire : fi l’eau
s’élève & s’enfle au - deffus de l’obftacle, fa vîteffe
vient de fa chute ; fi elle ne fait que s’arrêter, fa vî-,
teffe vient de la preffion de fes parties. 7 ,
Les fleuves, félon Guglielmini, fe creufent prefque
tous feuls leur lit. Si le fond a originairement
beaucoup de pente, l’eau acquiert en conféquence
une grande vîteffe ; elle doit par conféquent détruire
les parties du fond les plus é le v é e s , & les porter
dans les endroits plus bas , & appJanir ainfi peu-à-
peu le fond en le rendant plus horifontal. Plus l’eau
aura de yîteffe, plus elle creuferaîfon fond, 8c plus
elle fe fera par conféquent un lit profond.c.
Quand l’eau du fleuve a rendu fon lit piushorifon-.
îal ,.elle commence alors à couler elle-meme horifontalement
, 8ç par conféquent agit fur le fond de
fon lit avec moins de force ,.jufqu’à ce qu’à la fin fa
force devienne égale à la réfiftanee du fond. Alors,
le fond demeure dans un état permanent, au moins
pendant un tems confidérable , & ce tems eft plus
ou moins.long félon la qualité du fol ; car l’argillc 8c
la craie, par exemple, réfiftent plus long-tems que.
le fable & le limon.
D’un autre côté, l’eau ronge continuellement les
bords de fon lit ,6 c cela avec plus pu moins de force
félon qu’elle les frappe plus perpendiculairement^
Par cet effort continuel, elle tend à rendre les bords
de fon lit parallèles au courant ; 8c quand elle a produit
cet effet autant qu’il eft poffible, elle ceffe alors
de changer la figure de fes bords. En même tems que
fon courant devient moins tortueux , fon lit s’élargit
, c’eft-à-diré que le fleuve perd de fa profondeur,
8c par conféquent de la force de fa preffion : ce qui
continue jufqu’à ce qu’il y ait équilibre entre la force
de l’eau 8c la réfiftanee des bords ; pour lors le
fleuve ni les bords ne changent plus. Il eft évident
par l’expérience , qu’il y a réellement un tel équilibre,
puifque l’on trouve que la profondeur 8c la largeur
des rivières ne paffe point certaines bornes. .
Le contraire de tout ce qu’on vient de dire peut
auffi quelquefois arriver. Les fleuves dont les eaux
font épaiffes 8c limoneufes, doivent dépoferau fond
de leur lit une partie des matières hétérogènes que
ces eaux contiennent, 8c rendre par-là leur lit moins
profond. Leurs bords peuvent auffi fe rapprocher par
la dépofition continuelle de ces mêmes matières. Il
peut même arriver que ces matières étant jettées
loin du fil de l’eau, entre les bords 8c le courant, 8ç
n’ayant prefque point de mouvement, forment peu-
,à-peu un nouveau rivage.
Or, ces effets contraires 8c oppofés femblentprefque
toujours concourir , ôç fe combiner différent*
$ S s s s i| *