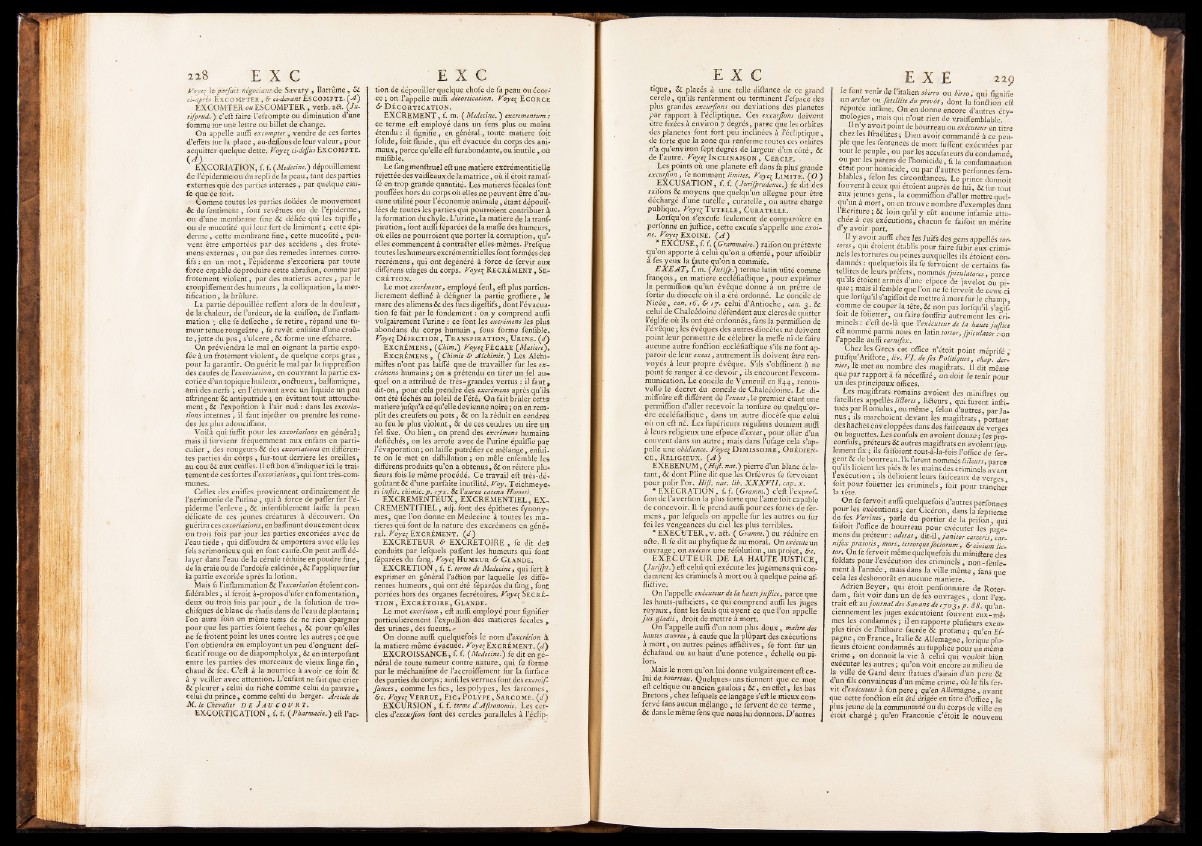
228 E X C Voyt^ le\parfait négociantAe Savary , Barrême , ôc
ci-après ExcoMPTER, & ci-devant ESCOMPTE. (A )
EXGOMTEft ou E SCOMPTER, verb. aô. (/«-
rifprud. ). c’éft faire l’efeompte ou diminution d’une
fomme iur une lettre ou-billet de change.
On appelle aufli excompur, vendre de ces fortes
d’effets lur là place, au-deflbus de leur valeur, pour
acquitter quelque dette. Foye^ci-deffus Ex compte. h m m i i EXCORIATION, f. f. (\Medecme.) dépouillement
de Pépidermteou du repli de la peau, tant des parties
externes qu'e des parties internes , par quelque cau-
fe que ce foit.
• Comme toutes les parties douées de mouvement
& de fentiméht, font revêtues ou de l’épiderme ,
ou d’une membrane fine & déliée qui les tapifle,
ou de mucolité qui' leur fert de liniment ; cette épiderme
, cette membrane fine, cette mucofité, peuvent
être e importées par des accidens , des frote-
mens externes, ou par des remedes internes corro-
fifs : en un mot, l’épiderme s’excoriera par toute
force capable de produire cette abrafion, comme par
frotement violent, par des matières acres , par le
crbupiflementdes humeurs, la colliquation, la mortification
, la brûlure.
La partie dépouillée relient alors de la douleur,
de la chaleur, de l’ardeur, de la cuiffon, de l’inflammation
; elle fe defleche, fe retire, répand une tumeur
tenue rougeâtre , fe revêt enluite d’une croût
e , jette du pus, s’u lcere, 6c forme une efcharre.
On préviendra le mal en oignant la partie expo-
fée à un frotement violent, de quelque corps, gras ,
pour la garantir. On guérit le mal par la fuppreflion
des caufes de ¥ excoriation, en couvrant la partie excoriée
d’un topique huileux, onâueux, balfamique,
ami des nerfs ; en l’étuvant avec un liquide un peu
aftringent 6c antiputride ; en évitant tout attouchement
, 6c l’expofition à l’air nud : dans les excoriations
internes, il faut inje&er ou prendre les remedes
les plus adouciffans.
Voilà qui fuffit pour les excoriations en général ;
mais il furvienr fréquemment aux enfans en particulier
, des rougeurs 6c des excoriations en différentes
parties du corps , fur-tout derrière les oreilles ,
au cou 6c aux cuifles. Il eft bon d’indiquer ici le traitement
de ces fortes d'excoriations, qui font très-coim
munes.
Celles des cuifles proviennent ordinairement de
l’acrimonie de l’urine , qui à force de pafler fur l’épiderme
l’enleve, 6c infenfiblement laifle la peau
délicate de ces jeunes créatures à découvert. On
guérira ces excoriations, en baflinant doucement deux
ou trois fois par jour les parties excoriées avec de
l ’eau tiede, qui difFoudra 6c emportera avec elle les
fels acrimonieux qui en font caufe.On peut aufli dé-
layçr dans l’eau de la cérufe réduite en poudre fine,
de la craie ou de l’ardoife calcinée, 6c l’appliquer fur
la partie excoriée après la lotion.
Mais fi l’inflammation 6c Y excoriation ét oient con-
üdérables, il feroit à-propos d’ufer en fomentation,
deux ou trois fois par jo u r , de la folution de tro-
chifques de blanc de rhafis dans de l’eau de plantain ;
l’on aura foin en même tems de ne rien épargner
pour que les parties foient feches, ôc pour qu’elles
ne fe frotent point les unes contre les autres ; ce que
l’on obtiendra en employant un peu d’onguent def-
ficatif rouge ou de diapompholyx, 6c en interpofant
entre les parties des morceaux de vieux linge fin,
chaud 6c fec. C ’eft à la nourrice à avoir ce foin 6c
à y veiller avec attention. L’enfant ne fait que crier
6c pleurer, celui du riche comme celui du pauvre,
celui du prince, comme celui du berger. Article de
M. le Chevalier D E J A U C OU RT.
EXCORTICATION, f. f. ( Pharmacie.) eft l’aç-
E X C tion ce; odne dl’éappopuelillele ar uqfulei lque chofe de fa peau ou écordécortication.
Voyt£ Ecorce
& D écortication.
EXCREMENT, f. m. ( Medecine. ) excrementum:
ce terme eft employé dans un fens plus ou moins
étendu : il lignifie, en général, toute matière foit
folide, foit fluide, qui eft évacuée du corps des animaux,
parce qu’elle eft furabondante,ou inutile, ou
nuifible.
Le fangmenftruef eft une matière cxdrémentitielle
rejettée des vaiffeaux de la matrice, oit il étoit ramaf-
fé en trop grande quantité. Les matières fécales font
pouflees hors du corps oii elles ne peuvent être d’aucune
utilité pour l’économie animale, étant dépouillées
de toutes les parties qui pourroient contribuer à
la formation du chyle. L’urine, la matière de la tranf-
piration, font aufli féparées de la mafle des humeurs,
où elles ne pourroient que porter la corruption, qu’elles
commencent à contracter elles-mêmes. Prefque
toutes les humeurs excrémentitielles font formées des
recrémens, qui ont dégénéré à force de fervir aux
différens ufages du corps. Foye[ Recrément , Secrétion.
Le mot excrément, employé feul, eft plus particulièrement
deftiné à défigner la partie grofliere, lé
marc des alimens ôc des lues digeftifs, dont l’évacuation
fe fait par le fondement : on y comprend aufli
vulgairement l’urine : ce font les excrémens les plus
abondans du corps humain, fous forme fenfible.
Voye^ Déjection , Transpiration, Urine. (d) Excrémens , (Chim.) FoyefYkc\i.E (Matière). Excrémens , ( Chimie & Alchimie. ) Les Alchi-
miftes n’ont pas laifle que de travailler fur les excrémens
humains ; on a prétendu en tirer un fel au-»
quel on a attribué de très-grandes vertus : il faut*
dit-on, pour cela prendre des excrémens après qu’ils
ont été féchés au foleil de l’été. On fait brûler cette
matière jufqu’à ce qu’elle devienne noire ; on en remplit
des creufets ou pots, & on la réduit en cendres
au feu le plus violent, & de ces cendres on tire un
fel fixe. Ou bien, on prend des excrémens humains
defîechés, on les arrofe avec de l’urine épaiflie par
l’évaporation; on laifle putréfier ce mélange, enluite
on le met en diftillation; on mêle enfemble les
différens produits qu’on a obtenus, & on réitéré plu»
fleurs fois le même procédé. Ce travail eft très-dégoûtant
ÔC d’une parfaite inutilité. Foy. Teichmeye»
ri injlit. chimie, p. tyx. ÔC Y aurea catena Ho meri.
EXCREMENTEUX, EXCREMENTIEL, EX»
CREMENTITIEL, adj. font des épithetes fynony-
mes, que l’on donne en Medecine à toutes les matières
qui font de la nature des excrémens en général.
Voye{ Excrément. {d)
conEdXuCitRs pEaTrE lUefRqu e&ls EpaXffCeRntE lTesO hIuRmEe u, rsfe q duiit fodnets: féparées du fang. Foye^ Humeur & Glande.
EXCRETION , f. f. terme de Medecine , qui fert à
exprimer en général l’a&ion par laquelle les différentes
humeurs, qui ont été féparées du làng, font
portées hors des organes fecrétoires. Voye{ Secrétion
, Excrétoire, Glande.
Le mot excrétion, eft aufli employé pour lignifier
particulièrement l’expulfion des matières fécales ,
des urines, des fueurs.
On donne aufli quelquefois le nom d’excrétion à
la matière même évacuée. Foye[ Excrément. {d)
EXCROISSANCE, f. f. {Medecine.) fe dit en général
de toute tumeur contre nature, qui fe forme
par le méchanifme de l’accroiflement fur la furface
des parties du corps ; ainfi les verrues font des excroif-
fances, comme les fies, les polypes, les farcomes,
&c. Voye{Verrue, Fic ,P olype,Sarcome, {d)
EXCURSION, f. f. terme d'Afironomie. Les cercles
d'excurjîon font des cercles parallèles à l’éclip-
E X C tique, & placés à. une telle diftance de ce. grand
cercle, qu’ils renferment ou terminent l’efpace dès
plus grandes excurfions ou déviations des planètes
par rapport à l’écliptique. Ces excurfions doivent
être fixées à environ 7 degrés, paree que les orbites
des planètes font fort peu inclinées à l’écliptique,
de forte jque la zone qui renferme toutes ces orbites
n’a qu’environ fept degrés de largeur d’un côte, ôc
de l’autre. Inclinaison , Cerclai ,
Les points où une planete eft dans fa plus' grande
excurfion , fe nomment limites. Foyer Limite. (O )
EXCUSATION , f.,f. {Jurifprudence.) fe ditjles
raifons 8c moyens que quelqu’un allégué pour être
déchargé, d’une tutelle, curatelle, ou autre charge
publique. Foye{ Tutelle, Curatelle.
Lorfqu’on s’exeufe feulement de comparoître en
perfonne en juftice, cette exeufe s’appelle une exoi-
ne. Foye^ Exoine. {A )
EXCUSE, f. f. {Grammaire!) raifono.uprétexte
qu’on apporte à celui qu’on a oftènfé, pour affoiblir
à fes yeux la faute qu’on a commife.
E X E A T , {, m. (Jurifp, Y terme latin ufité comme
françois, en matière ecclefiaftique, pour exprimer
la permiflion qu’tin évêque donne à un prêtre de
fortir dû diocefe où il a été ordonné. Le concile de
N icée, can. iC. & t j . celui d’Antioche , can. 3 . 8c
celui de Chalcédoine défendent aux clercs de quitter
l’églife où ils ont été ordonnés, fans la permiflion de
l’évêque ; les évêques des autres diocèfes ne doivent
point leur permettre de célébrer la mefle ni de faire
aucune autre fonôion eccléfiafrique s’ils ne font apparoir
de leur exeat, autrement ils doivent être renvoyés
à leur propre évêque. S’ils s’ohftinent à ne
point fe ranger à ce devoir, ils encourent l’excommunication.
Le concile de Verneuil en 844, renouvelle
le decret du concile de Chalcédoine. Le di-
mifloire eft different de Y exeat, le premier étant une
permiflion d’aller recevoir la tonfure ou xjuelqu’or-
dre eccléfiaftique, dans un autre diocèfe que celui
où on eft né. Les fupéfieurs réguliers donnent aufli
à leurs religieux une efpece à’exeat, pour aller d’un
couvent dans un autre.; mais dans l’ufagè cela s’appelle
une obédience. Voyeç DiMissoiRE, Obédienc
e , Religieux. {A )
EXEBENUM, {Hiß. nat.) pierre d’un blanc éclatant,
& dont Pline dit que les Orfèvres fe fervoient
pour polir l’or. Hiß. nat. lib. X X X V I I . cap. x.
* EXÉ CRATION , f. f. {Gramm.) c’eft l’expref-
fion de l’averfion la plus forte que l’ame foit capable
de concevoir. Il fe prend aufli pour ces fortes de fer-
mens, par lefquels on appelle fur les autres ou fur
foi les vengeances du ciel les plus terribles.
* EX E CU TER, v . aô . ( Gramm. ) ou réduire en
afre. Il fe dit au phyfique & au moral. On exécute un
ouvrage; on exécute une réfolution, un projet, &c.
E X É C U T E U R DE LA HAUTE JUSTICE,
{Jurifpr.) eft celui qui exécute les jugemens qui condamnent
les criminels à mort ou à quelque peine afi*
fliûive.'
On l’appelle exécuteur de la haute jufiiee, parce que
les hauts-jufticiers, ce qui comprend aufli les juges
royaux, font les feuls qui ayent ce que l’on appelle
ju s gladii, droit de mettre à mort.
On l’appelle aufli d’un nom plus doux, maître des
hautes oeuvres , à caufe que la plûpart des exécutions
à mort, ou autres peines afflifrives, fe font fur un
échafaud ou au haut d’une potence, échelle ou pilori.
Mais le nom qu’on lui donne vulgairement eft ee-
lui de bourreau. Quelques-uns tiennent que ce mot
eft celtique ou ancien gaulois ; & , en effet, les bas
Bretons, chez lefquels ce langage s’eft le mieux con-
ferve fans aucun mélange, fe fervent de ce terme,
& dans le même fens que nous lui donnons. D ’autres
E X E 2 2 9
le font venir de Titalien sbirro ou birro, qui fignifie
un archer ou fatellite du prévôt, dont la fon&ion eft
reputee infâme. On en donne encore d’autres étymologies,
mais qui n’ont rien de vraiflemblable.
Il n’y avoit point de bourreau ou exécuteur en titre
chez les Ifraelites ; Dieu avoit commandé à ce peu»
pie que les fentences de mort fuflent exécutées par
tout le peuple, ou par les accufateurs du condamné,
ou par les parens de l’homicide, fi la condamnation
eteit pour homicide., ou par d’autres perfonnes fem-
blables, félon les circonftances. Le prince donnoit
fouvent à ceux qui étoient auprès de lui, 6c fur-tout
aux jeunes gens, la commiflîon d’aller mettre quel*
qu un à mort, on en trouve nombre d’exemples dans 1 Ecriture ; & loin qu’il y eût aucune infamie attachée
à ces.exécutions, chacun fe faifoit un mérite
d’y avoir part.
Il y avoit aufli chez les Juifs des gens appelles iot-
tores y qui étoient établis pour faire fubir aux criminels
les tortures ou peines auxquelles ils étoient condamnes
: quelquefois ils fe fervoient de certains fa»
tellites de leurs préfets, nommés fpiculatores, parce
qu’ils etoient armés d’une efpece de javelot ou pique
; mais il femble que l’on ne fe fervoit de ceux-ci
que lorfqu’il s’agiffoit de mettre à mort fur le champ,
comme de couper la tête, & non pas lorfqu’il s’agiffoit
de fouetter, ou faire foùffrir autrement les criminels
: c’eft de-là que Y exécuteur de la haute juflice
eft nommé parmi nous en latin torior,fpiculator .-.on
l’appelle aufli carnifex.
Chez les Grecs cet office n’étoit point méprifé
puifqu’Ariftote, liv .V I. de fes Politiques, chap. dernier,
\k met au nombre des magiftrats. I l dit même
que par rapport à fa nécefliré, on doit le tenir pour
un des principaux offices.
Les magiftrats romains avoient des miniftres ou
fatellites appellés liâfores, li&eurs, qui furent infti-
tués par Romulus, ou même, félon d’autres, par Janus
; ils marchoient devant les magiftrats, portant
des haches enveloppées dans des faifeeaux de verges
ou baguettes. Les confuls en a voient douze; les pro-
confuls, préteurs & autres magiftrats en avoient feulement
flx ; ils faifoient tout-à-la-fois l’office de fer-
gent & de bourreau. Ils furent nommés licteurs, parc«
qu’ils lioient les pies 8t les mains des criminels avant
l’exécution ; ils délioient leurs faifeeaux de verges
foit pour fouetter les criminels, foit pour trancher
la tête.
On fe fervoit aufli quelquefois d’autres perfonnes
pour les exécutions; car Cicéron, dans la feptieme
de fes Ferrines, parle du portier de la prifon, qui
faifoit l’office de bourreau pour exécuter les ju<*e->
mens du prêteur : aderat, dit-il, janitor carceris, car-
nifex pratoris, mors, terrorque Jociorum, 6* civium lie-
tor. On fe fervoit même quelquefois du miniftere des
foldats pour l’exécution des criminels , non-feulement
à l’armée, mais dans la ville même, fans que
cela les deshonorât en aucune maniéré.
Adrien Beyer, qui étoit penfionnairê de Rotef-
dam, fait voir dans un de fes ouvrages, dont l’extrait
eft au journal des Savons de 170 3 ,p. 88. qu’anciennement
les juges exécutoient fouvent eux-mêmes
les condamnés ; il en rapporte plufieurs exemples
tirés de l’hiftoire facrée & profane ; qu’en Ef-
pagne, en France, Italie 6c Allemagne, lprfque plu»
fleurs etoient condamnes au fupplice pour un même
crime , on donnoit la vie à celui qui vouloir bien
executer les autres ; qu’on vôit encore au milieu de
la ville de Gand deux ftatues d’airain d’un pere Ôc
d’un fils convaincus d’un même crime, où le fils fer-
vit d!exécuteur à fon pere ; qu’en Allemagne, avant
que cette fon&ion eût été érigée en titre d’office, le
plus jeune de la communauté ou du corps de ville en
étoit chargé ; qu’en Franconie c’étoit le nouveau