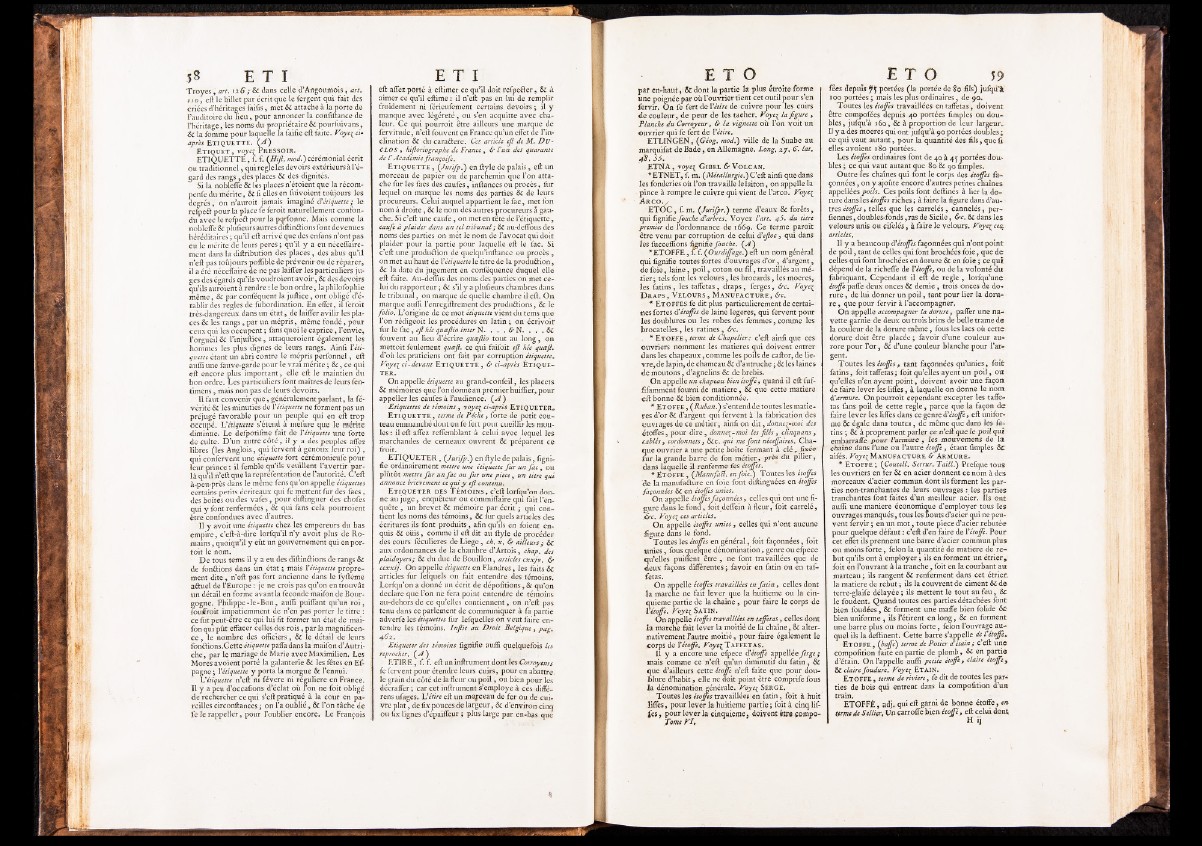
Troves, art. 1 2 6 ;& c dans celle d’Angoumois, art.
j 1 o , eft le billet par écrit que le fergent qui fait des
criées d’héritages faifis, met & attache à la porte de
l’auditoire du lieu, pour annoncer la confiftance de
l’héritage, les noms du propriétaire & pourfuivans,
& la fomme pour laquelle la faifie eft faite. V o y e z ci»
après Etiquette. ( A ) Etiquet , v o y e z Pressoir.
ETIQUETTE, f. f. (H i f i . m o i.') cérémonial écrit
ou traditionnel > qui réglé les devoirs extérieurs à l’égard
des rangs, des places & des dignités.
Si la nobleffe & les places n’étoient que la récompense
du mérite, & fi elles en fuivoient toûjours les
degrés, on n’auroit jamais imaginé d’ étiquette; le
reipeft pour la place fe feroit naturellement confondu
avec le refpeél pour la pqrfonne. Mais comme la
nobleffe & plufieurs autres diftindions font devenues
héréditaires ; qu’il eft arrivé que des enfans n’ont pas
eu le mérite de leurs peres ; qu’il y a eu néceffaire-
ment dans la diftribution des places , des abus qu’il
n’eft pas toûjours poffible de prévenir ou de réparer,
il a été néceffaire de ne pas laiffer les particuliers juges
des égards qu’ils voudroient avoir, & des devoirs
qu’ils auroient a rendre : le bon ordre, la philofophie
même, & par conféquent la juftice, ont obligé d’établir
des réglés de fubordination. En effet, il feroit
très-dangereux dans un état, de laiffer avilir les places
& les rangs, par un mépris, même fondé, pour
ceux qui les occupent ; fans quoi le caprice, l’envie,
l’orgueil & l’injuftice, attaqueroient également les
hommes les plus dignes de leurs rangs. Ainfi ¥ étiquette
étant un abri contre le mépris perfonnel, eft
auflï une fauve-garde pour le vrai mérite ; & , ce qui
eft encore plus important, elle eft le maintien du
bon ordre. Les particuliers font maîtres de leurs fen-
timens, mais non pas de leurs devoirs.
Il faut convenir que, généralement parlant, la fé-
vérité & les minuties de ¥ étiquette ne forment pas un
préjugé favorable pour un peuple qui en eft trop
occupé. \Jétiquette s’étend à mefure que le mérite
diminue. Le defpotifme fait de ¥étiquette une forte
de culte. D’un autre côté, il y a des peuples affez
libres (les Anglois, qui fervent à genoux leur roi) ,
qui confervent une étiquette fort cérémonieufe pour
leur prince : il femble qu’ils veuillent l’avertir par-
là qu’il n’eft que la repréfentation de l’autorité. C’eft
à-peu-près dans le même fens qu’on appelle étiquettes
certains petits écriteaux qui fe mettent fur des facs,
des boîtes ou des vafes, pour diftinguer des chofes
qui y font renfermées, & qui fans cela pourroient
être confondues avec d’autres.
11 y avoit une étiquette chez les empereurs du bas
empire, c’eft-à-dire lorfqu’il n’y avoit plus de Romains
, quoiqu’il y eût un gouvernement qui enpor-
toit le nom.
De tous tems il y a eu des diftinâions de rangs &
de fondions dans un état ; mais ¥ étiquette proprement
dite , n’eft pas fort ancienne dans le fyftème
aéhiel de l’Europe : je ne crois pas qii’on en trouvât
lin détail en forme avant la fécondé maifon de Bourgogne.
Philippe-le-Bon, aufli puiffant qu’un roi,
iouffroit impatiemment de n’en pas porter le titre :
ce fut peut-être ce qui lui fit former un état de maifon
qui pût effacer celles des rois, par la magnificenc
e , le nombre des officiers, & le détail de leurs
fon&ions.Cette étiquette paffadans la maifon d’Autriche,
par le mariage de Marie avec Maximilien. Les
Mores avoient porté la galanterie & les fêtes en Ef-
pagne ; ¥ étiquette y porta la morgue & l’ennui.
L’étiquette n’eft ni févere ni reguliere en France.
Il y a peu d’occafions d’éclat où l’on ne foit obligé
de rechercher ce qui s’eft pratiqué à la cour en pareilles
circonftances ; on l’a oublié, &C l’on tâche de
fe le rappeller, pour l’oublier encore. Le François
eft affez porté à eftimer ce qu’il doit refpeôer, & à
aimer ce qu’il eftime : il n’eft pas en lui de remplir
froidement ni férieufement certains devoirs ; il y
manque avec légéreté, ou s’en acquitte avec cha-
lèur. Ce qui pourroit être ailleurs une marque de
fervitude, n’eft fouvent en France qu’un effet de l’inclination
& du cara&ere. Cet article ejl de M. D u -
CLOS , hifioriographe de France, & l'un des quarante
de l'Académie françoife. Etiquette , (Jurifp.) en ftyle de palais, eft un
morceau de papier ou de parchemin que l’on attache
fur les facs des caufes, inftançes ou procès, fur
lequel on marque les noms des parties & de leurs
procureurs. Celui auquel appartient le fac, met fon
nom à d roite, & le nom des autres procureurs 5. gauche.
Si c’eft une caufe, on met en tête de l’étiquette,
cauj'e à plaider dans un tel tribunal ; & aurdeffous des
noms des parties on met le nom de l’avocat qui doit
plaider pour la partie pour laquelle eft le fac. Si
c’eft une production de quelqu’inftance ou procès,
on met au haut de ¥ étiquette le titre de la produôion,
& la date du jugement en conféquence duquel elle
eft faite. Au-deffus des noms des parties on met celui
du rapporteur ; & s’il y a plufieurs chambres dans
le tribunal, on marque de quelle chambre il eft. On
marque aufli l’enregiftrement des productions, & le
folio. L’origine de ce mot étiquette vient du tems que
l’on rédigeoit les procédures en latin ; on écrivoit
fur le fa c , ejl hîc quoejlio inter N. . . . £ N. . . . &
fouvent au lieu d’écrire quoejlio tout au long, on
mettoit feulement quoejl. ce qui faifoit ejl hîc quoejl.
d’où les praticiens ont fait par corruption étiquette.
Voyez ci-devant TER. ETIQUETTE, & ci-après ÉTIQUEOn
appelle étiquette au grand-confeil, les placets
& mémoires que l’on donne au premier huiflier, pour
appeller les caufes à l’audience. ( A )
Etiquettes de témoins , voyez ci-après ETIQUETER.
Etiquette, terme de Pêche, forte de petit couteau
emmanché dont on fe fert pour cueillir les moules
: il eft affez reffemblant à celui avec lequel les
marchandes de cerneaux ouvrent & 'préparent cè
fruit.
ETIQUE TER, ( Jurifp.) en ftyle de palais, figni-
fie ordinairement mettre une étiquette fur un fa c , ou
plûtôt mettre fur un fac ou fur une piece , un titre qui
annonce brièvement ce qui y ejl contenu. Etiqueter des T émoins, c’eft lorfqu’ondonne
au ju g e, enquêteur ou commiffaire qui fait l’enquête
, un brevet & mémoire par écrit ; qui contient
les noms des témoins, & liir quels articles des
écritures ils font produits, afin qu’ils en foient en-
quis & oiiis, comme il eft dit au ftyle de procéder
des cours féculieres de Liege, ch. x. & ailleurs ; &
aux ordonnances de la chambre d’Artois, chap. des
plaidoyers; & du duc de Bouillon, articles cxxjv. 6*
ccxxij. On appelle étiquette en Flandres, les faits &
articles fur leïquels on fait entendre des témoins.
Lorfqu’on a donné un écrit de dépolirions, & qu’on
déclaré que l’on nè fera point entendre de témoins
au-dehors de ce qu’elles contiennent, on n’eft pas
tenu dans ce parlement de communiquer à fa partie
adverfe les étiquettes fur lefquelles on veut faire entendre
les témoins. Injlit au Droit Belgique, pag.
462.
Etiqueter des témoins fignifie aufli quelquefois les
reprocher. (A )
ETIRE, f. f. eft un infiniment dont les Corroyeurs
fe fervent pour étendre leurs cuirs, pour en abattre,
le grain du côté de la fleur ou p o il, ou bien poür les
décraffer ; car cet infiniment s’employe à ces diffé-
rens ufages. Vétire eft un monceau de fer ou de cuivre
p lat, de fix pouces de largeur, & d’environ cinq
ou fix lignes d’épaiffeur ; plus large par en-bas que
par en-haut, & dont la partie la plus étroite forme
une poignée par où l’ouvrier tient cet outil pour s’en
fervir. On fe fert de ¥ étire de cuivre pour les cuirs
de couleur, de peur de les tacher. Voyez la figure ,
Planche du Corroyeur, & la vignette où l’on voit un
ouvrier qui fe fert de ¥étire.
ETLINGEN, (Géog. mod.) ville de la Suabe au
marquifat de Bade, en Allemagne. Long, xy, 6. lut.
48. JS.
E TN A , voyez Gibel & Volcan.
* ETNET, f. m . ( Métallurgie. ) C’eft ainfi que dans
les fonderies où l’on travaille le laiton, on appelle la
pince à rompre le cuivre qui vient de l’arco. Voyez
A R C O y
E T O C , f. m. (Jurifpr.) terme d’eaux & forêts,
qui fignifie fouche d’arbres. Voyez l'art. 4 J. du titre
premier de l’ordonnance de 1669. Ce terme paroît
être venu par corruption de celui à'ejloc , qui dans
les fucceflions fignifie fouthe. (A )
* ETOFFE, iTf. (’ Ourdiffage. ) eft un nom général
qui fignifie toutes fortes d’ouvrages d’o r , d’argent,
de foie, laine, p o il, coton ou f il, travaillés au métier;
tels font les velours, les brocards, les moeres,
les fatins, les taffetas, draps, ferges, &c. Voyez Draps , Velours , Manufacture , &c.
* Etoffes fe dit plus particulièrement de certaines
fortes d’étoffes de laine legeres, qui fervent pour
blerso dcaotuebllluesre, sl eosu r aletisn reosb es des femmes, comme les , &c.
. * Etoffe , terme de Chapelier: c’eft ainfi que ces
ouvriers nomment les matières qui doivent entrer
dans les chapeaux, comme les poils de caftor, de lièvre,
de lapin, de chameau & d’autruche ; & les laines
de moutons, d’agnelins & de brebis.
On appelle un chapeau bien étoffé, quand II eft fuf-
fîfamment fourni de matière, & que cette matière
çft bonne & bien conditionnée.
* Etoffe , (Ruban.) s’entend de toutes les matières
d’or & d’argent qui fervent à la fabrication des
ouvrages de ce métier ; ainfi on dit, donnez-moi des
étoffes, pour dire, donne^-moi les filés , clinquans,
câblés, cordonnets, & c . qui me font néceffaires. Chaque
ouvrier a une petite boîte fermant à clé , fixée
fur la grande barre de fon métier, près du pilier,
dans laquelle il renferme fes étoffes.
* Etoffe , (Manufact. en Joie.) Toutes les étoffes 'de la manufaôure en foie font diftinguées en étoffés
façonnées & en étoffes unies.
On appelle étoffes façonnées , celles qui ont une figure
dans le fond, foit deffein à fleur, foit carrelé,
x<&c. Voyez ces articles.
On appelle étoffes unies, celles qui n’ont aucune
figuie dans le fond.
Toutes les étoffes en général, foit façonnées, foit
unies, fous quelque dénomination, genre ou efpece
qu’elles puiffent être , ne font travaillées que de
deux façons différentes ; fayoir en fatin ou en taffetas.
On appelle étoffes travaillées en fatin, celles dont
la marche ne fait lever que la huitième ou la cinquième
partie de la chaîne, pour faire le corps de
¥ étoffe. Voyez Satin.
On appelle étoffes travaillées en taffetas, celles dont
la marche fait lever la moitié de la chaîne, & alternativement
l’autre moitié, pour faire également le
corIpl s de ¥ étoffe. Voyez Taffetas. y a encore une efpece d’étoffe appellée ferge; mais comme ce n’eft qu’un diminutif du fatin, &
qbuluer ed ’da’ihllaebuirts, ceelltete n éet odfofei tn p’eofitn fta iêtter eq uceo mpporuifre dfoouus
la dénomination générale. Voyez Serge.
Toutes les étoffes travaillées en fatin, foit à huit
liffes, pour lever la huitième partie ; foit à cinq liftes
, pour lever la cinquième, doivent être çompo-
Tome V I»
fées depuis portées (la portée de 80 fils) jufqii’â
100 portées ; mais les plus ordinaires, de 90.
Toutes les étoffes travaillées en taffetas, doivent
être compofées depuis 40 portées Amples ou doubles,
jufqu’à 160, & à proportion de leur largeur.
Il y a des moeres qui ont jufqu’à 90 portées doubles ;
ce qui vaut autant, pour la quantité des fils, que d
elles avoient 180 portées.
Les étoffes ordinaires font de 40 à 45 portées doubles
; ce qui vaut autant que 80 & 90 Amples.
Outre les chaînes qui font le corps des étoffes façonnées
, on y ajoûte encore d’autres petites chaînes
appellées poils. Ces poils font deftinés à lier la dorure
dans les étoffes riches ; à faire la figure dans d’autres
étoffes, telles que les carrelés, cannelés, per-
fiennes, doubles-fonds, ras de S icile, &c. & dans les
velours unis ou cifelés, à faire le velours. Voyez ceSf
articles.
Il y a beaucoup d’étoffes façonnées qui n’ont point
de p oil, tant de celles qui font brochées foie, que de
celles qui font brochées en dorure & en foie ; ce qui
dépend de la richeffe de ¥ étoffe, ou de la volonté du
fabriquant. Cependant il eft de réglé , lorfqu’une
étoffe paffe deux onces & demie , trois onces de dorure
, de lui donner un p o il, tant pour lier la dorure
, que pour fervir à l’accompagner.
On appelle accompagner la dorure, paffer une navette
garnie de deux ou trois brins de belle trame de
la couleur de la dorure même, fous les lacs où cette
dorure doit être placée.; favoir d’une couleur aurore
pour l’o r , & d’une couleur blanche pour l’argent
» 1 W Ê m Ê Ê Ê Ê Toutes les étoffes, tant façonnées qu’unies, foit
fqaut’ienllse,s fno’ietn ta afyfeetnats ;p ofoinitt q, ud’eolilvees naty eanvto uirn u pneo ifla, çooun
dde faire lever les liffes, à laquelle on donne le nom 'armure. On pourroit cependant excepter les taffetfaasir
fea lnesv peor ille ds eli fcfeest tdea nrésg cleé g, epnarrec de que la façon de 'étoffe, eft unifortmines
& égale dans toutes, de même que dans les fa;
& à proprement parler ce n’eft que le poil qui cehmabînaerr dafafnes pl’ouunre lo’aur lm’auurtree, les mouvemens de la étoffe, étant fimplés ÔC
aifés. Voyez Manufacture & Armure.
*■ ETOFFE; (Coutell. Serrur. Taillé) Prefque tous
les ouvriers en fer & en acier donnent ce nom à des
morceaux d’acier commun dont ils forment les parties
non-tranchantes de leurs ouvrages : les parties
tranchantes font faites d’un meilleur acier. Ils ont
aufli une maniéré économique d’employer tous les
ouvrages manqués, tous les Bouts d’acier qui ne peuvent
fervir ; en un mot, toute piece d’acier rebutée
pour quelque défaut : c’eft d’en faire de ¥ étoffe. Pour
cet effet ils prennent une barre d’acier commun plus
ou moins forte, félon la quantité de matière de rebut
qu’ils ont à employer ; ils en forment un étrier,'
foit en l’ouvrant à la tranche, foit en la courbant au
marteau ; ils rangent & renferment dans cet étrier,
la matière de rebut ; ils la couvrent de ciment & d&
terre-glaife délayée ; ils mettent le tout au feu , 8c
le foudent. Quand toutes ces parties détachées font
bien foudées, & forment une maffe bien folide &•
bien uniforme, ils l’étirent en long, & en forment
une barre plus ou moins forte, félon l’ouvrage auquel
ils la deftinent. Cette barre s’appelle de l'étoffe. ETOFFE, (baffe) terme de Potier d'étain; C’eft une
compofition faite en partie de plomb, & en partie
d’étain. On l’appelle aufli petite étoffe, claire étoffe,
& Eclaire foudure. Voyez Etain. toffe , terme de riviere, fe dit de toutes les parties
de bois qui entrent dans la compofition d’un
train.
ÉTOFFÉ, adj. qui eft garni de bonne étoffe, trt
terme de Sellier, Un carroffe bien étoffé, eft celui dont
H ij