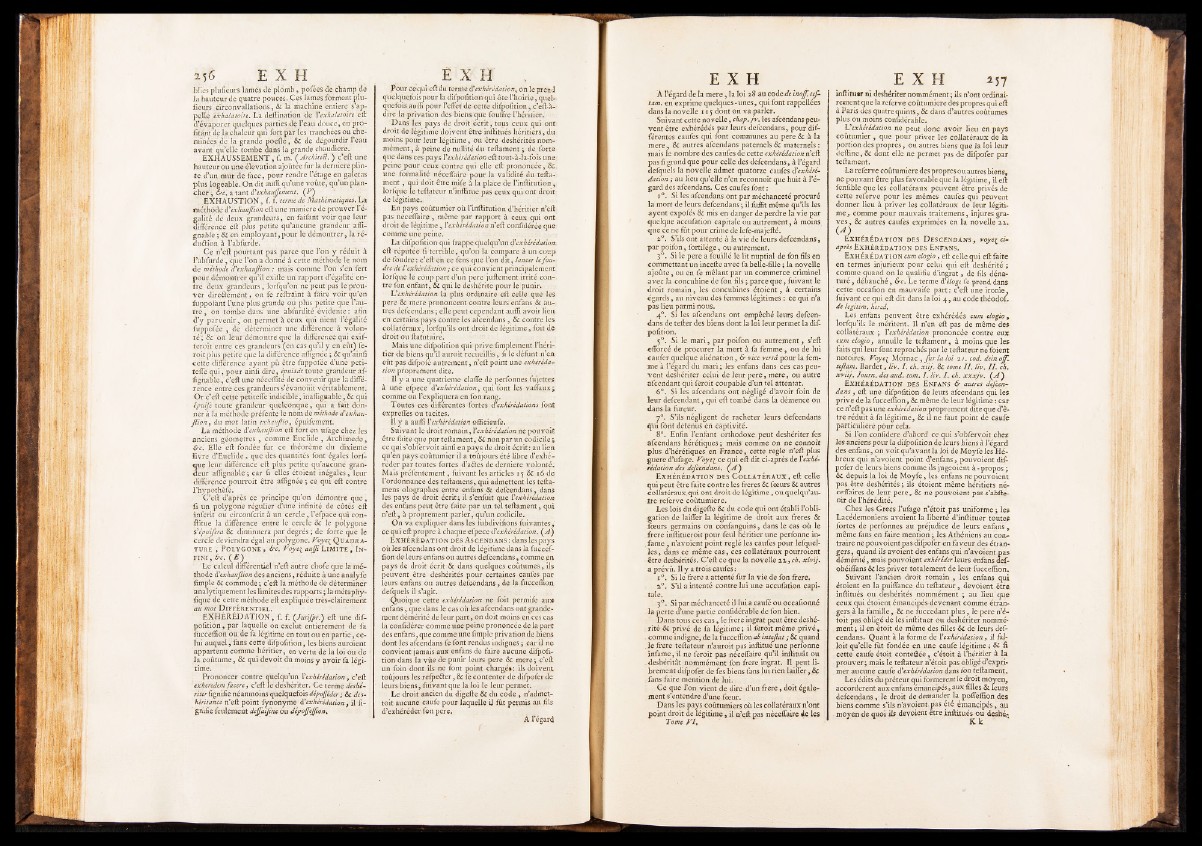
blies plufieurs lamés de plômb, pofées de champ de
la hauteur de quatre pouces. Ces lames forment plu-
iieiir.s circonvallations, & la machine éntiere s’appelle
exhalatoire. La deffination de l’exhalatoire eft
d'évaporer quelques parties,àé l’eau douce, en profitait
de.la chaleur qui fort pàr les tranchées ou cheminées,
de là grande poëflë, 6c de dégourdir l’eau
avant qu’elle tombe dans la grande chaudière.
EXHAUSSEMENT, f. m; [Architecl. ) c’eft une
hauteur pu une élévation ajoutée fur la derniere plin-
te d’un mur de face, pour rendre l’étage en galetas
plus logeable. On dit auffi qu’une voûte, qu’un planch
e r , Grc. a tant â’exhauj/ement. (E)
' EXHAUSTION, f. f. terme de Mathématiques. La
méthode d’èxfiaujlion eft une maniéré de prouver l’e-
galite dé deux grandeurs, en faifant voir que leur
différence éft plus petite qu’aucune grandeur affi-
gnablè ; & en employant,pour le démontrer, la réduction
à l’abfurde.
Ce n’eft pourtant pas parce que l’on y réduit à
l’abfurdé , que l’on a donné à cette.méthode le nom
de méthode d’exhaujfion : mais comme l’on s’en fert
pour.démontrer qu’il exifte un rapport d’égalité entré
deux grandeurs,'lorfqu’on ne peut pas le prouver
dire&emènt , on fe reftraint à faire voir qu’en
fuppofânt l’une plus grande où plus petite que l’autre
, on tombe dans une ablurdité évidente: afin
d’y parvenir ,r on permet à ceux qui nient l’égalité
fitppofée , de déterminer une différence à volonté
; 6c on leur démontre que la différence qui exif-
teroit entre ces grandeurs (en cas qu’il y en eût) ferait
plus petite que la différence affignée ; 6c qu’ainfi
cette différence ayant pû être fuppofée d’une peti*
teffe qui, pour ainfi dire, épuisât toute grandeur af-
fign,able., c’eft une néceffité de convenir que la différence
entre ces grandeurs s’évanoiiit véritablement.
Or c’ eft cette petiteffe indicible, inaffigaable, 6c qui
épuife toute grandeur quelconque, qui a fait donner
à là méthode préfente le nom de méthode d'exhau-
Jlion, du mot latin exhaujlio, épuifemeùt.
La méthode d’exhaufiion eft fort en ufage chez les
anciens géomètres , comme Euclide , Archimede,
&c. Elle eft fondée fur ce théorème du dixième
livre d’EuClide, que des quantités font égales lorsque
leur différence eft plus petite qu’aucune grandeur
affignable ; car fi elles étoient inégales, leur
différence pourrait être affignée ; ce qui eft contre
l ’hypothèfe.
C ’eft d’après ce principe qu’on démontre que,
fi un polygone régulier d’une infinité de côtés èft
infcrit ou circonfcrit à un cercle, l’efpace qui cort-
ftitue la différence ëritrë le cercle & le polygone
s’épilifera 6c diminuera par degrés ; de forte que le
cercle deviendra égal au polygone, Voye^ Q u a d r a t
u r e , Po l y g o n e , & c . Voye^ aujjiL im i t e , Inf
i n i , &c. ( £ )
Le calcul différentiel n’eft autre chofe que la méthode
d'exhaujlion des anciens, réduite à une analy fe
fimple 6ç commode ; c’eft la méthode de déterminer
aùalytiquement les limites des rapports ; la métaphy-
fique de cette méthode eft expliquée très-clairement
au mot D if f é r e n t ie l .
EXHÉRÉDATION, f. f. (Jurifpr.) eft une difpofition
, par laquelle on exclut entièrement de fa
îùcceffion oui de fa légitime en tout ou en partie, celui
auquel, fans cette difpofition, les biens auraient
appartenu comme héritier, en vertu de la loi ou de
la cofitume, 6c qui devoit du moins y avoir fa légitime.
Prononcer contre quelqu’un l’exhérédation, c’eft
exheredem facere 3 c’eft le deshériter. Ce terme deshériter
fignifie néanmoins quelquefois dépojjéder ; 6c déshéritante
ii’eft point fynonyme d’exhérédation, il fi-
‘ gnifïe feulement dejfaijinç ou dépojfejjion.
Pour ce qui eft du ternie8 exhérédation^ on le prend
quelquefois pour la difpofition qui ôte l’hoirie, quelquefois
auffi pour l’effet'de cette difpofition -, c’eft-à-
dirê la privation des biens que fouffre l’héritier.
Dans les' pays de droit écrit, tous ceux qui ont
droit de légitime doivent être inftitués héritiers, du
moins pour leur légitime, ou être déshérités nommément,
à peine de nullité du teftament ; de. forte
que dans ces pays Y exhérédation efitowt-h-la-fois une
peine pour ceux contre qui elle eft prononcée, 6c.
une formalité néceffaire pour la validité du teftament
, qui doit être mife à la place de l’inftitution,
lorfqùe le teftateur n’inffitue pas ceux qui ont droit
de légitime.
En pays coûtumier oit l’inftitution d’héritier n’eft
pas néceffaire ,.même par rapport à ceux qui ont
droit de légitime,. l’exhérédation n’eft confidérée que
comme une peine.
La difpofition qui frappe quelqu’un d’exhérédation
eft réputéè fi!terrible, qu’on la compare à un coup
de foudre : c’eft en ce fens que l’on dit, lancer le foudre
de l'exhérédation; ce qui convient principalement
lorfque le coup part d’un pere juftement irrité contre
fon enfant, 6c qui le déshérité pour le punir.
i?exhérédation la plus ordinaire eft celle que les
pere & mere prononcent-contre leurs enfans :& autres
dêfcendans ; elle peut cependant auffi avoir lieu
en certains pays contre les afcendans , 6c contre les
collatéraux, lorfqu’ils ont droit de légitime, foit de
droit ou ftatutaire.
Mais une difpofition qui prive Amplementl’héri-,
tier de biens qu’il aurait recueillis, fi le défunt n’en
eût pas difpôfe autrement, n’eft point une exhérédtî-
tion proprement dite.
Il y a une quatrième claffe de perfonnes fujettes
à une efpece d’'exhérédation^ qui font les vaffaux ;
comme on l’expliquera en fon rang.
Tontes ces différentes fortes à?exhérédations font
expreffes ou tacites.
Il y a auffi l’exhérédation officieufe., '
Suivant le droit romain, Y exhérédation ne pouvoit
être faite que par teftament, 6c non par un codicile ;
ce qui s’obfer voit ainfi en pays de droit écrit : au lieu
qu’èn pays coûtumier il a toûjours été libre d’exhé-
réder par toutes fortes d’aftes de derniere volonté.
Mais préfentement, fuivant les articles 15 6c 16 de
l’ordonnance des teftamens, qui admettent les tefta-
mens olographes entre enfans & defcendans, dans
les pays de droit écrit; il s’enfuit que l’exhérédation
des enfans peut être faite par un tel teftament, qui
n’eft, à proprement parler, qu’un codicile.
On va expliquer dans les fubdivifions fuivantes,'
ce qui eft propre à chaque efpece d’exhérédation. (A}
E x h é r é d a t io n d e s A s ç e n d a n s : dans les pays
où les afcendans ont droit de légitime dans la fucceffion
de leurs enfans ou autres defcendans, comme en
pays de droit écrit & dans quelques coûtumes, ils
peuvent être déshérités pour certaines caufes par
leurs enfans ou autres defcendans, de la fucceffion
defquels il s’agit.
Quoique cette exhérédation ne foit permife au»
enfans, que dans le cas où les afcendans ont grandement
démérité de leur part, on doit moins en ces cas
la confidérer comme une peine prononcée de la part
des enfans, que comme une fimple privation de biens
dont les afcendans fe font rendus indignes ; car il ne
convient jamais aux enfans de faire aucune difipofi-
tion dans la vûe de punir leurs pere 6c mere ; c’eft
un foin dont ils ne font point chargés : ils doivent
toûjours les refpeûer, & fe contenter de difpofer de
leurs biens, fuivant que la loi le leur permet.
Le droit ancien du digefte 6c du code , n’admet-
toit aucune caufe pour laquelle il fût permis au fils
d’exhéréder fon pere.
A l’égard
 l’égard de la mere, la loi z8 au code de inojf. tef-
tam. en exprime quelques-unes, qui font rappellées
dans la novelle 115 dont on va parler.
Suivant cette novelle, chap.jv. les afcendans peuvent
être exhérédés par leurs defcendans, pour différentes
caufes qui font communes au pere & à la
mere, 6c autres afcendans paternels 6c maternels :
mais le nombre des caufes de cette exhérédation n’eft
pas fi grand que pour celle des defcendans, à l’égard
defquels la novelle admet quatorze Caufes d?exhérédation;
au lieu qu’elle n’en reconnoît que huit à l’égard
des afcendans. Ces caufes font :
i° . Si les afcendans ont par méchanceté procuré
la mort de leurs defcendans ; il fufiît même qu’ils les
ayent expofés 6c mis en danger de perdre la vie par
quelque accufation capitale ou autrement, à moins
que ce ne fût pour crime de lefe-majefté.
x°. S’ils ont attenté à la v ie de leurs defcendans,
par poifon, fortilége, ou autrement.
30. Si le pere a fouillé le lit nuptial de fon fils en
commettant un incefte avec fa belle-fille ; la novelle
ajoûte, ou en fe mêlant par un commerce criminel
avec la concubine de fon fils ; parce que, fuivant le
droit romain, les concubines étoient, à certains
égards, au niveau des femmes légitimes : ce qui n’a
pas lieu parmi nous.
40. Si les afcendans ont empêché leurs defcendans
de tefter des biens dont la loi leur permet la difpofition.
5°. Si le mari, par poifon ou autrement, s’eft
efforcé de procurer la mort à fa femme, ou de lui
caufer quelque aliénation,. & vice versa pour la femme
à l’egard du mari ; les enfans dans ces cas peuvent
deshériter celui de leur p ere, mere, ou autre
afcendant qui ferait coupable d’un tel attentat.
■ 6°. Si les afcendans ont négligé d’avoir foin de
leur defcendant, qui eft tombé dans la démence ou
dans la fureur.
70. S’ils négligent de racheter leurs defcendans
qui font détenus en captivité.
8°. Enfin l’enfant orthodoxe peut deshériter fes
afcendans hérétiques ; mais comme on ne connoît
plus d’hérétiques en France, cette réglé n’eft plus
guere d’ufage. Voye{ ce qui eft dit ci-après de Y exhérédation
des defcendans. {A ) Exhérédation qui peut être faite condteres lCeso flrelraest éraux, eft celle collatéraux, qui ont droit de légitim6ce f,oe ouur qsu 6ecl qauut’areus-
tre referve coûtumiere.
Les lois du digefte 6c du code qui ont établi l’obligation
de laiffer la légitime de droit aux freres &
l'oeurs germains ou confanguins, dans le cas où le
frere inftitueroit pour feul héritier une perfonne in-
, famé , n’avoient point réglé les caufes pour lefquel-
le s , dans ce même cas, ces collatéraux pourraient
être déshérités. C’eft ce que la novelle n , c h . xlvij.
a prévit. Il y a trois caufes :
i° . Si le frere a attenté fur la v ie de fon frere.
a°. S’il a intenté contre lui une accufation capitale.
30. Si par méchanceté il lui a caufé ou occafionné
la perte d’une partie confidérable de fon bien.
Dans tous ces ca s , le frere ingrat peut être deshé-
; rité 6c privé de fa légitime ; il ferait même privé,
. comme indigne, de la fucceffion ab intejlat ; 6c quand
.le frere teftateur n’aurait pas inftitué une perfonne
infâme, il ne ferait pas neceffaire qu’il inftituât ou
. déshéritât nommément fon frere ingrat. Il peut librement
difpofer de fes biens fans lui rien laiffer, 6c
fans faire mention de lu i.,
Ce que l’on vient de dire d’un frere, doit également
s’entendre d’une foeur.
Dans les pays coûtumiers où les collatéraux n’ont
point droit de lég it im e il n’eft pas néceffaire de les
Tome VI»
inftituer ni deshériter nommément ; ils n’ont ordinairement
que la referve coûtumiere des propres qui eft
à Paris des quatre quints, 6c dans d’autres coûtumes
plus ou moins confidérable.
L’exhérédation ne peut donc avoir lieu en pays
coûtumier , que pour priver les collatéraux de la
portion des propres, ou autres biens que la loi leur
deftine, 6c dont elle ne permet pas de difpofer par
teftament.
La referve coûtumiere des propres ou autres biens,
ne pouvant être plus favorable que la légitime, il eft
fenfible que les collatéraux peuvent être privés de
cette referve pour les mêmes caufes qui peuvent
donner lieu à priver les collatéraux de leur légitime,
comme pour mauvais traitemens, injures graves
, 6c autres caufes exprimées en la novelle 22.
mEx hérIédation des Descendans, voye^ ci-
après Exhérédation des Enfans.
Exhérédation cum elogio, eft celle qui eft faite
en termes injurieux pour celui qui eft déshérité ;
comme quand on le qualifie d’ingrat, de fils dénaturé
, débauché, &c. Le terme d?éloge fe prend dans
cette occafion en mauvaife part: c’eft une ironie,
fuivant ce qui eft dit dans la loi 4 , au code théodof.
de legitim. hered.
Les enfans peuvent être exhérédés cum elogio,
lorfqu’ils le méritent. Il n’en eft pas de même des
collatéraux ; Y exhérédation prononcée contre eux
cum elogio, annulle le teftament, à moins que les
faits qui leur font reprochés par le teftateur ne foient
notoires. Voye% Mornac , fur la loi 2.1. cod. deinoff-
tejlam. Bardet, liv. I. ch. xiij. 6c tome I I. liv. II. ch.
xviij. Journ. desaud. tom. I. liv. I . ch. xxxjv. (A ') Exhérédation des Enfans & autres defcendans
3 eft une difpofition de leurs afcendans qui les
prive de la fucceffion, 6c même de leur légitime : car
ce n’eft pas une exhérédation proprement dite que d’être
réduit à fa légitime, 6c il ne faut point de caufe
particuliere pour cela.
Si l’on confidere d’abord ce qui s’obfervoit chez
les anciens pour la difpofition de leurs biens à l’égard
des enfans, on voit qu’avant la loi de Moyfe les Hébreux
qui n’avoient point d’enfans, pouvoient difpofer
de leurs biens comme ils jugeoient à-propos ;
6c depuis la loi de Moyfe, les enfans ne pouvoient
pas être déshérités ; ils étoient même héritiers né-
ceffaires de leur pere, & ne pouvoient pas s’abfte-
nir de l’hérédité.
Chez les Grecs l’ufage n’étoit pas uniforme ; les
Lacédémoniens avoient la liberté d’inftituer toutes
fortes de perfonnes au préjudice de leurs enfans,
même fans en faire mention ; les Athéniens au contraire
ne pouvoient pas difpofer en faveur des étrangers
, quand ils avoient des enfans qui n’avoient pas
démérité, mais pouvoient exhéréder leurs enfans défi-
obéiffans 6ç les priver totalement de leur fucceffion.
Suivant l’ancien droit romain , les énfans qui
étoient en la puiffance du teftateur, devôient être
inftitués ou déshérités nommément ; au lieu que
ceux qui étoient émancipés-devenant comme étrangers
à la famille, 6c ne fuccedant plus, le pere n’étoit
pas obligé de les inftituer ou deshériter nommément;
il en étoit de même des filles 6c de leurs defcendans.
Quant à la forme de Y exhérédation , il fâl-
loit qu’elle fût fondée en une caufe légitime ; & fi
cette caufe étoit conteûée, c’étoit à l’héritier à la
prouver; mais le teftateur n’étoit pas obligé d’exprimer
aucune caufe d’exhérédation dans fon teftament.
Les édits du préteur qui formèrent le droit moyen,
accordèrent aux enfans émancipés, aux filles & leurs
defcendans ,Te droit de demander la poffeffion .des
biens comme s’ils n’avoient. pas été émancipés, aji
moyen de quoi ils dévoient être inftituésou deshé-
K k '