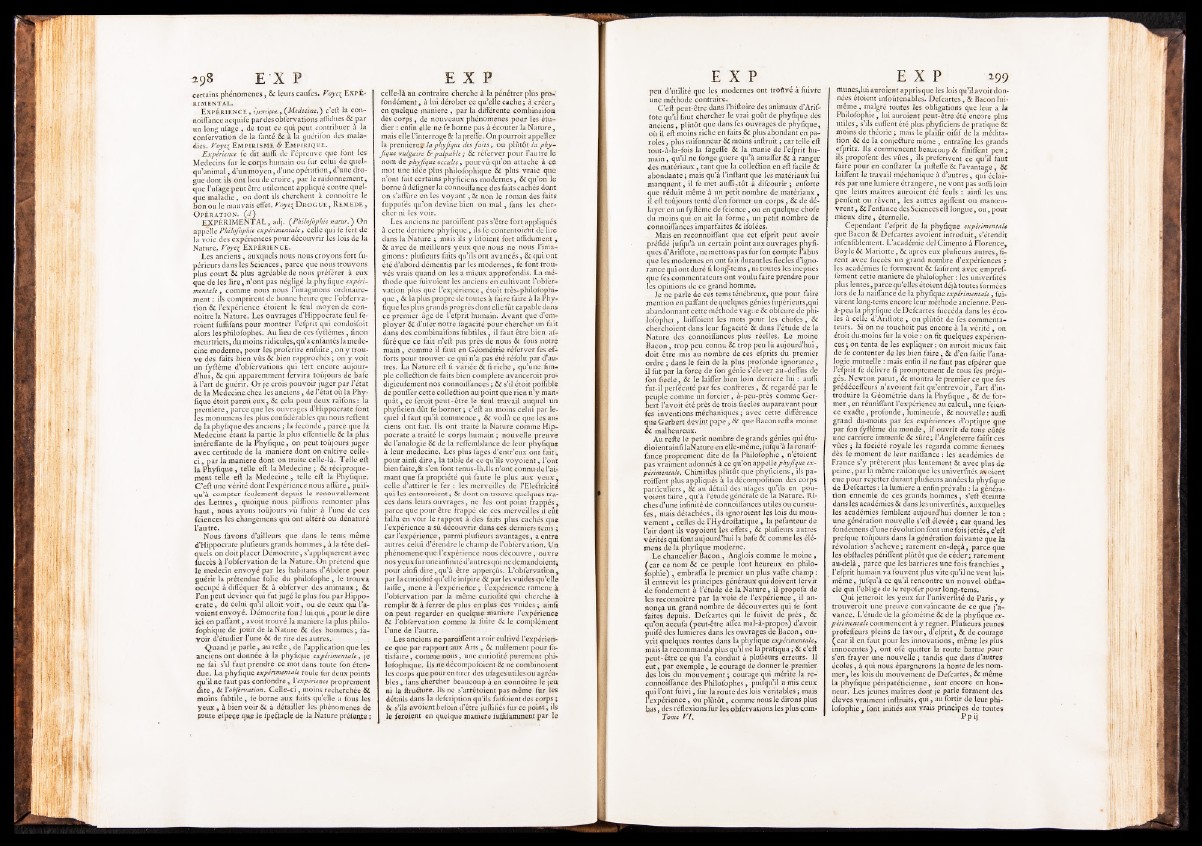
certains phénomènes, Ôc leurs caufes. Ÿoye^ Ex p é rimEental.
xpérience, t/xmipity (Médecine.} c’eft la con-
noilTance acquife pardesobfervations affidues ôc par
un long ufage , de tout ce qui peut contribuer à la
conforvation de la fanté & à la guérifon des maladies.
Voyt{ Empirisme & Empirique.
Expérience fe dit auffi de l’épreuve que font les
Médecins fur le corps humain ou fur celui de quel-
qu’animal, d’un moyen, d’une opération, d’une drogue
dont ils ont lieu de croire, par le raifonnement,
que l’ufage peut être utilement applique contre quelque
maladie, ou dont ils cherchent à connoitre le
bon ou le mauvais effet. Voyt^Drogue, Rem eue ,
Opération. (d ) EXPÉRIMENTAL, adj. {Philofophie natur.) On
appelle Philofophie expérimentale, celle qui fe fert de
la voie des expériences pour découvrir les lois de la
Nature. Voye{ Expérience.
Les anciens, auxquels nous nous croyons fort fu-
périeurs dans les Sciences, parce que nous trouvons
plus court ôc plus agréable de nous préférer à eux
que de les lire, n’ont pas négligé la phyfique expérimentale
, comme nous nous l’imaginons ordinairement
: ils comprirent de bonne heure que l’obferva-
tion ôc l’expérience étoient le feul moyen de con-
noître la Nature. Les ouvrages d’Hippocrate feul fe-
roient fuffifans pour montrer l’efprit qui condnifoit
alors les philofophes. Au lieu de ces fyltèmes, finon
meurtriers, du moins ridicules, qu’a enfantés la médecine
moderne, pour les profcrire enfuite, on y trouve
des faits bien vus ôc bien rapprochés ; on y voit
un fyftème d’obfervations qui fert encore aujourd’hui
, Ôc qui apparemment fervira toujours de bafe
à l’art de guérir. Or je crois pouvoir juger par l’état
de la Medecinexhez les anciens, de l’état où la Phyfique
étoit parmi eux, ôc cela pour deux raifons : la
première, parce que les ouvrages d’Hippocrate font
les monumens les plus confidérables qui nous relient
de la phyfique des anciens ; la fécondé, parce que la
Medecine étant la partie la plus elfentielle ôc la plus
intéreffante de la Phyfique, on peut toujours juger
avec certitude de la maniéré dont on cultive celle-
c i , par la maniéré dont on traite celle-là. Telle eft
la Pnyfique, telle eft la Medecine ; Ôc réciproquement
telle eft la Medecine, telle eft la Phyfique.
C ’eft une vérité dont l’expérience nous affûre, puif-
qu’à compter feulement depuis le renouvellement
des Lettres, quoique nous pûffions remonter plus
haut, nous avons toûjours vû fubir à l’une de ces
fciences les changemens qui ont altéré ou dénaturé
l’autre.
Nous favons d’ailleurs que dans le tems même
d’Hippocrate plufieurs grands hommes, à la tête desquels
on doit placer Démocrite, s’appliquèrent avec
iuccès à l’obfervation de la Nature. On prétend que
le médecin envoyé par les habitans d’Abdere pour
guérir la prétendue folie du philofophe , le trouva
occupé à dilféquer ôc à obferver des animaux ; ôc
l’on peut deviner qui fut jugé le plus fou par Hippocrate
, de celui qu’il alloit vo ir , ou de ceux qui l’a-
voient envoyé. Démocrite fou ! lui q ui, pour le dire
ici en paflant, avoit trouvé la maniéré la plus philosophique
de jouir de la Nature ôc des hommes; fa-
yoir d’étudier l’une ôc de rire des autres.-
Quand je parle, au refte, de l’application que les
anciens ont donnée à la phyfique expérimentale, je
ne fai s’il faut prendre ce mot dans toute fon étendue.
La phyfique expérimentale roule fur deux points
u’il ne faut pas confondre, Y expérience proprement
it e , & Yobfervation. Ce lle-ci, moins recherchée ÔC
moins fubtile, fe borne aux faits qu’elle a fous les
y e u x , à bien voir ôc à détailler les phénomènes de
joute elpeçe que le fpeôaçle de la Nature préfeiÿe ;
celle-là au contraire cherche à la pénétrer plus pro-;
fondément, à lui dérober ce qu’elle cache ; à créer,
en quelque maniéré , par la différente combinaifoa
dès corps, de nouveaux phénomènes pour les étudier
: enfin elle ne fe borne pas à écouter la Nature,
mais elle l’interroge & lapreffe. On pourroit appeller
la première^1 la phyfique des faits, ou plutôt la phyfique
vulgaire & palpable ■; ÔC réferver pour l’autre le
nom de phyfique occulte, pourvu qu’on attache à ce
mot une idée plus philofophique ôc plus vraie que
n’ont fait certains phyficiens modernes, & qu’on le
borne à défigner la connoiffance des faits cachés dont
on s’affure en les v o y an t, & non le roman des faits
fuppofés qu’on devine bien ou mal, fans les chercher
ni les voir.
Les anciens ne paroiffent pas s’être fort appliqués
à cette derniere phyfique, ils fe contentoieht de lire
dans la Nature ; mais ils y lifoient fort affidument ,
& avec de meilleurs yeux que nous ne nous l’imac
ginons : plufieurs faits qu’ils ont avancés, ôc qui ont
été d’abord démentis par les modernes, fe font trouvés
vrais quand on les a mieux approfondis. La méthode
que fuivoient les anciens en cultivant l’obfèr-
vation plus que l’expérience, étoit très-philofophi-r
que, & la plus propre de toutes à faire faire à la Phy?
fique les plus grands progrès dont elle fût capable dans
ce premier âge de l’efprit humain. Avant que d’em*
ployer ôc d’ulèr notre fagacité pour chercher un fait
dans des combinaifons fubtiles, il faut être bien afif
fûré que ce fait n’eft pas près de nous & fous notrè
main , comme il faut en Géométrie réferver fes e£*
forts pour trouver ce qui n’a pas été réfolu par d’autres.
La Nature eft fi variée & fi riche, qu’une fim*
pie colleôion de faits bien complété avanceroit pro^
digieufement nos connoiffances ; ôc s’il étoit poffibl'e
de pouffer cette colleâion au point que rien n’y man*
quât, ce feroit peut - être le feul travail auquel un
phyficien dût fe borner ; c’eft au moins celui par lequel
il faut qu’il commence , ôc voilà ce que les an*
ciens ont fait. Ils ont traité la Nature comme Hip*
pocrate a traité le corps humain ; nouvelle preuve
de l’analogie ôc de la reffemblance de leur phyfique
à leur medecine. Les plus fages d’enrr’eux ont fait^
pour ainfi dire, la table de ce qu’ils voyoient, l’pnt
bien faite,& s’en font tenus-là.lls n’ont connu de l’air
mant que fa propriété qui faute le. plus aux y e u x ,
celle d’attirer le fer : les merveilles de l’Eleûricité
qui les entouroient, & dont on trouve quelques traces
dans leurs ouvrages, ne les ont point frappés ÿ
parce que pour être frappé de ces merveilles il eût
fallu en voir le rapport à, des- faits plus cachés que
l’expérience a sû découvrir dans ces derniers tems ;
car l’expérience, parmi plufieurs avantages,, a entre
autres celui d’étendre le champ de l’obfervation. Un
phénomène que l’expérience nous découvre, ouvre
nos yeux fur une infinité d’autres qùi ne demandoienty
pour ainfi dire, qu’à être apperçûs. L ’obfervation $
par la curiofité qu’elle infpire ôc par les, vuidesqu’elle
laifTe, mene à l’expériertce ; l’expérience ramene à
l’oblervation par la même curiofité qui cherche-à
remplir & à ferrer de plus en plus ces vuides-; ainfi
on peut regarder en quelque- maniefe l’expérience
& l’obfervation comme la fuite ôc le complément
l’une de l’autre. ■
Les anciens ne paroiffent avoir cultivé l’expêrien*
ce que par rapport- aux Arts , ôc nullement pour fa*
tisfaire, comme nous, une curiofité purement philofophique.
Ils ne décompofoient ôc ne combinoient
les corps que pour en tirer des ufagesutilesou agréables
, fans chercher beaucoup à en connoître le jeu.
ni la ftruéture. Ils ne s’arrêtoient pas même fur les
détails dans la defeription qu’ils faifoient des corps ;
& s’ils avoient befoin d’être juftifiés fur ce point, ils
le feroient en quelque maniéré îuififàmmcnt par le
peu d’iitilité que les modernes ont troûvé à fiiivre
une méthode contraire.
C ’eft peut-être dans l’hiftoire des animaux d’Arif-
tote qu’il faut chercher le vrai goût de phyfique des
anciens, plûtôt que dans fes ouvrages de phyfique,
où;il eft moins riche en faits ôc plus abondant en paroles
, plus raifonneur ôc moins inftruit ; car telle eft
tout-à-la-fois la fageffe & la manie de l’efprit humain
, qu’il ne fonge guere qu’à amaffer ôc à ranger
des matériaux, tant que la colleftion en eft facile ôc
abondante ; mais qu’à l’inftant que les matériaux lui
.manquent, il fe met auffi>tôt à difeourir ; enforte
que réduit même à un petit nombre de matériaux ,
il eft toûjours tenté d’en former un corps, Ôc de délayer
en un fyftème de fcience, ou en quelque chofe
du moins qui en ait la forme, un petit nombre de
connoiffances imparfaites ôc ifolées.
Mais en reconnoiffant que cet efprit peut avoir
préfidé jufqu’à un certain point aux ouvrages phyfi-
ques d’Ariftote, ne mettons pas fur fon compte l’abus
que les modernes en ont fait durant les fiecles d’ignorance
qui ont duré fi lon^-tems, ni toutes les inepties
que fes commentateurs ont voulu faire prendre pour
les opinions de ce grand homme.
Je ne parle de ces tems ténébreux, que pour faire
mention en paflant de quelques génies iiipérieurs,qui
abandonnant cette méthode vague ôc obfcure de phi-
lofopher, laiffoient les mots pour les chofes, ôc
cherchoient dans leur fagacité & dans l’étude de la
Nature des connoiffances plus réelles. Le moine
Eacon, trop peu connu ôc trop peu lû aujourd’hui,
doit être mis au nombre de ces efprits du premier
ordre ; dans le fein de la plus profonde ignorance,
il fut par la force de fon génie s’élever au-defl’us de
fon fiecle, ôc le laiffer bien loin derrière lui : auffi
fut-il perfécuté par fes confrères , ôc regardé par le
peuple comme un forcier, à-peu-près comme Ger-
bert l’avoit été près de trois fiecles auparavant pour
fes inventions méchaniques ; avec cette différence
queGerbert devint pape, ôc que Bacon refta moine
ôc malheureux.
Au refte le petit nombre de grands génies qui étu-
dioient ainfilaNature en elle-même, jufqu’à la renaif-
fance proprement dite de la Philofophie , n’etoient
pas vraiment adonnés à ce qu’on appellephyfique expérimentale.
Chimiftes plutôt que phyficiens, ils paroiffent
plus appliqués a la décompofition des corps
particuliers, ÔC au détail des ufages qu’ils en poq-
voient faire, qu’à l’étude générale de la Nature. Riches
d’une infinité de connoiffances utiles ou curieu-
fes, mais détachées, ils ignoroient les lois du mouvement
, celles de l’Hydroftàtique , la pefanteur de
l’air dont ils voyoient les effets, ôc plufieurs autres
vérités qui font aujourd’hui la bafe ôc comme les élé-
mens de la phyfique moderne.
Le chancelier Bacon -, .Anglois comme le moine ,
(car ce nom ôc ce peuple font heureux en philofophie)
, embraffa le premier un plus vafte champ :
il entrevit les principes généraux qui doivent lervir
de fondement a l’étude de la Nature, il propofa de
les reconnoître par la voie de l’expérience , il annonça
un grand nombre de découvertes qui fe font
faites depuis. Defcartes qui le fuivit de près, Ôc
qu’on accufa (peut-être allez mal-à-propos) d’avoir
puifé des lumières dans les ouvrages de Bacon, ouvrit
quelques routes dans la phyfique expérimentale,
mais la recommanda plus qu’il ne la pratiqua ; & c’eft
peut-être ce qui l’a conduit à plufieurs erreurs. Il
eut, par exemple, le courage de donner le premier
des lois du mouvement ; courage qui mérite la re-
connoiffance des Philofophes, puifqu’il a mis ceux
qui l’ont fu iv i, fur la route des lois véritables ; mais
l’expérience, ou plûtôt, comme nous le dirons plus
fias, des réflexions fur les obiervarions les plus com-
Tome VI,
mimes,lui auroient appris que les lois qu’il avoit données
étoient infoûtenables. Defcartes, Ôc Bacon lui-
même , malgré toutes les obligations que leur a la
Philofophie, lui auroient peut-être été encore plus
utiles, s’ils euffent été plus phyficiens de pratique ôc
moins de théorie ; mais le plaifir oifif de la méditation
ôc de la conjeôure même , entraîne les grands
efprits. Ils commencent beaucoup & finiflent peu ;
ils propofent des vûes, ils preferivent ce qu’il faut
faire pour en conftater la jufteffe ôc l’avantage, ôc
laiffent le travail méchanique à d’autres, qui éclairés
par une lumière étrangère, ne vont pas auffi loin
que leùrs maîtres auroient été feuls : ainfi les uns
penfent ou rêvent, les autres agiffent ou manoeuvrent
, ôc l’enfance des Sciences eft longue, ou, pour
mieux dire, éternelle.
Cependant l’efprit de la phyfique expérimentale
que Bacon ôc Defcartes avoient introduit, s’étendit
infenfiblement. L’académie del Cimento à Florence,
Boyle ôc Mariotte, ôc après eux plufieurs autres, firent
avec fuccès un grand nombre d’expériences ;
les academies fe formèrent ôc faifirent avec empref-
fement cette maniéré de philofopher : les univerfités
plus lentes, parce qu’elles étoient déjà toutes formées
lors de la naiffance de la phyfique expérimentale , fui-
virent Iong-tems encore leur méthode ancienne. Peu-
à-peu la phyfique de Defcartes fuccéda dans les écoles
à celle d’Ariftote , ou plûtôt de fes commentateurs.
Si on ne touchoit pas encore à la vérité , on
étoit du-moins fur la voie : on fit quelques expériences
; on tenta de les expliquer : on auroit mieux fait
de fe contenter de les bien faire, ôt d’en faifir l’analogie
mutuelle : mais enfin il ne faut pas efpérer que
l’efprit fe délivre fi promptement de tous fes préjugés.
Newton parut, ôc montra le premier ce que fes
prédéceffeurs n’avoient fait qu’entrevoir, l’art d’introduire
la Géométrie dans la Phyfique , ôc de former
, en réunifiant l’expérience au calcul, une fcience
exafte, profonde, lumineufe, ôc nouvelle : auffi
grand du-moins par fes expériences d’optique que
par fon fyftème du monde, il ouvrit de tous côtés
une carrière immenfe ôc sûre; l’Angleterre faifit ces
vues ; la fociété royale les regarda comme fiennes
dès le moment de leur naiffance : les académies de
France s’y prêtèrent plus lentement ôt avec plus de
peine, par la même raifon que les univerfités avoient
eue pour rejetter durant plufieurs années la phyfique
de Defcartes : la lumière a enfin prévalu : la génération
ennemie de ces grands hommes, s’eft éteinte
dans les académies ôt dans les univerfités, auxquelles
les académies femblent aujourd’hui donner le ton :
une génération nouvelle s’eft élevée ; car quand les
fondemens d’une révolution font une fois jettés, c’efl:
prefque toûjours dans la génération fuivante que la
révolution s’acheve; rarement en-deçà, parce que
les obftacles périffent plûtôt que de céder; rarement
au-delà, parce que les barrières une fois franchies ,
l’efprit humain va fouvent plus vite qu’il ne veut lui-
même , jufqu’à ce qu’il rencontre un nouvel obfta-
cle qui l’oblige de le repofer pour long-tems.
Qui jetteroit les yeux fur l’univernté de Paris, y
trouveroit une preuve convaincante de ce que j’avance.
L’étude de la géométrie ÔC de la phyfique expérimentale
commencent à y regner. Plufieurs jeunes
profefleurs pleins de l’avoir, d’efprit, ôt de courage
( car il en faut pour les innovations, même les plus
innocentes), ont ofé quitter la route battue pour
s’en frayer une nouvelle ; tandis que dans d’autres
écoles, à qui nous épargnerons la honte de les nommer,
les lois du mouvement de Defcartes, ôc même
la phyfique péripatéticienne, font encore en honneur.
Les jeunes maîtres dont je parle forment des
éleves vraiment inftruits, qui, au fortir de leur philofophie
, font initiés aux vrais principes de toutes
I j || II ! Il il
§ g ?