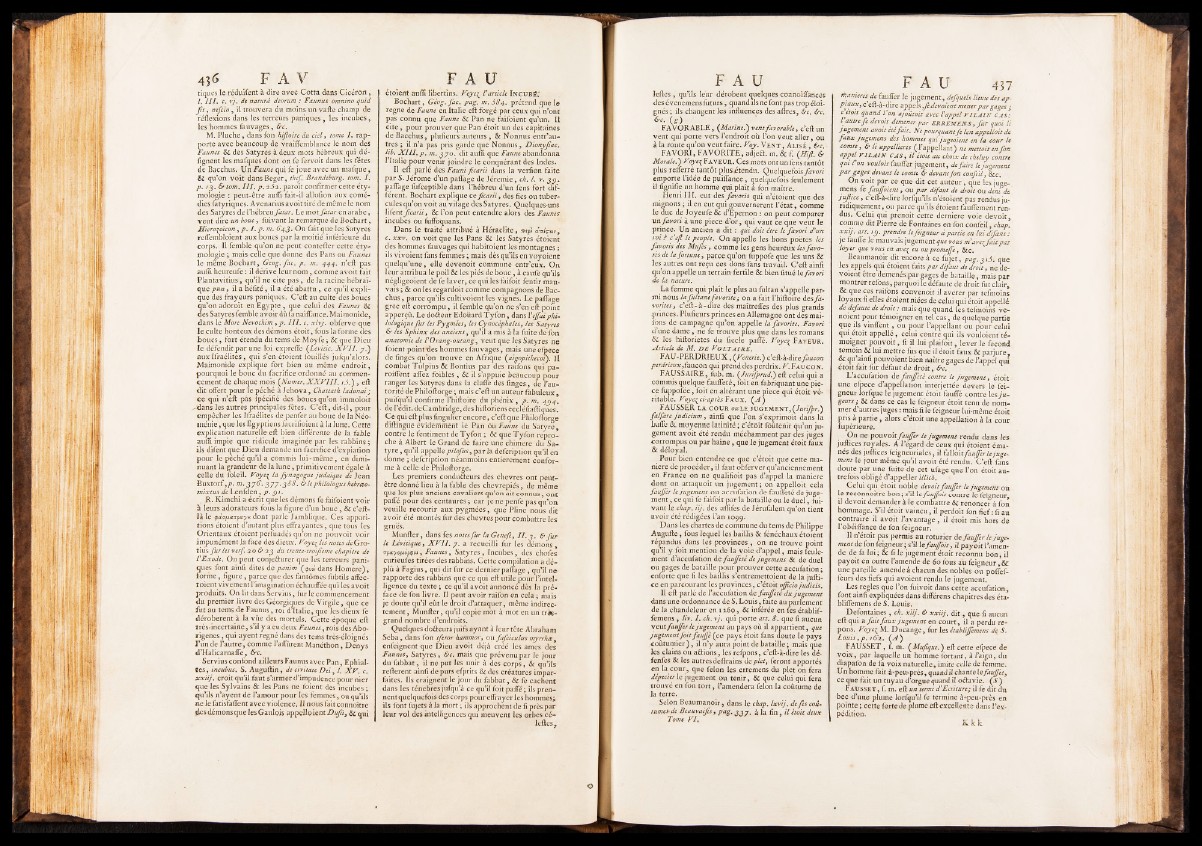
tiques leréduifent à dire avec Cotta dans Cicéron,
l. I II. c. vj. de naturâ deorum : Faunus omnino quid
J it, nefeio, il trouvera du moins un vafte champ de
réflexions dans les terreurs paniques , les incubes,
les hommes fauvages, &c.
M. Pluche, dans fon hifioire du ciel, tome I . rapporte
avec beaucoup de vrai'flemblance le nom des
Faunes & des Satyres à deux mots hébreux qui dé-
fignent les marques dont on fe fer voit dans les fêtes
de Bacchus. Un Faune qui fe joue avec un mafque,
& qu’on voit dansBeger, thef. Brandeburg. tom. I.
p. 13. & tom. I I I . p. 2.5%. paroît confirmer cette étymologie
: peut-être aufli fait-il allufion aux comédies
fatyriques. Avenarius avoit tiré de même le nom
des Satyres de l’hébreu fatar. Le mot fatar en arabe,
veut dire un bouc, fuivant la remarque de Bochart,
Hiero[oicon, p. I. p. m. 64J . On fait que les Satyres
reflembloient aux boucs par la moitié inférieure du
corps. Il femble qu’on ne peut contefter cette étymologie
; mais celle que donne des Pans ou Faunes
le même Bochart, Geog. fac, p. m. 444. n’eft pas
aufli heureufe : il dérive leur nom, comme avoit fait
Plantavitius, qu’il ne cite pas , de la racine hébraïque
pun, il a hé fit é , il a été abattu , ce qu’il explique
des frayeurs paniques. C ’eft au culte des boucs
qu’on adoroit en Egypte, que celui des Faunes &
des Satyres femble avoir dûfa naiflance. Maimonide,
dans le More Nevochim, p. I I I . c. xlvj. obferve que
le culte honteux des démons étoit, fous la forme des
boucs, fort étendu du tems de Moyfe ; & que Dieu
le défendit par une loi exprefle ( Levitic. X V I I . y A
aux Ifraélites, qui s’en étoient fouillés jufqu’alors.
Maimonide explique fort bien au même endroit,
pourquoi le bouc du facrifice ordonné au commencement
de chaque mois (Numer. X X V I I I . i5. ) , eft
dit offert pour le péché à Jehova, Chattath ladonai;
c e qui n’eft pas fpécifié des boucs qu’on immoloit
-dans les autres principales fêtes. C ’eft, dit-il, pour
empêcher les Ifraélites de penfer au bouc de la Néoménie
, que les Egyptiens facrifioient à la lune. Cette
explication naturelle eft bien différente de la fable
aufli impie que ridicule imaginée par les rabbins ;
ils difent que D ieu demande un facrifice d’expiation
pour le péché qu’il a commis lui-même, en diminuant
la grandeur de la lune, primitivement égale à
celle du foleil. Voye{ la fynagogue judaïque de Jean
Buxtorf,p. m. 3 y 6 .3 yy. 3 88. & lephilologus hebrtzo-
jnixtus de Lenfden, p. g i.
R. Kimchi a écrit que les démons fe faifoient voir
à leurs adorateurs fous la figure d’un bouc, & c’eft-
là le (fctvpMrTfetyv dont parle Jamblique. Ces apparitions
étoient d’autant plus effrayantes, que tous les
Orientaux étoient perfuadés qu’on ne pouvoit voir
impunément la face des dieux. Voye^ les notes de Grotius
fur les verf. 20 & 23 du trente-troifîeme chapitre de
C Exode. On peut conjecturer que les terreurs paniques
font ainfi dites de panim (ç>v» dans Homere),
forme, figure, parce que des fantômes fubtils affec-
toient vivement l’imagination échauffée qui les avoit
produits. On lit dans Servius, furie commencement
du premier livre desGéorgiques de V irgile, que ce
fut au tems de Faunus, roi d’Italie, que les dieux fe
dérobèrent à la vue des mortels. Cette époque eft
très-incertaine, s’il y a eu deux Faunes, rois des Aborigènes
, qui ayent régné dans des tems très-éloignés
l ’un de l’autre, comme l’aflurent Manéthon, Denys
d’Halicarnaffe, &c.
Servius confond ailleurs Faunus avec Pan, Ephial-
tes , incubus. S. Auguftin, de civitate Del l. X V . c.
xx iij. croit qu’il faut s’armer d’impudence pour nier
que les Sylvains & les Pans ne foient des incubes ;
qu’ils n’ayent de l’amour pour les femmes, ou qu’ils
ne le fatisfaffent avec violence. Il nous fait connoître
tics démons que les Gaulois appelloient Dujii, & qui
etoient aufli libertins. Veye^ Varticle Incubé»
Bochart, Gèog. fac. pag. m. 684. prétend que îé
régné de Faune en Italie eft forgé par ceux qui n’ont
pas connu que Faune & Pan ne faifoient qu’un. Il
c ite , pour prouver que Pan étoit un des capitaines
de Bacchus, plufieurs auteurs , & Nonnus entr’atitres
; il n’a pas pris garde que Nonnus, Dionyfiac.
lib. X I I I . p . m. 3 yo. dit aufli que Faune abandonna
I Italie pour venir joindre le conquérant des Indes.
II eft parlé des Fauni ficarii dans la verfion faite
par S. Jérome d’un palfage de Jéremie, ch. I. v. 3
palfage fufceptible dans l’hébreu d’un fens fort différent.
Bochart explique ce ficarii, des fies ou tubercules
qu’on voit au viiage des Satyres. Quelques-uns
lifent ficarii, & l’on peut entendre alors des Faunes
incubes ou fuffoquans.
Dans le traité attribué à Héraclite, irtp) airiç-uv ,
c. xxv. on voit que les Pans & les Satyres étoient
des hommes fauvages qui habitoient les montagnes :
ils vivoient fans femmes ; mais dès qu’ils en voyoient
quelqu’une, elle devenoit commune entr’eux. On
leur attribua le poil & les piés de bouc, à caufe qu’ils
négligeoient de fe laver, ce qui les faifoit fentir mauvais
; & on les regardoit comme compagnons de Bacchus
, parce qu’ils cultivoient les vignes. Le palfage
grec eft corrompu, il femble qu’on ne s’en eft point
apperçû. Le dofteur Edoiiard T y fon , dans Ÿeffaiphilologique
fur les Pygmées y les Cynocéphales, les Satyres
& les Sphinx des anciens, qu’il a mis à la fuite de fon
anatomie de VOrang-outang, veut que les Satyres ne
foient pointées hommes fauvages, mais une efpece
de linges qu’on trouve en Afrique (aigopithecoi). Il
combat Tulpius & Bontius par des raifons qui pa-
roilfent alfez foibles , & il s’appuie beaucoup pour
ranger les Satyres dans la clalfe des linges, de l’autorité
de Philoftorge ; mais c’eft un auteur fabuleux,
puifqu’il confirme l’hiftoire du phénix , p. m. 494.
de I’edit. deCambridge, des hiftoriens eccléfiaftiques.
Ce qui eft plus lingulier encore, c’eft que Philoftorge
diftingue évidemment le Pan ou Faune du Satyre,
contre le fentiment de Tyfon ; & que T yfon reproche
à Albert le Grand de faire une chimere du Sa-
ty re , qu’il appellepilofus, parla defeription qu’il en
donne ; defeription néanmoins entièrement conforme
à celle de Philoftorge.
Les premiers condu&eurs des chevres ont peut-
être donné lieu à la fable des chevrepiés, de même
que les plus anciens cavaliers qu’on ait connus ont
palfé pour des centaures ; car je ne penfe pas qu’on
veuille recourir aux pygmées, que Pline nous dit
avoir été montés fur des chevres pour combattre les
grues.
Munfter, dansfes notes fur la Gene/è, I I . 3 . & fur
le Lévitique, X V I I . y. a recueilli fur les démons,
rpayepocipoi, Faunes, Satyres, Incubes, des chofes
curieufes tirées des rabbins. Cette compilation a déplu
à Fagius, qui dit fur ce dernier palfage, qu’il ne
rapporte des rabbins que ce qui eft utile pour l’intelligence
du texte ; ce qu’il avoit annoncé dès la préface
de fon livre. Il peut avoir raifon en cela ; mais
je doute qu’il eût le droit d’attaquer, même indirectement,
Munfter, qu’il copie mot à mot en un très-
grand nombre d’endroits.
Quelques doâeurs juifs ayant à leur tête Abraham
Seba, dans fon tferor hammor, ou fafciculus myrrhes
enfeignent que Dieu avoit déjà créé les âmes des
Faunes, Satyres, &c. mais que prévenu par le jour
du fabbat, il ne put les unir à des corps, & qu’ils
refterent ainfi de purs efprits & des créatures imparfaites.
Ils craignent le jour du fabbat, & fe cachent
dans les ténèbres jufqu’à ce qu’il foit palfé ; ils prennent
quelquefois des corps pour effrayer les hommes;
ils font fujets à la mort ; ils approchent de fi près par
leur vol des intelligences qui meuvent les orbes cé-
leftes,
O
Icftes, qu’ils leur dérobent quelques connoiffances
des évenemens futurs, quand ils ne font pas trop éloignés
; ils changent les influences des aftres, &c. &c. M I I FAVORABLE, (Marine.') vent favorable y c’eft un
vent qui porte vers l’endroit où l’on veut aller, ou
à la route qu’on veut faire. P~oy. V ent , A l isé , &c. •
FAVORI, FAVORITE, adjeft. m. & f . (Hifi. &
Morale. ) Voye{ Faveu r. Ces mots ont un fens tantôt '
plus relferré tantôt plus étendu. Quelquefois/zvori
emporte l’idée de puiflance, quelquefois feulement
il lignifie un homme qui plaît à fon maître.
Henri I II. eut des favoris qui n’étoient que des
mignons ; il en eut qui gouvernèrent l’état, comme
le duc de Joyeufe ôc d’Epernon : on peut comparer
un favori à une piece d’o r , qui vaut ce que veut le
prince. Un ancien a dit : qui doit être le favori d'un
roi? c'efl le peuple. On appelle les bons poètes les
favoris des Mufes , comme les gens heureux les favoris
de Infortuné, parce qu’on fuppofe que les uns &
les autres ont reçu ces dons fans travail. C ’eft ainfi
qu’on appelle un terrain fertile & bien fitué le favori
de la nature.
La femme qui plaît le plus au fultan s’appelle parmi
nous la fultane favorite ; on a fait l’hiftoire des fa vorites,
c’eft-à-dire des maîtrefles des plus grands
princes. Plufieurs princes en Allemagne ont des mai-
îons de campagne qu’on appelle la favorite. Favori -
d’une dame , ne fe trouve plus que dans les romans
les hiftorietes du fiecle pane. Voye[ Faveur.
Article de M. d e V o l t a i r e .
FAU-PERDRIEUX, (Venerie.) c’eft-à-dire faucon
perdrieux,faucon qui prend des perdrix. V. Fau con .
FAUSSAIRE, fub. m. (Jurifprud.) eft celui qui a
commis quelque faufleté, foit en fabriquant une piece
fuppofée, foit en altérant une piece qui étoit vé- I
ritable. Voye^ci-après Fau x . (A )
FAUSSER LA COUR ou LE JUGEMENT, (/uriffrr.)
falfare judicium, ainfi que l’on s’exprimoit dans la
baffe & moyenne latinité; c’étoit foûtenir qu’un jugement
avoit été rendu méchamment par des juges
corrompus ou par haine, que le jugement étoit faux
& déloyal.
Pour bien entendre ce que c’étoit que cette maniéré
de procéder, il faut obferver qu’anciennement
en France on ne qualifioit pas d’appel la maniéré
dont on attaquoit un jugement; on appelloit cela
f außer lejugement ou accufation de faufleté de jugement
, ce qui fe faifoit par la bataille ou le duel, lui-
vant le chap. iij. des aflifes de Jérufalem qu’on tient
avoir été rédigées l’an 1099.
Dans les chartes de commune du tems de Philippe
Augufte, fous lequel les baillis & fénéchaux étoient
répandus dans les provinces , on ne trouve point
qu’il y foit mention de la voie d’appel, mais feulement
d’accufation de fauffeté de jugemens & de duel
ou gages de bataille pour prouver cette accufation ;
enforte que fi les baillis s’entremettoient de la jufti-
ce en parcourant les provinces, c’étoit officio judicis.
Il eft parlé de l’accufation de fauffeteiu jugement
dans une ordonnance de S. Louis, faite au parlement
de la Chandeleur en 1160, & inférée en tes é tablii-
femens , liv. I. ch. vj. qui porte art. 8. que fi aucun
veut f außer le jugement au pays où il appartient, que
jugement foit faujfe (ce pays étoit fans doute le pays
coutumier), il n’y aura point de bataille; mais que
les clains ou actions, les refpons, c’eft-à-dire les dé-
fenfes & les autres deftrains de plet, feront apportés
en la cour, que félon les erremens du plet ori fera
dépecier le jugement ou tenir, & que celui qui fera
trouve en fon tort, l’amendera félon la coutume de
la terre.
Selon Beaumanoir, dans le chap. Ixvij. deJes coutumes,
de Beauvaifis, pag. 3 3 y . à la fin, il étoit deux
Tome VI,
maniérés^ de fauffer le jugement, defquels lieux des ap-
piaux, c eft-à-dire appels f e dévoient mener par gages ;
c étoit quand l'on ajoûtoit avec l'appel V IL A IN CAS:
l autre fe devoit démener par e r r e m e n s , fur quoi U
jugement avoit été fait. Ne pourquant fe len appelloit de
faux jugemens des hommes qui jugeoient en la cour le
comte , & ü appellieres (-l’appellant) ne mettoit en fort
appel^ V IL A IN CAS, il étoit au choix de cheluy contre
qui l'on voulait fauffer jugement, de faire le jugement
par gages devant le comte & devantfon confcil, &c.
On voit par ce que dit cet auteur, qiie les jugement
fe faußoient, ou par défaut de droit ou déni de
juflice, c’eft-à-dire lorfqu’ils n’étoient pas rendus juridiquement,
ou parce qu’ils étoient fauffement rendus.
Celui qui prenoit cette derniere voie devoit,
comme dit Pierre de Fontaines en fon confeil, chap.
xxij. art. ig. prendre le feigneur à partie en lui difant :
je fauffe le mauvais jugement que vous m'aver^faitpar
loyer que vous en ave[ eu ou promejfe, & c.
Beaumanoir dit encore à ce fujet, pag. 315. que
les appels qui étoient faits par défaut de droit, ne dévoient
être demenés par gages de bataille, mais par
montrer refons, parquoi le défaute de droit fut clair,
& que ces raifons convenoit il averer par tefmoins
loyaux fi elles étoient niées de celui qui étoit appellé
dedefautede droit: mais que quand les tefmoins ve-
noient pour témoigner en tel cas, de quelque partie
que ils y inffent, ou pour l’appellant ou pour celui
qui etoit appelle, celui contre qui ils vouloient témoigner
pouvoit, fi il lui plaifoit, lever le fécond
témoin & lui mettre fus que il étoit faux & parjufe,
& qu’ainfi pouvoient bien naître gages de l’appel qui
étoit fait fur défaut de droit, &c.
L accufation de fauffeté contre le jugement, étoit
une efpece d’appellation interjettée devers le feigneur
lorfque le jugement étoit fauffé contre les ju -
geurs ; & dans ce cas le feigneur étoit tenu de nommer
d’autres juges : mais fi le feigneur lui-même étoit
pris à partie, alors c’étoit une appellation à la cour
fupérieure.
On ne pouvoit fauffer le jugement rendu dans les
juftices royales. A l ’égard de ceux qui étoient émanés
des juftices feigneuriales, il falloit fauffer le juge-
ment le jour même qu’il avoit été rendu. C ’eft fans
doute par une fuite de cet ufage que l’on étoit autrefois
obligé d’appeller illicb.
Celui qui étoit noble devoit fauffer le jugemeût où
le reconnoître bon; s’il lefauß'oit contre le feigneur,
il devoit demander à le combattre & renoncer à fon
hommage. S’il étoit vaincu, il perdoit fon fief : fi au
contraire il avoit l’avantage, il étoit mis hors de
l’obéiflance de fon feigneur.
Il n’étoit pas permis au roturier de fauffer le juge*-
ment de fon feigneur; s’il lefauffoit, il payoit l’amende
de fa loi ; 8c fi le jugement étoit reconnu bon, il
payoit en outre l’amende de 60 fous au feigneur, &
une pareille amende à chacun des nobles ou poflef-
feurs des fiefs qui avoient rendu le jugement.
Les réglés que l’on fuivoit dans cette accufation,
font ainfi expliquées dans différens chapitres des éta-
bliflemens de S. Louis.
Defontaines , ch. xiij. & x x iij. d it , que fi aucun
eft qui a fait faux jugement eu court, il a perdu répons.
Voyi{ M. Ducange, fur les établiffemens de S.
Louis, p. 162. (A )
FAUSSET, f. m. ( Mufique.) eft cette efpece de
v o ix , par laquelle un homme lortant, à l’aigu, du
diapafon de fa voix naturelle, imite celle de femme.
Un homme fait à-peu-près, quand il chante le fauffet,
ce que fait un tuyau d’orgue quand il oftavie. (S )
F a u s s e t , f. m . eft un terme d'Ecriture; il fe dit du
bec d’une plume Iorfqu’il fe termine à-peu-près en
pointe ; cette forte de p lu m e eft excellente dans l’expédition.
K k le