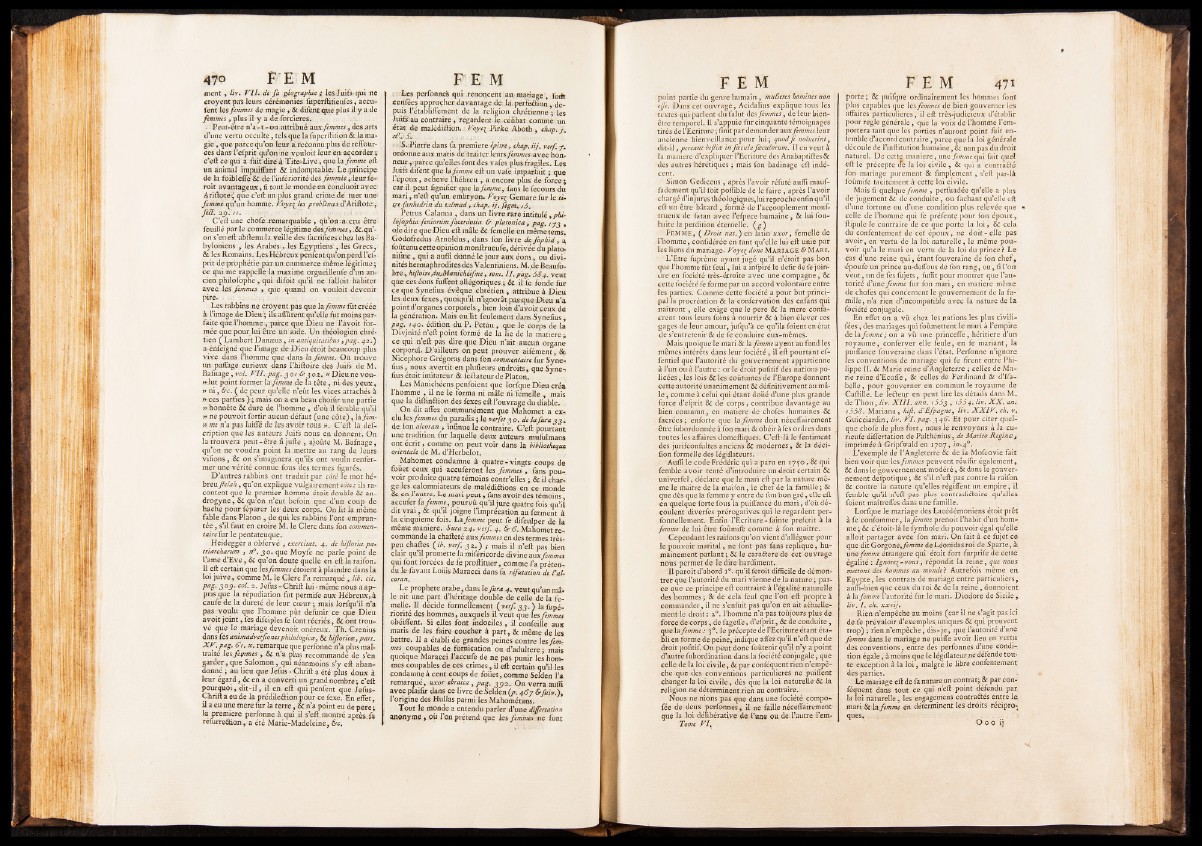
4?° F'EM
ment , liv. V IL de fa géographie $ les Juifs-qui ne
croyent pas leurs cérémonies fuperftitieufos, acculent
les femmes de magie , difent qite plus iliy ade
femmes , plus al y a de forcieres.
- ^Peut-être n’a - 1 - on :attribué ae x femmes 4 des arts
d’ une vertu occulte, tels que la fuperftitiôn & la mag
ie , que parce qu’on leur 'à.iieèonnù.'phts’dé ueffour-
ces dansl’efprit qu’on ne vpuloit leurieiraccorder^
c’eft ce qui a fait dire à 3ntèftLiyé, que la fertimc eft
un animal impuiffanf & indomptable. Le .principe
de la foiblefle & .de l’infériorité des fermais
roit avantageux; fi tout Je inonde en éoncluoil avec
Ariftpte^' que c’eft un plus grand crinière tuer unë'
femme qu’un homme. Voyel les problémcSid’ A n û o i& ,
fa t. affl'ij. a | , ••<• " jS " J, j « ! ‘Æ f
C ’eft une chofe.remarquable , qü’on ;accçu être
fouillé parle commerce légitime de&fe/ttrnesj.&c.qu’on
s’eneft abftenuia. veille des fecrifices'chez les Babyloniens
, les Arabes;-? les Egyptiens * les Grecs,
&Jes Romains. LesHébrëux penfentqu’onperd l’ef-
prit deiprophétie par un commerce même légitime ;
ce qui. me rappellera maxime orgueilleufe cfun ancien
philofophe, qui difoit qu’il ne fal!oit: habiter
axec. Iss.femmes , que quand on vouloit.devenir
pire. i
Les rabbins ne croyent pas que la femme fut créée
à l’image-de Dieu ; ils aflurent qu’elle fyt moins parfaite
qüe l’homme, parce que D ieu ne l’âvoit formée
quepour lui'être ün aide. Un théologien chrétien
( Lambert Danæus, in antiquitatibus ,pag..42.)
a- èhfëîgné que l’image de: Dieu étoit beaucoupplus
vive dans l’homme que dans la femme. On trouve
un paffage curieux clans l’hiftoire des Juifs de M.
Rafnage, vol. VII. pag, 301 & 3 02, « D ieu ne voul
u t pointformer lafe/n.m.e de la tête, ni des.yeux,
» n i, ùc. ( de peur qu’elle n’eût les vices attachés à
y>:ces parties ) ; mais on a eu beau choifir une partie
w honnête Ôc dure de l’homme , d’oû il ferable qu’il
» ne pouvoir fortir aucun défaut (une cô te) , làfem-
». me n’a pas laifle de les avoir tous ». C ’eft la description
que les auteurs Juifs nous en donnent. On
la trouvera peut-être fi jufte , ajoute M. Bafnage,
qu’on ne voudra point la mettre au rang de leurs
vifions, & on s’imaginera qu’ils ont voulu renfermer
une vérité connue fous des termes figurés.
D ’autres rabbins ont traduit par côté le mot hébreu
Jlelah, qu’on explique vulgairement côte: ils racontent
que le premier homme étoit double & an-
drogyne, & qu’on n’eut befoin que d’un coup de
hache pour féparer les deux corps. On lit la même
fable dans Platon , de qui les rabbins l’ont empruntée
, s’il faut en croire M. le C lerc dans fon commentaire
fur le pentateuque.
Heidegger a obfervé , exercitat. 4. de hifioria pa-
triarckarum , n°. 30. que Moyfe ne parle point de
l’ame d’E v e , & qu’on doute quelle en eft la raifon.
Il eft certain que les femmes étoient à plaindre dans la
loi juive, comme M. le Clerc l’a remarqué , lib. cit.
PalT* 3 °9 ' co^' 2* Jefus - Chrift lui - même nous a appris
que la répudiation fut permife aux Hébreux, à
caufe de la dureté de leur coeur ; mais lorfqu’il n’a
pas voulu que l’homme pût defunir ce que Dieu
a voit joint, fes difciples fe font récriés, & ont trouv
é que le mariage devenoit onéreux. Th. Crenius
dans issanimadverfionespkilologicce, & hijioricoe, part.
X V . pag. 6 1 .x . remarque que perfonne n’a plus maltraite
les femmes, & n’a plus recommande de s’en
garder, que Salomon, qui néanmoins s’y eft abandonné
; au lieu que Jefiis - Chrift a été plus doux à
leur égard, & en a converti un grand nombre; c’eft
pourquoi, d it- il, il eri eft qui penfent que Jefus-
Chrift a eu de la prédiledion pour ce fexe. En effet
il a eu une mere fur la terre, & n’a point eu de pere ;
la première perfonne à qui .il s’eft. montré après, fa
réfurre&ion , a été Marie-Madeleine, &c.
P E M
ï 3 Les perfonnes qui .renoncent au mariage , fortt
cenfée? approçher davantage de., fe, perfection depuis
i ’établiffement de la religion chrétienne ; les
Juifstaü contraire , 'regardent fei,célibat comme un
état de malédiction. : Voye{ ;Pirke Àboth , chap. j ,
«ÎD iic , .
r-JS».: Pierre dans fa première épitre, -chap. iij. verf. y.
ordonne aux maris de traiter leurs femmesAvec honneur,
»parce qu’elles font des vafes: plus.fragiles. Les
Juifs (bfent que \ i fernme eft un vais imparfait ; que
l’époüx, achevie l’hébreu ; a encore plus de force ;
car il peut fignifier que la}è^mc ,.faps le fecoursdu
mari, n’eft qu’un, embryon. Voye{ Gemare fur le titre
fankedrin du tplmud y chap. ij. Jcgtn. i5,
Petrus Calanna , dans un livre rare intitulé, phi-
làfaphiafeniorüm jacerdotia & platonica , pag. jy.3 ,
ofe dire que Dieu eft. mâle & . femelle en même tems,
Gôdofredus Arnoldus, dans fon livre de..faphid, a
fbûtenu cette opinion monftrueufe, dériveë du plator
nifine y qui a aufil detnné le jour aux éons, ou divi-r
nités hermaphrodites des Valentiniens. M.,de Beaufo-
bre , hifloire jhtjManichéifmc , tom. I I . pag* 534. veut
que ces éons fuffent allégoriques.; & il fe fonde fur
çe que Synefius. évêque chrétien , attribue à Dieu
les deux fexes, quoiqu’il n’ignorât;pasxpieDieu n’a
pointd’orçanes corporels, bien loin d’avoir ceux de
la génération. Mais on lit feulement dans Synefius*
pag. 140. édition, du P. Petâu, qlie.le'corps de la
Divinité n’eft point formé de la lie de la matière ;
ce qui n’eft pas dire que Dieu n’ait aucun organe
corpQrel. D ’ailleurs on peut prouver aifément, &
Nicèphore Grégoras dans fon commentaire fur Syne-
fius , nous avertit en plufienrs endroits, queSyne-»
fuis, étoit imitateur & fedateur de Platon..
Les Manichéens penfoient que lorfque Dieu créa
l’homme , il ne le forma ni mâle ni femelle , mais
que la diftinûion. des fexes eft l’ouvrage du diable.
.On dit affez communément que Mahomet a ex-,
clu les femmes 4u paradis ; le verfet 30. déjàfura 33+
de fon alcoran , infinue le contraire. C ’eft pourtant
une tradition fur laquelle deux auteurs mufulmans
ont écrit, comme on peut voir dans la bibliothèque
orientale de M. d’Herbelot.
Mahomet condamne à quatre-vingts coups de
fouet ceux qui accuferont les femmes , fans pouvoir
produire quatre témoins contr’elles ; & il charge
les calomniateurs de malédictions en ce monde
& en l ’autre. Le mari peut, fans avoir des témoins,
accufer fa femme, pourvû qu’il jure quatre fois qu’il
dit v r a i, & qu’il joigne l’imprécation au ferment à
la. cinquième fois. La femme peut fe difculper de la
même maniéré. Sura 24. verf. 4. <5* <f. Mahomet recommande
la chafteté aux femmes en des termes très-
peu chaftes (ib. verf. 3 2 .) ; mais il n’eft pas bien
clair qu’il promette la miféricorde divine aux femmes
qui font forcées de fe proftituer, comme l’a prétendu
le favant Loiiis Maracci dans fa réfutation de l'aiçoran.
Le prophète arabe, dans le fura 4. veut qu’un mâle
ait line çart d’héritage double de celle de la femelle.
Il décide formellement (verf. 3 3 . ) lafupé-
riorité des hommes, auxquels il veut que les femmes
obéiflent. Si elles font indociles, il confeille aux
maris de les faire coucher à part, & même de les
battre. Il a établi de grandes peines contre les femmes
coupables de fornication ou d’adultere ; mais
quoique Maracci Faccufe de ne pas punir les hommes
coupables de ces crimes, il eft certain qu’il les
condamne à cent coups de foiiet, comme Selden l’a
remarqué, uxor ebraica, pag. 393.. On verra aufli
avec plaifir dans ce livre de Selden (p. jS y &fuiv.)t
l’origine des Huilas parmi les Mahométans.
Tout le monde a entendu parler d’une differtanon
anonyme, où l’on prétend que les femmes ne font
F E M
point partie du genre humain , mulieres homines non
ejjè. Dans cet ouvrage, Acidalius explique tous les
textes qui parlent du falut des femmes, de leur bien-
être temporel. Il s’appuie fur cinquante témoignages
tirés de l’Ecriture ; finit par demander aux femmes leur
ancienne bienveillance pour lui; quodfi noluerint,
dit-il, pereant bejlioe in foecula foeculorum. Il en veut à
la maniéré d’expliquer l’Ecriture des Anabaptiftes &
des autres hérétiques ; mais fon badinage eft indécent.
Simon Gediccus, après l’avoir réfuté auffi mauf-
fadement qu’il foit pofiïble de le faire , après l’avoir
chargé d’injures théologiques,lui reproche enfin qu’il
eft un être bâtard , forme de l’accouplement monf-
trueux de fatan avec l’efpece humaine, & lui fou-
haite la perdition éternelle, (g')
Fe m m e , ( Droit nat.) en iatin’Kxor, femelle de
l’homme, confidérée en tant qu’elle lui eft unie par
les liens du mariage. Voyeç donc Ma r ia g e & Ma r i .
L’Etre fuprème ayant jugé qu’il n’étoit pas bon
que l’homme fût feul, lui a infpiré le defir de fe joindre
en fociété très-étroite avec une compagne, &
cette fociété fe forme par un accord volontaire entre
les parties. Comme cette fociété a pour but principal
la procréation & la confervation des eiifans qui
naîtront , elle exige que le pere & la mere confa-
crent tous leurs foins à nourrir & à bien élever ces
•gages de leur amour, jiifqu’à ce qu’ils foient en état
de s’entretenir & de fe conduire eux-mêmes.
Mais quoique le mari & la femme ayent au fond les
mêmes intérêts dans leur fociété, il eft pourtant ef-
fentiel que l’autorité du gouvernement appartienne
à l’un ou à l’autre : or le droit pofitif des nations po-
licées, les lois & les coûtumes de l’Europe donnent
cette autorité unanimement & définitivement au mâle
, comme à celui qui étant doiié d’une plus grande
force d’efprit & de corps, contribue davantage au
bien commun, en matière de chofes humaines &
facrées ; enforte que la femme doit néceflairement
être fubordonnée à fon mari & obéir à fes ordres dans
toutes les affaires domeftiques. C ’eft-là le fentiment
des jurifconfultes anciens & modernes, & la déci-
fion formelle des légiftateurs.
Aufli le code Frédéric qui a paru en 1750, & qui
femble avoir tenté d’introduire un droit certain &
univerfel, déclare que le mari eft par la nature même
le maître de la maifon, le chef de la famille ; &
, que dès que la femme y entre de fon bon g ré, elle èft
en quelque forte fous la puiffance du mari, d’où découlent
diverfes prérogatives qui le regardent per-
fonnellement. Enfin l’Ecriture - fainte preferit à la
femme de lui être foûmifb comme à fon maître.
Cependant les raifons qu’on vient d’alléguer pour
le pouvoir marital, ne font pas fans répliqué, humainement
parlant ; & le caraâere de cet ouvrage
nous permet de le dire hardiment.
Il paroît d’abord i°. qu’il feroit difficile de démontrer
que l’autorité du mari vienne de la nature ; parce
que ce principe eft contraire à l ’égalité naturelle
des hommes ; & de cela feul que l’on eft propre à
commander, il ne s’enfuit pas qu’on én ait aftuelle-
ment le droit : z°. l’homme n’a pas toûjours plus de
force de corps, de fageffe, d’efprit, & de conduite,
que la femme .-3°. le précepte de l’Ecriture étant établi
en forme de peine, indique affez qu’il n’eft que de
droit pofitif. On peut donc foûtenir qu’il n’y a point
d’autre fubordination dans la fociété conjugale, que
celle de la loi civile, & par conféquent rien n’empêche
que des conventions particulières ne puiffent
changer la loi civile, dès que la loi naturelle & la
religion ne déterminent rien au contraire.
Nous ne nions pas que dans une fociété compo-
fée de deux perfonnes, il ne faille néceflairement
que la. loi délibérative de l’une ou de. l’autre l’em-
Tomc VI»
F E M 471
porte ; & puilque ordihairement les hommes font
plus capables que 1 es femmes de bieri gouverner les
affaires particulières, il eft très-judicieux d’établir
pour réglé générale, que la voix de l’homme l’em*-
portera tant que les parties n’auront point fait en-
lemble d’accord contraire, parce que la loi générale
découle de l’inftitution humaine, oc non pas du droit
naturel. De cette maniéré, une femme qui fait quel
eft le précepte de la loi civile , & qui a contrarié
fon mariage purement & Amplement, s’eft par-là
foûmife tacitement à cette loi civile.
Mais fi quelque femme , perfuadée qu’elle a plus
de jugement & de conduite, ou fachant qu’elle eft
d’une fortune ou d’une condition plus relevée que
celle de l’homme qui fe préfente pour fon époux,
ftipule le contraire de ce que porte la loi, & cela
du confentement de cet époux, ne doit - elle pas
avoir, en vertu de la loi naturelle, le même pouvoir
qu’a le mari en vertu de là loi du prince ? Le
cas d’une reine qui, étant fouveraine de fon chef,
époufe un prince au-deffous de fon rang, ou, fi l ’on
veu t, un de fes fujets, fuffit pour montrer que l’autorité
d’une femme fur fon mari, en matière même
de chofes qui concernent le gouvernement de la famille,
n’a rien d’incompatible avec la nature de la
fociété conjugale.
En effet on a vû chez les nations les plus civili—
fées, des mariages qui foûmettent le mari à l’empire
de la femme ; on a vû une princéffe, héritière d’un
royaume, conferver elle feule, en fe mariant, la
puiffance fouveraine dans l’état. Perfonne n’ignore
les conventions de mariage qui fe firent entre Philippe
II. & Marie reine d’Angleterre ; celles de Ma^
rie reine d’Ecoffe, & celles de Ferdinand & d’Ifa-
belle, pour gouverner en commun le royaume de
Caftille. Le letteiir en peut lire les détails dans M.
deThou , liv. X I I I . ann. i553 , / i i f liv. X X . an.
i558. Mariana, hijl. d'Efpagney liv. X X IV . ch.v*
Guicciardin, liv. VI. pag. 3 46. Et pour citer quelque
chofe de plus for t, nous le renvoyons à la cu-
rieufe differtation de Palthénius, de Marito Regina,
imprimée à Gripfwald en 1707, in-40.
L’exemple de l ’Angleterre & de la Mofcovie fait
bien voir que les femmes peuvent reuffir egalement,
& dans le gouvernement modéré, & dans le gouvernement
defpotique ; & s’il, n’eft pas contre la raifon
& contre la nature .qu’elles régiffent un empire, il
femble qu’il n’eft pas plus contradictoire qu’elles
foient maîtreffes dans une famille.
Lorfque le mariage des Lacédémoniens étoit prêt
à fe confommer, la femme prenoit l’habit d’un homme;
& c’étoit-là le fymbole du pouvoir égal qu’elle
alloit partager avec fon mari. On fait à ce fujet ce
que dit Gorgone, femme de Léonidas roi de Sparte, à
unie femme étrangère qui étoit fort furprife de cette
égalité : Ignoreç - vous, répondit la reine, que nous,
mettons des hommes au monde} Autrefois même en
Egypte, les contrats de mariage entre particuliers,
aufli-bien que ceux du roi & de la reine, donnoient
à la femme l’autorité fur le mari. Diodore de Sicile ,.
liv. I. ch. xxvij.
Rien n’empêche au moins (car il ne s’agit pas ici
de fe prévaloir d’exemples, uniques & qui prouvent
trop) ; rien n’empêche, dis-je, que l’autorité d’une
femme dans le mariage ne puiffe avoir lieu en vertu
des conventions, entre des perfonnes d’une condition
égale, à moins que le légiflateur^ne defende toute
exception à la l o i , malgré le libre confentement
des parties.
Le mariage eft de fa nature un contrat; & par conféquent
dans tout ce qui n’eft point défendu par
là loi naturelle, les engagemens contractés ernre le
mari & la femme en déterminent les droits récipro^
ques* . ;. . . . . - ....
O 0 o ij