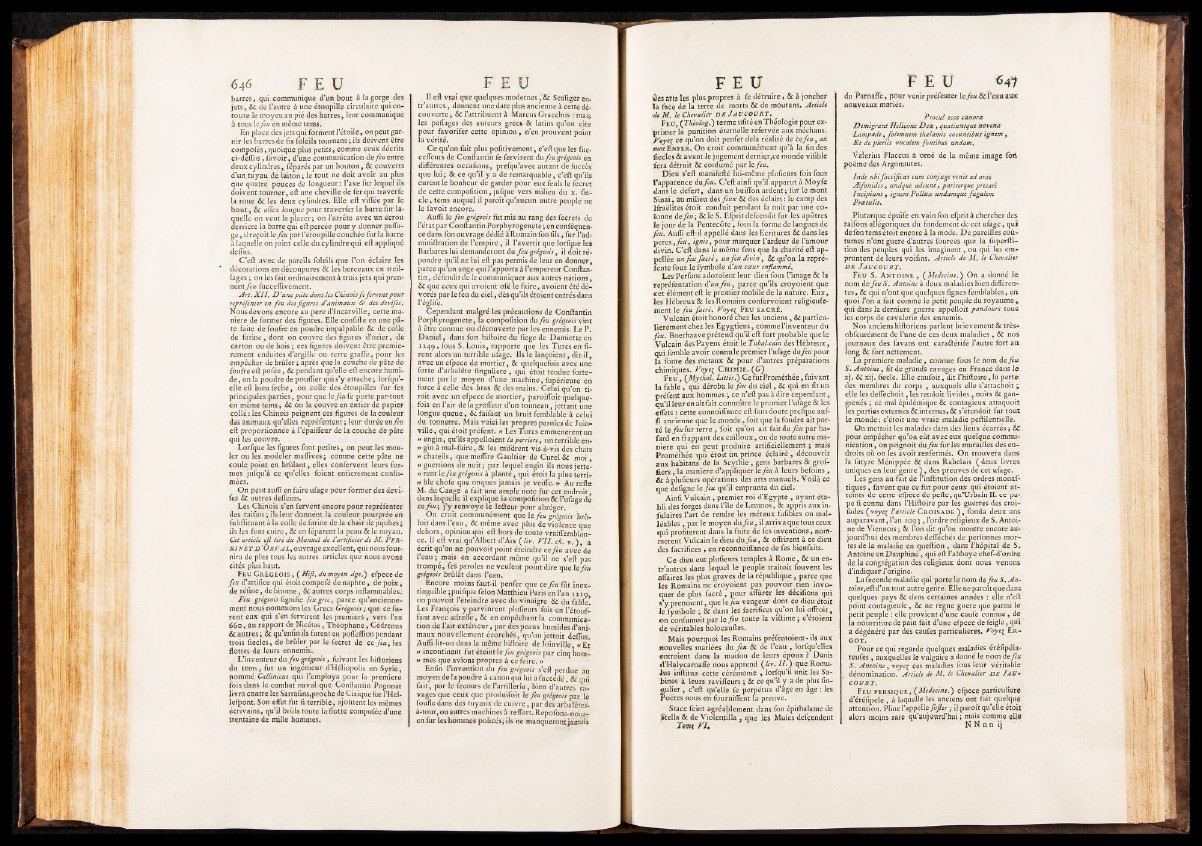
barres , qui communique d’un bout à la gorge des
jets, 8c de l’autre à une étoupille circulaire qui entoure
le moyeu au pié des barres, leur communique
à tous le feu ên même tems.
En place des jets qui forment l’étoile, on peut garnir
les barres de fix foleils tournans ; ils doivent être
compofés, quoique plus petits, comme ceux décrits
ci-deffns , fa vo ir , d’une communication de feu entre
deux cylindres , féparés par un bouton, 8c couverts
d’un tuyau de laiton ; le tout ne doit avoir au plus
que quatre pouces de longueur: l’axe fur lequel ils
doivent tourner, eft une cheville de fer qui traverfe
la roue 8c les deux cylindres. Elle eft viflee par le
bout, 8c affez longue pour traverfer la barre fur laquelle
on veut la placer; on l’arrête avec un écrou
derrière la barre qui eft percée pour y donner pairag
e, il reçoit le feu parl’étoupille couchée fur la barre
à laquelle on joint celle du cylindre qui eft appliqué
defliis,
C ’eft avec de pareils foleils que l’on éclaire les
décorations en découpures 8c les berceaux en treillages
; on les fait ordinairement à trois jets qui prennent
feu fueceiîivement.
Art. X I I . D'une pâte dont les Chinoisfe fervent pour
repréfenter en feu des figures d'animaux & des devifes.
Nous devons encore au pere d’incarville, cette maniéré
de former des figures. Elle confifte en une pâte
faite de foufre en poudre impalpable 8c de colle
de farine, dont on couvre des figures d’ozier, de
carton ou de bois ; ces figures doivent être premièrement
enduites d’argille ou terre graille, pour les
empêcher de brûler ; après que la couche de pâte de
foufre eft pofée, 8c pendant qu’elle eft encore humide
, on la poudre de pouflier qui s’y attache ; lorfqu’-
elle eft bien feche, on colle des étoupilles fur fes
principales parties, pour que le feule porte, par-tout
en même tems, 8c on la couvre en entier de papier.
collé : les Chinois peignent ces figures de la couleur
des animaux qu’elles repréfentent ; leur durée en feu
eft proportionnée à l’épaifleur de la couche de pâte
qui les couvre.
Lorfque les figures font petites, on peut les mouler
ou les modeler maflives; comme cette pâte ne
coule point en brûlant, elles confervent leurs formes
jufqu’à ce qu’elles foient entièrement confu-
mées.
On peut àulîi en faire ufage pour former des devî-
fes 8c autres .deffeins.
Les Chinois s’en fervent encore pour repréfenter
des raifins ; ils leur donnent la couleur pourprée en
fubftituant à la colle de farine de la chair de jujubes ;
ils les font cuire, 8c en féparent la peau & le noyau.
Cet article efi tiré du Manuel de l'artificier de M. Per •
r in e t d 'Or v a l , ouvrage excellent, qui nousfour-
nira de plus tous les autres articles que nous avons
cités plus haut.
F e u G r é g e o i s , Ç^Hifi. du moyen âge.') efpecede
feu d’artifice qui étoit compofé de naphte, de p oix,
de réfine, de bitume, 8c autres corps inflammables.'
Feu grégeois lignifie feu grec, parce qu’ancienne-
ment nous nommions les Grecs Grégeois ; que c e furent
eux qui s’en fervirerit les premiers , vers Fan
660, au rapport de Nicétas, Théophane, Gédrenus
& autres ; 8c qu’enfinils furent en pofleflion pendant
trois fiecles, de brûler par le fecret de ce feu9 les
flottes de leurs ennemis.
L’inventeur du feu grégeois, fuivant les hiftoriens
du tems, fut un ingénieur d’Héliopolis en Syrie,
nommé Callinicus qui l’employa pour la.première
fois dans le combat naval que Çonftantin Pogonat
livra contre les Sarrafins,proche de Ciziquefur l’Hel-
lefpont. Son effet fut fi terrible, ajoutent les mêmes
écrivains, qu’il brûla toute la flotte compofée d’une
trentaine de mille hommes.
Il eft vrai que quelques modernes,’8c Scaliger en-
tr’autres, donnent une date plus ancienne à cette découverte
, 8c l’attribuent à Marcus Gracchus : mais
les paffages des auteurs grecs & latins qu’on cite
pour favorifer cette opinion, n’en prouvent point
la vérité.
Ce qu’on fait plus pofitivement, c’eft que les fuc-
ceffeurs de Çonftantin fe fervirent du feu grégeois en
différentes occafions, prefqu’avec autant de fuccès
que lui; 8c ce qu’il y a de remarquable, c’eft qu’ils
eurent le bonheur de garder pour eux feuls le fecret
de cette compofition, jufque vers milieu du x. fie-
ele, tems auquel il paroît qu’aucun autre peuple ne
le favoit encore.
Aufli le feu grégeois fut mis au rang des fecrets de
l’état par Çonftantin Porphyrogenete ; en conféquen-
ce dans fon ouvrage dédié à Romain fon fils, fur l’ad-
miniftration de l’empire, il l’avertit que lorfque les
Barbares lui demanderont du feu grégeois, il doit répondre
qu’il ne lui eft pas permis de leur en donner,
parce qu’un ange qui l’apporta à l’empereur Conftan-
tin, défendit de le communiquer aux autres nations ,
8c que ceux qui avoient ofé le faire, a voient été dévorés
par le feu du ciel, dès qu’ils étoient entrés dans
l’églife.
Cependant malgré les précautions de Çonftantin
Porphyrogenete, la compofition du feu grégeois vint
à être connue ou découverte par les ennemis. Le P.
Daniel, dans fon hiftoire du fiege de Damiette en
1249 , fous S. Louis, rapporte que les Turcs en firent
alors, tin terrible ufage. Ils le lançoient, dit-il,
avec un efpece de mortier, 8c quelquefois avec une
forte d’arbalète finguUere , qui étoit tendue fortement
par le moyen d’une machine, fupérieure en
force à celle dés bras 8c des mains. Celui qu’on ti-
roit avec un efpece de mortier, paroiflbit quelquefois
en l’air de la groffeur d’un tonneau, jettant une
longue queue, 8c faifànt un bruit femblable à celui
du tonnerre. Mais voici lès propres paroles de Joinv
ille , qui étoit préfent. » Les Turcs emmenerentun
» engin, qu’ils appelaient la perriere, un terrible en-
» gin à mal-faire, 8c les mifdrent vis-à-vis des chats
» chateils, que mefiire Gaultier de Curel 8c m o i,
» guettions dé nuit ; par lequel engin ils nous jette-
» rent le feu grégeois à plante, qui étoit la plus terri-
h ble chofe que onques jamais je veiffe. » Au refte
M. du Gange a fait une ample note fur cet endroit,
dans laquelle i l explique la compofition 8c l’ufage de
ce feu i j’y renvoyé le leéfeur pour abréger.
On croit communément que le feu grégeois- bru-
loit dans l’eaii, 8c même avec plus de violence que
dehors, opinion qui eft hors de toute vraiffemblan-
ce. Il eft vrai qu’Albert d’Aix ( liv. F i l . ch, r. ) , a
écrit qu’on ne pouvoit point éteindre ce feu avec de
l’eau ; mais en accordant même qu’il ne s’eft pas
trompé, fes paroles ne veulent point dire que le feu
grégeois brûlât dans l’eau.
Encore - moins faut-il penfer que ce feu fût inextinguible
;puifque félon Matthieu Paris en Fan 1219,
on pouvoit l’éteindre avec du vinaigre 8c du fable!
Les François y parvinrent plufîeurs fois en l’étouffant
avec adrefle, 8c en empêchant la communication
de l’air extérieur, par des peaux humides d’animaux
nouvellement écorchés, qu’on jettoit deffus.
Aufli lit-on dans la même hiftoire de Joinville « Et
» incontinent fut éteint le feu grégeois par cinq hom-
» mes que avions propres à ce faire. »
Enfin l’invention du feu grégeois s’eft perdue ait
moyen de la poudre à canon qui lui a fuccedé, 8c qui
fait , par le fecours de l’artillerie, bien d’autres rar
vages que ceux que produifoit le feu grégeois p a rlé
foufledans des tuyaux de cuivre, par des arbalêteS-
à-tour, ou autres machines à refforr. Repofons-nous-
enfur les hommes policés; ils ne manqueront jamais
fàés aïts les plus propres à fe détruire, & 4 joncher
ïa face de la terre de morts 8c de môurans. Article
■ de M . le Chevalier D E J A U COU R T .
Féû, ( Théolog.) terme ufitë en Théologie pôur ex>-
primer la punition éternelle refervée aux méçhans.
Voye^ ce qu’on doit penfer delà réalité de te feü , au
mot Enfer» On croit communément qti’à la fin des
fiecles 8c avant le jugement dernier,ce mondé vifible ’
fera détruit 8c Confumé par le feu.
Dieü s’eft manifefté lui-même plufieùrs fois fous \
l ’apparence du feu. C ’eft ainfi qu’il apparut à Moyfe :
dans le defert, dans un buiffon ardent ; fut lé mont
Sinaï, âu milieu des feux 8c des éclairs : le camp des
Ifraëlites étoit conduit pendant la nuit par une colonne
de feu-, 8cle S. Efprit defeendit fur les apôtres
le jour de la Pentecôte, fous la forme de langues de
feu. Aufli eft-il appelle dans les Ecritures 8c dans les
j>eres,feu, ignis, pour marquer l’ardeur de l’amour
divin. C ’éft dans le même fens que la charité eft ap-
peilée un feu facré, un feu divin, 8c qu’on la repréfente
fous le fymbole d'un coeur enflammé.
Les Perfa'ns adoroient leur dieu fous l’image 8c la
repréfentation d'un feu , parce qu’ils croyoient que
cet élément eft le premier mobile de la nature. Eux,
les Hébreux & les Romains confervoient religieufe-
inertt le feu facré. Voye[ Feu SACRÉ.
Vulcain étoit honoré chez les anciens, 8c particulièrement
chez les Egygtiens, comme l’inventeur du
feu. Boerhaave prétend qu’il eft fort probable que le
Vulcain des Payens étoit le Tubal-caïn des Hébreux,
qui femble avoir connu le premier l’ufage du feu pour
la forite des métaux 8c pour d’autres préparations
chimiques. Voye^ C h im ie . (G)
F e u , (Mythol. Lïttér.) Ce fut Prométhée, fuivant
la fable, qui déroba le feu du c ie l, 8c qui en fit un
préfent aux hommes ; ce n’eft pas à dire cependant,
qu’il leur en aitfait connoîtrê le premier l ’üfâge 8c les
effets : cette conuoiffance eft fans doute prefque auffi
ancienne que le monde, foit que la foudre ait porté
le feu fur terre , foit qu’on ait fait du feu par ha*-
fard en frappant des cailloux, ou de toute autre maniéré
qui en peut produire artificiellement ; mais
Prométhée qui étoit ùn prince éclairé , découvrit
aux habitans de la Scythie, gens barbares 8c greffiers
, la maniéré d’appliquer le feu à leurs befoins ,
& àplufieurs opérations des arts manuels. Voilà ce
que defigne le feu qu’il emprunta du ciel»
Ainfi Vulcain, premier roi d’Egypte , ayant établi
des forges dans l’île de Lemnos, 8c appris aux in-
fulaires l’art de rendre les métaux fufibles ou malléables
, par le moyen du feu , il arriva que tous ceux
qui profitèrent dans la fuite de fes inventions, nommèrent
Vulcain le dieu du feu , 8c offrirent à ce dieu
des facrifices, en reconnoiffance de fes bienfaits.
C e dieu eut plufieurs temples à Rome, 8c un en-
tr’autres dans lequel le peuple traitôit fouvent les
affaires les plus graves de la république, parce que
les Romains ne croyoient pas pouvoir rien invoquer
de plus facré, pour affûrer les dêcifions qui
s’y prenoient, que le feu vengeur dont ce dieu étoit
le fymbole ; 8c dans les facrifices qu’on lui offroit,
on confumoit par le feu toute la vifrime ; c’etoient
.do véritables holocauftes.
Mais pourquoi les Romains préfentoient-ils aux
nouvelles mariées du feu 8c de l’eau , Iorfqu’elles
entroient dans la maifon de leurs époux ? Denis
d’Halycarnaffe nous apprend (/iv. I I .) que Romu-
lus inftitua cette cérémonie , lorfqu’il unit les Sa-
bines à leurs raviffeurs ; 8c ce qu’il y a de plus finfulier,
c’eft qu’elle fe perpétua d’age en âge : les
oëtes nous en fourniffent la preuve.
Stace feint agréablement dans fon épithalame de
jStella 8c de Violentilla, que les Mules defeendent
T m i VI»
du Parnaffe, pour venir préfenter \e feu 8>ci ’eau aux
nouveaux mariés-.
■ Procul ecc'e cànorot
Démigrdnt Helicone De ce, quatiuntque novehà
-Lampade, folemnem thalamis coeuhtibüs ignem >'
E t de pieriis vocdlem fontibus undam,
Vaîerius Plaçais à orné de la même image foA
pôëme 'des Argonautes.
Inde ubi ficcificas cum cônjuge venit ad aras
Æfonides , unâque adeunt, pariterque precatî
-,Incipïunt, ignem Póllux undamque fugalem
Preetulit.
Plutarque épuife en Vain fon efprit à chercher des
raifons allégoriques du fondement de cet ufage, qui
de fon tems étoit encore à la mode. De pareilles coû-
tumes h’ont guère d’autres fources que la fuperfti-
tion des peuples qui lès imaginent, ou qui les empruntent
de leurs voifins. Article de M. le Chevalier
DÉ J AU COU RT.
Feu S. A n t o i n e , (Medecine.) On a donné le
nom de feu S. Antoine à deux maladies bien différentes,
8c qui n’ont que quelques lignes femblables, en
quoi l’on a fait comme le petit peuple du royaume ,
qui dans la derniere guerre appeiloit pandours tous
les corps de cavalerie des ennemis.
Nos anciens hiftoriens parlent brièvement 8c très-,
obfcurément de l’une de ces deux maladies , 8c nos
journaux des favans ont carafrérifé l’autre fort au
long 8c fort nettement.
La première maladie, connue fous le nom de feu-
S. Antoine, fit de grands ravages en France dans le.
xj. 8c xij. fiecle. Elle caufoit, dit l ’hiftoire, la perte
des membres du corps , auxquels elle s’attachoit ;
elle les deffechoit, les rendoit livides, noirs 8c gangrenés
; ce mal épidémique 8c Contagieux attaquoit
les parties externes 8c internes, 8c s’étendoit fur tout
le monde : c’étoit une vraie maladie peftilentiellè.
On mêttoit les malades dans des lieux écartés ; ÔC
pour empêcher qu’on eût avec eux quelque communication
, on peignoit du feu fur les murailles des endroits
oii on les avoit renfermés. On trouvera dans
la fatyre Ménippée 8c dans Rabelais ( deux livres
uniques en leur genre ) , des preuves de cet ufage.
Les gens au fait de Finftitution des ordres monaf*
tiques , favent que ce fut pour ceux qui étoient atteints
de cette efpece de peftè,qü*Urbain IL ce pape
fi connu dans l’Hiftoire par les guerres des croi-
fades ( voyt^ Varticle C r o i s a d e ) , fonda deux ans
auparavant, Fan 1093 , l’ordre religieux de S. Antoine
de Viennois ; 8c Fon dit cju’on montre encore au*
jourd’hui des membres deffechés de perfonnes mortes
de la maladie en queftion , dans l’hôpital de S.
Antoine en Dauphiné, qui eft l’abbaye chef-d’ordre
de la congrégation des religieux dont nous venons
d’indiquer l’origine.
La ïecôrtde maladie qui porte le hom dé feu S. A n-
roz/i«,eftd’ün tout autre genre. Elle ne paroît que dans
quelques pays 8c dans certaines années : elle n’eft
pdint contagieufe, 8c ne régné guere que parmi le
petit peuple : elle provient d’une caufe connue, dè
la nourriture de pain fait d’une efpece de feiglé, qui
a dégénéré par des caufes particulières. Poye^ E r g
o t .
Pour ce qui regarde quelques maladies éréfipéla-»
teufes , auxquelles le vulgaire a donné le nom de feu
S. Antoine, voye^ ces maladies fous leur véritable
, dénomination. Article de M. le Chevalier DE J AU*
C O U R T .
F e u p e r s i q u e , ( Medecine.) é fp e c é p a r ticu lie r^
; d’éréfipele , à laquelle les anciens ont fait quelque
! attention. Pline l’appelle fofier ; il paroît qu’elle étoit
alors moins rare qu’aujourd’hui 3 mais comme elle
N N n n ij