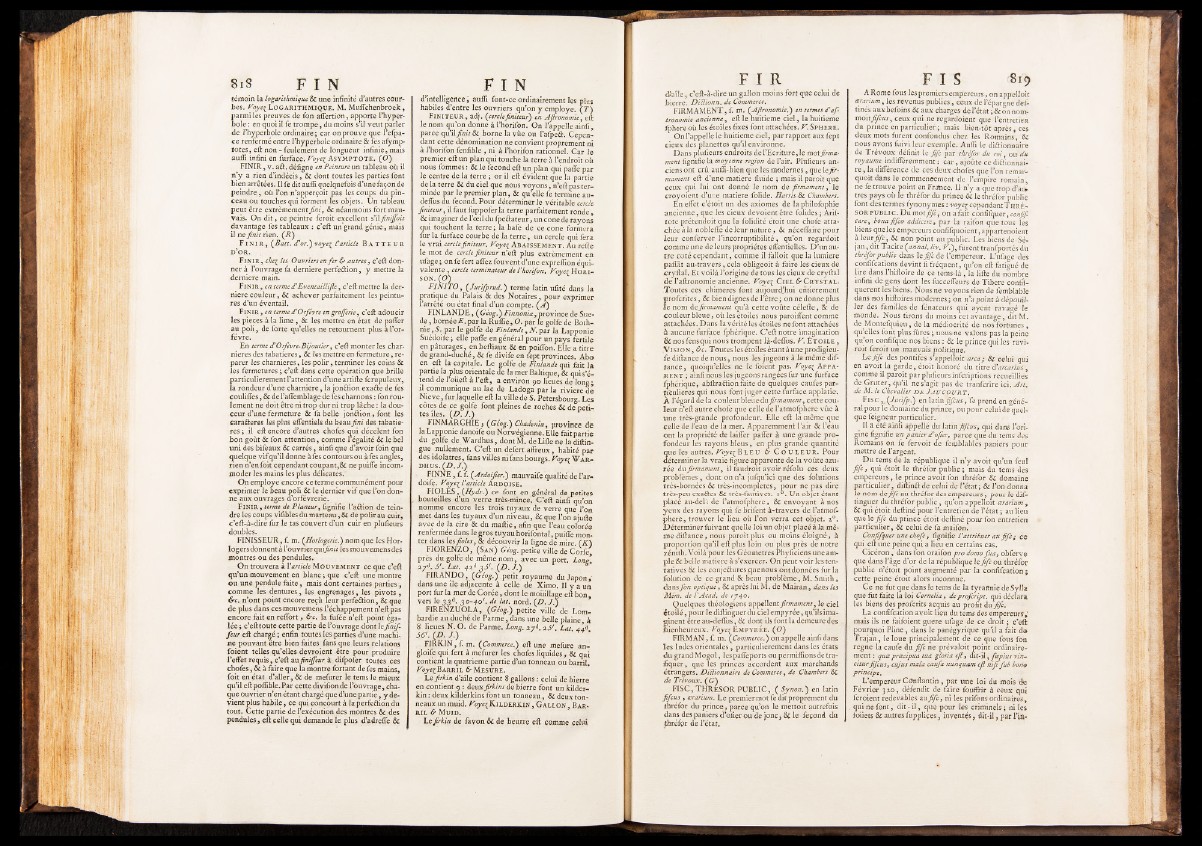
témoin la logarithmique & une infinité d’autres courbes.
Voye^ L o g a r ithm iq u e . M. Muffchenbroek,
parmi les preuves de fon affertidn, apporte l’hyperbole
: en quoi il fe trompe, du moins s’il veut parler
de l’hyperbole ordinaire; car on prouve que l’efpa-
ce renfermé entre l’hyperbole ordinaire & fes afymp-
îotes, eft non - feulement de longueur infinie, mais
aufii infini en furface. Voye^ As ym p t o t e . (O )
FINIR, v. ad. défigne en Peinture un tableau où il
n’y a rien d’indécis, & dont toutes les parties font
bien arrêtées. Il fe dit aufii quelquefois d’une façon de
peindre, où l’on n’apperçoit pas les coups du pinceau
ou touches qui Forment les objets. Un tableau
peut être extrêmement f in i, & néanmoins fort mauvais.
On dit, ce peintre feroit excellent s’ilfiniffoit
davantage fes tableaux : c’eft un grand génie, mais
il ne finit rien, (f?)
F i n i r , ( S a it . d'or.') voyei l'article B a t t e u r
d’o r .
Fin ir , cher les Ouvriers en fer & autres , c’eft donner
à l’ouvrage fa derniere perfection, y mettre la
derniere main.
Fin ir , en terme d'Eventaillifie, c’eft mettre la der*
niere couleur, & achever parfaitement les peintures
d’un éventail.
Finir , en terme d Orfèvre en grojferie, c’eft adoucir
les pièces à la lime, & les mettre en état de palier
au poli, de forte qu’elles ne retournent plus à l’or-
févre.
En terme d Orfèvre-Bijoutier, c’eft monter les charnières
des tabatières , & les mettre en fermeture, reparer
les charnières, les polir, terminer les coins &
les fermetures ; c’eft dans cette opération que brille
particulièrement l’attention d’une artifte fcrupuleux,
la rondeur d’une charnière, la jonâion exafte de fes
couliffes, & de l’affemblage de fes charnons : fon roulement
ne doit être ni trop dur ni trop lâche : la douceur
d’une fermeture & fa belle jon&ion, font les
carafteres les plus effentiels du beau fin i des tabatières
; il eft encore d’autres chofes qui décelent fon
bon goût & fon attention, comme l’égalité & le bel
uni des bifeaux & carrés, ainfi que d’avoir foin que
quelque vif qu’il donne à fes contours ou à fes angles,
rien n’enfoit cependant coupant,& ne puiffe incommoder
les mains les plus délicates.'
On employé encore ce terme communément pour
exprimer le beau poli & le dernier vif que l’on donne
aux ouvrages d’orfèvrerie.
Finir , terme de Planeur, lignifie l’a&ion de teindre
les coups vifibles du marteau, & de polir au cuir,
c ’eft-à-dire fur le tas couvert d’im cuir en plufieurs
doubles.
FINISSEUR , f. m. (Horlogerie.) nom que les Horlogers
donnent à l’ouvrier quifinit les mouvemens des
montres ou des pendules.
On trouvera à P article Mouvement ce que c’eft
qu’un mouvement en blanc ; que c’eft une montre
ou une pendule faite, mais dont certaines parties,
comme les dentures, les engrenages, les pivots ,
& c. n’ont point encore reçu leur perfection, & que
de plus dans ces mouvemens l’échappement n’eft pas
encore fait en reflort, & c. la fufée n’eft point égalée
; c’eft toute cette partie de l’ouvrage dont le finif-
feur eft chargé ; enfin toutes les parties d’une machine
pouvant être bien faites fans que leurs relations
foient telles qu’elles devroient être pour produire
l’effet requis , c’eft au finiffeur à difpofer toutes ces
chofes, & à faire que la montre fortant de fes mains,
foit en état d’aller, & de mefurer le tems Je mieux
qu’il eftpoflible.Par cettediyifionde l’ouvrage, chaque
ouvrier n’en étant chargé que d’une partie, y devient
plus habile, ce qui concourt à la perfe&ion du
tout. Cette partie de l’exécution des montres & des
pendules, eft celle qui demande le plus d’adreffe &
d’intelligence aufii font-ce ordinairement les plus
habiles d’entre les ouvriers qu’on y employé. (T)
FlNITEUR, adj. (cerclefiniteur) en Afironomie, eft
le nom qu’on donne à l’horifon. On l’appelle ainfi
parce qu’il finit & borne la vûe ou I’afpeCh Cependant
cette dénomination ne convient proprement ni
à l’horifon fenfible , ni à l’horifon rationnel. Car le
premier eft un plan qui touche la terre à l’endroit où
nous fommes: & le fécond eft un plan qui paffe par
le centre de la terre ; or il eft évident que la partie
de la terre & du ciel que nous voyons, n’eft pas terminée
par le premier plan, & qu’elle fe termine au-
deffus du fécond. Pour déterminer le véritable cercle
finiteur, il faut fuppoferla terre parfaitement ronde,
& imaginer de l’oeil du fpeftateur, un cône de rayons
qui touchent la terre ; la bafe de ce eone formera
lur la furface courbe de la terre, un cercle qui fera
le vrai cercle finiteur. Voye^ A b a i s s e m e n t . A u refte
le mot de cercle finiteur n’eft plus extrêmement en
ufage ; on fe fert allez fouvent d’une expreflion équivalente
, cercle terminateur de l'horifon. Voyez H o r i -
SON. (O)
F J N IT O , ( Jurifprud.) terme latin ufité dans la
pratique du Palais & des Notaires, pour exprimer
l’arrêté ou état final d’un compte. ( A )
FINLANDE, ( Géog.) F innonia, province de Suède
, bornée E . par la Ruflie, O. par le golfe de Bothnie
, S. par le golfe de Finlande, N . par la Lapponie
Suédoife ; elle paffe en général pour un pays fertile
en pâturages, en beftiaux & en poiffon. Elle a titre
de grand-duché, & fedivife en fept provinces. Abo
en eft la capitale. Le golfe de Finlande qui fait la
partie la plus orientale de la mer Baltique, & qui s’étend
de l’oiieft à l’eft, a environ 90 lieues de long;
il communique au lac de Ladoga par la riviere de
Nieve, fur laquelle eft la ville de S. Petersbourg. Les
côtes de ce gqlfe font pleines de roches & de petites
îles. (D . J .)
FINMARCHIE, (Géog.) Chadenia, province de
la Lapponie danoife ou Norvégienne. Elle fait partie
du golfe de "Wardhus, dont M. de Lifte ne la diftin-
gue nullement. C’eft un defert affreux, habité par
des idolâtres, fans villes ni fans bourgs. Voyez War-
d h u s . ( D . / . )
FINNE, f . f . (Ardoifier.) m a u v a if e q u a lité d e l ’a r -
d o i fe . Voye^l'article A r d o i s e .
FIOLES ,(H y d r .) ce font en général de petites
bouteilles d’un verre très-mince. C’eft ainfi qu’on
nomme encore les trois tuyaux de verre que l’on
met dans les tuyaux d’un niveau, & que l’on ajufte
avec de la cire & du maftic, afin que l’eau colorée
renfermée dans le gros tuyau horifontal, puiffe monter
dans les fioles, & découvrir la ligne de mire. (K \
FIORENZO, (San) Géog. petite ville de Corfe,
près du golfe de même nom, avec un port. L om .
ayd. 5 '. Lat. q z d 3 6 '. (D . J .)
FIRANDO, (Géog.) petit royaume du Japon,-
dans une île adjacente à celle de Ximo. Il y a un
port fur la mer de Corée, dont le moiiillage eft bon
vers le 3 3 d. 3 0 -40'. de lat. nord. (D . /.)
FIRENZUOLA, (Géog.) petite ville de Lombardie
au duché de Parme, dans une belle plaine à
8 lieues N. O. de Parme. Long. 27d. z S ' , Lat a l*
3? : .(L > . J .) |
FIRKIN, f. m. (Commerce.) eft une mefure an-
gloife qui fert à mefurer les chofes liquides, & qui
contient la quatrième partie d’un tonneau ou barril.
Voye^ B a r r i l & M e s u r e .
Lefirkin d’aîle contient 8 gallons : celui de bierre
en contient 9 : deux firkins de bierre font un kilder-
kin : deux kilderkins font un tonneau, & deux tonneaux
un muid. f ’oy^KiLDERKiN, G a l l o n , B a r r
i l & M u i d .
L efirkin de favon U de beurre eft comme celui
dfoîle, c’eft-à-dire un gallon moins fort que celui de
bierre. Diclionn. de Commerce.
FIRMAMENT, f. m. (Afironomie.) en termes d'df-
tronomie ancienne, eft le huitième ciel, la huitième
fphere où les étoiles fixes font attachées. V. Sphere.
On l’appelle le huitième ciel, par rapport aux fept
cieux des planettes qu’il environne.
Dans plufieurs endroits de l’Ecriture, le mot firmament
fignifie la moyenne région de l’air. Plufieurs anciens
ont crû auifi-bien que les modernes, que le firmament
eft d’une matière fluide ; mais il paroît que
ceux qui lui ont donné le nom de firmament, le
croyoient d’une matière folide. Harris & Ckumbers.
En effet c’étoit un des axiomes de la philofophie
ancienne, que les cieux dévoient être folides ; Arif-
tote prétendoit que la folidité étoit une ehofe attachée
à la nobleffe de leur nature, & néceffaire pour
leur conferver l’incorruptibilité, qu’on regardoit
comme une de leurs propriétés effentielles. D’un autre
coté cependant, comme il falloit que la lumière
paflat au-travers, cela obligeoit à faire les cieux de
cryftal. Et voilà l’origine de tous les cieux de cryftal
de l’aftronomie ancienne. Voye{ Ciel 6*Crystal.
Toutes ces chimères font aujourd’hui entièrement
profcrites, & bien dignes de l’être ; on ne donne plus
le nom de firmament qu’à cette voûte célefte, & de
couleur bleue, où les étoiles nous paroiffent comme
attachées. Dans la vérité les étoiles ne font attachées
à aucune furface fphérique. C’eft notre imagination
& nosfensqui nous trompent là-deffus. V . Étoile ,
.Vision, & c. Tôutes les étoiles étant à une prodigieu-
fe diftance de nous, nous les jugeons à la même dif-
îance, quoiqu’elles ne le foient pas. V y e^ Apparent
; ainfi nous les jugeons rangées fur une.furface
fphérique, abftradtion faite de quelques caufes particulières
qui nous font juger cette furface, applatie.
A l’égard de la couleur bleue du firmament, cette couleur
n’eft autre chofe que celle de l’atmofphere vûe à
line très-grande profondeur. Elle eft la même que
celle de Peau de la mer. Apparemment l ’air & l’eau
ont la propriété de laiffer paffer à une grande profondeur
les rayons bleus, en plus grande quantité
que les autres. Voye^ Bl eu <£ C o u l e u r . Pour
déterminer la vraie figure apparente de la voûte azurée
du firmament, il faudroit avoir réfolu ces deux
problèmes , dont on n’a jufqu’ici que des folutions
très-bornées & très-incompletes, pour ne pas dire
très-peu exaftes & très-fautives. i c. Un objet étant
placé au-de 1A de l’atmofphere, & envoyant à nos
yeux des rayons qui fe brifent à-travers de l’atmofphere,
trouver le lieu où l’on verra cet objet. z°.
Déterminer fuivant quelle loi un objet placé à la même
diftance, nous paroît plus ou moins éloigné, à
proportion qu’il eft plus loin ou plus près de notre
7.énith. Voilà pour les Géomètres Phyficiens une ample
& belle matière à s’exercer. On peut voir les tentatives
& les conje&ures quenous ont données fur la
folution de ce grand & beau problème, M. Smith,
dans fo n optique, & après lui M. de Mairan, dans les
'Mém. de L’Acad, de 1740.
Quelques théologiens appellent firmament, le ciel
étoilé, pour le diftinguer du ciel empyrée, qu’ils imaginent
être au-deffus, & dont ils font la demeure des .
bienheureux. Voye^ E m p y r Ée . ( O )
FIRMAN, f. m. ( Commerce.) on appelle ainfi dans
les Indes orientales , particulièrement dans les états
du grand Mogol, les paffeports ou permiflions de trafiquer,
que les princes accordent aux marchands
étrangers. Dictionnaire de Commerce, de Chambers &
de Trévoux. (G )
FISC, THReSOR PUBLIC, ( Synon. ) en latin
fifcu s , arariuni. Le premier mot fe dit proprement du
îhrefor du prince, parce qu’on le mettoit autrefois
dans des paniers d’ofier ou de jonc, ÔC le fécond du
thréfpr de l’état,
A Rome fous les premiers empereurs, on appelloit
a rarium , les revenus publics, ceux de l’épargne del-
tinés auxbefoins & aux charges de l’état ; &on nom-
moitfifc u s , ceux qui ne regardoient que l’entretien
du prince en particulier.; mais bien-tôt après, ces
deux mots furent confondus chez les Romains , &
nous avons fuivi leur exemple. Aufii le di&ionnaire
de Trévoux définit le fifc par ihréfor du ro i, ou du
royaume indifféremment : car, ajoûte ce diaionnai-
re, la différence de ces deux chofes que l’on remar-
quoit dans le commencement de l’empire romain-
ne fe trouve point en France. Il n’y a que trop d’aiv
très pays où le thréfor du prince & le thréfor public
font des termes fynonymes : voye^ cependant T hré-
SOR p u b l i c . Du m o t fifc , on a fait confifquer, confifi
care, bon afifco addicere, par la raifon que tous les
biens queles empereurs confîfquoient, appartenoient
à leurre, & non point au public. Les biens de-Sé-
jan, dit Tacite (a n n a l, liv . V ,)} furent tranfportés du
thréfor p ub lic dans le fifc de l’empereur. L’ufage des
confifcations devint fi fréquent, qu’on eft fatigué de
lire dans l’hiftoire de ce tems-là, la lifte du nombre
infini de gens dont les fucceffeurs de Tibere confisquèrent
les biens. Nous ne voyons rien de femblable
dans nos hiftoires modernes; on n’a point à dépouiller
des familles de fénateurs qui ayerit ravagé le
monde. Nous tirons du moins cet avantage, dit M.
de Montefquieu, de la médiocrité de nos fortunes ,
qu’elles font plus fûres ; nous-ne valons pas la peine
qu’on confifque nos biens : & le prince qui les ravi-
roit feroit un mauvais politique.
Lo fifc des pontifes s’appelloit area; & celui qui
en avoit la garde, étoit honoré du titre d'arcarius,
comme il paroît par plufieurs inferiptions recueillies
de Gruter, qu’il ne s’agit pas de tranferire ici. A r t.
de M . le Chevalier d u J A U C OU RT.
F ï s c . (Jurifp.) en latin fifc u s , ïe prend en général
pour le domaine du prince, ou pour celui de quelque
feigneur particulier.
Il a été ainfi appellé du latin fifcu s, qui dans l’origine
fignifie u n p an ier d'ojier, parce que du tems des
Romains on fe fervoit de fenablables paniers pour
mettre de l’argent.
Du tems de la république il n’y avoit qu’un feul
fifc , qui étoit le thréfor public ; mais du tems des
empereurs, le prince avoit fon thréfor & domaine
particulier, diftinél de celui de l’état ; & l’on donna
le nom de fifc au thréfor des empereurs, pour le diftinguer
du thréfor public, qu’on appelloit ararium ,
& qui étoit deftiné pour l’entretien de l’état ; au lieu
que le fifc. du prince étoit deftiné pour fon entretien
particulier, & celui de fa maifon.
Confifquer une chofe , fignifie 1'attribuer au fifc ; ce
qui eft une peine qui a lieu en certains cas.
Cicéron, dans fon oraifon pro domo fu a , obferve
que dans l’âge d’or de la république le fifc ou thréfor
public n’étoit point augmenté par la confifcation;
cette peine étoit alors inconnue.
Ce ne fut que dans le tems de la tyraftnie deSylfa
que fut faite la loi Cornelia, depro feript. qui déclara
les biens des proferits acquis au profit du fifc.
La confifcation avoit lieu du tems des empereurs,’
mais ils ne faifoient guere ufage d e c e droit ; c’eft
pourquoi Pline, dans le panégyrique qu’il a fait d®
Trajan, le loue principalement de ce que fous fon
régné la caufe du fifc ne prévaloir point ordinairement
: quoi prceçipua tua gloria e fi, dit-il, feepius v in -
citu rfifcus, cujus m ala caufa nunquam efi n ifi fu b botio
principe.
L’empereur Cdnftantin, par une loi du mois de
Février 32.0, défendit de faire fouflrir à ceux qui
feroient redevables au fifc , ni les prifons ordinaires,
qui ne font, dit - i l , que pour les criminels ; ni les
fouets & autres fupplices , inventés, dit-il, par l’in