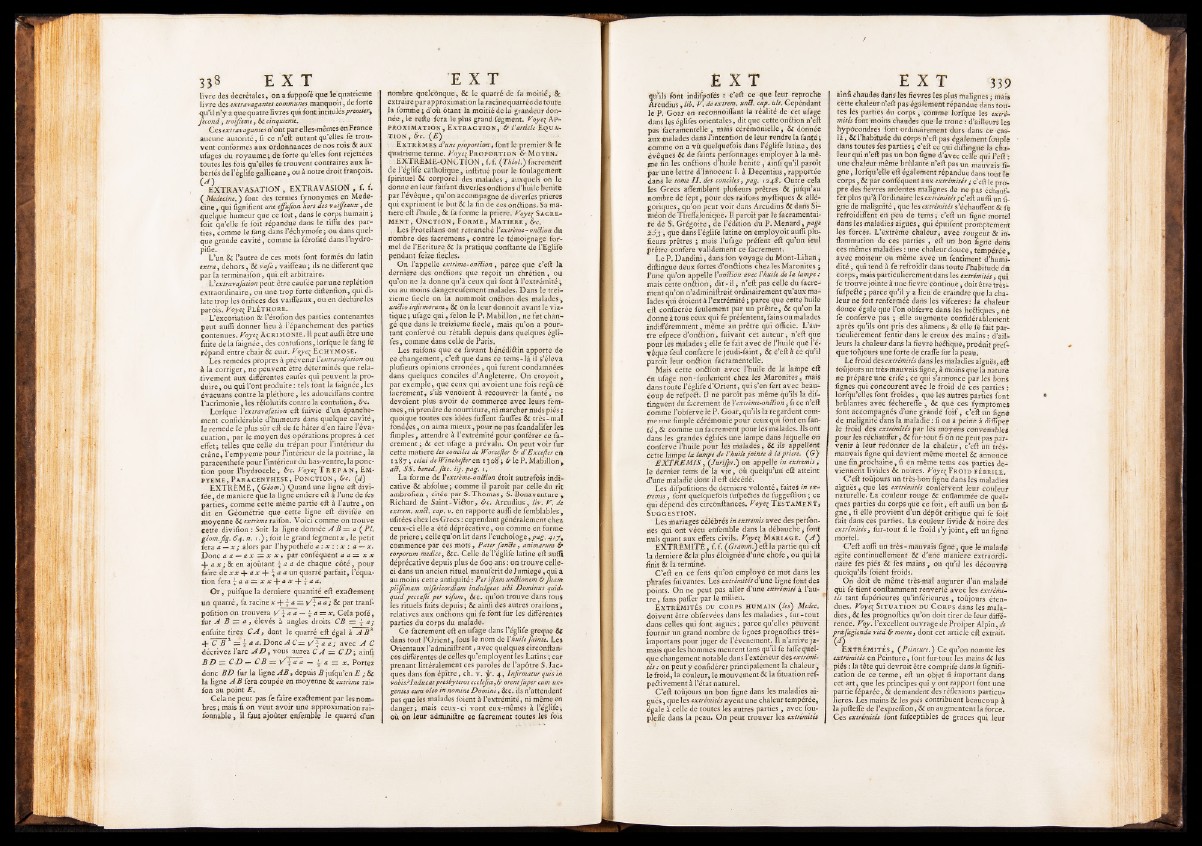
livre des décrétales, on a fuppofé que le quatrième
livre des extravagantes communes manquoit, de forte
qu’il n’y a que quatre livres qui font intitulés premierf
fécond, , trotjieme , & cinquième.
Ces extravagantes n’ont par elles-mêmes enFrance
aucune autorité, fi ce n’eft autant qu’ellesfe trouvent
conformes aux ordonnances de nos rois & aux
ufages du royaume ; de forte qu’elles font rejettées
toutes les fois qu’elles fe trouvent contraires aux libertés
de l’églile gallicane, ou à notre droit françois.
(A )
EXTRAVASATION , EXTRAVASION , f. f.
{Médecine.) font des termes fynonymes en Médecine
, qui lignifient une effujion hors des vaijfeaux, de
quelque humeur que ce io it, dans le corps humain ;
foit qu’elle fe foit répandue dans le tiflu des parties,
comme le fang dans l’échymofe ; ou dans quelque
grande cavité, comme la férofité dans l’hydro-
pifie.
L’un & l’autre de ces mots font formés du latin
extra, dehors, & vafa -, vaiffeau ; ils ne different que
par la terminaifon, qui eft arbitraire;
Vextravafation peut être caufée par une replétion
extraordinaire, ou une trop forte diftenfion, qui dilate
trop les orifices des vaiffeaux, ou en déchire les
parois. Voye{ PLÉTHORE.
L’excoriation & l’érofion des parties contenantes
peut aufli donner lieu à l’épanchement des^ parties
contenues. Voye^ A c r im o n ie . Il peut aufli être une
fuite de la faignée, des contufions, lorfque le fang fe
répand entre chair & cuir. Voye^ E c h y m o s e .
Lés remedes propres à prévenir Vextravafation ou
à la corriger, ne peuvent être déterminés que relativement
aux différentes caufes qui peuvent la produire
, ou qui l’ont produite : tels font la faignée, les
évacuans contre la pléthore, les adoucilfans contre
l ’acrimonie, les résolutifs contre la contufion, &c.
Lorfque Vextravafation eft fuivie d’un épanchement
confidérabie d’humeurs dans quelque cavité,
le remede le plus sûr eft de fe hâter d’en faire l’évacuation,
par le moyen des opérations propres à cet
effet; telles que celle du trépan pour l’intérieur du
crâne, l’empyeme pour l’intérieur de la poitrine, la
paracenthefê pour l’intérieur du bas-ventre, la ponction
pour l’hydroeele, &c. Voyt{ T r é p a n , Em -
p y e m e , P a r a c e n t h e s e , P o n c t io n , &c. {d)
EXTRÊME, {Géom.) Quand une ligne eft divi-
fée, de maniéré que la ligne entière eft à l’une de fes
parties, comme cette même partie eft à l’autre,on
dit en Géométrie que cette ligne eft divifée en
moyenne &c extrême raifon. Voici comme on trouve
cette divifion : Soit la ligne donnée A B — a (P/.
géom.fig. G4. n. 1.) ; foit le grand fegmentar, le petit
fera a — x ; alors par l’hypothèfe a : x : : x : a — x.
Donc a a — a x = x x , par conféquent a a — x x
4- a x ; & en ajoutant ^ a a de chaque cô té , pour
faire de x x + a x - f - ^ <z <2 un quarré parfait, l’équation
fera j a a — x x + a x + ^a a.
O r , puifque la derniere quantité eft exactement
un quarré, fa racine x-\-\ a — a a; & par tranfpofition
on trouvera V \ a a — ±a — x . Cela pofé,
fur A B =. a , élevés à angles droits CB 3=}VŸ a;
enfuite tirez C A , dont le quarré eft égal à A B X
-J- C B * — 1 a a. Donc A C=z / j a a ; avec A C
décrivez l’arc A D , vous aurez C A = C D \ ainfi
B D — C D — C B — V \ a a — x a = x , Portez
donc B D fur la ligne A B , depuis B jufqu’en E ; &
la ligne A B fera coupée en moyenne & extrême raifon
au point E.
Cela ne peut pas fe faire exactement par les nombres
; mais fi on veut avoir une approximation raisonnable
, il faut ajouter enfemble le quarré d’un
nombre quelconque, & le quarré de fa moitié, 8c
extraire par approximation la racine quarrée de toute
fomrtie ; d’où ôtant la moitié delà grandeur donnée
, le refte fera le plus grand fëgment. Voyt{ A pp
r o x im a t io n , Ex t r a c t i o n , & l'article ÉQUATION.,
&c. {£ )
E x t r ÙM es d'une proportion font le premier & le
quatrième terme. V.oye^ Pr o p o r t io n & M o y e n .
EXTRÊME-ONCTION, ù i (Théo/.) facrement
de l ’églife catholique, inftitué pour le foulagérfterft
fpirituel &: corporel des malades, auxquels on le
donne en leur faifant diverfes codions d’huile benitfe
par l’évêque , qu’on accompagne dé diverfes prières
qui expriment le but & la fin de ces onCtions. Sa matière
eft l’huile, & fa-forme la priere. Voyc[ Sa c r e m
e n t , O n c t i o n , F o r m e , Ma t i è r e , &c.
,. Les Proteftans ont retranché Vextrême - onction dtt
nombre des facremens, contre le témoignage formel
de l’Ecriture>& la pratique confiante de l’Eglife
pendant feize liecles.
On l’appelle extrême-onction, parce que c’eft là
derniere des onClions que reçoit un chrétien, ou
qu’on ne la donne qu’à ceux qui font à l’extrémité ;
ou au moins dangereufementmalades. Dans lé treizième
fiecle on la nommoit ortCfion des malades,
undio infirmorum , & on la leur donnoit avant le viatique
; ufage qui, félon le P. Mabillon, ne fut changé
que dans le treizième fiecle, mais qu’on a pourtant
confervé ou rétabli depuis dans quelques églt-
fes, comme dans celle de Paris.
Les raifons que ce favant bénédiCUn apporte de
ce changement, c’eft que dans ce tems-là il s’éleva
plufieurs opinions erronées, qui furent condamnées
dans quelques conciles d’Angleterre. On croyoit,
par exemple, que ceux qui avoient une fois reçu eè
facrement * s’ils venoient à recouvrer la fanté, ne
dévoient plus avoir de commerce avec leurs fen*-
mes, ni prendre de nourriture, ni marcher nuds pies :
quoique toutes ces idées fulfent faillies &C très- mal
fondées, on aima mieux, pour ne pas fcandalifer les
fimples, attendre à L’extrémité pour conférer ce facrement
; & cet ufage a prévalu. On peut voir fur
cette matière les conciles de Worcejler & d'ExceJier en
1187 ; celui de Winchefier en 1308 ; & le P. Mabillon-,
acl. SS. bened. fac. iij. pag. 1.
La forme de Vcxtrême-ondion étoit autrefois indicative
& abfolue ; comme il paroît par celle du rit
ambrofien , citée par S. Thomas, S. Bonaventure ,
Richard de Saint -V iô o r , &c. Arcudius, liv. V. de
extrem. unct. cap. y. en rapporte aufli de femblables ,
ufitées chez les Grecs : cependant généralement chez
ceux-ci elle a été déprécative, ou comme en forme
de priere ; celle qu’on lit dans l’eucholpge, pag. 41
commence par ces mots, Pater fancle, animarum St
corporum medice, &c. Celle de‘l’églife latine eft aufli
déprécative depuis plus de 600 ans : on trouve celle-
ci dans un ancien rituel maniifcrit de Jumiege, qui a
au moins cette antiquité : Per ijtam unelionem & fuarti
piijjîmam mifericordiam indulgeat tibi Dominus quid-
quid peccajli per vifum, &c. qu’on trouve dans tous
les rituels faits depuis ; & ainfi des autres oraifons,
relatives aux onftions qui fe font fur les différentes
parties du corps du malade.
Ce facrement eft en ufage dans l’églife greque &
dans tout l’Orient, fous le nom de Vhuile fainte. Les
Orientaux l’adminiftrent, avec quelques cireonftan-
ces différentes de celles qu’employent les Latins ; car
prenant littéralement ces paroles de l’apôtre S. Jacques
dans fon épître, ch. v. "ÿ. 4 , Infirmatur quis iti
vobis?Inducatpresbyteros ecclejîoe,b orentfuper eum ur,•-
gentes eum oleo in nomine Domini, &c. ils n’attendent
pas que les malades foient à l’extrémité, ni même ert
danger; mais ceux-ci vont eux-mêmes à l’églife;
où on leur adminiftre ce facrement toutes les fois
qu’ils font indifpdfés : c’eft ce qué leitt reproche
Arcudius, lib. V. dé extrem. uhU. cap. ult. Cepéndant
le P. Goar ên reèbfliibiflant la réalité de eet ufage
dans les églifes orientales, dit que cette on&ioft n’eft
pas fàcramentelle , mais cérémonielle, & donnée
aux malades danS l’inténtion de leur fendre la fanté;
cbmriie ôn a vû quelquefois dans l’églife latine, des
cVêqùeS & de faints pèrfohnagès employer à la même
fin les onôions d’huile benite , ainfi qti’il paroît
par une lettre d’innocent L à Decentius, rapportée
dans le totne I I . des conciles, pag. 12.48. Outre cela
les Grecs aflemblent phifieurs prêtres & jufqu’au
nombre de fept, pour des-faifons myftiques & allé-4-
goriques, qu’on peut voir dans Arcudius & daiis Si-
méon dé Tneffaloniqtie. II paroît pâr lé facrattientai-
fe dé S. Grégoire, de l’édition dû P. Ménard, page
5rSy, que dans l’églife latine on employoit aufli plufieurs
prêtres ; mais l’ufage préfent eft qu’un feul
prêtre cOnfere validêthéfit eè facrement.
Le P. Daftdini, dans fon voyage du Mont-Libatl ;
diftingue déitx fortes d’ônftiofis chez les Maronites ;
l’une qu’on appelle Ÿoticliôn avec Ühuile de la lampe :
mais cette on&iori, d it-il j n’eft pas eélle du faere-»
filent qu’on n’adminiftroit ordinairement qu’aux malades
qui étoient à l’extrémité ; parce que cette huile
eft confacrée feülemêht par Un prêtre, & qu’on la
donne à tous ceux qui fe préfentent* fains ou malades
indifféremment, mêmé au prêtre qui officie. L’âü-
fre efpece d’onÔibn, fuivant cét auteur, n’eft que
pour les malades ; elle fe fait avec dé l’huilé qué I’é-
véque feul confâcre le jêudi-faint, & é’èft à Cé qu’il
paroît leur onftion factamentelle.
Mais cette onâiôfr avec l’huile de là lafnpè eft
éti lifàge noft- feulenterit chez lés Maronites, mais
dans toute l’églife d’Orient, qui s’en fert avec beaucoup
de refpeÔ. Il né pârbît pas même qu’ils la dif-
t ingtrént dit facrement dé Vextrêtiic-ohciion, fi ce n’eft
comme l’obferve le P. G oar, qu’ils la regardent comme
une fimplé cérémonie pour Ceux qui font en fan-
t ê , & comme mi facrement pour lés malades. Ils bût
dans les grandes églifes Une làmpe dans laquelle on
Confervé l’huile pour lés malades, & ils appellent
cette lampe ta lampe de l'kuile jàihte à là ptiert. (G)
E X T R EM IS , (Jurifpr.) on appelle in extremis;
îe dernier teins dé la v ie , où quelqu’un eft atteint
d’une maladie dont il eft décédé.
Les difpofitions de derniere volonté, faites iri entremis
, font quelquefois fufpéôes dé függéftion ; ce
qui dépend des circonftartces. Voyt^ T Es ï am e n f ,
S u g g e s t io n .
Les mariages Célébrés in extremis avec des péffèn-
liés qui ont vécu enfemble dans la. débauche, font
nuis quant aux effets civils, foye^ MàRiaGë. (A )
EXTRÉMITÉ, f. f. {Gramm.) eft la partie qui eft
la derniere & la plus éloignée d’uné ehofé, ou qüi là
finit & la termine.
C ’eft en ce fertS qu’on employé Ce mot dans les
phrafes fui vantes. Les extrémiiés d’une ligné foht des
points. On ne peut pas allér d’Une eütrétniti à l’au-
i r e , fans paffer par le milieu.
E x t r é m it é s d u c o r p s h u m a in {les) Medec.
doivent être obfervées dans les maladies , fur-tout
dans celles qui font aiguës ; parce qu’elles pèuvénf
fournir lin grand nombre de lignes prognoftics très-
importans pour juger de l’évenement. Il n’arrive jamais
que les hommes meurent fans qu’il fe faffe quelque
changement notable dans l’extérieur des extrémités
: on peut y confidérer principalement la chaleur ','!
le froid, la couleur, le mouvement & la fituation ref-
pettivement à l’état naturel.
C ’e ll toujours un bon ligne dans les maladies aiguës
, que les extrémités ayent une chaleur tempérée,
«gale à celle de toutes les autres parties, avec fou-
pleffe dans la peau. On peut trouver les extrémités
aihfi chàudés dan^fès fievres les plus malignes ; mais
eètte chaleur n’ eft pas également répandue dans toutes
lès parties du corps ; comme lorfque lés extrémités
font moins chaudes que le tronc : d’ailleurs les
hypôcondres font ordinairement durs dans ce cas-
là , & l’habitude du corps h’eft pas également fouplfc
dans toutes fes parties; c’eft ce qui diftingue la chaleur
qui n’eft pas un bon ligne d’avec celle qui l’eft
une chaleur même brûlanté n’eft pas un màuVâis ligné
, lorfqu’éllé eft également répandue dans tout le
corps, & pàr conféquent aux extrémités ; c’eft le preÿ-
pre des fievrës ardèntës malignes de ne pas échauffer
plus qu’à l’bfdinairè les extrémités; c ’eft aufli un ligne
de malignité, que lés extrémités s’échauffent & fe
feftoidiffeht ert peu de tems ; e’eft un ligne mortel
dans les maladies aigues, qui épuifent promptement
les forcés. L’extrême chaleur, avec rougeur & inflammation
de ces parties , eft un bon figrte dans
cés irtêmes maladies : une chaleur douce, tempérée
avec moiteur ou même avèé un fentiment d’huniî-
dité, qui tend à fe refroidir dans toute l’habitude dû
corps, mais particulièrement dans les extrémités , qui
fe trouve jointe à une fievre continue, doit être très-
fufpeôe ; parce qu’il y a lieu de craindre que la chaleur
ne foit renfermée dans les Vifceres: la chaleur
douce égale que l’on obferve dans lés heâiques, né
fé conferVe pas ; elle augmente confidérablement
après qu’ils ont pris des alimens, & elle fe fait particuliérement
fentir dans le creux dés mains : d’ail—
Iéurs lâ chaleur dans la fièvre heâique, produit pref-
que toûjburS Une forte de craffe fur la peau.
Le froid des extrémités dans les maladies aiguës, eft
toujours un très-mauvais ligne, à moins que la nature
ne prépare urte crife ; ce qui s’ànnonce par les boni
lignes qui concourent aVèc le froid de ces parties :
lorfqu’elles font froides, que les autres parties l'ont
brûlantes avec féchereffe, & qué ces fymptomei
font accompagnés d’une grande fo i f , c’eft un ligné
de malignité dans la maladie : fi on à peiné à diflîpef
le froid des extrémités par lés moyens convenables
pour les réchauffer, & fur-tout fi on ne péut pas parvenir
à leur redbtlrier de la chaleur, c’éft uft très*
mauvais ligne qui devient même mortel & annonce
une fin prochaine, fi en même tems ces parties deviennent
livides & noires. Poye% Froid Eébrile.
C ’eft toujours un très-bon figrte dans les maladies
aiguës, que les extrémités confervent leur couleur
naturelle. La couleur rOuge & enflammée de quél-
quëè paftiéS du corps qüë ce foit, eft aufli un bon f r
gne, li ellé provient d’un dépôt critique qui fe foie
fait dans céS parties. Lâ coüléur livide & noire des'
extrémités, fur-tout fi le froid s’y joint, eft un ligne
mortel.
C ’eft aufli UH très-mauvais ligné, que lé malade
agité continuellement &c d’une manière extrâbr'di-
nâife lèS pies &t fes mains, ou qu’il les découvre
quoiqu’ils fbiéht froids.
On doit de même très-mal augurer d’un malade
qui fe fient conftaminent renverfé avec lés extrémités
tant fupérieures qu’inférieures , toûjours étendues.
Voye^ Situation du Corps dans les maladies
, & les prognoftics qu’on doit tirer de leur différence.
V^oy. l’excellent ouvrage de Profper Alpin, de
pràfagiehda vitâ St morte, dont cet article eft extrait.
■ H , Extrémités , {Peinture.) Ce qu’on nomme les
extrémités en Peinture, font fur-tout les mains &c les
piés : la tête qui devroit être comprife dans la lignification
de ce terme, eft un objet fi important dans
cet art, que les principes qui y ont rapport font une
partie féparée, & demandent des réflexions particulières.
Les mains & les piés contribuent beaucoup à
la jufteffe de l’expreflïon, & en augmentent la force.
Ces extrémités font fufceptibles de grâces qui leur