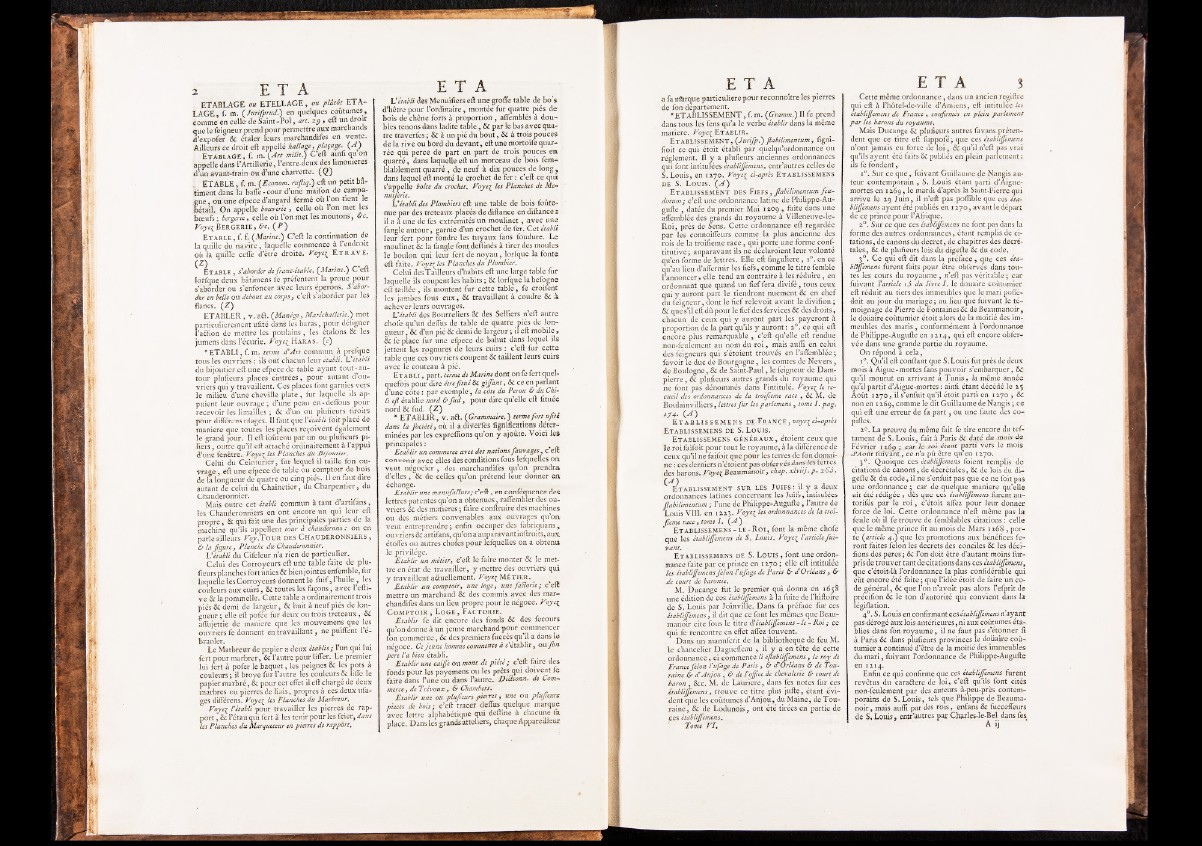
a E T A
ETÀBLAGE ou ETE LLAGE, ou plutôt ETALAG
E , f. m. ( Jurifprud.) en quelques coutumes,
comme en celle de Saint-Pol, art. z $ , eft un droit
que le feigneur prend pour permettre aux marchands
d’expofer 8c étaler leurs marchandifes en vente.
Ailleurs ce droit eft appelle hallage, plaçage. (A )
Et a b l aGe , f. m. (Art milit.) C ’eft ainftquon
appelle dans l’Artillerie, l’entre-deux des limomeres
d’un avant-train ou d?une charrette. (Q 1)
ETABLE, f. m. (E conom. ruftiq.) eft un petit bâtiment
dans la baffe-cour d’une maifon de campagne
, ou une efpece d’angard fermé où l’on tient le
bétail. On appelle bouverie, celle où l’on met les
boeufs ; bergerie, celle où Pon met les moutons, &c.
Voye{ Bergerie, &c. (P )
Et a b l e , f. f. (Marine.) C’eft la continuation de
la quille du navire, laquelle commence à l’endroit
où la quitte ceffe d’être droite. Voye£ E t r a v e .
(Z)E
table , Saborder de franc-étable, (Marine.) C eft
loffque deux bâtimens le préfentent la proue pour
s’aborder ou s’enfoncer kvec leurs éperons. S'aborder
en belle ou debout au corps, c’eft s’aborder par les
flancs. (Z )
ETABLER , V. aft. ( Manège, Maréchallerie.) mot
particulièrement ulité dans les haras, pour deligner
l’action de mettre les poulains, les étalons 8c les
jumens dans l’écurie, Voye^ Haras, (e)
* ETABLI, f. m. terme d.' Art commun à prefque
tous les ouvriers : ils ont chacun leur établi. U établi
du bijoutier eft une efpece de table ayant tout-autour
plulieurs places cintrées, pour autant d’ouvriers
qui y travaillent. Ces places font garnies vers
le milieu d’une cheville plate, fur laquelle ils appuient
leur ouvrage ; d’une peau en - deffous pour
recevoir les limailles ; 8c d’un ou plufieurs tiroirs
pour différens ul'ages. Il faut que l'établi foit placé de
maniéré que toutes les places reçoivent egalement
le grand jour. Il eft foûtenu par un ou plufieurs piliers
, outre qu’il eft attaché ordinairement à l’appui
d’une fenêtre. Voyeç les Planches du Bijoutier.
Celui du Ceintüriér, fur lequel il taille fon ouvrage
, eft une efpece de table ou comptoir de bois
de la longueur de quatre ou cinq piés. 11 en faut dire
autant de celui du Chaînetier, du Charpentier, du
Chauderonnier.
Mais outre cet1 établi commun à tant d’artifans,
les Chauderonniers en ont encore un qui leur eft
propre, & qui fait une des principales parties de la
machine qu’ils appellent tour à chauderons : on en
parle ailleurs Voy.Tour des Chauderonniers ,
& la figure, Planche du Chauderonnier.
Vétabli du Cifeleur n’a rien de particulier.
Celui des Corroyeurs eft une table faite de plufieurs
planches fort unies & bien jointes enfemble, fur
laquelle les Corroyeurs donnent le fu if, l’huile , les
Couleurs aux cuirs, 8c toutes les façons, avec 1 efti-
v e & la pommelle. Cette table a ordinairement trois
piés 8c demi de largeur, 8c huit à neuf piés de longueur
; elle eft pofée fur deux ou trois tréteaux, 8c
âffujettie de maniéré que les mouvemens que les
ouvriers fie donnent en travaillant, ne puiffent l’ébranler.
Le Marbreur de papier a deux établis ; l’un qui lui
fert pour marbrer, 8c l’autre pour liffer. Le premier
lui fert à pofer le baquet, les peignes 8c les pots à
couleurs ; il broyé fur l’autre les couleurs 8c liffe le
papier marbré, 8c pour cet effet il eft charge de deux
marbres ou pierres de liais, propres à ces deux ufa-
ges différens. Voye%_ les Planches du Marbreur.
Voye[ l'établi pour travailler les pierres de rapport
, 8c l’étau qui fert à les tenir pour les feier, dans
les Planches du Marqueteur en pierres de rappbrt,
Vétabli des Menuifiers eft une groffe table de bo’s
d’hêtre pour l’ordinaire, montée fur quatre piés. de
bois de chêne forrs à proportion, affemblés à doubles
tenons dans ladite table, & par le bas avec quatre
traverfes ; 8c à un pié du bout, 8c à trois pouces
de la rive ou bord du devant, eft une mortoife quar-
rée qui perce de part en part de trois pouces en
quarré, dans laquelle eft un morceau de bois fem-
blablement quarré , de neuf à dix pouces de long ,
dans lequel eft monté le crochet de fer : c’eft ce qui
s’appelle boîte du crochet. Voye%_ les Planches de Me-
nuij'erie.
L ’établi des Plombiers eft une table de bois foûte-
nue par des tréteaux placés de diftance en diftance z
il a à une de fes extrémités un moulinet, avec une
fangle autour, garnie d’un crochet de fer. Cet établi
leur fert pour fondre les tuyaux fans foudure. Le
moulinet ëc la fangle font deftinés à tirer des moules
le boulon qui leur fert de noyau, lorfque la fonte
; eft faite. Voye{ les Planches du Plombier.
Celui des Tailleurs d’habits eft une large table fur
laquelle ils coupent les habits ; 8c lorfque la befogne
eft taillée , ils montent fur cette table, fe croifent
les jambes fous eu x , 8c. travaillent à coudre 8c à
achever leurs ouvrages.
Vétabli des Bourreliers 8c des Selliers n’eft autre
chofe qu’un deffus de table de quatre piés de longueur
, 8c d’un pié 8c demi de largeur ; il eft mobile ,
8c fe place fur une efpece de bahut dans lequel ils
jettent les rognures de leurs cuirs : c’eft fur cette
table que ces ouvriers coupent 8c taillent leurs cuirs
avec le couteau à pié.
E t abli , part, terme de Marine dont on fe fert quelquefois
pour dire êtrefituè 8c gijffint, & ce en parlant
d’une côte : par exemple, la côte du Pérou & du Chili
eft établie nord & fu d , pour dire qu’elle eft fituée
nord 8c fud. (Z ) #
* ETABLIR, v. att. (Grammaire.) terme fort ufiti
dans la focièté, où il a diverfes fignifications déterminées
par les expreflions qu’on y ajoûte. Voici les
principales :
Etablir un commerce avec des nations fauvages, c eft:
convenir avec elles des conditions fous lefquelles on
veut négocier , des marchandifes qu’on prendra
d’elles , & de celles qu’on prétend leur donner en
échange.
Etablir une manufacture; c’eft, en conféquence des
lettres patentes qu’on a obtenues, raffembler des ouvriers
8c des matières ; faire conftruire des machines
ou des métiers convenables aux ouvrages qu’on
veut entreprendre ; enfin occuper des fabriquans ,
ouvriers 8c artifans, qu’on a auparavant inftruits, aux
étoffes ou autres choies pour lefquelles on a obtenu
le privilège.
Etablir un métier, c’eft le faire monter 8c le mettre
en état de travailler, y mettre des ouvriers qui
y travaillent aâuellement. Voye{ Métier.
Etablir un comptoir, une loge, une faclorie; c’eft
mettre un marchand 8c des commis avec des marchandifes
dans un lieu propre pour le négoce. Vjyeç Comptoir , Loge, Factorie.
Etablir fe dit encore des fonds & des fecours
qu’on donne à un jeune marchand pour commencer
ion commerce, 8c des premiers fuccès qu’il a dans le
négoce. Ce jeune homme commence à s’établir, ou fon
pere l'a bien établi. .
Etablir une caijfe ou mont de piete ; c’eft faire des
fonds pour les payemens ou les prêts qui doivent fe
faire dans l’une ou dans l’autre. Diclionn. de Commercet,
de Trévoux , 6* Chambers.
Etablir une ou plufieurs pierres, une ou plufieurs
piues de bois; c’eft tracer deffus quelque marque
avec lettre alphabétique qui deftine à chacune fa
place. Dans les grands atteliers, chaque Appareilleur
a fa marque particulière pour reconnoître les pierres
de fon departement.
* ETABLISSEMENT, f. m. (’Gramm.) Il fe prend
dans tous les fens qu’a le verbe établir dans la même
maEtière. Voye^ Etablir. tablissement, (Jurifp.) ftabilimentum, figni-
fioit ce qui étoit établi par quelqu’ordonnance ou
réglement. Il y a plufieurs anciennes ordonnances
qui font intitulées établijfemens, entr’autres celles de
S. Louis, en 1270. Voye^ ci-après Etablissemens
deE S. Louis. (A ) tablissement des Fiefs , ftabilimentum feu-
dorum; c’eft une ordonnance latine de Philippe-Au-
gufte , datée du premier Mai 1209 , faite dans une
affemblée des grands du royaume à Villeneuve-le-
R o i, près de Sens. Cette ordonnance eft regardée
par les connoiffeurs comme la plus ancienne des
rois de la troifieme race, qui porte une forme corif- j
titutive ; auparavant ils ne déclaroient leur volonté
qu’en forme de lettres. Elle eft finguliere, i°. en ce
qu’au lieu d’affermir les fiefs, comme le titre femble
l’annoncer, elle tend au contraire à les réduire, en
ordonnant que quand un fief fera divifé, tous ceux
qui y auront part le tiendront nuement 8c en chef
du feigneur, dont le fief relevoit avant la divifion;
& que s’il eft dû pour le fief des fer vices & des droits,
chacun de ceux qui y auront part les payeront à
proportion de la part qu’ils y auront : 20. ce qui eft
encore plus remarquable , c’eft qu’eUe eft rendue
.non-feulement au nom du r o i, mais aufli en celui
des feigneurs qui s’étoient trouvés en l’affemblée ;
lavoir le duc de Bourgogne, les comtes de Ne vers,
de Boulogne, 8c de Saint-Paul, le feigneur de Dam-
pierre , 8c plufieurs autres grands du royaume .qui
ne font pas dénommés dans l’intitulé. Voyeç le recueil
des ordonnances de la troifieme race , & M. de
Boulainvïlliers, lettres fur ies parlement, tome 1. pag.
B BEtBa bQli.s sem en s de IFr ance, H voye^a-apres Etablissemens de S. L ou is. Etablissemens généraux, étoient ceux que
lcee uroxi q fuai’filo nite p foaiufro tito quut ele p orouyra luesm tee,r ràe lsa d dei fffoénr ednocme adie
dnees : bcaerso dnesr.n iers n’étoient pas obfer vis dans lés terres Voye% Beaumanoir, chap. xlviij. p- zCâ.
(A ')
K Etablissement sur les Juifs: il y a deux
ordonnances latines concernant les Juifs, intitulées
ftabilimentum ; l’une de Philippe-Augufte, l’autre de
Louis VIII. en 1223. Voye^ les ordonnances de la troi-
fieme race , tome l. (A ) Etablissemens- le-R o i , font la même chofe
que les établijfemens de S. Louis. Voyeç 1'article fui-
vant. Etablissemens de S. L o u is , font une ordonnance
faite par ce prince en 1270 ; elle eft intitulée
les établijfemens félon Ûufage de Paris & d'Orléans , &
de court de baronie.
M. Ducange fut le premier qui donna en 1658
une édition de ces établijfemens à la fuite de l’hiftoire
de S. Louis par Joinville. Dans fa préface fur ces
établijfemens, il dit que ce font les mêmes que Beaumanoir
cite fous le titre d’établijfemens - le - Roi; ce
qui fe rencontre en effet affez fouvent.
Dans un manuferit de la bibliothèque de feu M.
le chancelier Dagueffeau , il y a en tête de cette
ordonnance, ci commence li ejtablijfemens, le roy de
France félon Tufage de Paris , & d> Orléans & de Touraine
& dé Anjou, & de l'office de chevalerie & court de
baron, & c . M. de Lauriere, dans les notes fur ces
établijfemens, trouve ce titre plus jufte, étant évident
que les coutumes d’Anjou, du Maine, de Touraine,
& de Lodunois, ont été tirées en partie dé
Ces établijfemens,
Tome V f
Cette même ordonnance, dans un ancien regiftre
qui eft à l’hôtel-de-ville d’Amiens, eft intitulée les
établijfemens de France , confirmés en plein parlement
par les barons du royaume.
Mais Ducange & plufieurs autres favans prétendent
que ce titre eft fuppofé; que ces établijfemens
n’ont jamais eu force de loi., Ôc qu’il n’eft pas vrai
qu’ils ayent été faits &. publiés en plein parlement :
ils fe fondent,
i°. Sur ce que, fuivant Guillaume de Nangis auteur
contemporain , S. Louis étant parti d’Aigue-
mortes en 1269, le mardi d’après la Saint-Pierre qui
arrive le 29 Juin, il n’eft pas poffible que ces eta-
blijfemens ayent été publiés en 1270, avant le départ
de ce prince pour l’Afrique.
20. Sur ce que c es établijfemens ne font pas dans la
forme des autres ordonnances, étant remplis de citations,
de canons du decret, de chapitres des décrétales
, & de plufieurs lois du digefte & du code.
30. Ce qui eft dit dans la préface, que ces éta-
blljfemens furent faits pour être obferves dans toutes
les cours du royaume , n’eft pas véritable ; car
fuivant l'article iS du livre I . le douaire coutumier
eft réduit au tiers des immeubles que le mari poffé-
doit au jour du mariage ; au lieu que fuivant le témoignage
de Pierre de Fontaines & de Beaumanoir,
le doiiaire coutumier étoit alors de la moitié des immeubles
des maris , conformément à l’ordonnance
de Philippe-Augufte en 1214, qui eft encore obfer-
vée dans une grande partie du royaume.
On répond à cela,
i°. Qu’il eft confiant que S. Louis fut près de deux
mois à Aigue-mortes fans pouvoir s’embarquer, Sc
qu’il mourut en arrivant à Tunis, la même année
qu’il partit d’Aigue-mortes : ainfi étant décédé le 25
Août 1270, il s’enfuit qu’il étoit parti en 1270 } &:
non en 1269, comme le dit Guillaume de Nangis ; ce
qui eft une erreur de fa p a rt , ou une faute des co-
piftes.
20. La preuve du même fait fe tire encore du tef-
tament de S. Louis, fait à Paris & daté du mois d&
Février 126g ; cor Je roi étant parti vers le mois
d’Août îifivànt , ce n’a pu être qu’en 1270.
30. Quoique ces établijfèr/iens foient remplis de
citations de canons, de décrétales, & de lois du digefte
& du code, il ne s’enfuit pas que ce ne foit pas
une ordonnance ; car de quelque maniéré qu’elle
ait été rédigée, dès que ces établijfemens furent au-
torifés par le r o i , c’étoit affez pour leur donner
force de loi. Cette ordonnance n’eft même pas la
feule où il fe trouve de femblables citations : celle
que le même prince fit au mois de Mars 1268 , porte
(article 4.) que les promotions aux bénéfices feront
faites félon les decrets des conciles & les dédiions
des peres ; 8c l’on doit être d’autant moins fur-
pris de trouver tant de citations dans ces établijfemens,
que c’étoit-là l’ordonnance la plus confidérable qui
eût encore été faite ; que l’idée étoit de faire un code
général, & que l’on n’avoit pas alors l’efprit de
précifion 8c le ton d’autorité qui convient dans la
légiflation.
40. S. Louis en confirmant ces établijfemens n’ayant
pas dérogé aux lois antérieures, ni aux coutumes établies
dans fon royaume, il ne faut pas s’étonner fi
à Paris 8c dans plufieurs provinces le doiiaire coû-
tumier a continué d’être de la moitié des immeubles
du mari, fuivant l’ordonnance de Philippe-Augufte
en 1214.
Enfin ce qui confirme que ces établijfemens furent
revêtus du cara&ere de loi, c’eft qu’ils font cités
non-feulement par des auteurs à-peu-près contemporains
de S. Louis, tels que Philippe de Beaumanoir
, mais aufli par des rois, enfans 8c fucceffeurs
de S, Louis, entr’autres par Charles-le-Bel dans fes
A ij