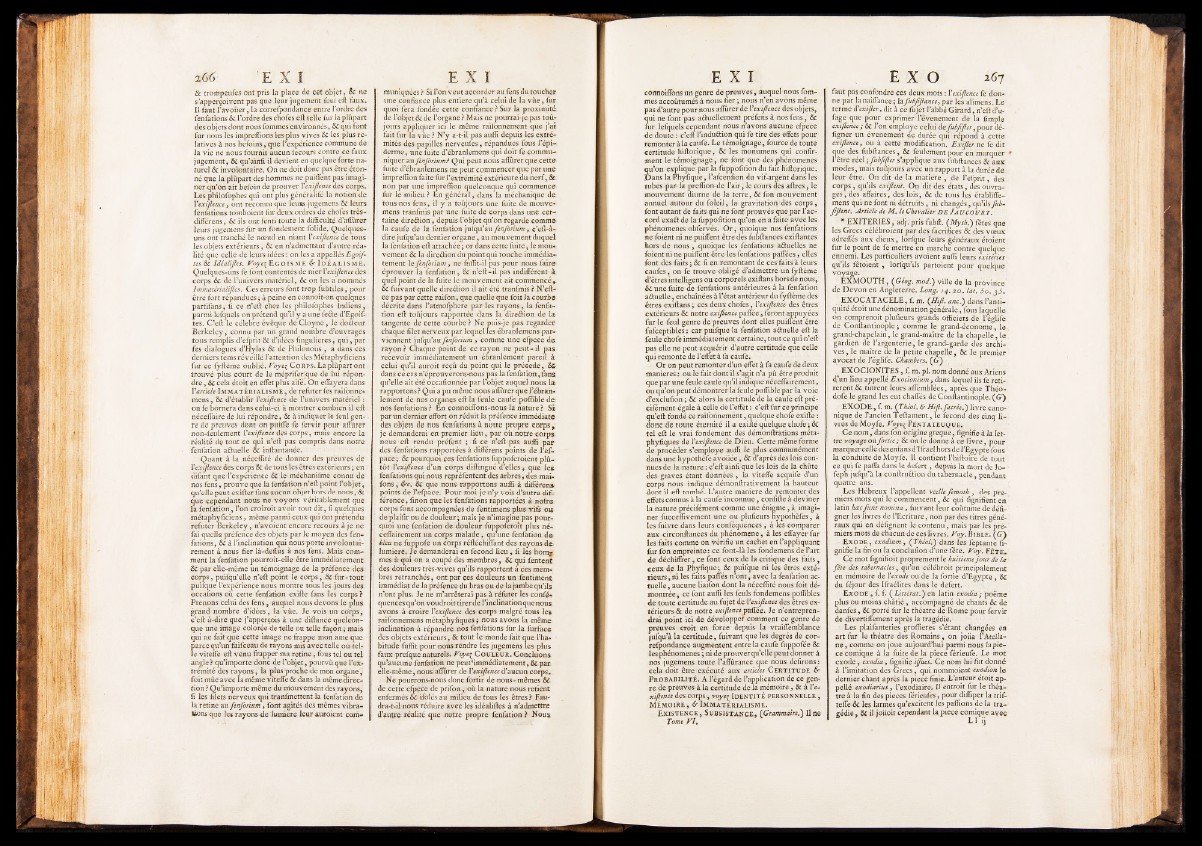
z 66 E X I & trompeufes ont pris la place de cet objet, ol ne
s ’apperçoivent pas que leur jugement feul eft faux.
11 faut l’avoïter, la correfpondance entre l’ordre des
fenfations & l’ordre des chofes eft telle fur la plupart
des objets dont nous fommes environnés, & qui font
fur nous les imprelîions les plus vives & les plus relatives
à nos befoins, que l’expérience commune de
la vie ne nous fournit aucun fecours contre ce faux
jugement, & qu’ainfi il devient en quelque forte naturel
& involontaire. On -ne doit donc pas être éton*
né que la plupart des hommes ne puiffent pas imaginer
qu’on ait befoin de prouver Vexifence des corps»
Les philofophes qui ont plus générâlifé la notion.de
Vexifence» ont reconuu que leuas jugemens & leurs
fenlatiens tomboient fur deux ordres de chofes très-
différens, & ils ont fenti toute la difficulté d’aflurer
leurs jugemens fur un fondement folide. Quelques-
uns ont tranché le noeud en niant Vexijlence de tous
les objets extérieurs, & en n’admettant d’autre réa*
lité que celle de leurs idées ï on les a appellés Egoif-
tes & Idéalifes. Foye[ E g o ï sm e & IDÉALISME»
Quelques-uns fe font contentés de nier Vexijlence des
corps & de l’univérs matériel , & on les a nommés
Immatèrialijles. Ces erreurs font trop fubtiles, pouf
être fort répandues ; à peine en connoît-on quelques
partifans, fi ce n’eftcnez les philofophes Indiens,
parmi lefquels on prétend qu’il y a une fefte d’Egoif*
tes. C ’eft le célébré évêque de C lo yn e, le dofteuf
Berkeley, connu par un grand nombre d’ouvrages
tous remplis d’efprit & d’idées fingulieres, qui, par
fes dialogues d’Hylas & de Philonoiis , a dans ces
derniers tems réveillé l’attention des Métaphyliciens
fur ce fyftème oublié. Foye{ C orps. La plupart ont
trouvé plus court de le méprifer|que de lui répondre
, & cela étoit en effet plus aifé. On effayera dans
Varticle Im m a t é r ia l ism e , de refüter fes raifonne*
mens, & d’établir Vexijlence de l’univers matériel :
on fe bornera dans celui-ci à montrer combien il eft
néceffaire dé lui répondre» & à indiquer le feul geri-i\
re de preuves dont on puiffe fe fervir pour affûrer
non-feulement Vexijlence des corps, mais encore la
réalité de tout ce qui n’eft pas compris dans notre
fenfation aûuelle & inftantanée.
Quant à la néceffité de donner des preuves de
V-exifience des corps & de tous les êtres extérieurs ; en
difant que l ’expérience & le-'méèhanifme connu de
nos fens , prouve que la fenfation n’eft point l’objet,
qu’elle peut exifter fans aucun objet hors de nous, &
que cependant nous ne voyons véritablement que
la fenfation, l’on croiroit avoir tout d it, li quelques
métaphyliciens, même parmi ceux qui ont prétendu
refluer Berkeley, n’avoient encore recours à je ne
fai quelle préfence des objets par le moyen des fenfations,
& à l’inclination qui noiis porte involontairement
à nous fier là-deffus à nos fens. Mais comment
la fenfation pourroit-elle être immédiatement
& par elle-même un témoignage de la préfence des
corps, puifqu’elle n’eft point le corps, & fur-tout
puilque l’expérience nous montre tous les. jours des
occafions où cette fenfation exifte fans les corps ?
Prenons celui des fens, auquel nous devons le plus
grand nombre d’idées, la vue. Je vois un corps,
c ’eft à-dire que j’apperçois à une diftance quelconque
une image colorée de telle ou telle façon ; mais
qui ne fait que cette image ne frappe mon .ame.que
parce qifun faifceau de rayons mis avec telle où telle
vîtèffe eft venu frapper ma retine, fous tel ou tel
angle ? qu’importe donc de l’objet, pourvû.que l’extrémité
des rayons, la plus proche de mon.organe,
foit mûe avec la même vîteffe& dans la même.direc-
tion ? Qu’importe même du mouvement des rayons,
li les .filets nerveux qui tranfmettent la fenfation dë
la .retine au fenforium , font agités .des mêmes vibrations
que les rayons de lumière leur auraient conu-
E X I muniquées ? Si l’on veut accorder au fens du toucher
une confiance plus entière qu’à celui de la v u e , fur
quoi fera fondée cette confiance ? Sur la proximité.,
de l’objet & de l’organe? Mais ne pourrai-je pas toujours
appliquer ici le même raifonnement que j’ai
fait fur la vue ? N’y a-t-il pas auffi depuis les extrémités
des papilles nerveufes, répandues fous l’épiderme,
une fuite d’ébranlemens qui doit fe communiquer
au fenforium? Q ui peut nous affûrer que cette
fuite d’ébranlemens ne peut commencer que par une
impreffion faite fur l’extrémité extérieure du nerf, &
non par une impreffion quelconque qui commence
fur le milieu ? En général, dans la méchanique de
tous nos fens, il y a toujours une fuite de mouve-
mens tranfmis par une fuite de corps dans une certaine
direélion, depuis l’objet qu’on regarde commet
la caufe de laf fenfation jufqu’au fenforium » c’eft-à-
dire jufqu’au dernier organe » àu mouvement duquel
la fenfation eft attachée ; or dans cette fuite » le mou*
vement & la direction du point qui touche immédiatement
le fenforium, ne fnffit-il pas pour nous faire
éprouver la fenfation, & n’eft-il pas indifférent à
quel point de la fuite le mouvement ait commencé ,
& fuivant quelle direction il ait été tranfmis ? N’eft-*
ce pas par cette raifon, que quelle que foit la courbe
décrite dans l’atmofphere par les rayons, la fenfation
eft toûjours rapportée dans la direâion de la
tangente de Cette courbe ? Ne puis-je pas regarder
chaque filet nerveux par lequel les ébranlemens parviennent
jufqu’au fenforium , comme une efpece de
rayon ? Chaque point de ce rayon ne peut-il pas
recevoir immédiatement un ébranlement pareil à
celui qu’il auroit réçû du point qui le précédé, 6&
dans ce cas n’éprouveronsmous pas la fenfation, fans
qu’elle ait été occafionnée par l’objet auquel nous la
rapportons? Qui a pu même nous affûrer que i’ébràn-
lemenf de nos organes eft la feule caufe poffible de-
nos fenfations ? En connoiffons-nous la nature ? Si
par un dernier effort 6n réduit la préfence immédiate
des objets de nos fenfations à notre propre corps ,
je demanderai en premier lieu , par oirnotre corps
nous eft rendu préfent ; fi ce n’eft-pas auffi par
des fenfations rapportées à différens points de l ’èf-
pace ; & pourquoi çes fenfations fiippoferoient p lutôt'lV,
ri/?£«ce d’un corps diftingué d’elles ». que les
fenfations qui nous reprëfentent des arbres, des mai-
fons, &c. & que nous-rapportons auffi-à différens
points de l’efpace. Pour moi je n’y vois d’autre différence,
finon que les fenfations rapportées à notre
corps font accompagnées de fentimens plus vife ou
deplaifir oü de douleur; mais je n’imagine pas pourquoi
une fenfation de douleur fuppoferoit plus né-
ceffairementun corps malade,.qu’une fenfation de
bleu ne fuppofe un corps réfléchiffant des rayons de.
lumière. Je demanderai en fécond lieu , fi les hom*
mes à qui orna coupé des membres, & qui fentent
des douleurs très-vives qu’ils rapportent.à ces membres
retranchés, ontpar ces douleurs un fentiment
immédiat de la préfence du bras ou de la jambe qu’ils
n’ont plus. Je ne m’arrêterai pas à réfuter les confé-
quenees qu’on voudroit tirer de l’inclination que nous
avons à croire Vexifence des corps malgré tous les
raifonnemens métaphyfiques ; nous avons la même
inclination- à répandre, nos fenfations fur la furface
des objets extérieurs, & tout le monde fait que l’ha^ -
bitude fuffit pour nous rendre les jugemens les plus
faux prefque naturels» Voyer C o u l e u r . Concluons
qu’aucune fenfation ne peutfimmédiatement, & par
elle-même, nousaffûrer de Vexijlence d’aucun corps.
Ne' pourrons-nous donc fortir de nous - mêmes &
decetteefpece de prifon,.où la nature nous retient
enfermés 6c ifolés au milieu de tous les êtres ? Fau-
dra-t-ilnous réduire avec les idéaliftes à n’admettre
d’autre- réalité que notre propre fenfation ? Noua
E X I connoiffons un genre de preuves, auquel-nous fommes
accoutumés à nous fier ; nous n’en avons même
pas d’autre pour nous affûrer de Vexijlence des objets,
qui ne font pas usuellement préfens à nos fens, &
fur lefquels cependant nous n’avons aucune efpece
de doute : c’eft l’indu&ion qui fe tire dés effets pour
remonter à la calife. Le témoignage, fouir ce de toute
certitude hiftorique, & les monumens qui confirment
le témoignage, ne font que des phénomènes
qu’on explique par la fuppofition du fait Hiftorique.
Dans la Phyfique, l’afcenfion du vif-argent dans les
tubes par- la preffion-de l’air, le cours des aftres, le
mouvement diurne de la terre, &? fon mouvement
annuel autour du foleil, la gravitation'dés corps,
font autant de faits qui ne font prouvés que par ra ccord
exaS de la fuppofition-qu’on en a faite avéc les
phénomènes obfervés. O r , quoique nos fenfations
ne foient ni ne puiffent être des fubftances exiftantes
hors de nous , quoique les fenfations- a&uelles ne
foient ni ne puiffent être les fenfations paffées, elles
font des faits ; & li en remontant de ces'faits à leurs
caufes , on fe trouve obligé d’admettre rin fyftème
d’êtres intelligens ou corporels exiftans hors de nous,
&: une fuite de fenfations antérieures à la fenfation
aftuelle, enchaînées à l’état antérieur du fyftème des
êtres exiftans ; ces deux chofes, Vexijlence des êtres
extérieurs & notre exifience paffée » feront appuyées
fur le feul genre de preuves dont elles puiffent être
fufceptibles : car puifque la fenfation aâuelle eft la
feule chofe immédiatement certaine, tout ce qui n’eft
pas elle ne peut acquérir d’autre certitude que celle
qui remonte de l ’effet à fa caufe.
Or on peut remonter d’un effet à fa caufe de deux
maniérés-: ou lë fait dont il s’agit n’a pu être produit
que par une feule caufe qu’il indique néceffairèment,
ou qu’on peut démontrer là feule poffible par la voie
d’exclufion ; & alors la certitude de la caufe eft pré-
çifément égale à celle de l’effet : c’eft fur ce principe
qu’eft fondé ce raifonnement, quelque chofe exifte :
donc de toute éternité il a exifté quelque chofe ; &
tel eft le vrai fondement des démonftrations métaphyfiques
de Vexijlence de Dieu. Cette même forme
de procéder s’employe auffi le plus communément
dans une hypothèfe avoüée, & d’après dès lois connues
de la nature : c’èft ainfique les lois de la chûte
des graves étant données , la vîteffe acquife d’un
corps nous indique- démonftrativement là hauteur
dont il eft tombé. L’autre maniéré de remonter des
effets connus à la caufe inconnue, confifte à deviner
la nature précifément comme une énigme, à imaginer
fucceffivement une ou plufieurs hypothèfes, à
les fuivre dans leurs conféquences , à les comparer
aux circonftances du phénomène, à les effayer fur
les faits comme on vérifie un cachet en l’appliquant
fur fon empreinte: ce font-là les fondemens de l’art
de déchiffrer, ce font ceux de la critique des faits,
ceux de la Phyfique; & puifque ni les êtrès extérieurs,
ni les faits paffés n’ont, avec la fenfation actuelle,
aucune liaifon dont la néceffité nous foit démontrée,
ce font auffi les feuls fondemens poffibles
de toute certitude au.fujet de Vexijlence des êtres extérieurs
& de notre exijlence paffée. Je rt’entrepren-
drai point ici de développer comment ce genre de
preuves croît en force depuis la vraiffemblance
jufqu’à la certitude, fuivant que les degrés de correfpondance
augmentent entre la caufe fuppofée &
les phénomènes ; ni de prouver qu’elle peutdonner à
nos jugemens toute l’affûrance que nous délirons:
cela doit être exécuté aux articles C e r t it u d e 6*
P r o b a b i l i t é . A l’egard de l’application de ce genre
de preuves à la certitude de la mémoire , & à Vexifence
des corps, voyei Id e n t it é p e r so n n e l l e ,
M ém o ir e , & Im m a t é r ia l i sm e . Existence, Subsistance, (Grammaire.) line
Tome Fl*
E X O i 67
faut pas confondre ces deux mots : V e x i f e n c e fe donne
par lanaiffance; la fu b j i f ia n c e3 par les alimens. Le
terme V e x i f t e r , dit à ç ë fil j e t l’abbé Girard, n’eft d’u-
fage que pour exprimer l’ëvenement de la fimple
e x i j le n c e ; & l’on employé celui à e f u b f i f e r , pour dé-
figner un evenement de durée qui répond à cette
e x i f e n c e , ou à cette modification. E x i f e r n e fe dit
que des fubftances, & feulement pour en marquer *
l?être réel \ fu b f t f t e r s’applique aux fubftances & aux
modes, mais toujours avec un rapport à la durée de
leur être. On dit de la màtiere , de l’efprit, des
corps, qif.ils e x f i e n t . O n ’dit des états, des ouvragés^
des affaires, des Ibis, & de tous les établiffe-
mens qui ne font ni détruits , ni changés , qu’ils f i t b -
f i f i è n t . A r t i c l e d e M . l e C h e v a l ie r d e J a u c o u r t .
* EXITERIES, adj/pris fubft. (Myth.Jfêtes que
les Grecs célébroient par des facrificès & des voeux
adreffés aux dieux, lorfque leurs généraux éfoient
fur le point de fe mettre en inàrche contre quelque
ennemi. Les particuliers avoient auffi leurs exitéries
qu’ils fêtoient , lorfqu’ils partoient pour quelque
voyage.
' EXMOUTH, (Gèog. mod.) ville de la province
de Devon en Angleterre. Long. 14.20. lat. J 0. 3 5 .
EXOCATACELE, f. m. (Hifi. ancV) dans l’antiquité
étoit une dénomination générale, fous laquelle
on comprenoit plufieurs grands officiers de l’eglife
de Çonftantinople ; comme le grand-économe, le
grandrchapelain, le grand-maître de la chapelle, le
gardien de l’argenterie, le grand-garde des archiv
e s, le maître de la petite chapelle, & le premier
avocat de l’églife. Chambers. (G)
| EXOCIONITES, f. m. pi. nom donné aux Ariens
d’un lieu appellé Exocionium , dans lequel ils fe retirèrent.&
, tinrent leurs affemblées, après que Théo-
dofe le grand les eut chaffés de Çonftantinople. (G )
EX O D E , f. m.ÇThéol. & Hif.facréeV) livre canonique
de l’ancien Teftament, le fécond des cinq livres
de Moyfe. Foye^ Pe n t a t e u q u e .
. Ce nom , dans fon origine greque, fignifie à la lettre
voyage ou farcie; & on le donne à ce livre, pour
marquer celle des enfansd’lfrael hors de l’Egypte fous
la conduite de Moyfe. Il contient l’hiftoire de tout
ce qui fe paffa dans le defert, depuis la mort de Jo- -
feph jufqu’à la conftru&ion du tabernacle, pendant
quatre ans.
Les Hébreux l’appellent reelle femoth , des premiers
mots qui le commencent, & qui fignifient en
latin hcec funt nomina, fuivant leur coutume de défi-
gner les livres de l’Ecriture, non par des titres généraux
qui en défignent le contenu, maïs par les pré-
miers mots de chacun de ces livres. Foy. Bib l e . (G )
E x o d e , e x o d i u m , ( T h é à i . J d a n s les feptante fignifie
la fin ou la conclufion d’une fête. F o y . F ê t e .
Cè mot fignifioit proprement le huitième jour de la
fête des tabernacles, qu’on célébroit principalement
en mémoire de Vexode o\\ de la fortie d’Egypte, êc
du féjour des Ifraélitës dans le defert.
E x o d e , f. f. ( Littèrat.') en latin exodia; poème
plus ou moins châtié » accompagné de chants & de
danfes, & porté fur le théâtre de Rome pour fervir
de divertiffement après la tragédie.
Les plaifanteries groffierès s’étant changées en
art fur le théâtre des Romains, on joiia l’Atella-
n e , comme on joue aujourd’hui parmi nous la pièce
comique à la fuite de la piece férieufe. Le mot
exode, exodia, fignifie Ce nom lui fut donné
à l’imitation des Grecs, qui nommoient exodion le
dernier chant après la piece finie. L’auteur étoit appellé
exodiarius , l’exodiaire; Il entroit fur le théâtre
à la fin des pièces férieufes, pour diffiper la trifi
teffe & les larmes qu’excitent les paffions de la tragédie,
& il joiioit cependant la piece comique ayec