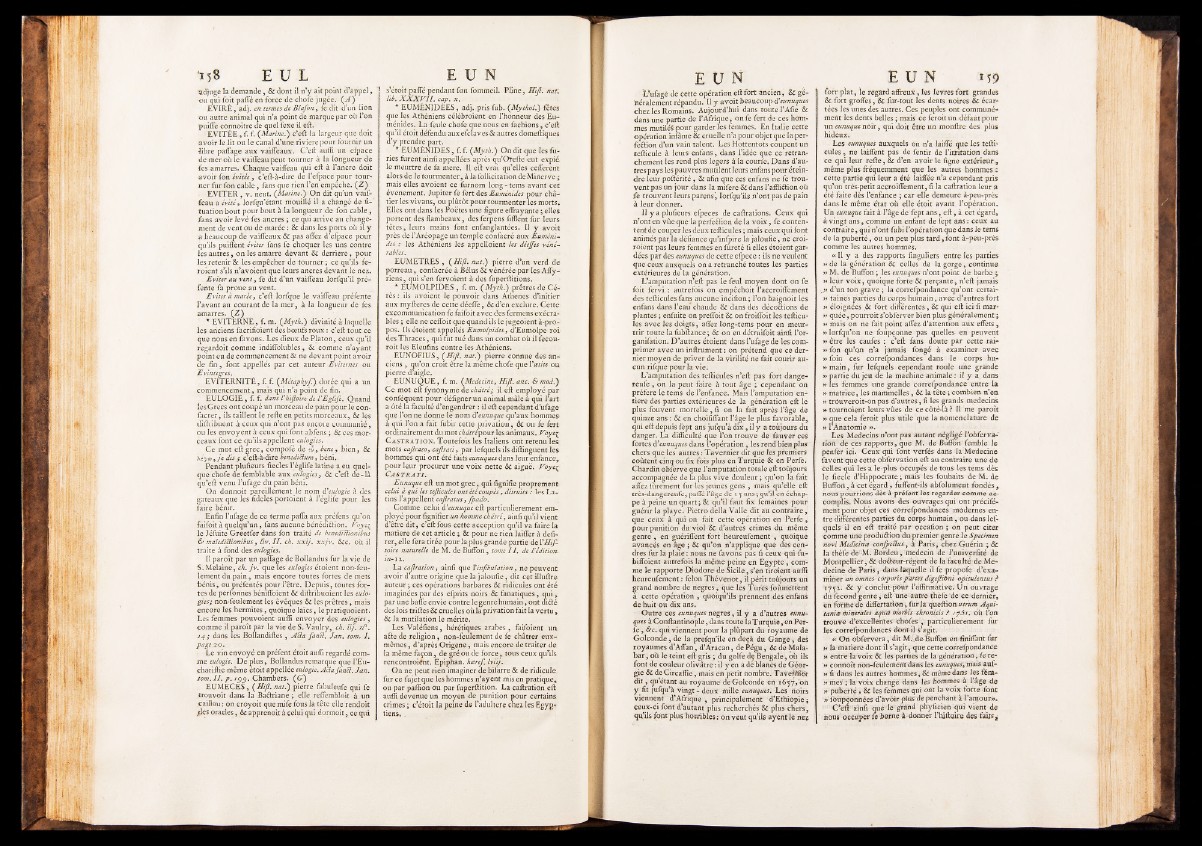
adjuge la demande, & dont il n’y ait point d’appel,
-ou qui foit paffé en force de choie jugée,' (A )
EVIRÉ, adj. en termes de Blafon, fe dit d’un lion
ou autre animal qui n’a point de marque par oh l’on
puiffe connoître de quel fexe il eft.
EVITEE, f. f. (Marine.') c’ eft la largeur que doit
avoir le lit ou le canal d’une riviere pour fournir un
libre paflage aux vaiffeaux. C ’eft aufli un efpace
de mer oh le vaiffeau peut tourner à la longueur de
fes amarres. Chaque vaiffeau qui eft à l’ancre doit
avoir fon évitée, c ’eft-à-dire de l’efpace pour tourner
fur fon cable, fans que rien l’en empêche. (Z )
EV ITER , v. neuf. (Marine.) On dit qu’un vaiffeau
a évité, Iorfqu’étant mouillé il a changé de fi-
tuation bout pour bout à la longueur de fon cable,
fans avoir levé fes ancres ; ce qui arrive au changement
de vent ou de marée : & dans les ports oh il y
a beaucoup de vaiffeaux & pas affez d’efpace pour
qu’ils puiflent éviter fans fe choquer les uns contre
les autres, on les amarre devant Sc derrière, pour
les retenir & les empêcher de tourner ; ce qu’ils fe-
roient s’ils n’avoient que leurs ancres devant le nez.
Eviter au vent, fe dit d’un vaiffeau lorfqu’il préfente
fa proue au vent.
Eviter à marée, c’eft lorfque le vaiffeau préfente
Pavant au courant de la mer, à la longueur de fes
amarres. (Z )
* EVITERNE, f. m. (Myth.) divinité à laquelle
les anciens facrifioient des boeufs roux : c’eft tout ce
que nous en favons. Les dieux de Platon, ceux qu’il
regardoit comme indiffolubles, St comme n’ayant
point eu de commencement & ne devant point avoir
de fin, font appellés par cet auteur Eviternes ou
Evintegres.
EVITERNITÉ, f. f. (Métapkyf), durée qui a un
commencement, mais qui n’a point de fin.
EULOGIE, f. f. dans l'hijloire de l'Eglife. Quand
les Grecs ont coupé un morceau de pain pour le con-
facrer, ils taillent le refte en petits morceaux, Sc les
diftribuent à ceux qui n’ont pas encore communié,
ou les envoyent à ceux qui font abfens ; Sc ces morceaux
font ce qu’ils appellent eulogies.
Ce mot eft g rec, compofé de su, bene, bien, &
M ya,je d is j c’eft-à-dire bemdiclum , béni.
Pendant plufieurs fiecles l’églife latine a eu quelque
chofe de femblable aux eulogies, Sc c’eft de-là
qu’eft venu l’ufage du pain béni.
On donnoit pareillement le nom d'eulogie à des
gateaux que les fideles portoient à l’églife pour les
faire bénir.
Enfin l’ufage de ce terme paffa aux préfens qu’on
faifoit à quelqu’un, fans aucune bénédiâion. Voye^
le Jéfuite Greetfer dans fon traité de benediclionibus
& malediclionibus y liv .II. ch. xxij. xxjv. &c. oh-il
traite à fond des eulogies.
Il paroît par un paffage de Bollandus fur la vie de
S. Melaine, ch. jv . que les eulogies étoient nOn-feu-
lement du pain, mais encore toutes fortes de mets
bénis, ou préfentés pour l’être. Depuis, toutes fortes
de perfonnes béniffoient & diftribuoient les eulogies;
non-feulement les êvêques Sc les prêtres, mais
encore les hermites, quoique laïcs, le pratiquoient.
Les femmes pouvoient aufli envoyer des eulogies,
-comme il paroît par la vie de S. Vaulry, ch. üj. n°.
j 4 ; dans les Bollandiftes , A cia fancl. J an. tom. I.
page x o .
Le vin envoyé en préfent étoit aufli regardé comme
eulogie. De plus, Bollandus remarque que l’Eu-
chariftie même étoit appellée eulogie. Acla fancl. J an.
tom. II. p. !£)$. Chambers. (G)
EUMECES, (Hifl. nat.) pierre fabuleufe qui fe
.irouvoit dans la Baftriane ; elle reffembloit à un
caillou : on croyoit que mife fous la tête elle rendoit
jdçs oracles, Sc apprenoit à celui qui dormoit, ce qui
s’étoit paffé pendant fon fommeil. Pline, Hiß. naf.
lib. X X X V I I . cap. x.
* EUMÉNIDÉES, adj. pris fub. (Mythol.) fêtes
que les Athéniens célébroient en l’honneur des Euménides.
La feule chofe que nous en fâchions , c’eft:
qu’il étoit défendu aux efclaves & autres domeftiques
d’y prendre part.
* EUMÉNIDES, f. f. (Myth.) On dit que les furies
furent ainfi appellées après qu’Orefte eut expié
le meurtre de fa mere. Il eft vrai qu’elles cefferent
alors de le tourmenter, à la follicitation de Minerve ;
mais elles avoient ce furnom long - tems avant cet
événement. Jupiter fe fert des Euménides pour châtier
les vivans, ou plutôt pour tourmenter les morts.
Elles ont dans les Poètes une figure effrayante ; elles
portent des flambeaux, des ferpens fifflent fur leurs
têtes, leurs mains font enfanglantées. Il y avoit
près de l’Aréopage un temple confacré aux Euménides
: les Athéniens les appelloient les déejfes vénérables.
EUMETRES , ( Hiß. nat.) pierre d’un verd de
porreau, confacrée à Bélus 8c vénérée par les Affy-
riens, qui s’en fervoient à des fuperftitions.
* EUMOLPIDES , f. m. (Myth.) prêtres de Ceres
:, ils avoient le pouvoir dans Athènes d’initier
aux myfteres de cette déeffe, Sc d’en exclure. Cette
excommunication fe faifoit avec des fermens exécrables
; elle ne ceffoit que quand ils le jugeoient à-propos.
Ils étoient appellés Eumolpidesd’Eumolpe roi
des Thraces, qui fut tué dans un combat oh il fecou-
roit les Eleufins contre les Athéniens.
EUNOFIUS, (Hiß. nat.) pierre connue des anciens
, qu’on croit être la même chofe que Y cuite ou
pierre d’aigle.
EUNUQUE, f. m. (Médecine, Hiß. anc. & mod.)
Ce mot eft fynonyme de châtré; il eft employé par
conféquent pour défigner un animal mâle à qui l’art
a ôté la faculté d’engendrer : il eft cependant d’ufage
que l’on ne donne le nom d'eunuque qu’aux hommes-
à qui l’on a fait fubir cette privation, & on fe fert
ordinairement du mot châtré pour lés animaux. Voyeç
C a s t r a t io n . Toutefois les Italiens ont retenu les
mots caßrato, caflrati, par lefquels ils diftinguent les
hommes qui ont été faits eunuques dans leur enfance,
pour leur procurer une voix nette Sc aiguë. Voye^
C A S T R A T I .
Eunuque eft un mot grec, qui lignifie proprement
celui a qui les tefiicules ont été coupés , détruits : les Latins
l’appellent caßratus, fpado.
Comme celui d'eunuque eft particulièrement employé
pour lignifier un homme châtré, ainfi qu’il vient
d’être dit, c’eft fous cette acception qu’il va faire la
matière de cet article ; & pour ne rien laiffer à délirer,
elle fera tirée pour la plus grande partie de Y Hiß
toire naturelle de M. de Buffon, tome I I . de l'édition,
in-ix.
La cafiration, ainfi que Y infibulation, ne peuvent
avoir d’autre origine que la jaloufie, dit cet illuftre
auteur ; ces opérations barbares & ridicules ont été
imaginées par des efprits noirs Sc fanatiques, q ui,
par une baffe envie contre le genre humain, ont d iâé
des lois trilles Sc cruelles oh la privation fait la vertu,
Sc la mutilation le mérite.
Les Valéfiens, hérétiques arabes , faifoient un
afte de religion, non-feulement de fe châtrer eux-
mêmes , d ’après Origene, mais encore de traiter de
la même façon, de gré ou de force, tous ceux qu’ils
rencontroiênt. Epiphan. hcerefi-lviij.
On ne peut rien imaginer de bifarre & de ridicule
fur ce fujet que les hommes n’ayent mis en pratique,
ou par paflion ou par fuperftition. La caftration. eft
aufli devenue un moyen de punition pour certains
crimes ; c’étoit la peine de l’adultere chez les Egyg*
tiens.,
L’ ufagé de Cette opération eft fort ancien, Sc généralement
répandu. Il y avoit beaucoup d'eunuques
chez les Romains. Aujourd’hui dans toute l ’Afie &
dans une partie de l’Afrique, onfe fert de ces hommes
mutilés pour garder les femmes. En Italie cette
opération infâme Sc cruelle n’a pour objet que la perfection
d’un vain talent. Les Hottentots coupent un
tefticule à leurs enfans, dans l’idée que ce retranchement
les rend plus légers à la courfe. Dans d’autres
pays les pauvres mutilent leurs enfans pour éteindre
leur poftérité , & afin que ces enfans ne fe trouvent
pas un jour dans la mifere Sc dans l’aflïiCtion oh
fe trouvent leurs parens, Iorfqu’ils n’ont pas de pain
à leur donner.
Il y a plufieurs efpeces de caftrations. Ceux qui
n’ont en vûe que la perfection de la v o ix , fe contentent
de couper les deux tefticules ; mais ceux qui font
animés par la défiance qu’infpire la jaloufie, ne crôi-
roient pas leurs femmes en fûreté fi elles étoient gardées
par des eunuques de cette efpece : ils ne veulent
que ceux'auxquels on a retranché toutes les parties
extérieures de la génération.
L’amputation n’eft pas le feul moyen dont on fe
foit fervi : autrefois on empêchoit l’accroiffement
des tefticules fans aucune incifion ; l’on baignoit les
enfans dans l’eau chaude Sc dans des décoctions de
plantes ; enfuite on preffoit Sc on froiffoit les'tefticules
avec les doigts, affez long-tems pour en meurtrir
toute la fubftance ; & on en détruifoit ainfi l’or-
ganifatiom D ’autres étoient dans l’ufage de les comprimer
avec un infiniment : on prétend que ce dernier
moyen de priver de là virilité ne fait courir aucun
rifque pour la vie.
L’amputation des tefticules n’eft pas fort dange-
reufe , on la peut faire à tout âge ; cependant on
préféré le tems de l’enfance. Mais l’amputation entière
des parties extérieures de la génération eft le
plus fouvenf mortelle , fi on la fait après l’ âge de
quinze ans : 8c en ehoififfant l’âge le plus favorable,
qui eft depuis fept ans jufqu’à d ix , il y a toujours du
danger. La difficulté que l’on trouve de fâuvér ces
fortes d'eunuques dans l ’opération, les rend bien plus
chers que les autres : Tavernier dit que les premiers
coûtent cinq ou fix fois plus en Turquie & en Perfe.
Chardin obferve que l’amputation totale eft toûjours
accompagnée de la plus vive douleur ;• qu’on la fait
affez finement fur les jeunes gens ; mais qu’elle eft
très-dangereufe, paffé l?âge de 15 ans ; qu’il ën échappe
à peine un quart; & qu’il faut fix femaines pour
guérir la playe. Pietro délia Vàlle dit ali contraire,
que ceux à qui on fait cette opération en Përfe *
pour punition du viol & d’autres crimes du même
genre , en guériffent fort heureufèment-, quoique
avancés en âge ; Sc qu’on n’applique que des cendres
fur la plaie : nous ne favons pas fi ceux qüi fii-
biffoient autrefois la même peine en Egypte, comme
le rapporte Diodore de Sicile, s’en tirOiept aüfli
heureufement : félon Thévênot, il périt toûjours un
grand nombre de negres, que les Turcs foûrtiettènt
à cette opération , qùoiqu’ils prennent ,dés enfans
de huit oiv dix ans.
Outre ces eunuques negres, il y a d’àutrès eunuques
à Conftantinôple, dans toute la Turquie, en Perfe
, d'c. qui viennent pour la plupart du royaume de
Golconde, de la prefqu’île en deçà du Gange ; deS
royaumes d’Affan, d’Àracan, de Pégu, Sc de Malabar
, oh le teint eft gris ; du golfe de Bengale, oh ils
font de couleur olivâtre : il y ën a de blancs de Géorgie
Sc de Circaffie, mais en petit nombre. Tave^flîër
d i t , qu’étant au royaume de Golconde en 16 57,'oh
y fit jufqu’à vingt - deux mille eunuques. Les rioirs
viennent d’Afrique , principalement d’Ethiopie ;
ceux-ci font d’autant plus recherchés Sc plus chers,
qu’ils font plus horribles : on veut qu’ils ayentlè nez
fort plat, le regard affreux, les levres fort grandes
& fort groffes, Sc fur-tout les dents noires Sc écartées
les unes des autres. Ces peuples ont communé-*
ment les dents belles ; mais ce feroit un défaut pour
un eunuque nôir, qui doit être un monftre des plus
hideux'.
Les eüjïuqùes auxquels ôn n’a laiffé que les tefti-
cüles, ne laiffent pas de fentir de l’irritation dans
ce qui leur refte, Sc d’en avoir le ligne extérieur ,
même plus fréquemment que les autres hommes c
cette partie qui leur a été laiflee n’a cependant pris
qu’un très-petit accroiffement, fi la caftration leur a
été faite dès l’enfance ; car elle demeure à-peu-près
dans le même 'état oh elle étoit avant l’opération.
Un eunuque fait à l’âge de fept ans, e ft , à cet égard,
à vingt ans, comme un enfant de fept ans : ceux au
contraire, qui n’ont fubi l’opération que dans le tems
de la puberté, ou un peu plus tard, font à-peu-près
comme les autres hommes. « Il y a des rapports finguliets entre les parties
» de la génération Sc celles de la gorge, continue
» M» de Buffon ; les eunuques n’ont point de barbe 5
» leur voix, quoique forte Sc perçante, n’eft jamais
■ ,» d’un ton grave ; la correfpondance qu’ont certai-
» taines parties du corps humain, avec d’autres fort
» éloignées ,8c fort » quée, pourroit s’obdfieffrévreern tbeise n, Spcl uqsu gi éenfét riaclie fmi menatr -;
» mais on ne fait point affez d’attention aux effets ,
»lorfqu’on ne foupçonne pas quelles en peuvent
»» fêotrne qlues’o nca unf’eas :j amc’eafits ffaonnsg éd oàu tee xpaamr icneetrt ea .vraeic*
»» fmoaini n,c efus r cleofrqreufeplso ncdeapnecnedsa ndta nrosu llee unceo rpgsra nhdue-
»» pleasr tfieem dmu ejes uu dnee lgar amnadceh icnoer raenfipmonaldea :n cile y e na.t rdea nlas »» tmrôautrviecreo, ilte-sô mn pamasm de’alluëtsr ,e sS,c f lia l etês tger ;a cnodms, mbiéedne nc’ienns
»» tqouuer ncoeliae nfet rloeiutr sp lvuûse us tidlee cqeu ce ôltaé -nloàm? eIln cmlaet upraer odîet
» l’Ariatomie ». • Les Médecins n’ont pas autant négligé ï'obferva-
tioh de ces rapports, que M. de Buffon femble le
penfér ici. Ceux qüi font vërfés daiïs la Medecine
favent que cette obfervation eft au contraire une de
celles qui les a le-plus occupés de tous les tems dès
lé fiecle d’Hippocrate ; mais les fouhàits de M. de
Buffori, à ce t égard , fuffent-ils abfolument fondés ,
nous pourrions dès-à-préfent les regarder comme accomplis.
Nous avons des ouvrages qui ont précifé-
ment poür objet ces correfpondances modernes entre
différentes parties du corps humain, ou dans lefquels
il en eft traité par occafion ; on peut citer
comme urte produ&ion du premier genre le Specimen
hovi MediciUce-confpeclus, à Paris, chez;Guérin ; &
la thèfe d eM . Bord eu , médecin de l’uni ver fité de
Montpellïèr, & doâeur-régèht de la faculté de Me*
deéine de Paris, dans laquelle il fe propofe d’èxa-
miher an omnes'Cârpotis partis digcjlfoni opitulentur ?
'ly y i: & y conclut polir l’affirmative. Un ouvrage
du fécond genre , éft une::aufrë thèfe de ce dernier,
en fOfttie de differtatiOnfür lâ queftion utrum Aqui-
’ tarda fninerale s aquee tttofbis thtüniçis £ iÿ3ï-;. oh l’on
trouve d’excellentes' ch’ôfèS ,, par-tieülïerement fur
lës correfpondances dOnï-il s’agit,
« On obferverâ , dit M . .de Buffon ert finiffant fur
» la màtiere dont il s’agit, qüe cette correfpondance
» entre la voix Sc les parties de la génération, fere-
» connoît non-feulertiehï dansleS eunuqites, triais auf-
» fi dans les autres hommès, & même dans Iesféra-
» mes ; la* voix changé dans lës hommes à l’âge de
»-puberté, SC lès femmes qui ont la voix forte-font
» foüpçonnées d’âvôir plus' de penchant à l ’amour».
C ?èft 'ainfi que le grand phyficien -qui vient de
hous occuper fe borne à-doûner l’hiftoire des faitsa