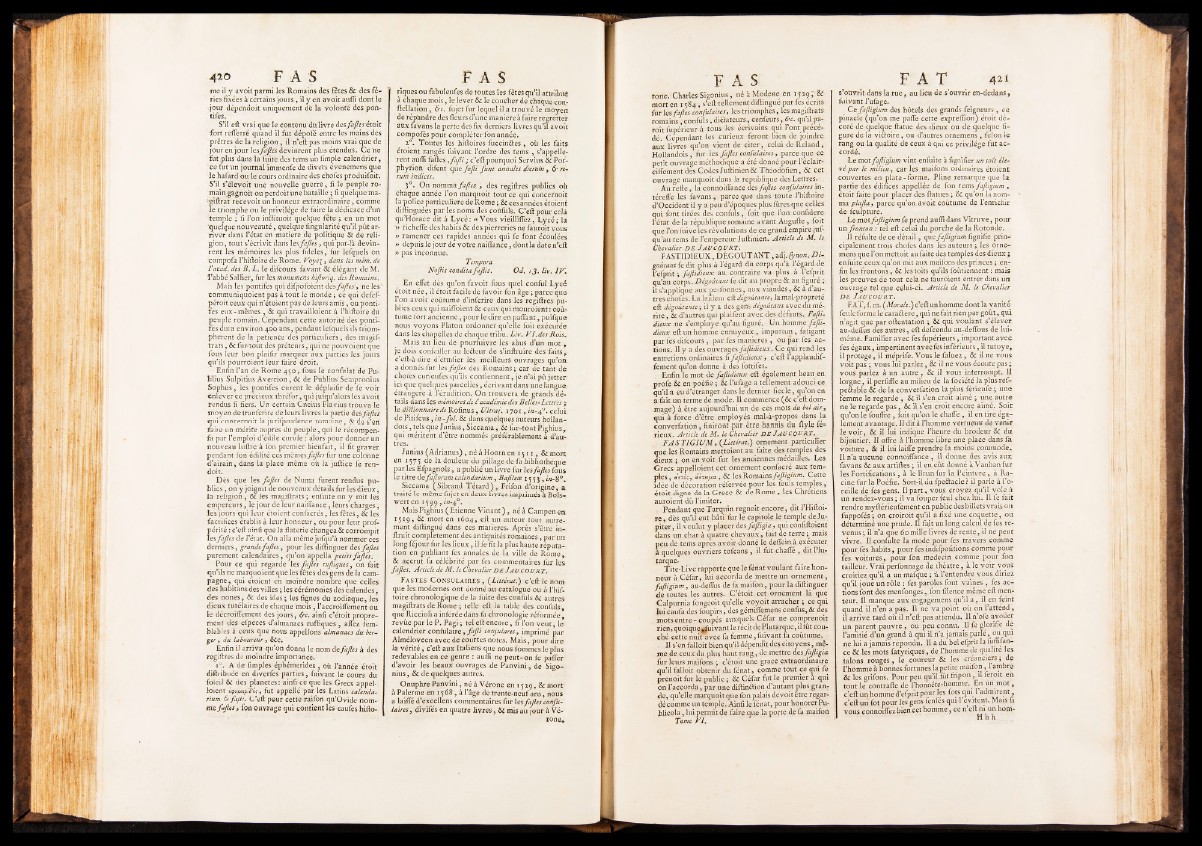
me il y avoit parmi les Romains des fêtes & des fériés
fixées à'certains jours, il y en avoit aulîi dont le
'.jour dépendoit uniquement de la volonté des pontifes.
S’il eft vrai que le contenu dtilivre des fajlesètOit
fort refTerrë quand il fut dépofé entre les mains des
prêtres de la religion, il n’eft pas moins vrai que de
Jour en jour 1 es fajles devinrent plus étendus. Ce ne
fut,plus dans la fuite des tems un fimple calendrier,
ce futun journal immenfe de divers évènemensque
le hafard ou te cours ordinaire des chofes produifoit.
S’il s’élevoit unè nouvelle guerre, fi le peuple ro-
maingagnoh ou perdoitune bataille ; fi quelquelna-
•'’gtftrat recevoit un honneur extraordinaire, comme
le triomphe ou le privilège de faire la dédicace d’un
temple ; fi l’on inftituoit quelque fête ; en un mot
'quelque nouveauté, quelque Angularité qu’il pût arriver
dans l’état en matière de politique & de religion,
tout s’écrivit dans lesfajles, qui pat-là devinrent
les mémoires les plus fideles, fur lefqüels on
•compofa l’hiftoire de Rome. Voye\, 'dans l'es mém. de
Vàtad. des B. L. le difcoürs favant & élégant de M.
l ’abbé Saîtier, fur les monumens hijloriq. des Romains.
Mais les pontifes qui difpofoient des fajles’, ne les1
communiquoient pas à tout le monde ; ce qui defef-
péroii ceux qui n’étoient pas de leurs amis, ou pontifes
eux - mêmes , & qui travailloient à l’hiftoire du
peuple romain. Cependant cette autorité des pontifes
dura environ 400 ans, pendant lefqüels ils triomphèrent
de la patience des particuliers, des magiftrats
, &c fur-tout des préteurs ,'qui ne pou voient que
fous leur bon plaifir marquer aux parties les jours
qu’ils pourroient leur faire droit.
Enfin l’ân de Rome 450, fous le confulat de Pu-
blius Sulpitius Averrion, & de Pùblius'Semprbnius
Sophus, les pontifes eurent le déplaifir de fe voir
enlever ce précieux thréfor, qui julqu’alors les avoit
rendus fi fiers. Un certain Cneius Flavius trouva le
moyen de tranfcrire de leurs livres la partie àesfafteî
qui concernoit la jurifprudence romaine, & de s’en
faire un mérite auprès du peuple, qui le récompen-
fa par l’emploi d’édile curule : alors pour donner un
nouveau luftre à fon premier bienfait, il fit graver
pendant fon édilité ces mêmes fajles fur une colonne
d’airain, dans la place même oit la juftice fe ren-
doit.
Dès que les fajles de Numa furent rendus publics
, on y joignit de nouveaux détails fur les dieux,
la religion, & les magiftrats ; enfuite on y mit les
empereurs, le jour de leur naiffance, leurs charges,
les jours qui leur étoient confacrés, les fêtes, & les
facrifices établis à leur honneur, ou pour leur prof-
périté : c’eft ainfi que la flaterie changea & corrompit
les fajles de l’état. On alla même jufqu’à nommer ces
derniers, grands fajles, pour les diftinguer des fajles
purement calendaires, qu’on appella petits fajles.
Pour ce qui regarde les fajles rujliqu.es, on fait
qu’ils ne marquoient que les fêtes des gens de la campagne,
qui étoient en moindre nombre que celles
des habitans des villes ; les cérémonies des calendes,
des nones, & des ides; les lignes du zodiaque-, les
dieux tutélaires de chaque mois, l’accroiffement ou
le décroiffement des jours, &c. ainfi c’étoit proprement
des efpeces d’almanacs ruftiques , affez fem-
blables à ceux que nous appelions almanacs du berger
, du laboureur, & c .
Enfin il arriva qu’on donna le nom ùe fajles à des
regiftres de moindre importance.
*°. A de fimples éphémerides , où l’année étoit
diftribuée en diverfes parties, fuivant le cours du
foleil & des planètes: ainfi ce que les Grecs appel-
loient ùpn/j.tp'.S'is, fut appelle par les Latins calenda-
rium & fajti. C ’eft pour cette raifon qu’Ovide nomme
fajles, fon ouvrage qui contient les caufes hiftoriques
ou fabuleufes de toutes lès fêtes qu’îl attribué
a chaque mois, le lever & le coucher de chaque con-
ftéllation, &c. füjet fur lequel il a trouvé le moyen
de répandre des fleurs d’une maniéré à faire regrette!:
aUx favans la perte des fix derniers livres qu’il avoit
compofés pour compléter fon année»
i° . Toutes les hiftoi'res fuccinftés , où les faits
éfoieht rangés fuivant l’ordre des tems , s’appelle-
rent aüflî faftes , fajli ; c ’éft pourquoi Servius & Por-
phyfion difent que fajli fuht annales dierum , & re-
runi indicés.
3°. On nomma fajles^ , dès regiftres publics où
chaque année l’on marquoit tout ce qui concernoit
la police particulière de Rome ; & ces années étoient
distinguées pat les noms de's confuls. Ç’eft pour cela
qu’Horace dit à Lycé: «Vous viêilliffez, L y cé ; la
» ficheffe des habits & des pierreries ne fauroit vous-
» ramener ces rapides années qui fe font éboulées
» depuis le jour de votre naiffance, dont la date n’eft
» pas inconnue*
Temporâ
Nojlis condita faflis. Od. 1 J . liv. IV.
En effet dès qu’on favoit fous quel conful Lycé
etoit née, il étoit facile de favoir fon âge ; parce que
l’on avoit coutume d’infcrire dans les regiftres publics
ceux qui naiffoient & ceux qui mouroient .* coutume
fort ancienne, pour le dire en paffant, puifque
nous voyons Platon ordonner qu’elle foit exécutée
dans les chapelles de chaque tribu. Liv. VI.des Rois.
Mais au lieu de pourfuivre les abus d’un mot ,
je dois confeiller au letteur de s’inftruire des faits,
c’eft-à dire d’étudier les meilleurs ouvrages qu’on,
a donnés fur les fajles des Romains ; car de tant de
chofes curieufes qu’ils contiennent, je n’ai pu jet ter
ici que quelques parcelles, écrivant dans une langue»
étrangère à l’érudition. On trouvera de grands détails
dans les mémoires de l'académie des B elles-Lettres ;
le dictionnaire de Rofinus, Ultraj. 1701., in-40. celui
de Pitifcus, in -fol. 8c dans quelques auteurs hollan-
dois, tels que Junius, Siccama, & fur-tout Pighius,!
. qui méritent d’être nommés préférablement à d’autres.
Junius (Adrianus), né à Hoorn en 1 5 1 1 , & mort
en 1575 de la douleur du pillage de fa bibliothèque
par les Efpagnols, a publié un livre fur les fajles fous
le titre de fajlorum calendarium, Bafileoe 1553, i/î-8%
Siccama (Sibrand T êta rd ), Frifon d’origine, a
traité le même fujet en deux livres imprimés à Boisv
e r t en 1599, in.-40.
Mais Pighius ( Etienne Vinant ) , né à Campen en
15 19, & mort en 1604, eft un auteur tout autrement
diftingué dans ces matières. Après s’être in-
llruit complètement des antiquités romaines, par un
long féjour fur les lieux, il fe fit la plus haute réputation
en publiant fes annales de la ville de Rome,
& accrut fa célébrité par fes commentaires fur les
f a j l e s . A r t i c l e d e M . l e C h e v a lie r D E J A U c o u r t .
F a s t e s C o n s u l a ir e s , (Littéral.) c ’eft le nom
que les modernes ont donné au catalogué ou à l’hif.
toire chronologique de la fuite des confuls & autres
magiftrats de Rome ; telle eft la table des confuls,
que Riccioli a inférée dans fa chronologie réformée ,
revûe par le P. Pagi ; tel eft encore, fi l’on veut le
calendrier confulaire, fajli conj'ulares, imprimé par
Alméloveen avec de courtes notes. Mais, pour dire
la vérité, c’eft aux Italiens que nous lommes le plus
redevables en ce genre : aulîi ne peut- on fe palier
d’avoir les beaux ouvrages de Panvini, de Sigo-
nius, 8c de quelques autres.
Onuphre Panvini, né à Vérone en 1519, & mort
à Palerme en 1568, à l’âge de trente-neuf ans, nous
a laiffé d’excellens commentaires fur les fajles confu-
laites, divifés en quatre livres, 8c mis au jour à Vérone,
rone. Châties Sigonius, né à Modene ôn 1^19, &
mort en 1584, s?eft tellement diftingué par fes écrits
fur les fajles confadair.es, les triomphes, les magiftrats
romains, confuls, di&ateurs, cenfeurs, &c. qu’il pa-
foît fupérieur à tous les écrivains qui 1 ont précédé.
Cependant les curieux feront: bien de joindre
aux livres qu’on vient de citer, celui de Reland,
Hollandois, fur les fajles confulaires, parce que ce,
petit ouvrage méthodique a été donné pour l’eclair-
ciffement des Codes Juftinienôc Théodofien, 8c c e t .
ouvrage manquoit dans la république des Lettres. ,
Au refte, la connoiflance des fajles confulaires in-
téreffe les favans, parce que dans toute l’hiftoire
d’Occident il y a peu d’époques plus fûtes que celles
qui font tirées des confuls, foit que l’on confidere
l’état de la république romaine avant Augufte , foit
que l’on fuive les révolutions de ce grand empire juf-
qu’aii tems. de l’empereur Juftinien. Article de M. le
Chevalier DE JAUCOURT.
FASTIDIEUX, D ÉGOÛTANT, adj.fyrwn. D égoûtant
fe dit plus à legard du corps qu’à l’égard de
l’efprit ; fajtidieux au contraire , va plus à l’efprit
qu’au corps. Dégoûtant fe dit au propre & au figuré ;
il s’applique aux perfon.nes , aux viandes, & à d autres
chofes. La laideur eft dégoûtante, la mal-propreté
eft dégoûtante y il y .a des gens dégoûtans avec du mé-,
r ite , & d’autres qui plaifent avec des défauts. Fajli-
dieux ne s’employe qu’au figuré. Un homme fajli-.
dieux eft un homme ennuyeux , importun, fatigant
par fes dilcours , par fes maniérés , ou par fes actions.
Il y a des ouvrages fajtidieux. Ce qui rend les
entretiens ordinaires fi fajtidieux » c’eft l’applaudif-
fement qu’on donne à des fottifes.
Enfin le mot de fajtidieux eft également beau en
profe & en poéfie ; & l’ufage a tellement adouci ce
qu’il a eu d’étranger dans le dernier fiecle, qu’on en
a fait un terme de mode. Il commence (& c’eft dommage)
à être aujourd’hui un de ces mots du b e l air ,
qui à force d’être employés mal-à-propos dans la
converfatipn, finiront par être bannis du ftyle fé-
rieux. Article de M. le Chevalier D E J A U C O U R T ,
F A S TIGIUM, (Littéral?) ornement particulier
que les Romains, mettoient au faîte des temples des
dieux ; on en voit fur les anciennes médailles. : Les
Grecs appelloient cet ornement eonfacre aux temples,
etîToç, cttTUfjLct, & les Romains fajligium. Cette
idée de décoration réfervée pour les leuis temples,
étoit digne de la Grèce & de Rome, les Chrétiens
auroient dû l’imiter. _
: Pendant que Tarquin regnoit encore, dit l’Hiftoi-
r e , dès qu’il eut bâti fur le capitole le temple de Jupiter,
il .voulut ÿ placer des fajligia, qui confiftoient
dans un char à quatre chevaux, fait.de terre^ mais,
peu de tems après avoir donné le deffein à executer
à quelques ouvriers tofeans , il fut chaffé , dit Plutarque.
Tite-Live rapporte que le fénat voulant faire honneur
à Céfar j lui accorda de mettre un ornement,
fajligium, au-deffus de fa maifon., pour la diftinguer
de toutes les autres. C ’étoit cet-ornement là que
Calpurnia fongeoit qu’elle voyoit arracher ; ce qui
lui caufa des foupirs, des gémiffemens confus, & des
mots entre - coupés auxquels Cefar ne comprenoit
rien, quoiquegfui vant le récit de Plutarque, il tût couché
cette nuit avec fa femme, fuivant la coutume.
Il s’en falloit bien qu’il dépendît des citoyens, même
de ceux du plus haut rang., de mettre des fajligia
fur leurs maifons ; c’étoit une grâce extraordinaire
qu’il falloit obtenir du fénat-, comme tout ce qui fe
prenoit fur le public ; & Céfar fut le premier à qui
on l’accorda, par une diftinttion d’autant plus gram
de, qu’elle marquoit que fon palais devoitêtre regardé
comme un temple. Ainfi le fénat, pour honorer Pu-
blicola, lui permit de faire que la porte de fa maifon
Tome VI.
s’ouvrît dans la rue, au lieu de s’ouvrir en-dedans,
fuivant l’ufage.
Ce fajligium des hôtels des grands feigneur9 , ce
pinacle (qu’on me paffe cette expreflion) étoit décoré
de quelque ftatue des dieux ou de quelque figure
de la victoire, ou d’autres ornemens , félon le
rang ou la qualité de ceux à qui ce privilège fut accordé.
Le mot fajligium vint enfuite à fignifier un toit élevé
par le milieu, car les maifons ordinaires étoient
couvertes en plate-forme. Pline remarque que la
partie des édifices appelîée de fon tems fajligium ,
étoit'faite pour placer des ftatues ; & qu’on la nomma
plajla, parce qu’on avoit coûtume de l’enrichir
de fculpture.
Le mot fajligium fe prend auffi dans Vitruve, pour,
un fronton : tel eft celui du porche de la Rotonde.
Il réfulte de ce détail, que fajligium fignifie principalement
trois chofes dans les auteurs ; les ornemens
que l’on mettoit au faîte des temples des dieux ;
enfuite ceux qu’on mit aux maifons des princes ; enfin
les frontons, & les toîts qu’ils foûtiennent : mais
les preuves de tout cela ne laurôient entrer dans un
ouvrage tel que celui-ci. Article de M. le Chevalier
D E JA U C O U R T .
FAT, f. m. (Morale.) c’eft unhomme dont la vanité
feule forme le cara&ere, qui ne fait rien par goût, qui
n’agit que par oftentation ; & qui voulant s’élever
au-deffus des autres, eft defeendu au-deffous de lui-
même. Familier avec fes fupérieurs, important avec
fes égaux, impertinent avec fes inférieurs, il tutoyé,
il protégé, il méprife. Vous le falüez, & il ne vous
voit pas ; vous lui parlez, & il ne vous.écoute pas;
vous parlez à un autre, & il vous interrompt. II
lorgne, il perfiffle au milieu de la fociété la plùsref-
peftable & de la converfation la plus férieufe ; une
femme le regarde , &: il s’en, croit aimé ; une autre
ne le regarde pas, & il s’en croit encore aimé. Soir
qu’on le foufffe , foit qu’on le chaffe , il en tire également
avantage. Il dit à l’homme vertueux de venir
le voir, & il lui indique l’heure du brodeur &C du
bijoutier. Il offre à l’homme libre une place dans fa
voiture, & il lui laiffe prendre la moins commode.
Il n’a-aucune connoiflance , il donne, des avis aux
favans & aux artiftes ; il en eût donné à Vauban fur
les Fortifications , à le Brun fur la Peinture à Racine
fur la Poéfie. Sort-il du fpettacle ? il parle à l’oreille
de fes gens. Il part, vous croyez qu’il vole à
un rendez-vous ; il va fouper feul. chez lui. Il fe fait
rendre myftérieufement en public des billets vrais ou
fûppofés ; on croiroit qu’il a fixé une coquette , ou
déterminé une prude. Il fait un long calcul de fes revenus
; il n’a que 60 mille livres de rente, il ne peut
vivre. Il confulte la mode pour fes. travers comme
pour fes habits, pour fes jndifpofitions comme pour
fes voitures, pour fon médecin comme pour fon
tailleur. Vrai perfonnage de. théâtre, à le voir vous
croiriez qu’il a un mafque ; -à l’entendre vous diriez
qu’il joue un rôle : fes paroles font vaines , fes actions
font des menfonges, fon filence même eft menteur.
Il manque aux engagemens qu’il a , il en feint
quand il n’en a pas. Il ne va point où. on l’atténd,
il arrive tard où il n’eft pas attendu, Il n’ofe avoiier
un parent pauvre , ou. peu connu. I lfe glorifie de
l’amitié d’un grand à qui il n’a jamais parlé, ou qui
ne lui a jamais répondu. Il a du bel efprit la fuflxfan-
ce & les mots fatyriques, de l’homme de qualité les
talons rouges , le coureur & les créanciers ; de
l’homme à bonnes fortunes la petite maifon ,1 ambre
& les grifons. Pour peu qu’il fut fripon., il feroit en
tout le contrafte de l’honnête-homme. En un mot,
c’eft un homme d’efprit pour les fots 3m 1 admirent,
c’eft un fot pour les gens fenfes qui 1 evUent. Mais li
vous connoiffez bien cet homme, ce n eft ni un hom