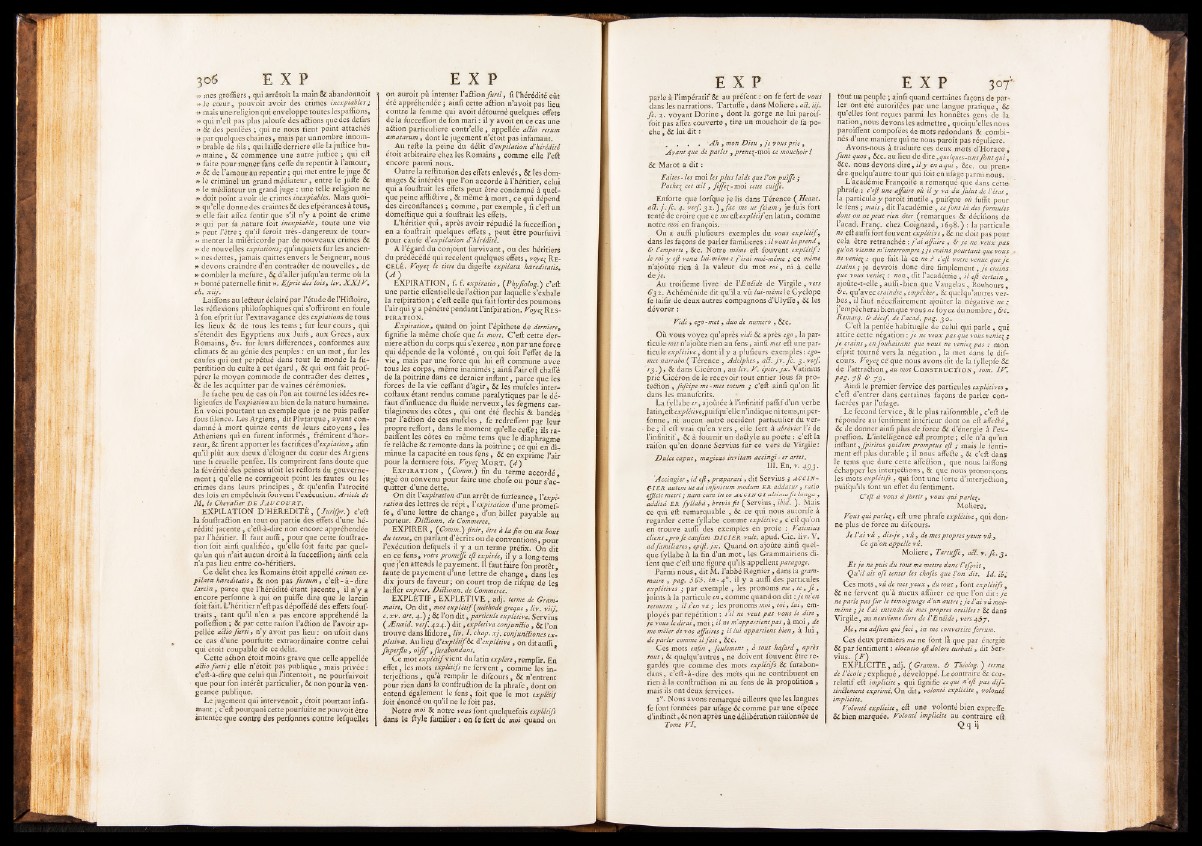
nies greffiers, qui arrêtoit la main & abandonnent
» le coeur, pouvoir avoir des crimes inexpiables;
■ » mais une religion qui enveloppe toutes lespaffions,
» qui n’eft pas plus jaloufe des aâions que des defirs
» 6c des penfées ; qui ne nous tient point attachés
■ » par quelques chaînes, mais par un nombre mnom-
» brable de fils ; quilaiffe derrière elle la juftice hu-
» maine, 6c commence une autre juftice ; qui eft
» faite pour mener fans celle du repentir à l’amour,
» Sc de l’amour au repentir ; qui met entre le juge Sc
» le criminel un grand médiateur , entre le jufte Sc
» le médiateur un grand juge : une telle religion ne
» doit point avoir de crimes inexpiables. Mais quoi-
» qu’elle donne des craintes Sc des efpérances à tous,
» elle fait affez fentir que s’il n’y a point de crime
» qui par fa pâture foit inexpiable, toute une vie
» peut l’être; qu’il feroit très-dangereux de tour-
» menter la miléricorde par de nouveaux crimes Sc
» de nouvelles expiations; qu’inquiets fur les ancien-
» nés dettes, jamais quittes envers le Seigneur, nous
» devons craindre d’en contracter de nouvelles, de
*» combler la mefure, Sç d’aller jufqu’au terme où la
» bonté paternelle finit ». Efprit des lois, liv. X X IV
ch. xiij.
Laiflons au leâeur éclairé par l’étude de l’Hiftoire,
les réflexions philofophiques qui s’offriront en foule
à fon efprit fur l’extravagance des expiations de tous
les lieux Sc de tous les tems ; fur leur cours, qui
s ’étendit des Egyptiens aux Juifs, aux Grecs, aux
Romains, &c. fur leurs différences, conformes aux
climats & au génie des peuples : en un mot, fur les
caufes qui ont perpétué dans tout le monde la fu-
perftition du culte à cet égard, & qui ont fait p rospérer
le moyen commode de contracter des dettes,
& de les acquitter par de vaines cérémonies.
Je fâche peu de cas où l’on ait tourné les idées re-
ligieufes de Y expiation au bien de la nature humaine.
En voici pourtant un exemple que je ne puis paffer
fous filence. Les A rgiens, dit Plutarque, ayant condamné
à mort quinze cents de leurs citoyens-, les
Athéniens qui en furent informés, frémirent d’horreur,
Sc firent apporter les facrifices d’expiation , afin
qu’il plût aux dieux d’éloigner du coeur des Argiens
une fi cruelle penfée. Ils comprirent fans doute que
la févérité des peines ufoit les refforts du gouvernement
; qu’elle ne corrigeoit point les fautes ou les
crimes dans leurs principes, & qu’enfin l’atrocité
des lois en empêchoit fouvent l’exécution. Article de
M . le Chevalier D E J A U CO U R T .
EXPILATION D ’HÉRÉDITÉ, ( Jurifpr.) c’eft
la fouftraâion en tout ou partie des effets d’une hérédité
jacente , c’eft-à-dire non encore appréhendée
par l’héritier. Il faut auffi, pour que cette fouftrac-
tion foit ainfi qualifiée, qu’elle foit faite par quelqu’un
qui n’ait aucun droit à la fucceffion; ainfi cela
n’a pas lieu entre co-héritiers.
Ce délit chez les Romains étoit appellé crimen ex-
pilata hareditatis, & non pas furtum, c’eft-à -d ire
Larcin, parce que l ’hérédité étant jacente, il n’y a
encore perfonne à qui on puiffe dire que le larcin
foit fait. L’héritier n’eft pas dépoffédé des effets fouf-
traits, tant qu’il n’en a pas encore appréhendé la
poffeffion ; & par cette raifon l’aâion de l’avoir ap-
pellée aclio furti, n’y avoit pas lieu : on ufoit dans
ce cas d’une pourfuite extraordinaire contre celui
qui étoit coupable de ce délit.
Cette aâion étoit moins grave que celle appellée
aclio furti ; elle n’étoit pas publique , mais privée :
c’eft-à-dire que celui qui l’intentoit, ne pourfuivoit
que pour fort intérêt particulier, Sc non pour la vengeance
publique.
Le jugement qui intervenoit, étoit pourtant infamant
; c’eft pourquoi cette pourfuite ne pouvoit être
internée que contre des perfonnes contre lefqueHes
on auroit pu intenter l’aâion furti, fi l’hérédité eût
été appréhendée ; ainfi cette aâion n’avoit pas lieu
contre la femme qui avoit détourné quelques effets
de la fuçceffion de fon mari : il y avoit en ce cas une
aâion particulière contr’e lle , appellée aclio rerum
amatarum, dont le jugement n’étoit pas infamant.
Au refte la peine au délit d'expilation d'hérédité
étoit arbitraire chez les Romains, comme elle l’eft
encore parmi nous.
Outre la reftitution des effets enlevés, & les dommages
Sc intérêts que l’on accorde à l’héritier, celui
qui a fouftrait les effets peut être condamné à quelque
peine affliâive, & même à m ort, ce qui dépend
des circonftances ; comme, par exemple, fi c’eft un
domeftique qui a fouftrait les effets.
L’héritier qui, après avoir répudié la fucceffion ,
en a fouftrait quelques effets , peut être pourfuivi
pour caufe # expilation d'hérédité. A l’égard du conjoint furvivant, ou des héritiers
du prédécédé qui recèlent quelques effets, voye^ Recelé.
Voye[ le titre du digefte expilata hareditatis.
I lE
XPIRATION, f. f. expiratio , (Phyfîolog.) c’eft
une partie la refpiratioenff e; nct’ieefltl ec deell le’ aqâuiio fna pita fro lratiqru deelsle p so’uexmhoanles
l’air qui y a pénétré pendant l’infpiration. Voye[ Respiration.
Expiration, quand on joint l’épithete de derniere,
lignifie la même chofe que la mort. C ’eft cette dernière
aâion du corps qui s’exerce, non par une force
qui dépende de la volonté, ou qui foit l’effet de la
v ie , mais par une force qui lui eft commune avec
tous les corps , même inanimés ; ainfi l’air eft chaffé
de la poitrine dans ce dernier inftant, parce que les
forces de la v ie ceffant d’agir, Sc les mufcles inter-
coftaux étant rendus comme paralytiques par îe défaut
d’influence du fluide nerveux, les fegmens cartilagineux
des côtes, qui ont été fléchis & bandés
par l’aâion de ces mufcles , fe redreffent par leur
propre reffort, dans le moment qu’elle ceffe • ils ra-
baiflent les côtes en même tems que le diaphragme
fe relâche Sc remonte-dans la poitrine ; ce qui en diminue
la capacité en tous fens, Sc en exprime l’air
pour la derniere fois. Voye^ Mort, (d') Expiration , ( Comm.) fin du terme accordé
jugé ou convenu pour faire une choie ou pour s’acquitter
d’une dette.
On dit l’expiration d’un arrêt de furfeance, Vexpi*
ration des lettres de répi, l’expiration d’une promef-
fe , d’une lettre de change, d’un billet payable au
porteur. Dicüonn. de Commerce.
EXPIRER, ( Comm.) finir, être à la fin ou au bout
du terme, en parlant d’écrits ou de conventions, pour
l’exécution defquels il y a un terme préfix. On dit
en ce fens, votre promeffe efl expirée, il y a long-tems
que j’en attends le payement. Il faut faire fon protêt,
faute de payement d’une lettre de change, dans les
dix jours de faveur ; on court trop de rifque de les
laiffer expirer. Diclionn. de Commerce.
EXPLÉTIF, EXPLÉTIVE, adj. terme de Gram*
maire. On dit, mot explétif ( méthode greque , liv. viij.
c. xv. art. 4 .) ; Sc l’on dit, particule explétive. Servius
(Ænaid. verf. 424.) d it, expletiva conjunclio , Sc l’on
trouve dans Ifidore, liv. I. chap. x j. conjuncliones expletiva.
Au lieu d’explétif Sc d’explétive , on dit auffi ,
fuperfiu y oifif yfurabondant.
Ce mot explétif vient du latin explere , remplir. En
effet, les mots explétifs ne fervent, comme les interjetions
, qu’à remplir le difeours, Sc n’entrent
pour rien dans la conftruâion de la phrafe, dont on
entend également le fens, foit que le mot explétij
foit énoncé ou qu’il ne le foit pas.
Notre moi & notre vous font quelquefois explétifs
dans le ftyle familier ; on fe fert de m i quand on
parle à l’impératif Sc au préfent : on fe fert de vous
dans les narrations. Tartuffe, dans Moliere, acl. iij.
fc . 2. voyant Dorine , dont la gorge ne lui paroif-
foit pas affez couverte, tire un mouchoir de fa poche
, Sc lui dit :
. . . . Ah , mon Dieu , je vous prie ,
Avant que de parler , preneç-moi ce mouchoir !
Sc Marot a dit :
Faites-les moi les plus laids que Von puijfe ;
Pocher cet oeil, feffe^-moi cette cuiffe.
Enforte que lorfque je lis dans Térence ( Heaut.
aU. j. f c . 4. verf. $%. ) 9fac me ut feiam , je fuis fort
tenté de croire que ce me eft explétif en latin, comme
notre.moi en françois. ■
On a auffi plufieurs exemples du vous explétif ,
dans les façons de parler familières : il vous la prend,
& Cemporte, & c. Notre même eft fouvent explétif:
le roi y efi venu lui-même : j'irai moi-même j ce meme
n’ajoûte rien à la valeur du mot roi, ni à celle
de je .
Au troifieme livre de l’Enéide de Virgile , vers
632. Achéménide dit qu’il a vû lui-même le Cyclope
fe laifir de deux autres compagnons d’Ulyffe, ôc les
dévorer :
Vidi ÿ ego-met y duo de numéro , & c .
Où vous voyez qu’après vidi 6c après ego, la particule
met n’ajoûte rien au fens, ainfi met eft une particule
explétive, dont il y a plufieurs exemples : ego-
met narrabo ( Térence , Adelphes, acl. jv . fc . 3 . verf.
* 3 .) , & dans Cicéron, au liv. V. épitr. j x . Vatinius
prie Cicéron dè le recevoir tout enrier fous fà pro-
teâion , fufeipe me-met totum ; c’eft ainfi qu’on lit
dans les manuferits.
La fyllabe er, ajoûtée à l’infinitif paffif d’un verbe
latin,eft c.r/;/énVe,puifqu’elle n’indique ni tems,ni perfonne,
ni aucun autre accident particulier du verbe
; il eft vrai qu’en vers , elle fert à abrévier l 'i de
l’infinitif, & à fournir un daâyle au poète : c’eft la
raifon qu’en donne Servius fur ce vers de Virgile:
Dulce caput, magicas invitam accingi - er artes.
III. En. v. 4$3.
Accingier, id efi, praparari, dit Servius ; a c c ik -
OIER autem ut ad infinitum modum ER addatur , ratio
ejficit metri; nam cum in eo ACCINGI ultimafit longa ,
additâ er fyllabâ, b revis fit (Servius, ibid. ) . Mais
ce qui eft remarquable ÿ ôc ce qui nous autorife à
regarder cette fyllabe comme explétive , c’eft qu’on
en trouve auffi des exemples en proie : Vatinius
cliens y pro fe caufam D ICI ER vult. apud. Cic. liv. V.
adfamiliaresy epift.jx. Quand on ajoûte ainfi quelque
fyllabe à la fin d’un mot, les Grammairiens di-
fent que c’eft une figure qu’ils appellent paragoge.
Parmi nous , dit M. l’abbé Regnier , dans là grammaire
y pag. 565. in -4 0. il y a .auffi des particules
explétives ; par exemple , les pronoms me , te , fe t
joints à la particule en, comme quand on dit :/« men
retourne , i l s’en va ; les pronoms moi, toi, lui, employés
par répétition : s'il ne veut pas vous le dire ,
je vous le dirai, moi ; il ne n i appartient pas , à m oi, de
me mêler de vos affaires ; il lui appartient bien y à lui ,
de parler comme il fa it , &C.
Ces mots enfin , feulement ; à tout hafard, après
tout, Sc. quelqu’autres , ne doivent fouvent être regardés
que comme des mots explétifs Sc furabon-
dans, c’eft-à-dire des mots qui ne contribuent en
rien à la conftruâion ni au fens de la propofition ,
mais ils ont deux fervices.
i° . Nous avons remarqué ailleurs que les langues
fe font formées par ufage 6c comme par une efpece
d’inftinâ, 6c non après une délibération raifonnee de
Tome VI.
tout un peuple ; ainfi quand certaines façons de parler
ont été autorifées par une langue pratique, &
qu’elles font reçues parmi les honnêtes gens de la
nation, nous devons les admettre, quoiqu’elles nous
paroiffent compofées de mots redondans & combinés
d’une maniéré qui ne nous paroît pas régulière.
Avons-nous à traduire ces deux mots d’H orace,
funt quos, 6cc. au lieu de dire y quelques-uns font qui,
&c. nous devons dire, il y en a qui. Sic. ou prendre
quelqu’autre tour qui foit en ufage parmi nous.
L ’académie Françoife a remarqué que dans cette
phrafec c efi une affaire ou il y va dufalut de L'état,
la particule y paroît inutile , puifque ou fuffit pour
le fens ; mais, dit l’académie , ce font là des formules
dont on ne peut rien ôter (remarques & décifions de
l’acad. Franç. chez Coignard, 1698.) : la particule
ne eft auffi fort fouvent explétive ,6 cn e doit pas pour
cela être retranchée : j ’ai affaire , & je ne veux pas
qu'on vienne m'interrompre ; je crains pourtant.que vous L
ne venieç : que fait là ce ne ? c’efi votre venue que je
crains ; je devrois donc dire Amplement y je crains
que vous venie^ : non, dit l’académie , il efi certain 9
ajoûte-t-elle, auffi-bien que Vaugeias, Bouhours,
&c. qu’avec craindre, empêcher, & quelqu’autres verbes
, il faut néceffairement ajoûter la négative ne z
j’empêcherai bien que vous ne foyez du nombre, &c*
Remarq. & décif. de l'acad. pag. 3 o. attiCre’e cfte ltate p neéngféaet ihoanb : itude de celui qui parle , qui je ne veux pas que vous veniez
je crains y en fouhaitant que vous ne venie^ pas : mon
eeofpurrist. tourné vers la négation , la met dans le difV>
yei ce'que nous avons dit de la fyllepfe Sc de l’attraâion, au mot Construction, tom. IV .
pag. y 8 & y $ . . ' ^
Ainfi le premier fervice des particules explétives ,
c’eft d’entrer dans certaines façons de parler con-
facrées par l’ufage.
Le fécond fervice, & le plus raifonnable, c’eft de
répondre au fentiment intérieur dont on eft affeâé ,
p6rce dflei odno.n Lne’irn ateinllfiig pelnucse d eef tf oprrcoem 6pct ed ;’ éenlelerg nie’a àq lu’e’uxn- mineftnatn et fyt f ppilruist udsu qraubidleem ; pilr onmoupst uasf feefiâ e; ,m &ai sc ’leef tf ednatnis
léec hteamppse qr ulees dinurtee rcjeeâttieo nafsf,e &âi oqnu,e qnuoeu sn opuros nloanifçloonnss lpeusi fmqou’tisl se xfopnlétt uifns ,e fqfueti dfoun fte nutnime feonrtt.e d’interjeâion ,
C'ejl à vous à fortir , vous qui parler.
Moliere.
Vous qui parler eft une phrafe explétive, qui donne
plus de force au difeours.
Je l'ai vu , dis-je , vu y de mes propres yeux vû>
Ce qu'on appelle vu,
Moliere, Tartuffe, acl. v . f c .3 .
E l je ne puis du tout me mettre dans l'efprit,
Qu'il ait ofé tenter les chofes que l ’on dit. Id. ib2
Ces mots, vu de mes y eu x, du tout, font explétifs ,
& ne fervent qu’à mieux aflurer ce que l’on dit : je
ne parle pas fur le témoignage d'un autre ; je l'ai vu moi-
Vmêirmgei l;e j,e a Vu ai entendu de mes propres oreilles : Sc dans neuvième livre de l'Enéide, vers45y.
Me 9 me adfum qui fe c i, in me convertite ferrum.
Ces deux premiers me ne font là que par énergie
Sc par fentiment : elocutio efi dolore turbati, dit Servius.
( F )
EXPLICITE, adj. ( Gramm. & Théolog. ) terme
de l'école; expliqué , développé. Le contraire Sc corrélatif
eft implicite y qui lignifie ce qui n'efi pas dif-
dnclemcnt exprimé. On dit, volonté explicite , volonté
implicite.
Volonté explicite, eft une volonté bien expreffe
& bien marquée. Volonté implicite au contraire eft.
Q q >i i l