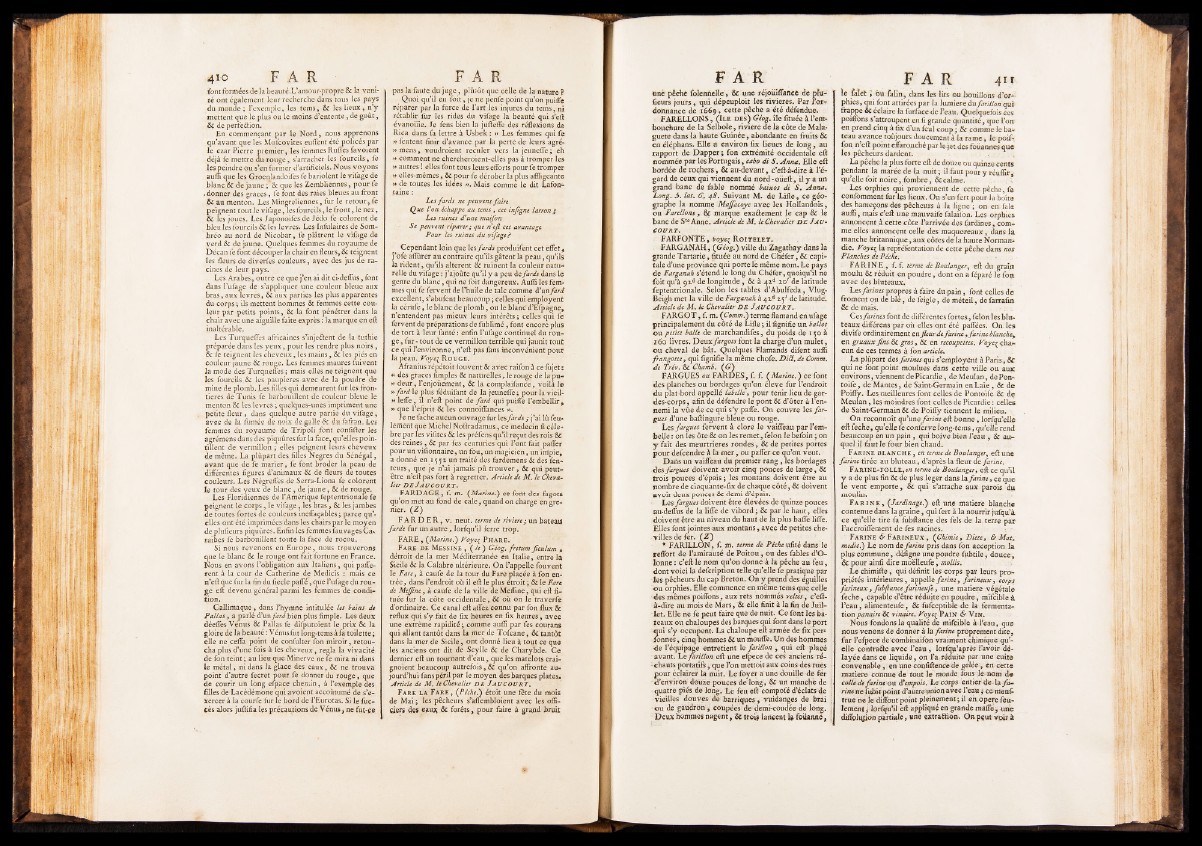
font formées de la beauté.L’amour-pïopre & la vanité
ont également leur recherche dans tous les pays
du monde; l’exemple, les tems, & les lieux, n’y
mettent que le plus ou le moins d’entente, de goût,
6c de perfection.
En commençant par le Nord, nous apprenons
qu’avant que les Molcovites euffent été policés par
le czar Pierre premier, les femmes Rufîes favoient
déjà fe mettre du rouge, s’arracher les fourcils, fe
les peindre ou s’en former d’artificiels. Nous voyons
suffi que les Groenlandoifes fe bariolent le vifage de
blanc & de jaune f & que les Zembliennes, pour fe
.donner des grâces, fe font des raies bleues au front
& au menton. Les Mingreliennes, fur le retour, fe
peignent tout le vifage, les fourcils, le front, le nez,
6c les joues. Les Japonoifes de Jédo fe colorent de
bleu les fourcils & les levres. Les Infulaires de Som-
bréo au nord de Nicobar, fe plâtrent le vifage de
verd & de jaune. Quelques femmes du royaume de
-Décan fe font découper la chair en fleurs, & teignent
les fleurs de diverfes couleurs, avec des jus de racines
de leur pays.
Les Arabes, outre ce que j’en ai dit ci-deffus, font
dans l’ufage de s’appliquer une couleur bleue aux
bras, aux levres, 6c aux parties les plus apparentes
du corps ; ils mettent hommes & femmes cette couleur
par petits points, 6c la font pénétrer dans la
chair avec une aiguille faite exprès : la marque en eft
inaltérable.
Les Turquefles africaines s’injectent de la tuthië
préparée dans les y eux, pour les rendre plus noirs,
& fe teignent les cheveux, les mains, 6c les piés en
couleur jaune 6c rouge. Les femmes maures fuivent
la mode des Turquefles ; mais elles ne teignent que
les fourcils. & les paupières avec de la poudre de
mine de plomb. Les filles qui demeurent fur les frontières
de Tunis fe barbouillent de couleur bleue le
menton 6c les levres ; quelques-unes impriment une
petite fleur, dans quelque autre partie du vifage,
avec de la fumée de noix de galle & du fafran. Les
femmes du royaume de Tripoli font confifter les
agrémens dans des piquûres fur la face, qu’elles poin-
tillent de vermillon ; elles peignent leurs cheveux
de même. La plupart des filles Negres du Sénégal,
avant que de fe marier, fe font broder la peau de
différentes figures d’animaux 6c de fleurs de toutes
couleurs. Les Négreffes de Serra-Liona fe colorent
le tour des yeux de blanc, de jaune, & de rouge.
Les Floriaiennes de l’Amérique feptentrionale fe
peignent le corps, le vifage, les bras, & les jambes
de toutes fortes de couleurs ineffaçables ; parce qu’-
élles ont été imprimées dans les chairs par le moyen
de plufieurs piquûres. Enfin les femmes fauvages Ca*.
raïbes fe barbouillent toute la face de rocou.
Si nous revenons en Europe, nous trouverons
que le blanc & le rouge ont fait fortune en France.
Nous en avons l’obligation aux Italiens, qui paffe-
rent à la cour de Catherine de Medicis : mais ce
n’eft que fur la fin du fiecle paffé, que l’ufage du rouge
eft devenu général parmi les femmes de condition.
Callimaque, dans l’hymne intitulée les bains dt
P allas , a parlé d’un fard bien plus fimple. Les deux
déeffes Vénus 6c Pallas fe difputoient le prix & la j
gloire de la beauté : Vénus fut long-tems à fa toilette ;
elle ne ceffa point de confulter fon miroir, retoucha
plus d’une fois à fes cheveux, régla la vivacité
de fon teint ; au lieu que Minerve ne le mira ni dans
le métal, ni dans la glace d.es eaux, & ne trouva
point d’autre fecret pour fe donner du rouge, que
de courir un long efpace chemin, à l’exemple des
filles de Lacédémone qui avoient accoûtumé de s’exercer
à la courfe fur le bord de l’Eurotas. Si le fuc-
cès alors juftifia les précautions de Vénus, ne fut-ce
pas la faute 4« juge, plûtôt que celle de la nature ?
Quoi qu’il en foit, je ne penfe point qu’on puiffe
réparer par la force de l’art les injures du tems, ni
rétablir fur les rides du vifage la beauté qui s’eft
évanouie. Je fens bien la jufteffe des réflexions de
Rica dans fa lettre à Usbek : « Les femmes qui fe
» fentent finir d’avance par la perté de leurs agré-
» mens, voudroient reculer vers la jeuneffe ; eh
» comment ne ehercheroient-elles pas à tromper les
» autres ! elles font tous leurs efforts pour fe tromper
» elles-mêmes, 6c pour fe dérober la plus affligeante
» de toutes les idées ». Mais comme le dit Lafon*
taine :
Les fards ne peuvent faire
Que l'on échappe au tems , cet inflgne larron ;
Les ruines d'une maifon
Se peuvent réparer; que n'efl cet avantage
Pour les ruines du vifage ?
Cependant loin que les fards produifent cet effet,
j’ofe affûter au contraire qu’ils gâtent la peau, qu’ils
la rident, qu’ils altèrent 6c ruinent la couleur naturelle
du vifage : j’ajoûte qu’il y a peu de fards dans le
genre du blanc, qui ne foit dangereux. Auffi les femmes
qui fe fervent de l’huile de talc comme d’un fard
excellent, s’abufent beaucoup ; celles qui eiftployent
la cérüfe, le blanc de plomb, ou le blanC d’Efpagne,
n’entendent pas mieux leurs intérêts ; celles qui fe
fervent de préparations de fublimé, font encore plus
de tort à leur fanté : enfin l’ufage continuel du rouge
, fur - tout de ce vermillon terrible qui jaunit tout
ce qui l’environne, n’eft pas fans inconvénient pour
là peau. V o y e { R o u g e .
Afranms répétoit fouvent & aVeC raifon à ce fujet :
« des grâces fimples & naturelles, le rouge de la pu-
» deur, l’enjoiiemeht, & la complaifance, vôiià 1©
»fard le plus féduifant de la jeuneffe; pour la vieil-
» leffe, il n’eft point de fard qui puiffe l’embellir,
» que l’efprit 6c les connoiffances >>.
Je ne fâche aucun ouvrage fur les fards ; j’ai lû feulement
que Michel Noftradamus, ce médecin fi célébré
par les vifites 6c les préfens qu’il reçut des rois 6c
des reines, & par fes centuries qui l’ont fait paffer
pour un vifionnaire, un fou, un magicien, un impie,
a donné en 1552 un traité des fardemens & des fen-
teurs, que je n’ai jamais pû trouver, 6c qui peut-
être n’eft pas fort à regretter. Article de M. le Chevalier
D E J A U CO U R T.
FARD AG E , f. m. (Marine.") ce font des fagots
qu’on met au fond de cale, quand on charge en grenier.
(Z )
F A R D E R , v . neut. terme de riviere; un bateail
farde fur un autre , lorfqu’il ferre trop.
FARE, (Marine.) Voye{ P h a r e .
F a r e d e Me s s in e , ( le ) Géog. freturh ficulum *
détroit de la mer Méditerranée en Italie, entre la
Sicile & la Calabre ultérieure. On l’appelle fouvent
le Fare, à caufe de la tour du Fare placée à fon entrée,
dans l’endroit où il eft le plus étroit ; 6c le Fare
de MeJJine, à caufe de la ville de Meffine, qui eft fi-
tuée fur la côte occidentale, & où on le traverf©
d’ordinaire. Ce canal eft affez connu par fon flux &
reflux qui s’y fait de fix heures en fix heures, avec
une extrême rapidité ; comme auffi par fes courans
qui allant tantôt dans la mer de Tofcane, 6c tantôt
dans la mer de Sicile, ont donné lieu à tout ce que
les anciens ont dit de Scylle & de Charybde. Ce
dernier eft un tournant d’eau, que les matelots crai-
gnoient beaucoup autrefois, 6c qu’on affronte aujourd’hui
fansp.éril par le moyen des barques plates.
Article de M. l e Chevalier D E J A U C O U R T .
Fa r e l a Fa r e , (Pêche.} étoit une fête du mois
de Mai ; les pêcheurs s’aflembloient avec les officier?
de? eaux & forêts, pour faire à grand bruit
ûnè pêche folenôelle, ôctme réjoui fiance de plu- '
fieurs jours, qui flépeuploif les rivières. Par l’orr
dolnnance de 1669 , cette pêché a été défendue.
FARELLONS1 ( I l e d e s ) Géog. île fituée à l’em>
bouchure de la Selbole, riviere de la côte de Mala-
guete dans la haute Guinée, abondante en fruits &
en éléphans. Elle à environ fix lieues de long, au
rapport de Dapper; fon extrémité occidentale eft
nommée par les Portugais, cabo di S. Anna. Elle eft
bordée de rochers, & au-devant, c’eft-à-dire à l’égard
de ceux qui viennent du nord- oüeft, il y a un
grand banc de fable nommé baixos di S . Anna.
Long. S . lat. f . 48. Suivant M. de L ille , ce géo- '
graphe la nomnjç Maffacoye avec les Hollandois,
ou Farellons , & marque exactement le cap & le
banc de Ste Anne. Article de M. le Chevalier DE J A V - .
C O U R T „
FARFONTE, i'oyei R o it e l e t .
FARGANAH, (Géog.) v ille du Zagathay dans la
grande Tartarie, fituée au nord de Chéfer, 6c capitale
d’une province qui porte le même nom. Le pays !
de Farganah s’étend le long dü Chéfer, quoiqu’il ne
foit qu’à 92d de longitude, & à 42e1 20' de latitude
feptentrionale. Selon les tables d’Abulfeda, Vlug-
Eeigh met la ville de Farganah à 42d x f de latitude.
Article de M . le Chevalier D E J A U C O U R T .
F A R G O T , f. m. (Comm.) terme flamand en ufâge
principalement du côté de Lille ; il lignifie un ballot
ou petite balle de marchandifes, du poids de 150 à
160 livres. Deux/argots font la charge d’un m ulet,
ou cheval de bât. Quelques Flamands difent auffi
frangotte, qui lignifie la même chofe. Dicl. de Comm.
de Trév. 6c Chqmb. (G )
FARGUES ou FARDES, f. f. (Marine.) ce font
des planches ou bordages qu’on éleve fur l’endroit
du plat-bord appellé labelle, pour tenir lieu de gardes
corps , afin de défendre le pont 6c d’ôter à l ’ennemi
la vue de ce qui s’y paffe. On couvre les far-
gues d’une baftingure bleue ou rouge.
Les f argues fervent à clore le vaiffeau par l’em-
belle : on les ôte 6c on les remet, félon le befoin ; on
y fait des meurtrières rondes, & de petites portes
pour descendre à la m er, ou paffer ce qu’on veut.
Dans un vaiffeau dü premier rang, les bordages ,
des fargues doivent avoir cinq pouces de large, 6c
trois pouces d’épais ; les montans doivent être au
nombre de cinquante-fix de chaque côté, & doivent
avoir deux pouces 6c demi d’épais.
Les fargues doivent être élevées de quinze pouces
au-deffus de la liffe de vibord ; 6c par le haut, elles
doivent être au niveau du haut de la plus baffe liffe.
Elles font jointes aux montans, avec de petites chevilles
de fer. ( Z )
* FARILLON, f. m. terme de Pêche ufité dans le
reffort de l’amirauté de Poitou, ou des fables d’O-
lonne : c’eft le nom qu’on donne à la pêche au feu,
dont voici la defeription telle qu’elle fe pratique par
les pêcheurs du cap Breton. On y prend des eguilles
ou orphies. Elle commence en même tems que celle
des mêmes poiffons, aux rets nommés veltes, c’eft-
à-dire au mois de Mars, & elle finit à la fin, de Juillet.
Elle ne fe peut faire que de nuit. Ce font lès bateaux
ou chaloupes des barques qui font dans le port
qui s’y occupent. La chaloupe eft armée de fix per*
ionnes, cinq hommes 6c un moufle. Un des hommes
de l’équipage entretient le farillon , qui eft placé
avant. Le farillon eft une efpece de ces anciens ré-
: chauts portatifs, que l’on mettoit aux coins des rues
pour éclairer la nuit. Le foyer a une douille de fer
d’environ douize pouces de long , & un manche de j
quatre piés de long. Le feu eft eompofé d’éclats de |
vieilles douves' dé barriques, vUidanges de brài ;
ou de gàudrôn, coupées de demi-coudée de long. ;
Deux hommes nagent, & trois lancent U foiîanne, .
le Jalèt 1 ôü (afin , dans les lits ou bouillons d’or*
phies, qui font attirées par la lumiere du farillon qur
frappe oc éclaire la furfaee de l’eau. Quelquefois ces
poiffons s’attroupent en fi grande quantité, que l’on
en prend cinq à fix d’un feul coup ; -&c comme le bateau
avance toujours doucement à la rame, le poif-
(°n ^eft point effarouche par le jet des foüannes que
les pêcheurs dardent.
La pêche la plus fo rte eft de douze Ou quinze cents
pendant la marée de la nuit ; il faut pour y réuffir.’
q u e lle fo it n o ir e , fom b re , & calme.
Les orphies qui proviennent de cette pêche, fe
confomment fur lçs lieux. On s’en fert pour la boîte
des hameçons des pêcheurs à la ligne ; on en fale
auffi, mais c’eft une maüvaife falaifon. Les orphies
annoncent à cette côte l’arrivée des fardines, comme
elles annoncent celle des maquereaux, dans la
manche britannique, aux côtes de la haute Norman*
die. Voye[ la représentation de cette pêche dans nos
Planches de Pêche.
FA R IN E , f. f. terme de Boulanger, eft di! grain
moulu & réduit en poudre, dont on a féparé le fon
avec des bluteaux.
"Les farines propres à faire du pain -, font celles de
froment ou de b lé, de feigle, de méteil, de farraûn
& de maïs.
Ces farines font de différentes fortes, félon les bluteaux
différens par où elles ont été paffées. On. les
divife ordinairement en fleur defarine 9farine blanche,
en gruaux fins & gros , 6c en recoupettes. Voye{ cha*
cun de ces termes à fon article.
La plupart des farines qui s’employént à Paris, &
qui ne font point moulues dans cette ville ou aux:
environs, viennent de Picardie, de Meulan, de Pon-
toife, de Mantes, de Saint-Germain en Laie , & de
Poiffy. Les meilleures font celles de Pontoife &c de
Meulan, les moindres font celles de Picardie : celles
de Saint-Germain & de Poiffy tiennent le milieu.
On reconnoît qu’une farine eft bonne, lorfqu’elle
eft feche, qu’elle fe conferve long-tems, qu’elle rend
beaucoup en un pain , qui boive bien l ’eàu , & auquel
il faut le four bien chaud.
Fa r in e BLANCHE, en terme de Boulanger, e ft une
farine tirée au b lu te au , d’après la fleur de farine.
F a r in e - f o l l e , en terme de Boulanger, eft ce qu’il
y a de plus fin & de plus leger dans la farine , ce que
le vent emporte, 6c qui s’attache aux parois du
moulin.
F a r i n e , (Jardinage.) eft une matière blanche
contenue dans la graine, qui fert à la nourrir jufqa’à
ce qu’elle tire fa fubftance des fels de la. terre par
l’accroiffement de fes racines.
F a r in e 6* F a r in e u x , (Chimie, Diete, & Mat.
medic.) Le nom de farine pris dans fon acception la
plys commune, défigne une poudre ftibtile, douce,
& pour ainfi dire moêlleufe, mollis.
L e chimifte, qui définit les corps par leurs propriétés
intérieures, appelle farine, farineux, corps
farineux , fubflanccjarineufc, une matière végétale
feche, capable d’être réduite en poudre, mifcible à
l’eau, alimenteufe, 6c fufceptible de la fermentation
panaire & vinaire. Voye^ P AI N & VlN.
Nous fondons la qualité de mifçible à l’eau, que
nous venons de donner à la farine proprement dite,
fur l’efpece de combinaifon vraiment chimique qu’elle
contracte avec l’eau , lorftra’après l’avoir délayée
dans ce liquide, on Fa,réduite par une cuite
convenable, en une confidence de gelée, en cette
matière connue de tout le monde fous le nom de
collé de farine ou d’empois. Le corps entier de - In fo rme
ne fubit point d’autre union avec l’eau ; ce menf-
true ne le diffout point pleinement ; il eh:opéré feulement
j lorfqu’il eft appliqué en grande maffé, «né
diffplmion partiale, une extraction. Onpçut voir à