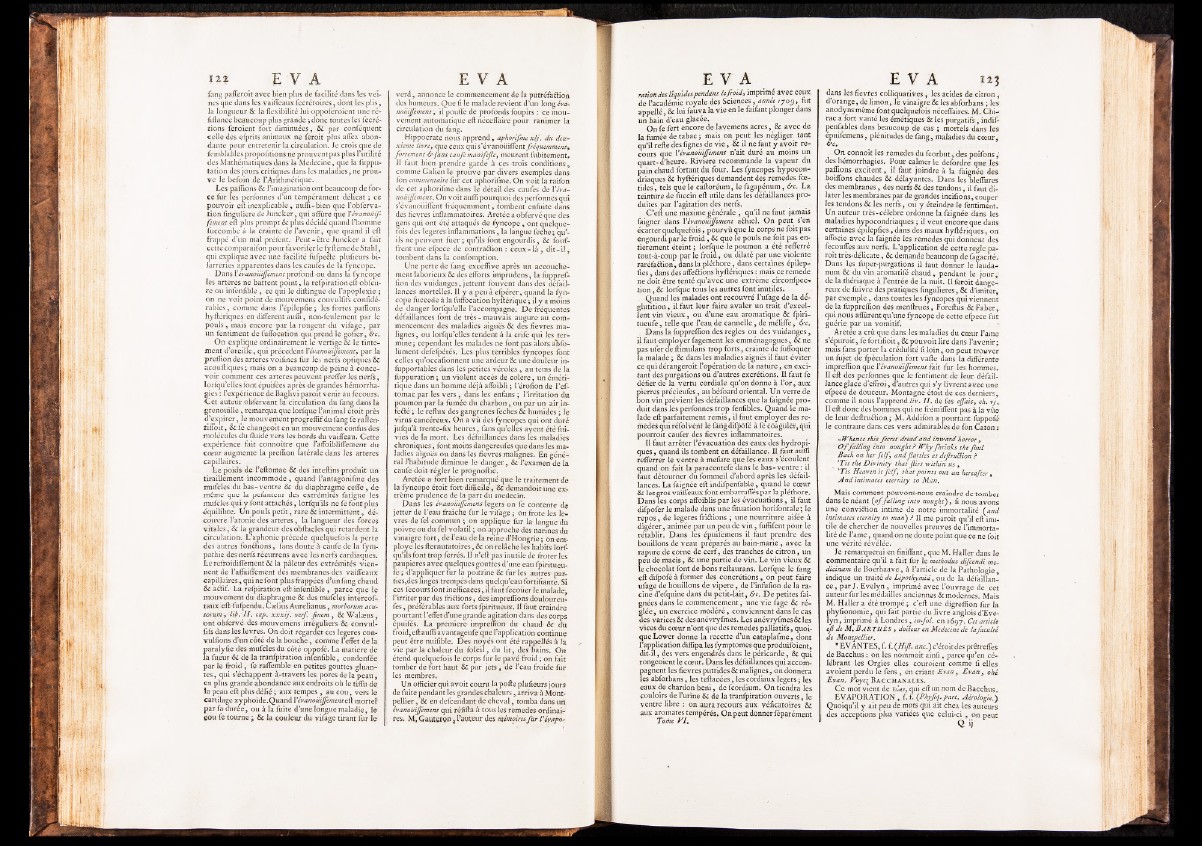
122. E V A
fang pafferoit avec bien plus de facilité dans les veines
q u e dans les vaille aux fecrétoires, dont les p lis,
la longueur & la flexibilité lui oppoferoient une ré-
fiftance beaucoup plus grande ; donc toutes les fecré-
tions feroient fort diminuées, & par conféquent
celle des efprits animaux ne feroit plus a l l e z abondante
pour entretenir la circulation. Je crois que de
f e m b l a b l e s proportions ne prouvent pas plus l’utilité
des Mathématiques dans la Medecine, que la fuppu-
tation des jours critiques dans les maladies, ne prouv
e le befoin dé l’Arithmétique.
Les pallions 6c l’imagination ont beaucoup de force
fur les perfonnes d’un tempérament délicat ; ce
pouyoir eft inexplicable, auffi-bien que l’obferva-
tion linguliere de Juncker, qui allure que Yévanoüif-
fement eft plus prompt & plus décidé quand l’homme
fuccombe à la crainte de l’avenir, que quand il eft
frappé d’un mal prélént. Peut-être Juncker a fait
cette comparaifon pour favorifçr le fyftème de Stahl,
qui explique avec une facilité liilpeâe plufieurs bi-
Jarreries apparentes dans les caufes de la fynçope.
DansT évanoüijfement profond ou dans la fyncope
les arteres ne battent point, la refpirationeft obfcu-
re ou infenlible , ce qui le diftingue de l ’ a p o p l e x i e ;
on ne voit point de mauvemens convullits confidé-
rables, comme dans l’épilepfie ; les fortes palîîons
hyAériques en different aufli, non-feulement par le
pouls, mais encore par la rougeur du vifage, par
un fentiment de fuffocation qui prend le golier, &c.
On explique ordinairement le vertige & le tintement
d’oreille, qui précèdent- Y évanoüif'ement, par la
preflion des arteres voifines fur les nerfs optiques &
acouftiques ; mais on a beaucoup de peine à concevoir
comment ces arteres peuvent preffer les nerfs,
lorfqu’elles font épuifées après de grandes hémorrhagies
: ^expérience de Baglivi par-oît venir au fecours.
C e t auteur ohferyant la circulation du fang dans la
grenouille, remarqua que lorfque l’animal étoit près
d’expirer, le mouvement progrelfifdu fang fe rallen-
liffo it, 6c fe changeoit en un mouvement confus des1
molécules du fluide vers les bords du vaiffeau. Cetté-
expérience. fait connaître que l’affoibliffement- du
coeur, augmente la preflion latérale dans les arteres
capillaires»
Le poids de l’ eftomac 6c des înteftins produit- un-
tiraillement incommode , quand l’antagonifme des
mufcles.du bas-ventre 6c du diaphragme ceffe , de
même que la pefanteur des extrémités fatigue les
mufeles.quLy font attachés, lorfqu-ils ne fefont-plus
équilibre.. Unpouls p etit, rare & intermittent, découvre.
Fatonie des arteres, la langueur des forces
vitales ;' & .la grandeur des obftacles qui retardent la
circulation. L’aphonie précédé quelquefois la perte
des autres fondions , fans doute à caufe de la fym-
pathie des nerfs.récurrens avec le,s nerfs cardiaques,
lie reffoidiffement 6c la pâleur des extrémités viennent
de Faffaiffement deà membranes des vaiffeaux
capillaires, qui ne font plus-frappées d’un fang chaud
ô ca â if. La refpiration-efh-infenfible , parce que le
mouvement du^ diaphragme & des mufelesintercof-
taux eft fufpendu. Cælius Aurelia-nus 9 morborum acu-
torum , lib.'II. cap. xxxij. verf. finem, & Walæus ,
ont obferyé- des mouvemens irréguliers & convul-
lifs dans les levres. On doit regarder ces legeres convulsions
d’un côté de la bouche, comme l’effet delà
paralyfie des mufclesdu côté oppofé. La matière de
la fueur 6c de la tranfpiration infenfible, condenfée
par le froid, fe raffemble en petites gouttes gluantes,
qui s?échappent à-travers les pores de la peau,
en plus grande abondance aux endroits oii le tiflu de
la peau eft plus délié ; aux tempes , au cou, vers le
cartilage xyphoïde.Quand l 'évanoüijfementeft mortel
par fa duree, ou à la fuite d’une longue maladie, le
gou fe tourne ; 6c la couleur du vifage tirant fur le1
E V A
verd, annonce le commencement de la putréfaéHon
des humeurs. Que fi le malade revient d ’un long éva-
noïùjj'cment, il pouffe de profonds foupirs : ce mouvement
automatique eft néeeffaire pour ranimer la
circulation du fang.
Hippocrate nous apprend, aphorifme x lj. du deuxieme
Livre y que ceux qui s’évanoiiiffent fréquemment,
fortement & fans caufe manifefe, meurent fubitement,
Il faut bien prendre garde à ces trois conditions,
comme Galien le prouve par divers exemples dans
fon commentaire fur cet aphorifme. On voit la raifon
de cet aphorifme dans le détail des caufes de Yéva-
noüiffement. On voit aufli pourquoi des perfonnes qui
s’évanoiiiffent fréquemment, tombent enfuite dans
des fievres inflammatoires. Aretée a obfervé que des
gens qui ont été attaqués de fyncope , ont quelquefois
des legeres inflammations, la langue feche ; qu’ils
ne peuvent fuer ; qu’ils font engourdis, 6c fouf-
frent une efpece de contraction : c e u x - là , dit-il j
tombent dans la confomption.
Une perte de fang exceflive après un accouchement
laborieux 6c des efforts imprudens, la fuppref-
fion des vuidanges, jettent fouvent dans des défaillances
mortelles. Il y a peu à efpérer, quand la fyncope
fuccede à la fuffocation hyftérique ; il y a moins
de danger lorfqu’elle l’accompagne. De fréquentes
défaillances font de très - mauvais augure au commencement
des maladies aiguës & des fievres. malignes
, ou lorfqu’elles tendent à la crife qui les termine
; cependant les malades ne font pas alors abfo-
liiment defefpérés. Les plus terribles fyncopes font
celles qu’oecafionnent une ardeur & une douleur in-
fupportables dans les petites véroles , au tëms de la
fuppuration ; un violent accès de colere, un éméti-
tique dans un homme déjà affoibli ; l’érofionde l ’ef-
tomac par les v e r s , dans les enfans ; l ’irritation du
poumon par la fumée du charbon, ou par un air in-
fefté ; le reflux des gangrenés feches 6c humides le
virus cancéreux. On a v u des fyncopes qui ont duré
jufqu’à t-rente-fix heures, fans qu’elles ayent été foi-
vies- de la mort. Les défaillances dans lès maladies
chroniques, font moins dangeceufes que dans les, maladies
aiguës ou dans les fievres malignes. En général
l’habitude diminue le danger, & l’ëxamen de la
caufe doit-régler le prognoftic.
Aretée a fort bien remarqué que le traitement de
la fyncope étoit fort-difficile-, & demandoit une ex?
trème prudence de là part du médecin-.
Dans les évanoüiffèmenslegers on fe contente de
jetter-de l ’eau fraîche fur le vifage; onfrote les levres
de fel commun ; on applique fur la-langue du
poivre ou du fel volatil ; omapprochedes narinesdu
vinaigre fort , de l’eau de là reine d’Hongrie ; ôn-em-
ploye les fternutatoires, 8c on relâeheles habits lorfqu’ils
font trop ferrés. Il n?eft pas inutile de froter les
paupières avec quelques gouttes d ’une eau fpiritueu-
fë ; d’appliquer fur la poitrine & fur les autres parties,
des linges trempés dans quelqu’eau fortifiante. Si
ces fecours font inefficaces, il faut fecoiier le malade*,
l’irriter par des friêtions, des impreflions-dbuloureu-
fes, préférables aux forts fpiritueux. Il faut craindre
pourtant l ’effet-d’une grande agitation dans des corps
épuifés. La première impreffton du chaud- 6c, du
froid j eft aufli avantageufe que l’application continue
peut être nuifîble. Des noyés ont été rappellës à la
vie par la chaleur du foleil, du lit , des bains. On
étend quelquefois le corps fur le pavé froid ; on fait
tomber de fort haut 6c par je ts , de l’eau froide fur
les membres.-
Un officier qui avoit couru la polie plufieurs jours
de fuite pendant les grandes chaleurs, arriva à Montpellier,
6c en defcendantde cheval, tomba dans un
évanoüijfement qui réfifta à tous les remedesordinai-
res. M, Gauteron , l’auteur des mémoires fur l'évapoe
y a
ration des liquides pendant lefroidy imprimé avec ceux
de l’académie royale des Sciences, année 1709* fut
appellé, 6c lui fauva la vie en le faifant plonger dans
un bain d’eau glacee.
On fe fert encore de Iavemens acres, & avec de
la fumée de tabac ; mais on peut les négliger tant
qu’il refte des fignes de v ie , & il ne faut y avoir recours
que Y évanoüijfement n’ait duré au moins un
quart-d’heure. Riviere recommande la vapeur du
pain chaud fortant du four. Les fyncopes hypocondriaques
6c hyftériques demandent des remedes foe-
tides, tels que le caftoréum, le fagapénum, &c. La,
teinture de fuccin eft utile dans les défaillances produites
par l’agitation des nerfs.
C ’eft une maxime générale , qu’il ne faut jamais
faigner dans Y évanoüijfement aâuel. On peut s’en
écarter quelquefois, pourvu que le corps ne foit pas
engourdi par le froid, 6c que le pouls ne foit pas entièrement
éteint ; lorfque le poumon a été refferré
tout-à-coup par le froid, ou dilaté par une violente
raréfa&ion, dans la pléthore, dans certaines épilep-
fies, dans des affections hyftériques : mais ce remede
ne doit être tenté qu’avec une extrême circonfpec»
tion, 6c lorfque tous les autres font inutiles.
Quand les malades ont recouvré l’ufage de la déglutition
, il faut leur faire avaler un trait d’excellent
vin v ieu x, ou d’une eau aromatique 6c fpiri-
tueufe, telle que l’eau de cannelle, de méliffe, &c.
Dans la fuppreffion des réglés ou des vuidanges,
il faut employer fagement les emménagogues, 6c ne
pas ufer de ftimulans trop forts, crainte de fuffoquer
la malade ; & dans les maladies aiguës i l faut éviter
ce qui dérangeroit l’opération de la nature, en excitant
des purgations ou d’autres excrétions. Il faut fe
défier de la vertu cordiale qu’on donne à l’or, aux
pierres précieufes, au béfoard oriental. Un verre de
bon vin prévient les défaillances que la faignée produit
dans les perfonnes trop fenfibles. Quand le malade
eft parfaitement remis, il faut employer des remedes
qui réfol vent le fangdifpofé à fe coaguler, qui
pourroit caufer des fievres inflammatoires.
Il faut arrêter l’évacuation des eaux des hydropiques
, quand ils tombent en défaillance. Il faut aufli
refferrer le ventre à mefure que les eaux s’écoulent
quand on fait la paracentefe dans le bas-ventre : il
faut détourner du fommeil d’abord après les défaillances.
La faignée eft indifpenfable, quand le coeur
6c les gros vaiffeaux font embarraffés par la pléthore.
Dans les corps affoiblis par les évacuations, il faut
difpofer le malade dans une fituation horifontale; le
repos, de legeres friCHons ; une nourriture aifée à
digérer, animée par un peu de v in , fuffifent pour le -
rétablir. Dans les épuifemens il faut prendre des
bouillons de veau préparés au bain-marie, avec la
rapure de corne de ce rf, des tranches de citron, un
peu de macis, 6c une partie de vin. Le vin vieux &
le chocolat font de bons reftaurans. Lorfque le fang
eft difpofé à former des concrétions, on peut faire
ufage de bouillons de v ipere, de l’infofion de la racine
d’efquine dans du petit-lait, &c. D e petites fai-
gnées dans le commencement, une vie fage & réglée
, un exercice modéré, conviennent dans le cas
des varices & des anévryfmes. Les anévryfmes&les
vices du coeur n’ont que des remedes palliatifs, quoique
Lover donne la recette d’un cataplafme, dont
l’application diflipa les fymptomes que produifoient,
dit-il, des vers engendrés dans le péricarde, & qui
rongeoient le coeur. Dans les défaillances qui accompagnent
les fievres putrides & malignes, on donnera
les abforbans, les teftacées, les cordiaux légers ; les
eaux de chardon béni, de feordium. On tiendra les
couloirs de l’urine 6c de la tranfpiration ouverts, le
ventre libre : on aura recours aux véficatoires 6c
aux aromates tempérés. On peut donner féparément
Tome VU
e y a îi?
dans les fievfeS colliquatives, les acides de citron,
d’orange, de limon, le vinaigre & les abforbans ; les
anodynsmême font quelquefois néceffaires. M. Chirac
a fort vanté les émétiques & les purgatifs, indispensables
dans beaucoup de cas ; mortels dans les
epuifemens, plénitudes de fang, maladies du coeur,
&c.
On connoit les remedes du feorbut, des poifons
des hémorrhagies. Pour calmer le defordre. que les
paflions excitent, il faut joindre à la faignée des
boiffons chaudes 6c délayantes. Dans les bleffures
des membranes, des nerfs 6c des tendons, il faut dilater
les membranes par de grandes incifions, couper
les tendons 6c les nerfs, ou y éteindre le fentiment.
Un auteur très-célébré ordonne la faignée dans les
maladies hypocondriaques ; il veut encore que dans
certaines épilepfies, dans des maux hyftériques, on
affocie avec la faignée les remedes qui donnent des
fecouffes aux nerfs. L ’application de cette regie pa-
roît tres-délicate, 6c demande beaucoup de fagacité.-
Dans les fuper-purgations il faut donner le laudanum
6c du vin aromatifé chaud, pendant le jour,:
de la thériaque à l’entrée de la nuit. Il feroit dangereux
de fuivre des pratiques fingulieres, 6c d’imiter,
par exemple, dans toutes les fyncopes qui viennent
de la fuppreffion des menftrues, Foreftus 6c Faber,
qui nous aflurent qu’iine fyncope de cette efpece fut
guérie par un vomitif.
Aretée a crû que dans les maladies du coeur l’ame
s’épuroit, fe fortifioit, & pouvoit lire dans l’avenir ;
mais fans porter la crédulité fi loin, on peut trouver
un fojet de fpéculation fort vafte dans la différente
impreflïon que Yévanoüiffement fait fur les hommes.
Il eft des perfonnes que le fentiment de leur défiail-
lance glace d ’effroi, d’autres qui s’y livrent avec une
efpece de douceur. Montagne étoit de ces derniers,
comme il nous l’apprend liv. II. de fes ejfais, ch. vj*
Il eft donc des hommes qui ne frémiffent pas à la vue
de leur definition ; M. Addifon a pourtant fuppofé
le contraire dans ces vers admirables de fon Caton :
-Whence this fecret dread and inward horror ,
O f falling into nought ? Why fhrinks the foul
Back on her felfy andfardes at defruction ?
’ Tis the Divinity that fir s within us ,
*Tis Heaven it felfy that points out an hereafter ,
And intimates eternity to Man,
Mais comment pouvons-nous craindre de tomber
dans le néant (o f falling into nought), fi nous avons
une conviction intime de notre immortalité (and
intimates eternity to man) ? Il me paroît qu’il eft inutile
de chercher de nouvelles preuves de l’immortalité
de l’ame, quand on ne doute point que ce ne foit
une vérité révélée.
Je remarquerai en finiffant, que M. Haller dans le
commentaire qu’il a fait fur le methodus difeendi me-
dicinam de Boerhaave, à l’article de la Pathologie
indique un traité de Lipothymiâ, ou de la défaillanc
e , par J. Evelyn , imprimé avec l’ouvrage de cet
auteur fur les médailles anciennes & modernes. Mais
M. Haller a été trompé ; c’eft une digrefîion fur la
phyfionomie, qui fait partie du livre anglois d’Eve-
lyn , imprimé à Londres, in-fol. en 1697. Cet article
e f de M, Ba r th e s , docteur en Medecine de la faculté
de Montpellier.
* EVANTES, f. f. (Hif. anc.) c’étoit des prêtreffes
de Bacchus : on les nommoit ainfi , parce qu’en célébrant
les Orgies elles couroient comme fi elles
avoient perdu le fens , en criant Evan, Evany ohé
Evan. Voye^ Bacchanales.
Ce mot vient de F.C*v, qui eft un nom de Bacchus.
EVAPORATION, f. f. (Phyfiq. part. Aérologie.)
Quoiqu’il y ait peu de mots qui ait chez les auteurs
des acceptions plus variées que celui-ci, on peut
q y