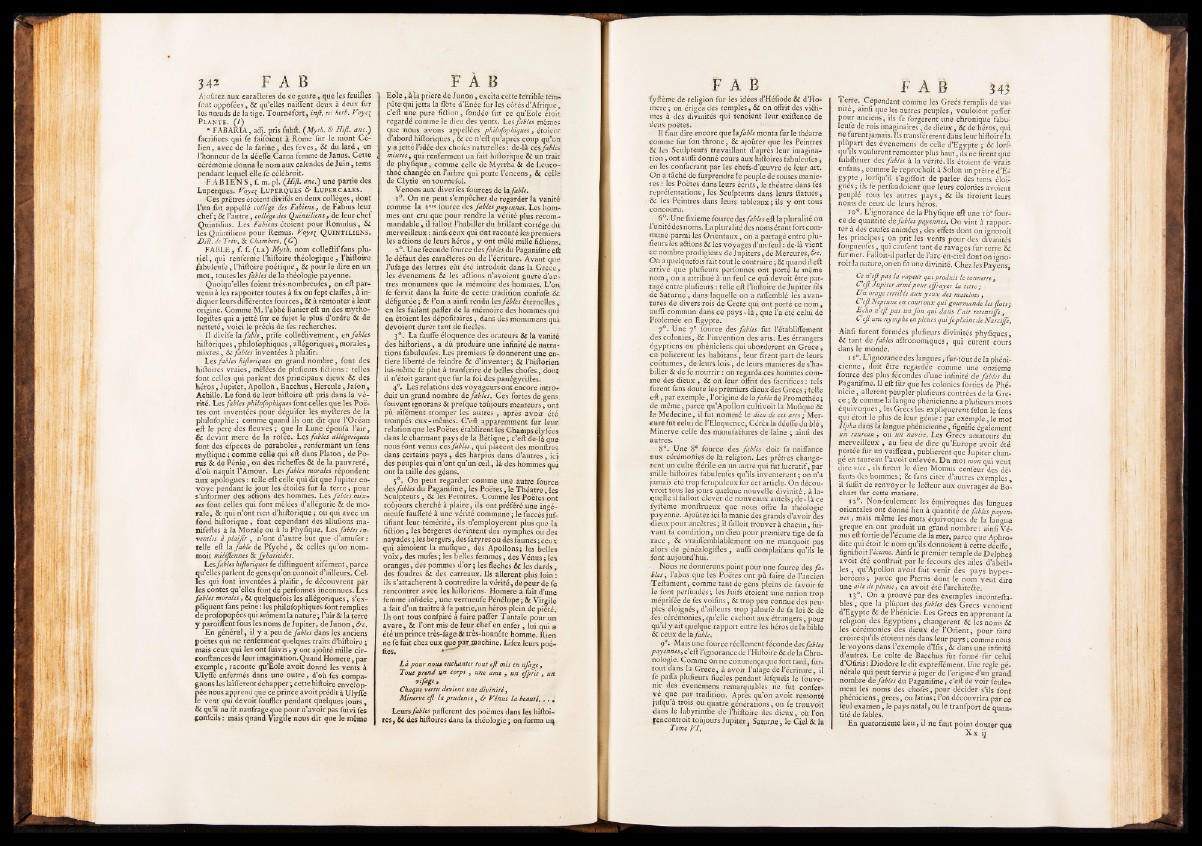
Ajoûtéz aux eara&eres de ce genre, que les feuilles
font oppofées, & qii’elles naillent deux à deux fur
les noeuds de la tige. Tournefort, injl. rei herb. V jyeç Plante. (7)
* FABARLA, adj. pris fubft. (Myth. & H f i . anc..)
fa orifices qui fe faifôient à Rome fur le mont Cé-
lien, avec de la farine , des feves, 8c du lard , en
l ’honneur de la déeffe Carna femme de Janus. Cette
cérémonie donna le nom aux calendes de Juin, tems
pendant lequel e llefe célébroit.
F A B IE N S , f. m. pl. (Hfi. anc.') une partie des
Luperques. Voye^ Luperques 6* Lupercales.
Ces prêtres étoient divifés en deux collèges, dont
l’un fut appelle collège des Fabitns, de Fabius leur
chef ; & l’autre, collège des Quintiliens, de leur chef
Quintilius. Les Fabiens étoient pour Romulus, 8c les Quintiliens pour Remus. Voyei Quintiliens.
Dicl. de Trèv. & Chambers. ((r)
FABLE, f. f, (la) Myth. nom colleftif fans pluriel
, qui renferme l’hiftoire théologique, l’hiftoire
fabuleufe, l’hiftoire poétique, 8c pour le dire en un
mot, toutes les fables de la théologie payenne.
Quoiqu’elles foient très-nombreufes, on eft parvenu
à les rapporter toutes à fix ou fept claffes, à indiquer
leurs différentes fources, 8c à remonter à leur
origine. Comme M. l’abbé Banier eft un des mÿtho-
logiftes qui a jetté fur ce fujet le plus d’ordre & de
netteté, voici le précis de les recherches.
II divife la fable, prife collectivement, en fables
hiftoriques, philofophiques, allégoriques, morales,
mixtes, & fables inventées à plaifir.
Les fables hifioriques en grand nombre, font des
hiftoires vraies, mêlées de plufieurs fictions : telles
font celles qui parlent des principaux dieux 8c des
héros, Jupiter, Apolloh, Bacchus, Hercule, Jafon,
Achille. Le fond de leur hiftoire eft pris dans la vérité.
Les fables philofophiqu.es font celles que les Poètes
ont inventées pour déguifer les myfteres de la
philofophie ; comme quand ils ont dit que l’Océan
eft le pere des fleuves ; que la Lune époufa l’air,
& devint mere de la rofée. Les fables allégoriques
font des efpeces de paraboles, renfermant un fens
myftique ; comme celle qui eft dans Platon, de Po-
rus & de Pénie, ou des richeffes 8c de la pauvreté,
d’où naquit l’Amour. Les fables morales répondent
aux apologues : telle eft celle qui dit que Jupiter env
o y é pendant le jour les étoiles fur la terre, pour
s’informer des aCtions des hommes. Les fables mixtes
font celles qui font mêlées d’allégorie & de morale,
& qui n’ont rien d’hiftorique ; ou qui avec un
fond hiftorique, font cependant des allufions ma-
nifeftes à la Morale ou à la Phyfique. Les fables inventées
à plaifir , n’ont d’autre but que d’amufer:
telle eft la fable de Pfyché, 8c celles qu’on nom-
moit milèjîennes & fybaritides.
Les fables hifioriques fe diftinguent aifément, parce
qu’elles parlent de gens qu’on connoît d’ailleurs. Celles
qui font inventées à plaifir, fe découvrent par
les contes qu’elles font de perfonnes inconnues. Les
fables moralesy & quelquefois les allégoriques, s’expliquent
fans peine : les philofophiques font remplies
de profopopées qui animent la nature ; l ’air & la terre
y paroiffent fous les noms de Jupiter, de Junon, &c.
En général, il y a peu de fables dans les anciens
poètes qui ne renferment quelques traits d’hiftoire ;
mais ceux qui les ont fuivis, y ont ajoûté mille cir-
conftances de leur imagination. Quand Homere, par
exemple, raconte qu’Eole avoit donné les vents à
Dlyffe enfermés dans une outre , d’où fes compa- I
gnons les biffèrent échapper ; cette hiftoire enveloppée
nous apprend que ce prince avoit prédit à Ulyffe
le vent qui devoit fouffler pendant quelques jours,
& qu’il ne fît naufrage que pour n’avoir pas fuivi fes
gonfeils : mais quand Virgile nous dit que le même
E o le , à la prière de Junon, excita cette terrible tem-
pête qui jetta la ffote d’Enée fur lès côtes d’Afrique,
c’eft une pure fiétion , fondée fur ce qu’Eole etoit
regardé comme le dieu des vents. 'Les fables mêmes
que nous avons appellées philofophiques, étoient
d’abord hiftoriques, & ce n ’eft qu’après coup qu’on'
y a.jetté l’idée des chofes naturelles : de-là ces fables,
' mixtes, qui renferment un fait hiftorique & un trait
de phyfique , comme celle de Myrrha & de Leuco-
i thoé changée en l’arbre qui porte l’encens, & celle
; de Clytie en tournefol.
Venons aux diver fes fource* de la fable.
ï ° . On ne peut s’empêcher de regarder la vanité
comme la ï ete fource des fables payennes. Les homf
mes ont cru que pour rendre la vérité plus recommandable
, il falloit l’habiller du brillant cortège du
merveilleux : airifi ceux qui ont raconté les premiers
les a étions de leurs héros, y ont mêlé mille fi étions.
. 2°. Une fécondé fource des fables du Paganifme eft
le défaut des eâraéleres ou de l’écriture. Avant que
l’ufage des lettres eût été introduit dans la Grèce,
les. évenemens 8c les a étions n’avoient guere d’autres
monumens que la mémoire des hommes. L’on
fe fervit dans la fuite de cette tradition confufe Sc
défigurée; & l’on a ainfi rendu les fables éternelles,
en les faifant palier de la mémoire des hommes qui
en étoient les dépofitaires, dans des monumens. qui
dévoient durer tant de fiecles.
3°. La fauffe éloquence des orateurs & la vanité
des hiftoriens, a dû produire une infinité de narra-:
lions fabuleufes. Les premiers fe donnèrent une entière
liberté de feindre 8c d’inventer; & l’hiftorie»
lui-même fe plut à tranferire de belles chofes, dont
il n’étoit garant que fur la foi des panégyriftes.
4°. Les relations des voyageurs ont encore introduit
un grand nombre de fables. Ces fortes de gens.;
fou vent ignorans & prefque toujours menteurs, ont
pu aifément tromper les autres., après avoir été
trompés eux-mêmes. C ’ eft apparemment fur leur,
relation que les Poètes établirent les Champs élyfées
dans le charmant pays de la Bétique ; c’eft de-là que.
nous font venus c es fables, qui placent des monftres.
dans certains p a y s , des harpies dans d’autres, ici
des peuples qui n’ont qu’un oe il, là des hommes qui
ont la taille des géans.
5°. On peut regarder cômme une autre fource
des fables du Paganifme, les Poètes, le Théâtre, les
Sculpteurs, & les Peintres. Comme les Poètes ont
toûjours cherché à plaire, ils ont préféré une in»é-
nieufe fauffeté à une vérité commune ; le fuccès juf-
tifiant leur témérité, ils n’employerent plus que là
fiélion ; les bergeres devinrent des nymphes ou des
nayades ; les bergers, des fatyres ou des faunes ; ceux
qui aimoient la mufique, des Apollons; les belles
v o ix , des mufes ; les belles femmes, des Vénus ; les
oranges, des pommes d’or ; les fléchés 8c les dards ,
des foudres 8c des carreaux. Ils allèrent plus loin :
ils s ’attachèrent à contredire la vérité, de peur de fe
rencontrer avec les hiftoriens. Homere a fait d’une
femme infidèle, une vertueufe Pénélope ; & Virgile
a fait d’un traître à fa patrie,un héros plein de pieté.
Ils ont tous confpiré à faire paffer Tantale pour un
avare, & l’ont mis de leur chef en enfer, lui qui a
été un prince très-fage & très-honnête homme. Rien
ne fe fait chez eux que parjjpachine. Lifez leurs poé-
fies.
Là pour nous enchanter tout ejl mis en ufage ,
Tout prend un corps , une ame , un efprit , un
vifage ,
Chaque vertu devient une divinité,
Minerve ejl la prudence, & Vénus la beauté. . .
Leurs fables pafferent des poèmes dans les hiftoi-
res, & des hiftoires dans la théologie ; on forma uq
fyftème de religion fur les idées d’Héfiode Ôc d’Ho-
mere ; on érigea des temples, 8c on offrit des viûi-
mes à des divinités qui tenoient leur èxiftence de
deux poètes.
Il faut dire encore que lafable monta furie théâtre
comme fur fon throne, 8c ajoûter que les Peintres
& les Sculpteurs travaillant d’après leiir imagina^
tion, ont auffi donné cours aux hiftoires fabuleufes,
en les confacrant par les chefs-d’oeuvre de leur art.
On a tâché de furprendre le peuple de toutes manières
: les Poètes dans leurs écrits, le théâtre dans fes
repréfentations, les Sculpteurs dans leurs ftatues,
& les Peintres dans leurs tableaux ; ils y ont tous
concouru.
■ 6°. Une fixième fource des fables eft la pluralité ou
Tu ni té des noms. La pluralité des noms étant fort commune
parmi les Orientaux, on a partagé entre plusieurs
les aéfions 8cles voyages d’un feul : de-là vient
ce nombre prodigieux de Jupiters, de Mercures,6*c.
On a quelquefois fait tout le contraire ; 8c quand il eft
arrive que plufieurs perfonnes ont porté le même
nom, on a attribué à un feul ce qui dèvoit être partagé
entre plufieurs : telle eft l’hiftoire de Jupiter fils
de Saturne , dans laquelle on a raffemblé les avan-
tures de divers rois de Crete qui ont porté ce nom,
aufii commun dans ce pays - là , que l’a été celui de
Ptolemée en Egypte.
7°. Une 7e fource des fables fut l’établiffement
des colonies, 8c l’invention des arts. Les étrangers
égyptiens ou phéniciens qui abordèrent en Grece,
«n polieerent les habitans, leur firent part de leurs
coûtumes, de leurs lois , de leurs maniérés de s’habiller
& de fe nourrir : on regarda ces hommes comme
des dieux , 8c on leur offrit des faerifices : tels
furent fans doute les premiers dieux des Grecs ; telle
eft ,-par exemple, l’origine de la fable de Promethée ;
de même , parce qu’Apollon cultivoit la Mufique 8c
la Medecine, il fut nommé le dieu de ces arts ; Mercure
fut celui de l’Eloquence, Cérès la déeffe du blé,
Minerve celle des manufactures de laine ; ainfi des
autres.
. 8°. Une 8e fource des fables doit fa naiffance
aux cérémofiies de la religion. Les prêtres changèrent
un culte ftérile en un autre qui fut lucratif, par
-mille hiftoires fabuleufes qu’ils inventèrent ; on n’a
jamais été trop fcrupuleux fur cet article. On découvrait
tous les jours quelque nouvelle divinité, à laquelle
il falloit élever de nouveaux autels; de - là ce
fyftème monftrueux que nous offre la théologie
payenne; Ajoutez ici la manie des grands d’avoir des
dieux pour ancêtres; il falloit trouver à chacun, fui-
•vant.fa condition, un dieu pour première tige de fa
r a c e , 8c vraiffemblablement on ne manquoit pas
.alors de généalogiftes , aufii complaifans qu’ils le
font aujoùrd’hui.
Nous ne donnerons point pour une fource des fables
, l’abus que les Poètes ont pû faire dé l’ancien
•Teftament, comme tant de gens pleins de fa voir fe
le font perfuadés ; les Juifs étoient une nation trop
méprifée de fes voifins, 8c trop peu connue des peuples
éloignés, d’ailleurs trop jaloufe de fa loi 8c dè
•fes cérémonies, qu’elle cachoit aux étrangers, pour
qu’il y ait quelque rapport entre les héros de la bible
8c ceux de îa fables
9°. Mais Une fource réellement féconde des fables
payennesy c’eft l’ignorance de l’Hiftoire 8c de la Chronologie.
Comme on ne commença que fort tard, fur-
tout dans la Grece, à avoir l’ufage de l’écriture, il
fe paffa plufieurs fiecles pendant lefquels le fouve-
nir des évenemens remarquables ne fut confer*
v é que par tradition. Après qu’on avoit remonté
jufqu’à trois ou quatre générations, on fe trouvoit
dans le labyrinthe de l’hiftoire des dieux, où Fon
.jencontroit toûjours Jupiter, Saturne, le Ciel 8c la
Tome, VI,
Terre. Cependant comhie les Grecs remplis de va*
nite, ainfi que les autres peuples, vouloiént paffef
pour anciens, ils fe forgèrent une chronique fabu-
leufe de rois imaginaires, de dieux, & de héros, qui
ne furent jamais. Ils transférèrent dahsleur hiftoire la
plupart des évenemens de celle d’Egypte ; 8c lorA
qu ils voulurent remonter plus haut, ils ne firent que
fubftituer des fables à la vérité. Ils étoient de vrais
enfans, comme le reprochoit à Solon un prêtre d’E-
gypte y lorfqu’il s’agiffoit dè parler des tems éloi*
gnés ; ils fe perfuadoient que leurs colonies avoient
peuple tous les autres pays ; 8c ils tiroient leurs
noms de ceux de leurs héros:
iO°. L’ignorance de la Phyfique eft une ib e four*-
ce de quantité de fables payennes, On vint à rapporter
à des caufes animées, des effets dont on ignoroit
les principes; on prit les vents pour des divinité*
fougueufes, qui caufent tant de ravages fur terre 8c
fur mer. Falloitûl parler de l’ârc-en-ciel dont on i<mo*
roit la nature,on en fit une divinité. Chez les Payens;
Ce n'ejl pas la vapeur qui produit le tonnerre ;
C eft Jupiter armé pour effrayer la terre ;
Un orage terrible aux yeux des matelots ,
C efl Neptune eh courroux qui gourmande les flots i
Écho n e f pas un fon qui dans l'air retentiffe ,
Cefl une nymphe en pleurs qui feplaiht de Narciffe*
Ainfi furent formées plufieurs divinités phyfiques ;
8c tant de fables aftronomiques ; qui eurent cours
dans le monde.
i i °. L ’igiiOrance dès langues, fur-tout de la phénicienne
, doit etre regardée comme une onzième
fource des plus fécondes d’une infinité de fables du
Paganifme. Il eft fur que les colonies forties de Phénicie
, allèrent peupler plufieurs contrées de la Gre^
ce ; 8e comme la langue phénicienne a plufieurs mot*
équivoques, les Grecs les expliquèrent félon le fens
qui étoit le plus de leur génie : par exemple, le mot
Ilpha dans la langue phénicienne, fignifie également
un taureau , ou un navire. Les Grecs amateurs du
merveilleux , au lieu de dire qu’Europe avoit été
portée fur un vaiffeau, publièrent que Jupiter changé
eh taureau l’avoit enlevée. D u mot mon qui veut
dire vice , ils firent le dieu Momus cenfeur des dé*>
fauts des hommes ; 8c fans citer d’autres exemples ,
il fuffit de renvoyer le le&eur aux ouvragés de Bo^
chart fur cette matière.
i i ° . Non-feulement les équivoques des langues
orientales ont donné lieu à quantité de fables payent
nés i mais même les mots équivoques de la Ianaué
greque en ont produit un grand norhbre: ainfi Vénus
eft fortie de l’écume de la mer, parce qüe Aphrodite
qui étoit le nom qu’ils donnoient à cette déeffe
fignifioit Xécume. Ainfi le premier temple de Delpheâ
avoit été conftruit par le fëcours des ailes d’abeilles
, qu’Apollon avoit fait venir des pays hyper-
boréens ; parce que Pteras dont le nom veut dire1
une aile de plume, en âvoit été l’architefte.
130. On a prouvé par des exemples incôntefta-
bles, que la plûpart des fables dès Grecs venoient
d’Egypte 8c de Phénicie: Les Grecs tri apprenant la
religion des Egyptiens, changèrent 8c les noms 8c
les cérémonies des dieux de l’Orient, pour faire*
croire qu’ils étoient nés dans leur pays ; comme nouâ
le voyons dans l’exemple d’Ifis, 8c dans une infinité
d’autres. Le culte de Bacchus fut formé fur celui
d’Ofiris : Diodore le dit expreffément. Une règle générale
qui peut fervir à juger de l’origine d’un grand
nombre de fables du Paganifme, c’eft de voir feulement
les noms des chofes, pour décider s’ils font-
phéniciens, grecs, ou latins ; l’on découvrira par cè
feul examen, le pays natal, ou le tranfport de quan«
tité de fables.
En quatorzième lieu, il ne faut point douter quoi
X x ij