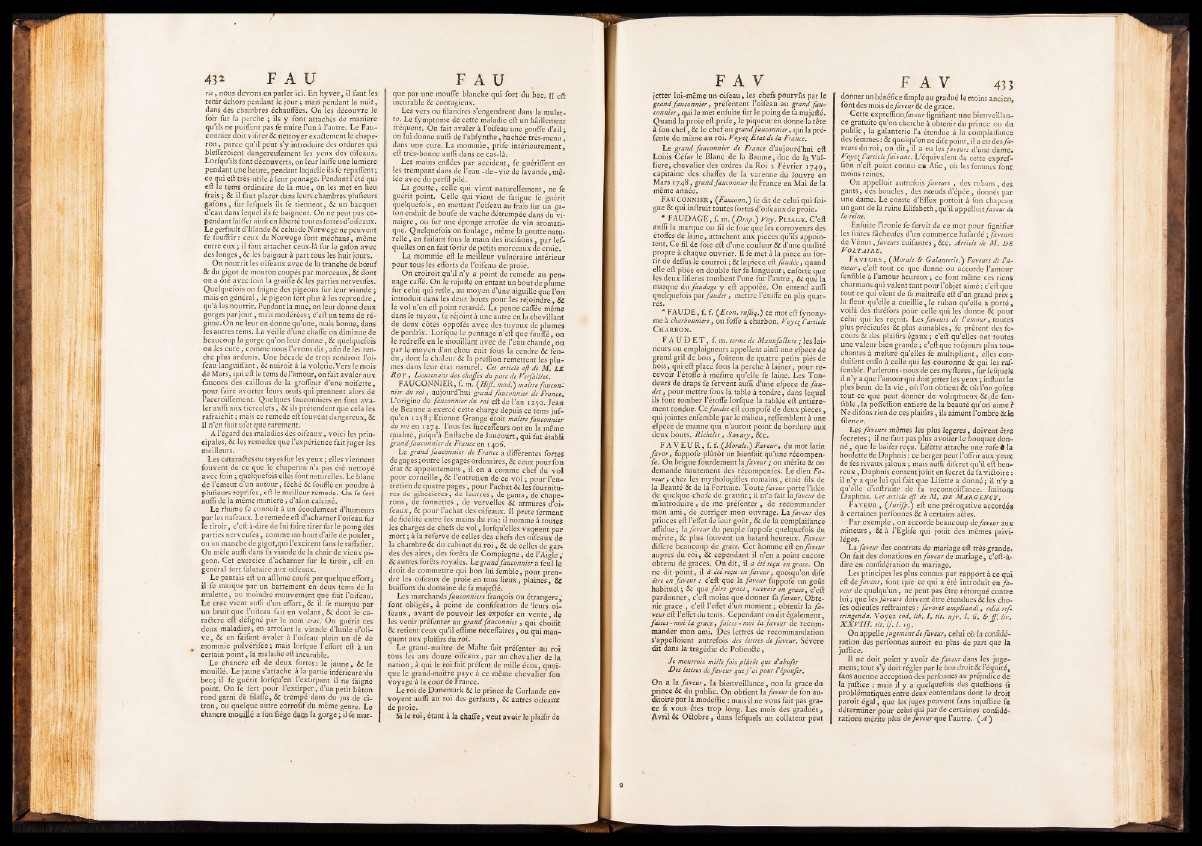
rie, nous devons en parler ici. En h y v er , il faut les
tenir dehors pendant le jour ; mais pendant la nuit,
dans dès chambres échauffées. On les découvre le
foir fur la perche ; ils y font attachés de maniéré
qu’ils ne puiffent pas fe nuire l’un à l’autre. Le Fauconnier
doit vifiter & nettoyer exactement le chaperon
, parce qu’il peut s’y introduire des ordures qui
blefferoient dangereufement les yeux des oifeaux.
Lorfqu’ils font découverts, on leur laiffe une lumière
pendant une heure, pendant laquelle ils fe repaffent ;
ce qui eft très-utile à leur pennage. Pendant l’été qui
eft le tems ordinaire de la mue, on les met en lieu
frais ; & il faut placer dans leurs chambres plufieurs
gafons, fur lefquels ils fe tiennent, & un bacquet
d’eau dans lequel ils fe baignent. On ne peut pas cependant
Iaiffer ainfi en liberté toutes fortesd’oifeaux.
Le gerfault d’ifîande & celui de Norvège ne peuvent
fe fouffrir : ceux de Norvège font méchans, même
entre eux ; il faut attacher ceux-là fur le gafon avec
des longes, & les baigner à part tous les huit jours.
On nourrit les oifeaux avec de la tranche de boeuf
& du gigot de mouton coupés par morceaux, & dont
on a ôté avec foin la graiffe & les parties nerveufes.
Quelquefois on faigne des pigeons fur leur viande ;
mais en général, le pigeon l'ert plus à les reprendre,
qu’à les nourrir. Pendant la mue, on leur donne deux
gorges par jour, mais modérées ; c’eft un tems de régime.
On ne leur en donne qu’une, mais bonne, dans
les autres tems. La veille d’une chaffe on diminue de
beaucoup la gorge qu’on leur donne, & quelquefois
on les cure, comme nous l’avons d it, afin de les rendre
plus ardents. Une bécade de trop rendroit l’oi-
feau languiffant, & nuiroit à la volerie. Vers le mois
de Mars, qui eft le tems de l’amour, on fait avaler aux
faucons des caillous de la groffeur d’une noifette,
pour faire avorter leurs oeufs qui prennent alors de
l’accroiffement. Quelques fauconniers en font avaler
aufli aux tiercelets, & ils prétendent que cela les
rafraichit ; mais ce remede eft fouvent dangereux, &
il n’en faut ufer que rarement.
A l’égard des maladies des oifeaux, voici les principales,
&c les remedes que l’expérience fait juger les
meilleurs.
Les cataraâes ou tayes fur les yeux ; elles viennent
fouvent de ce que le chaperon n’a pas été nettoyé
avec foin ; quelquefois elles font naturelles. Le blanc
de l’émeut d’un autour, féché & foufflé en poudre à
plufieurs reprifes, eft le meilleur remede. On fe fert
aufli de la même maniéré, d’alun calciné.
Le rhume fe connoît à un écoulement d’humeurs
par les nafeaux. L e remede eft d’acharner l’oifeau fur
le tiroir, c’eft à-dire de lui faire tirer fur le poing des
parties nerveufes, comme un bout d’aile de poulet,
ou un manche de gigot,qui l’excitent fans le raffafier.
On mêle aufli dans fa viande de la chair de vieux pigeon.
Cet exercice d’acharner fur le tiroir, eft en
général fort falutaire aux oifeaux.
Le pantais eft un afthme caufé par quelque effort;
il fe marque par un battement en deux tems de la
mulette, au moindre mouvement que fait l’oifeau.
Le crac vient aufli d’un effort, & il fe marque par
un bruit que l’oifeau fait en volant, & dont le ca-
raftere eft défigné par le nom crac. On guérit ces
deux maladies, en arrofant la viande d’huile d’oliv
e , & en faifant avaler à l’oifeau plein un dé de
mommie pulvérifée ; mais lorfque l’effort eft à un
certain point, la maladie eft incurable.
Le chancre eft de deux fortes : le jaune, & le
mouillé. Le jaune s’attache à la partie inférieure du
bec; il fe guérit lorfqu’en l’extirpant il ne faigne
point. On fe fert pour l’extirper, d’un petit bâton
rond garni de filafîe, & trempé dans du jus de citron,
ou quelque autre corrofif du même genre. Le
chancre mouillé a fiége da.Q$ la gorge ; il fe marque
par une moufle blanche qui fort du bec. Il eft
incurable & contagieux.
Les vers ou filandres s’engendrent dans la mulet-
te. Le fymptome de cette maladie eft un bâillement
fréquent. On fait avaler à l’oifeau fine gouffe d’ail ;
on lui donne aufli de l’abfynthe, hachée très-menu,
dans u n e cure. La mommie, prife intérieurement,
eft très-bonne aufli dans ce cas-là.
Les mains enflées par accident, fe guériffent en
les trempant dans de l’eau-de-vie de lavande,mêlée
avec du perfil pilé.
La goutte, celle qui vient naturellement, ne fe
guérit point. Celle qui vient de fatigue fe guérit
quelquefois, en mettant l’oifeau au frais fur un galon
enduit de boufe de vache détrempée dans du vinaigre
, ou fur une éponge arrofée de vin aromatique.
Quelquefois on foulage, même la goutte naturelle
, en faifant fous la main des incifions, par lef-
quelles on en fait fortir de petits morceaux de craie.
La mommie eft le meilleur vulnéraire intérieur
pour tous les efforts de l’oifeau de proie.
On croiroit qu’il n’y a point de remede au pennage
cafte. On le rajulle en entant un bout déplumé
fur celui qui refte, au moyen d’une aiguille que l’on
introduit dans les deux bouts pour les rejoindre, &
le vol n’en eft point retardé. La penne caffée même
dans le tuyau, fe réjoint à une autre en la chevillant
de deux côtés oppofés avec des tuyaux de plumes
de perdrix. Lorfque le pennage n’eft que fauffé, on
le redreffe en le mouillant avec de l’eau chaude, ou
par le moyen d’un chou cuit fous la cendre & fendu
, dont la chaleur & la preflïon remettent les plumes
dans leur état naturel. Cet article eft de M. LE
Roy , Lieutenant des chaffes du parc de Verfailles.
FAUCONNIER, f. m. (Hift. mod.) maître faucon-
nier du roi, aujourd’hui grand fauconnier de France^
L’origine de fauconnier du roi eft de l ’an 1250. Jean
de Beaune a exercé cette charge depuis ce tems juf-
qu’en 1258 ; Etienne Grange etoit maître fauconnier
du roi en 1174. Tous fes fucceffeurs ont eu la même
qualité, jufqu’à Euftàche de Jaucourt, qui fut établi
grand fauconnier de France en 1406.
Le grand fauconnier de France a différentes fortes
de gages ; outre les gages ordinaires, & ceux pour fon
état & appointemens, il en a comme chef du vol
pour corneille , & l’entretien de ce vol ; pour l’entretien
de quatre pages, pour l’achat & les fournitures
de gibecières, de leurres, de gants, de chaperons
, de fonnettes , de vervelles & armures d’oi-
feaux, & pour l’achat des oifeaux. Il prete ferment
de fidélité entre les mains du roi: il nomme à toutes
les charges de chefs de v o l , lorfqu’elles vaquent oar
mort ; à la referve de celles des chefs des oifeaux* de
la chambre & du cabinet du ro i, & de celles de gardes
des aires, des forêts de Compiegne, de l’Aigle
& autres forêts royales. L e grand fauconnier a feul le
droit de commettre qui bon lui femble, pour prendre
les oifeaux de proie en tous lieux, plaines, &c
buiflons du domaine de fa majefté.
Les marchands fauconniers françois ou étrangers
font obligés, à peine de confifcation de 'leurs oifeaux
, avant de pouvoir les expofer en v ente, de
les venir préfenter au grand fauconnier , qui choifit
& retient ceux qu’il eftime néceffaires, ou qui manquent
aux plaifirs du roi.
Le grand-maître de Malte fait préfenter au roi
tous les ans douze oifeaux, par un chevalier de la
nation, à qui le roi fait préfent de mille écus, quoique
le grand-maître paye à ce même chevalier fon
voyage à la cour de France.
Le roi de Danemark & le prince de Curlande envoyait
aufli au roi des gerfauts, & autres oifeaux
de proie.
Si le roi, étant à la chaffe, veut avoir le plaifir de
jetter lui-même un oifeau, les chefs pourvus par le
grand fauconnier , préfent ent l’oifeau au grand fauconnier
, qui le met enfuite fur le poing de famajefté.
Quand la proie eft prife, le piqueur en donne la tête
à fon chef, & le chef au grand fauconnier., qui la préfente
de même au roi. Voye^ Etat de la France.
Le grand fauconnier de France d’aujourd’hui eft
Loüis Céfar le Blanc de la Baume, duc de la Val-
liere, chevalier des ordres du Roi 2 Février 1749,
capitaine des chaffes de la varenne du louvre en
Mars 1748, grand fauconnier de France en Mai de la
même année.
Fa u c o n n ie r , (Fauconn.) fe dit de celui qui foi-
gne & qui inftruit toutes fortes d’oifeaux de proie.
* FAUDAGE, f. m. (Drap.) Voy. P l i a g e . C ’eft
aufli la marque ou fil de foie que les corroyeurs des
étoffes de laine, attachent aux pièces qu’ils appointent.
C e fil de foie eft d’une couleur & d’une qualité
propre à chaque ouvrier. Il fe met à la piece au for-
tir de deffus le courroi ; & la piece eft faudée, quand
elle eft pliée en double fur fa longueur; enforte que
les deux lifieres tombent l’une fur l’autre, & que la
marque du faudage y eft appofée. On entend aufli
quelquefois par fauder , mettre l’étoffe en plis quar-
rés.
* FAUDE, f. f. (’ Econ. ruftiq.) ce mot eft fynony-
me à charbonnière , ou foffe à charbon. Voyefl'article
C h a r b o n .
F A U D E T , f. m. terme de Manufacture ; les lai—
neurs ou emplaigneurs appellent ainfi une efpece de
grand gril de bois, foûtenu de quatre petits piés de
bois, qui eft placé fous la perche à lainer, pour recevoir
l’étoffe à mefitre qu’elle fe laine. Les Tondeurs
He draps fe fervent aufli d’une efpece de faudet,
pour mettre fous la table à tondre, dans lequel
ils font tomber l’étoffe lorfque la tablée eft entièrement
tondue. Ce faudet eft compofé de deux pièces,
qui jointes enfemble par le milieu, reffemblent à une
efpece de manne qui n’auroit point de bordure aux
deux bouts. Richelet, Savary, & c .
F A V E U R , f. f. (Morale.') Faveur, du mot latin
favor, fuppofe plûtôt un bienfait qu’une réeompen-
fe. On brigue fourdementla faveur ; on mérite & on
demande hautement des récompenfes. Le dieu Faveur,
chez les mythologiftes romains, étoit fils de
la Beauté & de la Fortune. Toute faveur porte l’idée
de quelque chofe de gratuit ; il m’a fait la faveur de
m’introduire, de me préfenter , de recommander
mon ami, de corriger mon ouvrage. La faveur des
princes eft l’effet de leur goût, & de la complaifance
aflidue ; la faveur du peuple fuppofe quelquefois du
mérite, & plus fouvent un hafard heureux. Faveur
différé beaucoup de grâce. Cet homme eft en faveur
auprès du ro i, & cependant il n’en a point encore
obtenu de grâces. On d it, il a été reçu en grâce. On
ne dit point, il â été reçu en faveur, quoiqu’on dife
être en faveur : c’eft que la faveur fuppofe un goût
habituel ; & que faire grâce, recevoir en grâce, c’eft
pardonner, c’eft moins que donner fa faveur. Obtenir
grâce , c’eft l’effet d’un moment ; obtenir la faveur
eft l’effet du tems. Cependant on dit également,
faites - moi la grâce , faites - moi la faveur de recommander
mon ami. Des lettres de recommandation
s’appelloient autrefois des lettres de faveur. Sévere
dit dans la tragédie de Polieuéle,
Je mourrois mille fois plûtôt que dfabufcr
JDes lettres de faveur que f a i pour V époufer'.
On a la faveur, la bienveillance, non la grâce du
prince & du public. On obtient la faveur de fon auditoire
par la modeftie : mais il ne vous fait pas grâce
fi vous êtes trop long. Les mois des gradués,
yVvril ôc Oûobre, dans lefquels un collateur peut
donner un bénéfice fimple au gradué le moins ancien,
font des mois de faveur & de grâce.
Cette expreflion faveur fignifiant une bienveillance
gratuite qu’on cherche à obtenir du prince ou du
public, la galanterie l’a étendue à la complaifance
des femmes : & quoiqu’on ne dife point, il a eu des fa veurs
du roi, on dit, il a eu les faveurs d’une dame»
Vjyei l'article fuivant. L’équivalent de cette expref-
fion n’eft point connu eu Afie, où les femmes font
moins reines.
On appelloit autrefois faveurs , des rubans, des
gants, des boucles, des noeuds d’épée, donnés par
une dame. Le comte d’Effex portoit à fon chapeau
un gant de la reine Elifabeth, qu’il appelloit faveur de
la reine.
Enfuite l’ironie fe fervit de ce mot pour lignifier
, les fuites fâcheufes d’un commerce hafardé ; faveurs
de Vénus, faveurs cuifantes, & c . Article de M. d e
V o l t a i r e .
F a v e u r s , (Morale & Galanterie.) Faveurs de Ûa-
mour, c’.eft tout cè que donne ou accorde l’amour
fenfible à l’amour heureux ; ce font même ces riens
charmans qui valent tant pour l’objet aimé : c’eft que
tout ce qui vient de fa maîtreffe eft d’un grand prix ;
la fleur qu’elle a cueillie, le ruban qu’elle a porté,
voilà des thréfors pour celle qui les donne ôc pour
celui qui les reçoit. Les faveurs, de l'amour, toutes
plus précieufes & plus aimables, fe prêtent des fe-
cours & des plaifirs égaux ; c’eft qu’elles ont toutes
une valeur bien grande ; c’eft que toûjours plus touchantes
à mefure qu’elles fe multiplient, elles con-
duifênt enfin à celle qui les couronne & qui les raf-
fembîe. Parlerons - nous de ces myfteres, fur lefquels
il n’y a que l’amour qui doit jetter les yeux ; inftant le
plus beau de la v ie , où l’on obtient & où l’on goûte
tout ce que peut donner de voluptueux ôcide fenfible
, la poffeflion entière de la beauté qu’oiï aime ?
Ne difons rien de ces plaifirs, ils aiment l’ombre & le
filence.
Les faveurs mêmes les plus legeres, doivent être
fecretês ; il ne faut pas plus avoiier le bouquet donné
, que le baifer reçu. Lifette attache une rofe ê la
houlette de Daphnis : ce berger peut l’offrir aux yeux
de fes rivaux jaloux ; mais aufli difcret qu’il eft heureux
, Daphnis content joiiit en fecret de fa vi&oire :
il n’y a que lui qui fait que Lifette a donné ; il n’y a
qu’elle d’inftruitp. de la reconnoiffance. Imitons
Daphnis. Cet article eft de M . d e M a r G e n c y .
F a v e u r , (Jurifp.) eft une prérogative accordés
à certaines perfonnes & à certains aftes.
Par exemple, on accorde beaucoup de faveur aux
mineurs, & à l’Eglife qui jouit des mêmes privilèges.
La faveur des contrats de mariage eft très-grande.
On fait des donations en faveur de mariage, c’eft-à-
dire en confidération du mariage.
Les principes les plus connus par rapport à ce qui
eft de faveur, font que ce qui a été introduit en faveur
de quelqu’un, ne peut pas être rétorqué contre
lui ; que les faveurs doivent être étendues & les cho-
fes odieufes reftraintes : favores ampliandi, odia reft
tringenda. Voyez cod. lib, I . tit. xjv. I. 6. b ff. lïv.
X X V I I I . tit. i j . l . iÿ.
On appelle jugement de faveur, celui où la confidération
des perfonnes auroit eu plus de part que la
juftice.
Il ne doit point y avoir de faveur dans les juge-
mens; tout s’y doit régler par le bon droit & l’équité,
fans aucune acception des perfonnes au préjudice de
la juftice : mais il y a quelquefois des queftions fi
problématiques entre deux cohtendans dont le droit
paroît éga l, que les juges peuvent fans injuftice fe
déterminer pour celui qui par de certaines confidé-
rations mérite plus défaveur que l’autre. (A )