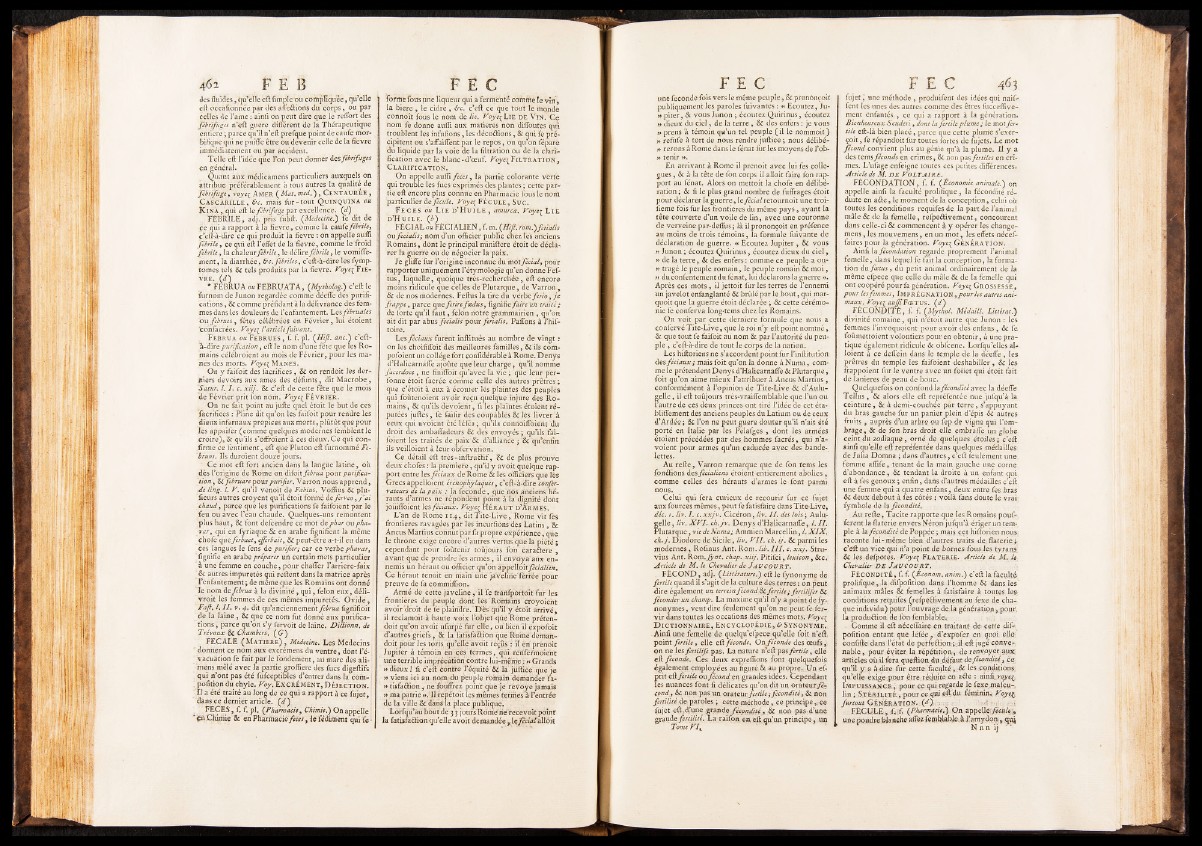
des fluides, qu’ elle eft fimple t>u compliquée, qü’ elle
eft occàfionnèe par des afteftions du corps, ou par
eelles de l’ame : ainfi on peut dire que le reffort des
fébrifuges n’èft guere différent de la Thérapeutique
entière ; parce qu’il n’eft prefque point de caufe morbifique
qui ne puifle être ou devenir celle de la fîevre
immédiatement ou par accident.
Telle eftT’idee que l’on peut donner dès fébrifuges
en général.
Quant aux médicamens particuliers auxquels on
attribue préférablement à tous autres la qualité de
fébrifuge9 voye£ AMER (M a t . med.) , CENTAUREE,
C a's c à r i l l e , & c. mais fur-tout Q u in q u in a o u
K in â , qui eft le fébrifuge par excellence. (d)
FÉBRILE, adj. pris fubft. (Medecfie.) fe dit de
ce ,qui a rapport à la fievre ,comnïe la eau (e febrile,
ç’eft-à-dire ce qui produit la fievre : on appelle aufli
febrile, ce qui eft l’effét de la fievre, comme le froid
fébrile, la chaleurfébrile, le délire fébrile, le vo'miffe-
nient, la diarrhée, &c. fébriles, c’eft-à-dire lés fymp-
tômes tels & tels produits par la fievre. Voye{ F ie v
r e . (d)
* FEBRUA ou FEBRUATA, (.Mytholpg.) c’eftle
fufnôm de Junon regardée comme déëffe dés purifications
, & comme préfidant à la délivrance des femmes
dans les douleurs de l’enfantement. Lés fébruales
ou februes, fêtes célébrées en Février, lui étoient
confàcréës. Voye[ Varticle fuivant.
F e b r u a ou F e b r u e s , f. f. pl. (Hiß. anc.) c’eft-
;à-dire purification, eft le nom d’une fête que ies Romains
célébroient au mois de Février, pour les mânes
des morts. Voye{ Mâ n e s .
On y faifoit des facrifices , & on rendoit les derniers
devoirs aux âmes des défunts, dit Macrobe,
Satur. 1. 1. c. xiij. & c’eft de cette fête que le mois
de Février prit fon nom. Voye{ FÉVRIER.
On ne fait point au Julie quel étoit le but de ces
facrifices : Pline dit qu’on les faifoit pour rendre les
dieux infernaux propices aux morts, plutôt que pour
lés appaifer (comme quelques modernes femblentle
croire), & qu’ils s’offroient à ces dieux. Ce qui confirme
ce ïentiment, eft que Pluton eft furnommé Fe-
bruos. Ils duroient douze jours.
‘ Ce mot eft fort ancien dans la langue latine, oîi
dès l’origine de Rome on difoit februa pour purification,
Scfebruare pour purifier. V arronnous apprend,
de ling. I. V. qu’il venoit de Fabius. Voflius & plusieurs
autres croyent qu’il étoit formé de ferveo , f a i
chaud, parce que les purifications fe faifoient par le
feu ou avec l’eau chaude. Quelques-uns remontent
plus haut, & font defeendre ce mot dephar oupha-
yar, qui en fyriaque & en arabe lignifient la même
chofe que ferbaet, efferbait, & peut-être a-t-il eu dans
. ces langues le fens de purifier; car ce verbe phavar,
'lignifie en arabe préparer un certain mets particulier
à une femme en couche, pour chaffer l’arriere-faix
& autres impuretés qui relient dans la matrice après
l ’enfantement ; de meme qùé les Romains ont donné
~Ie nom d e februa à la divinité, qui, félon eux, déli-
vroit lès femmes de ces mêmes impuretés. O v id e,
'Faß. I. II. v. 4. dit qu’anciennement februa fignifioit
de la laine , & que ce nom fut donné aux purifications
, parce qu’on s’y férvoit de laine. Diclionn. de
Trévoux & Chambers. (C )
FECALE (M a t iè r e ) , Medecine. Les Médecins
donnent ce nom aux excrémens du ventre, dont l’é- ;
vâcuâtion fe fait par le fondement, aii marc des ali-
mens mêlé avec la partie grofîiere des fucs digeftifs
qui n’ont pas été füfceptibles d’entrer dans la com-
pöfition du chyle. Voy. Ex c r é m e n t , D é j e c t io n .
Il a été traité au long de ce qui a rapport à ce fujet,
dans ce dernier article, (d )
FECES, f. f. pl. (Pharmacie, Chimie.) On appelle !
en Chimie & en Pharmacie feces, le fédiment qui f e ;
forme fous pne liqueur qui a fermenté cofiithe le v in *
la biere , le cidre , &c. c ’eft ce que fo u t le monde
con noît foiis le nom de lie. Voyeç L ié DE V in . C e
nom fe donne àùfli aux matières hon diffoiifés qui
troublent les infufîons, les d é co d ion s , & qui fe précipitent
ou s’affaiffent par le rep os , ou qu’on fépârè
du liquide par là v o ie de la filtration ou de la clarification
a v e c le b la n c -d ’oeuf. Voyc^ Fi l t r a t io n ,
C l a r i f i c a t io n .
On appelle aufli feces, la partie colorante verte
qui trouble les fucs exprimés des plantes ; cette par--
tie eft encore plus connue en Pharmacie fous lè nom
particulier de fécule. Voyeç FÉCULE, Suc.
F e c e s ó u L i e d ’ H ü i l e , dfnürcà. Voyez L i e
d ’H u i l ë . ( f i )
FÉCIAL ou FÉCIÀLIEN, f. m. (Hifi. röm.) fiti'àlts
ou fecialis; nom d’un officier public chez les anciens
Romains, dont le principal miniftërè étoit de décla-.
rer la guerre ou de négocier la paix.
Je gliffe fur l’origine inconnue du mot fécial, pour
rapporter uniquement l’étymologie qu’en donne Féfi
tus, laqüélle, quoique très-recherchée, eft encore
moins ridicule que celles de Plutarque, de VarrOn ,
& de nos modernes. Feftus la tire du vèrbefe r io ,je
frappe, parce que ferire fotdus, fignifie faire un traité ;
de forte qu’il faut, félon notre grammairien , qu’on
ait dit par abus fecialis‘pour ferialis. Paffons à i’hif-
toire.
Les féciaux furent inftitués au nombre de vingt :
on les choififfoit'des meilleures familles, 6cils com-
pofoient un collége fort confidéràble à Rome. Dériys
d’Halicarnaffe ajoûte que leiir charge, qu’il nomme
facerdoce , ne finiffoit qu’avec la vie ; que leur për-
fonne étoit facrée comme celle dés autres1 prêtres ;
que c’étoit à eux à écouter lés plaintes dés peuplés
qui foûtenoient avoir reçu quelque injure des Romains,
& qu’ils dévoient, files plaintes étoient réputées
juftes, fe fiiifir des coupables & les livrer à
ceux qui a voient été léfés ; qu’ils Conrioifloieiit du
droit des ambaffadeurs & des envoyés ; qu’ils faifoient
les traités de paix & d’àlliàhce ; & qu’enfin.
ils veillôient à leur ôbférvation.
Ce détail éft très-ihftruclif, de plus prouve
deux chofés :1a prëmiefe, qu’il y avoit quelque rapport
entre les féciaux de Rome & les officiers que lés
Grecs appèlloient érénophylaques, c’eft-à-dire cônfer-
vateurs de la paix : la fécondé, que hós anciens hérauts
d’armes ne fëpohdènt point à'la dignité dont
joüiffoient les féciaux. Voye^ H é r a u t D’A r m e s .
L’an de Rome 1 14 , dit T ite-Live, Rome Vit fes
frontières ravagéés par lés incûrfiôns dès Latins , &
Ancus Martius connut par fa propre expérience, que
le throne exige èncôré'd’autres vèrfus que la piété ;
cependant pour fouténir toujours fon carâétere ,
avant que de prendre Tes armés, il envqya aux ennemis
un héraut ou officier qu’on àppelloit féciàlièn.
Ce héraut tenôit en mam'ïïrié javeline'ferrée pour
preuve de fa commiflion.
Armé de cette jàvéline, il Te tràhfpôftôit fur les
frontières du .peuple dont lès RÖrTfains cfóyoient
avoir droit de fé plaindre.’Dës qii’il y étoit arrivé,
il reclamoit à haute vo ix l’objet qüe Rofne préten-
doit qu’on avdit iifùrpé fur elle, ou Bien il éxpofoit
d’autres.griefs, & la fatîsfàélion qûé Romédèman-
doit pour les torts qii’élle avoit reçus : iî en prènoit
Jupiter à témoin en çés termes, qui'rehfefmoieht
une terrible imprécation contre lùi-rnême ; « Grands
» ’dieux ! fi c’éff èôntre l ’êcjuité'ôc Tâ‘ jüfficé.que je
» viens ici au. nom,' du peuple rôlnâin demander fa-
» tisfaélion, ne fouffrez point que je révo'ye jamais
» ma, patrie ». Il repétoit les mêmes ternies à l’entrée
de là ville & dânsia place publique.
Lôrfqü’au bout de 3 3 jbtirslRóme''né f ece voit point
la fattsraétion qu’elle avoit demandée ,dçjÇ«Wàllôit
une fécondé fois vers le même peuple, & ptonônçoit
publiquement les paroles fuivantës,: « Ecoutez, Ju-
» p iter, & vous Junon ; écoutez Quirinus, écoutefc
» dieux du ciel, de la terre, & des enfers : je vous
» prens ’à témoin qu’un tel peuple ( il le nommoit )
» refufe à tort de nous rendre juftice ; nous délibé-
» rerons à Rome dans le fénat fur les moyens de l’ob-
» tenir ».
En arrivant à Rome il prenoit avec lui fes collègues
, & à la tête de fon corps il alloit faire fon rapport
au fénat. Alors on mettoit la .chofe en délibération
; & fi le plus grand nombre de fuffrages étoit
pour déclarer la guerre, le fécial retournoit une troi-
fieme fois fur les frontières du même pa ys, ayant la
tête couverte d’un voile de lin, avec une couronne
de verveine par-deflus; là il prononçoit en préfence
au moins de trois témoins, la formule fuivante de
déclaration de guerre. « Ecoutez Jupiter , & vous
» Junon ; écoutez Quirinus, écoutez dieux du c ie l,
» de la terre, & des enfers : comme ce peuple a ou-
» tragé le peuple romain, le peuple romain & moi,
» duconfentementdu fénat, lui déclarons la guerre ».
Après ces mots , il jettoit fur les terres de l’ennemi
un javelot enfanglanté & brûlé par le bout, qui mar-
quoit que la guerre étoit déclarée ; & cette cérémonie
fe conferva long-tems chez.les Romains.
On voit par cette derniere formule que nous a
confervé Tite-Live, que le roi n’y eft point nommé,
& que tout fe faifoit au nom & par l’autorité du peuple
, c’eft-à-dire de tout le corps de la nation.
Les hiftoriens ne s’accordent point fur l’inftitution
des féciaux; mais foit qu’on la donne à Numa, comme
le prétendent Denys d’Halicarnalfe & Plutarque,
foit qu’on aime mieux l’attribuer à Ancus Martius,
conformément à l’opinion de Tite-Live & d’Aulu-
gelie, il eft toujours très-vraiffemblable que l’un ou
l’autre de ces deux princes ont tiré l’idée de cet éta-
bliffement des anciens peuples du Latium ou de ceux
d’Ardée ; & l’on ne peut guere douter qu’il n’ait été
porté en Italie par les PélafgeS j dont, les armées
étoient précédées par des. hommes facrés, qui n’a-
voient pour armes qu’un caducée avec des bande-,
lettes.
Au refte, Vàrron remarque que de fon tems les
fondions des fécialiens étoient entièrement abolies ,
comme celles des hérauts d’armes le font parmi
nous.
Celui qui fera curieux de recourir fur ce fujet
aux fources mêmes, peut fe fatisfaire dans Tite-Live,
déc. 1. liv. I. c. xxjv. Cicéron, liv. I I . des lois', Aulu-
gelle, liv. X V I . ch.jv. Denys d’Halicarnafle, L. II.
Plutarque, vie de Numa; Ammien Marcellin, l. X IX .
ch.j. Diodore de Sicile, liv. VII. ch. ij. &c parmi les
modernes, Rofinus Ant. Rom. lib. I I I . c. xx j. Stru-
vius Ant. Rom.Jynt. chap. xiij. Pitifci, lexicon, & c.
Article de M. le Chevalier de J AV COURT.
. FÉCOND, adj. (Littérature.) eft le fynonyme de
fertile quand il s’agit de la culture des. terres : on peut
dire également un terrein fécond Sc fertile; fertilifer &
féconder un champ. La maxime qu’il n’y a point de fy-
nonymes, .veut dire feulement qu’on ne peut fe fer-
v ir dans toutes les occafions des mêmes mots. Voye^
D i c t io n n a ir e , En c y c l o p é d i e , & Sy n o n y m e *,
Ainfi une femelle de quelqu’efpece qu’elle foit n’eft,
point fertile, elle eft. féconde. Qnféconde des oeufs.,,
on ne les fertilife pas. La nature n’eft. pas fertile, elle
eft féconde. Ces deux exprefîions font quelquefois
également employées au figuré; & au propre.. Un ef-
prit eft fertile 011 fécond en grandes idées. Cependant
les nuances font fi délicates qu’on dit un orateuç/<b
cond, & non pas un orateur, fertile ; fécondité ; & non
fertilité de paroles ; cette méthode, ce principe , rce
fujet eft, d’une grand e fécondité, él. non pas; d’une
grande fertilité. La^raifon en, eft qu’un principe, uq
Tome VIt
fujet,' une méthode , produifent des idées qui naif-*
fent les unes des autres comme des êtres fucceflive-
ment enfantés , ce qui a rapport à la génération*
Bienheureux Scuderi, dont la fertile plume; le mot fer-*
tile eft-là bien placé, parce que cette plume s’exer-
çoit, fe répandoit fur toutes fortes de fujets. Le mot
fécond convient plus au génie qu’à la plume. Il y a
des tems féconds en crimes, & non pas fertiles en crimes.
L’ufage enfeigne toutes ces petites différences*
Article de M . d e V o l t a i r e .
FÉCONDATION, f. f. (Économie animale.) on
appelle ainfi la faculté pro lifiqu e , la fécondité rér-
duite en aé te, le moment de la con ception, celui où
toutes les conditions requifes de la part de l’animal
mâle & de la fem e lle , re fp ed iv em en t, concourent
dans celle-ci & commencent à y opérer les change-
mens, les mouvemens, en un m o t , les effets nécef-
faires pour la génération. Voye^ G é n é r a t io n ;
Ainfi la f é c o n d a t io n regarde proprement l’animal
femelle, dans lequel fe fait la conception, la formation
du foe t u s , du petit animal ordinairement de la
même efpece que celle du mâle & de la femelle qui
ont coopéré pour fa génération. V o y e { G r o s s e s s e ,
p o u r le s f em m e s , IMPRÉGNATION , p o u r l e s a u tr e s a n i m
a u x . V o y e^ a u f f i F oe t u s , ( d )
FÉCONDITÉ, f. f. (Mythol. Médaill. Littérat.)
divinité romaine, qui n’étoit autre que Junon : les
femmes l’invoquoient pour avoir des ehfans, & fe
foûmettoient volontiers pour en obtenir, à une pratique
également ridicule & ôbfcene. Lorfqu’elles al-
loient à ce deflein dans le temple de la déeffe , les
prêtres du temple les faifoient deshabiller, & les
rrappoient fur le ventre avec un foiiet qui étoit fait
de lanières dé peau de bouc.
Quelquefois on confond la fécondité avec la déeffe
Tellus , & alors elle eft repréfentée nue jufqu’à la
ceinture, & à demi-couchée par terre, s’appuyant
du bras gauche fur un panier plein d’épis & autres
fruits , auprès d’un arbre ou fep de vigne qui l’ombrage,
& de fon-bras droit elle embraffe un globe
ceint du zodiaque, orné de quelques étoiles ; c’eft:
ainfi qu’elle eft repréfentée dans quelques médailles
de Julia Domna ; dans d’autres, c’eft feulement une.
femme alïïfe, tenant de la main gauche une corne,
d’abondance, &C tendant la droite à un enfant qui
eft à fes genoux ; enfin, dans d’autres médailles c’eft.
une femme qui a quatre enfans, deux entre fes bras
& deux debout à les côtés.: yoilà fans doute le vrai
fymbole dé la fécondité. _ ;
Ait refte, T acite rapporte que les Romains pouffèrent
la flaterie envers Néron jufqu’à ériger .un temple
à la fécondité de Poppée ; mais cet hiftorien nous,
raconte lui-même bien d’autres,traits de flaterie;
c’eft un vice qui ri’a point de bernes fous des tyrans
& Ies.defpotes. Voye%_ F l a t e r ie . Article de, M. le
Chevalier D E J a u c o u r t .
F é c o n d i t é , f. f. (É c o n o m . a n im é ) c’ eft la fa cu lté
prolifique., ilajdifpofition dans, l’homme ôc dans les
animaux mâles & femelles à fatisfaire à toutes les;
conditions requifes (refpeâtiyement au fexe de chaque
individu) pour, l’ouvrage de,là génération;, pour,
la produélion, de fon femblablec .
Comme il . .eft néceffaire en traitant de cette dif-;
pofîtion entant que léfée , • d’exp'Qfer en quoi elfo
confifte dans l’état de petfe<ftipnr;2iTçft jugé convenable
, pour éyiter la. répétitipivj de,renvpyer.apx
articles où il fera queftion du jiéfaut de fécondité', çe;
qu’il y; a à dire fur cette Faculté, -fie les .conditions,
qu’elle exige.pD.ur êtrê;rédùifo.ehr a&e : ainfij'.qyei^
lMP,yt$S;ANe.E,, pour ce qui; regarde le .fo^emafcu-,
lin j S ^ é r i l i t é 9 pour ee.qui elldu féminin.;
furtout G é n é r a t io n . ..(d)ÿy .-. ;
FÉCULE ; ;fsif. (Pharmacie.') On appelle^cn/« ^
une poudre blanche affezfembkble à Famy don; ÿ qi^
N n n ij