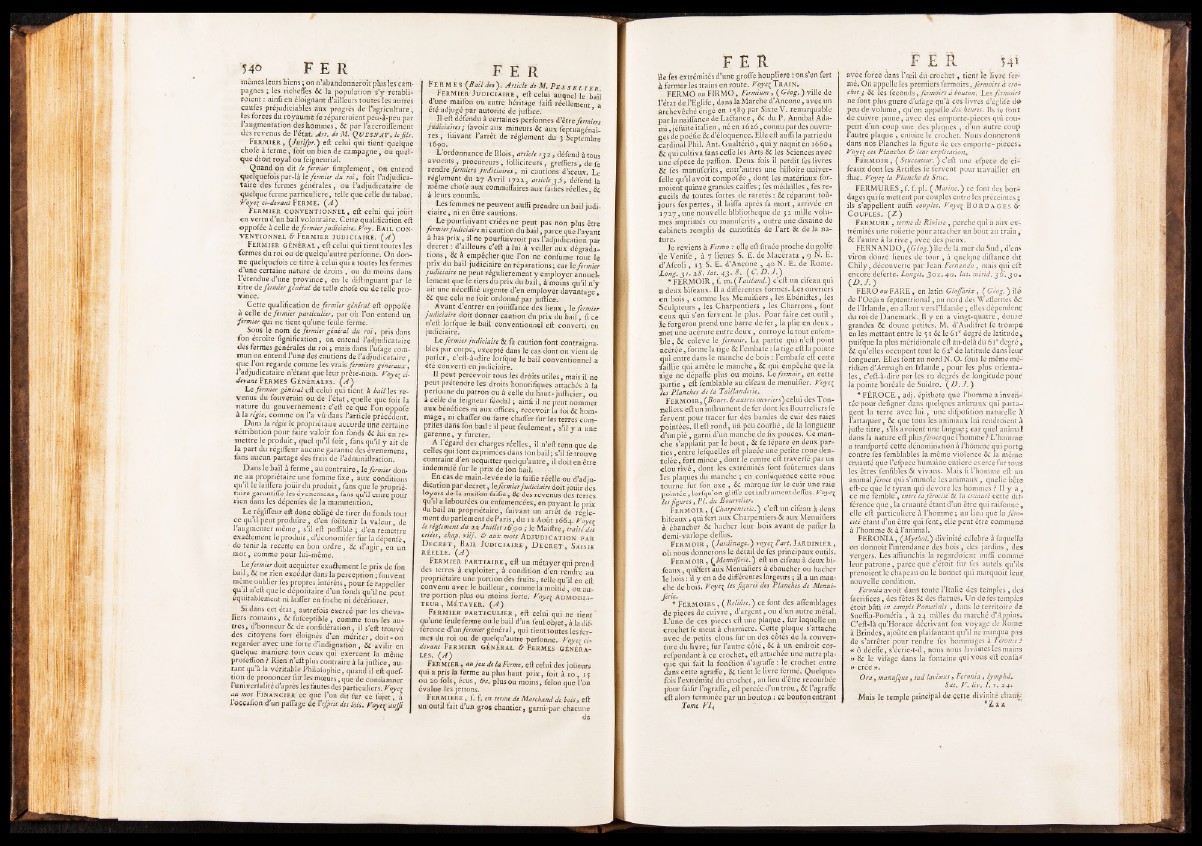
540 F E R
ïnemes leurs tiens ; on n’abandonneroit plus les’cam-
pagnes ; les richeffes & la population -s’y rétabli*
roient : ainfi en éloignant d’ailleurs toutes'les autres
caufes préjudiciables aux progrès de l'agriculture,
les forces du royaume fe répareroient peu-à-peu par
l ’augmentation des hommes, & par l’accroiffement
dès revenus de l’-état. A n . d e M . Q v e s n a y , l e f i l s .
Fe r m ie r , (Jurifpr.) eft celui qui tient quelque
chofe à ferme, foit un bien de campagne, ou quel*
que droit royal ou feigneurial.
Quand on dii l e f e rm ie r Amplement, on entend
quelquefois par-là le fe rm ie r d u r o i , foit l’adjudicataire
des fermes générales, ou l’adjudicataire de
quelque ferme particulière, telle que celle du tabac.
F o y e ^ c i -d e v a n t FERME. (/ / )
Fe r m ie r c o n v e n t io n n e l , eft celui qui joiiit
en vertu d’un bail volontaire. Cette qualification eft
oppofée à celle de fe rm i e r ju d i c ia i r e . V o y . Ba i l c o n v
e n t io n n e l & Fe r m ie r j u d ic ia ir e . ( A )
F e r m ie r g é n é r a l , eft celui qui tient toutes les
fermes du roi ou de quelqu’autre perfonne. On donne
quelquefois ce titre à celui qui a toutes les fermes
d’une certaine nature de droits , ou du moins dans
Fétendue d’une province, en le diftinguant par le
titre de fermier général de telle chofe ou de telle province.
Cette qualification de fermier gênerai eft oppofée
à celle de fermier particulier, par où l’on entend un
fermier qui ne tient qu’une feule ferme.
Sous le nom de fermier gênerai du roi, pris dans
fon étroite fignification, on entend l’adjudicataire
des fermes générales du roi ; mais dans l’ufage commun
on entend l’une des cautions de l’adjudicataire
que l’on regarde comme les vrais fermiers généraux, 1 adjudicataire n’étant que leur prête-nom. Foyer ci-
devant Fe rm e s G é n é r a l e s , (A )
Le fermier général eft celui qui tient à bail les revenus
du fouverain ou de l’état, quelle que foit la !
nature du gouvernement : c’eft ce que l’on oppofe
à la régie, comme on l’a vû dans l’article précèdent.
Dans la régie le propriétaire accorde une certaine
rétribution pour faire valoir fon fonds 8c lui en remettre
le produit, quel qu’il foit, fans qu’il y ait de
la part du régiffeur aucune garantie des évenemens
fans aucun partage des frais de l’adminiftration. S
Dans le bail à ferme, au contraire, le fermier donne
au propriétaire une fomme fixe, aux conditions
qu’il le laiffera jouir du produit, fans que le proprié- :
taire garantiffe les évenemens, fans qu’il entre pour
rien dans les dépenfes de la manutention.
Le régiffeur eft donc obligé de tirer du fonds tout
ce qu’il peut produire, d’en foûtenir la valeur, de
l ’augmenter même , s’il eft poflible ; d’en remettre
exactement le produit, d’économifer fur la dépenfe
de tenir la recette en bon ordre, 6c d’agir, en un
mot, comme pour lui-même.
Le fermier doit acquitter exaâcment le prix de fon
bail, 8c ne rien exceder dans la perception ; fouvent
même oublier fes propres intérêts, pour fe rappeller
cju il n’eft que le dépolitaire d’un fonds qu’il ne peut
equitablement ni laiffer en friche ni détériorer.
Si dans cet état, autrefois exercé par les chevaliers
romains, ôc fulceptible , comme tous les autres,
d’honneur 8c de confidération , il s’eft trouvé
des citoyens fort éloignés d’en mériter, doit - on
regarder avec une forte d’indignation , 8c avilir en
quelque maniéré tous ceux qui exercent la même
proféffion ? Rien n’eft plus contraire à la juftice, autant
qu’à la véritable Philofophie, quand il eft quef-
tion de prononcer fur les moeurs, que de condamner
l’umverfalité d’après les fautes des particuliers, Foyer
au mot Fin a n c ie r ce que l’on dit fur ce fujet, à
l’occafion d’un paffage de Vefprit des lois. Foyer auffi
F E R
F e r m e s {Baildes). Article de M. Pe s s e l i e r .
s F e rm ie r - Ju d ic ia ir e , eft celui auquel le bail
d\ine maifort Ota autre héritage faifi réellement a
été adjugé par autorité de juftice.
‘ Il eft défendu à certaines perfonnes d’être fermiers
judiciaires; favoir aux mineurs 8c aux feptuagénai-
r e s , fuivant l’arrêt de réglement du 3 Septembre
1690.
L ’ordonnance de Blois, article 132, défend à tous
avocats , procureurs , folliciteurs , greffiers, de fe
rendre fermiers judiciaires, ni cautions d’iceux. Le
réglement du ï j Avril 172 1 , article 3 $ , défend la
meme chofe aux commiffaires aux failles réelles, 8c-
à leurs commis. •
Les femmesne peuvent aulfi prendre un bail judiciaire,
ni en être cautions.
Le pourfuivant criées ne peut pas non plus être
fermier judiciaire ni caution du bail, parce que l’ayant
à bas p r ix , il ne pourfuivroit pas l’adjudication par
decret : d’ailleurs c’eft à lui à veiller aux dégradations
, 8c à empêcher que l’on ne confume tout le
prix du bail judiciaire en réparations ; car le fermier
judiciaire ne peut régulièrement y employer annuel^
lement que le tiers du prix du bail, à moins qu’il n’y
ait une neceffite urgente d’en employer davantage ,
& que cela ne foit ordonné par juftice.
Ayant d’entrer en joiiiffance des lieux, le fermier
judiciaire doit donner caution du prix du bail, fi ce
n’eft lorfque le bail conventionnel eft converti en
judiciaire.
Le fermier judiciaire & fa caution font contraignai
s . par corps, excepté dans le cas dont on vient de
parler, c eft-à-dire lorfque le bail conventionnel a
ete converti en judiciaire.
Il peut percevoir tous les drôits utiles, mais il ne
peut prétendre les droits honorifiques attachés à la
perfonne du patron ou à celle du haut- jufticier, ou
à celle du feigneur féodal ; ainfi il ne peut nommer
aux bénéfices ni aux offices, recevoir la foi 8c hom-
mage, ni chaffer ou faire chaffer fur les terres comprimes
dans fon bail : il peut feulement, s’il y a une
garenne, y fureter.
A l’égard des charges réelles, il n’eft tenu que de
celles qui font exprimées dans Ion bail ; s’il fe trouve
contraint d’en acquitter quelqu’autre, il doit en être
mdemnifé fur le prix de fon bail.
En cas de main-levée de la faifie réelle ou d’adjudication
par decret, le fermier judiciaire doit jouir des
loyers de la maifon faifie, 8c des revenus des terres
qu’il a labourées ou enfemencées, en payant le prix
du bail au propriétaire, fuivant un arrêt de réglement
du parlement de Paris, du 12 Août 1664. Foyer
le réglement du 22 Juillet 16 90 ; le Maiftre, traité des
criées, chap.viij. & aux /now'ADJUDICATION PAR
D e c r e t , Ba i l Ju d i c i a i r e . D e c r e t , S a is ie
r é e l l e . ( A )
Fe rm ie r p a r t i a i r e , eft un métayer qui prend
des terres à exploiter, à condition d’en rendre au
propriétaire une portion des fruits, telle qu’il en eft
convenu avec le bailleur, comme la moitié, ou autre
portion plus ou moins forte. Foye^ A d m o d ia -
t e u r , M é t a y e r . ( A )
Fe rm ie r * p a r t i c u l i e r , eft celui qui ne tient’
qu’une feule ferme ou le bail d’un fcul objet, à la différence
fermier général, qui tient toutes les fermes
du roi ou de quelqu’autre perfonne. Voyt{ d'devant
F e r m ie r g é n é r a l & Fe rm e s g é n é r a l
e s . { A )
Fe rm ie r , au jeu de la Ferme, eft celui des joueurs
qui a pris la ferme au plus haut p r ix , foit à 10, 15
ou 20 fo ls , e cu s , &c. plus ou moins, félon que l ’on
éva lu e les jettons.
F e rm ie r e , i, f. en terme de Marchand de bois, eft
un outil fait d’un gros chantier, garni^par chacune
de
F E R
ü e fes extrémités d’une groffe houpliere 1 on s’èn fert
a fermer les trains en route. Foye{ T r a in ,
FERMÔ ou F IRMO, Firmium, ( Géog. ,) ville de
l ’état de l’Eglife, dans la Marche d’Ancone, avec un
archevêché érigé en 1589 par Sixte V . remarquable
par la naiffance de La&ance, êc du P. Annibal Ada-
mi jéfuite italien, né en 16 26, connu par des ouvrages
de poéfie êc d’éloquence. Elle eft auffi la patrie du
cardinal Phil. Ant. Gualtério, qui y naquit en 1660,
& qui cultiva fans cefle les Arts 8c les Sciences avec
une efpece de paffion. Deux fois il perdit fes livres
& fes manuferits, entr’autres une hiftoire univer-
felle qu’il avoit compofée , dont les matériaux for-
moient quinze grandes caiffes ; fes médailles, fes Recueils,
de toutes fortes de raretés : 8c réparant toujours
fes pertes, il laiffa après fa mort, arrivée en
17 2 7 , une nouvelle bibliothèque de 32 mille volumes
imprimés ou manuferits , outre une dixaine de
cabinets remplis de curiofités de l’art & de la nature.
Je reviens à Fermo : elle eft fituée proche du golfe
’de Venife , à 7 lieues S. E. de Macérata , 9 N. E.
d’Afcoli, 13 S. E. d’Ancone , 40 N. E. de Rome. 1Long. 3 1. 2.8. lat. 43. 8. ( C .D . J .)
* FERMOIR, f. m. (TaiLland.) c’eft un cifeau qui
a deux bifeaux. Il a différentes formes. Les ouvriers
en bois , comme les Menuifiers , les Ebéniftes , les
Sculpteurs , les Charpentiers , les Charrons, font
ceux qui s’en fervent le plus. Pour faire cet outil -,
te forgeron prend une barre de fer, la plie en deux >
met une acérure entre deux, corroyé le tout ënfem-
Lle & enleve le fermoir. La partie qui n’eft point
acérée, forme la tige 8c l’embafe : la tige eft la.pointe
qui entre dans le manche de bois : l’embafe eft cette
faillie qui arrête le manche, 8c qui empêche que la
!tige ne dépaffe plus ou moins. Le fermoir, en eette
partie , eft femblable au cifeau de menuifier. Foye{
les Planches de la Taillanderie.
Ferm oir , (Bourr. & autres ouvriers) celui des Tonneliers
eft un infiniment de fer dont les Bourreliers fe
fervent pour tracer fur des bandes de cuir des raies
pointées. Il eft rond, un peu courbé, de la longueur
d ’un p ié , garni d’un manche de fix pouces. Ce manche
s’applatit par le bout, 8c fe fépare en deux parties
, entre lesquelles eft placée une petite roue den*
telé e, fort mince, dont le centre eft traverfé par un
clou r iv é , dont les extrémités font foûtenues dans
les plaques du manche ; en conféquence cette roue
tourne fur fon axe , 8c marque fur le cuir une raie
pointée, lorfqu’on gliffe cet inftrument deffus. Foye^
les figures , PL du Bourrelier.
Fermoir , ( Charpenterie.) c’eft un cifeau à deux
bifeaux, qui fert aux Charpentiers 8c aux Menuifiers
à ébaucher 8c hacher leur bois avant de paffer la
demi-vàrlope deffus.
FERMOIR, ( Jardinage.) voyei tart. JARDINIER ,
ôù nous donnerons le détail de fes principaux outils.
Fermoir , (Menuiferie. ) eft un cifeau à deux bifeaux
, quïfert aux Menuifiers à ébaucher ou hacher
le bois : il y en a de différentes largeurs ; il a un manche
de bois. Voyt{ les figurés des Planches de Menui-
ferie. .
* FérMOIRS , ( Reliure.) ce font des affemblages
de pièces de cuivre, d’argent, ou d’un autre métal.
L ’une de ces pièces eft une plaque, fur laquelle un
crochet fe meut à charnière. Cette plaque s’attache
avec de petits clous fur un des côtés de la couver*
ture du livre; fur l’autre côté, 8c à un endroit cor-
refpôndant à ce crochet, eft attachée une autre plaque
qui fait la fon&ion d’agraffe : le crochet entre
dans cette agraffe, 8c tient le livre fermé. Quelquefois
l’extrémité du crochet, au lieu d’être recourbée
p'our faifir l’agraffe, eft percée d’un trou, 8c l’agraffe eft alors terminée par unboutop ; ce bouton entrant
Tome FJ<
F E R 5 4*
avec force dans ï’oeil dit crochet, tient ïe livré fermé.
On appelle les premiers fermoirs y fermoirs à crochet
; 8c les féconds, .fermoirs à bouton. Les fermoirs
ne font plus guere d’ufagè qu’à ces livres d’églife dô
peu de volume, qu’on appelle des heures'. Iis le font
de cuivre jaune, avec des emporte-pieces qlii coupent
d’un coup une des plaques , d’un autre coup
l’autre plaque , ënl’uite le crochet. Nous donnerons
dans nos Planches la figure de ces emporte-pieces,
Foye£ ces Planches & leur explication*
. Fe rm o ir ; ( Stuccateur. ) c’eft une efpece de ci-
féaux dont les Artiftes fe fervent pour travailler eii
ftuc. Foyer la Planche de Stuc'.
FERMURES, f. f. pl. ( Marine.) ce font des bor-
dages quife mettent par couples entre les préceintes ;
ils s’appellent auffi couples. Foye%_ B o r d a g e s &
C ouples. ( Z )
FerMure , terme de Riviere , perche qui a aux extrémités
urie.roiiette pour attacher un bout au train ,
& l’autre à la r iv e , avec des pieux;
FERNANDO; (Géog.) île de là mer du Sud, d’en*
virOn douzé lieues de tour , à quelque diftance du
Ch ily , découverte par Jean Fernando , mais qui elfc
encore deferte. Longit. 3 0 2 .40. lut. mêrid. 3 6 .3 0 • H I ■ H H ■ m FERO ou FA R E , en latin Gloffàrice, ( Geôg. ) île
de l’Océan feptentrional, au nord des 'Wefternes 8c
de l’Irlande, en allant vers l’Iflande ; elles dépendent:
du roi de Danemark.vIl y en a vingt-quatre, douze
grandes 8c douze petites. M. d’Audifret fe trompé
en les mettant entre le 51 8c le 6 Ie degré de latitude ,
puifque la plus méridionale eft au-delà du 6 i e degré ^
8c qu’elles occupent tout le de latitude dans leur?
longueur. Elles font au nord N. O. fous le même méridien
d’Armagh en Irlande , pour les plus orientales,
c’ eft-à-dire par les 10 degrés de longitude pouT
la pointe boréale de SùidrO. (Z>. ƒ. )
* FÉROCE , adj. épithete que l’homme a inveh-,
téé pour defigner dans quelques animaux qui parta-,
gent la terre avec lui , une difpofition naturelle à 1
l’attaquer, 8c que tous les animaux lui rèndroient à
jufte titré, s’ils àvôienf une langue ; car quel animal
dans la hature eft plus féroce que l’homme ? L ’homme
a tranfporté cette déiïomiriation à l’homme qui port$,
contre fes femblables la même violence Sc la même
cruauté que l’efpece humaine entierè exerce fur tous
les êtres ferifibles 8c vivans. Mais fi l’honimé eft un
animal féroce qui s’immole lés animaux, quelle bête
eft-ce que le tyran qui dévore lès hommes ? Il y a ,
Cè me feriiblè, entré la férocité 8c la cruauté cetfe dif*
férence que, la cruauté étant d’un être qui raifonne *
elle eft particulière à l’homme ; au lieu que la férocité
étant d’un être qui fent, elle peut être commune
à l’homme 8c à l’animal.
FERONIA, (Mythôl.) divinité célébré à iaqùellé
on donnait l’intendance des bois , des jardins , des
vergers. Les affranchis la regardoient auffi comme
leur pâtrone, parce que c’étoit fur fes autels qu’ils
prenoient le chapeau ou le bonnet qui marquait leur
nouvelle condition.
Feronia avoit dans toute l’Italie dés tefnples , des
facrifices, des fêtes 8c des ftatues. Un de fes temples
étoit bâti in campis Pometinis , dans le territoire dé
Sueffia-Pométia , à 24 milles du marché d’Appiusi'
C ’eft-là qu’Horace décrivant fon voyagé de Rome
à Brindes, ajoute en plaifantant qu’il ne manqua pas
de s’arrêter pour rendre fès hommages à F ironie è
« ô déeffe, s’écrie-t-il, nous nous lavâmes les mains
» 8c le vifage dans la fontaine qui voùs e'ft confa^
» c ré e ».
Ora , mahufque , tua tavimus, Peronta ; lymphâi
Sat. F. liv, I. v. 24*
Mais le temple principal de cette divinité chanÿ
* Z z x