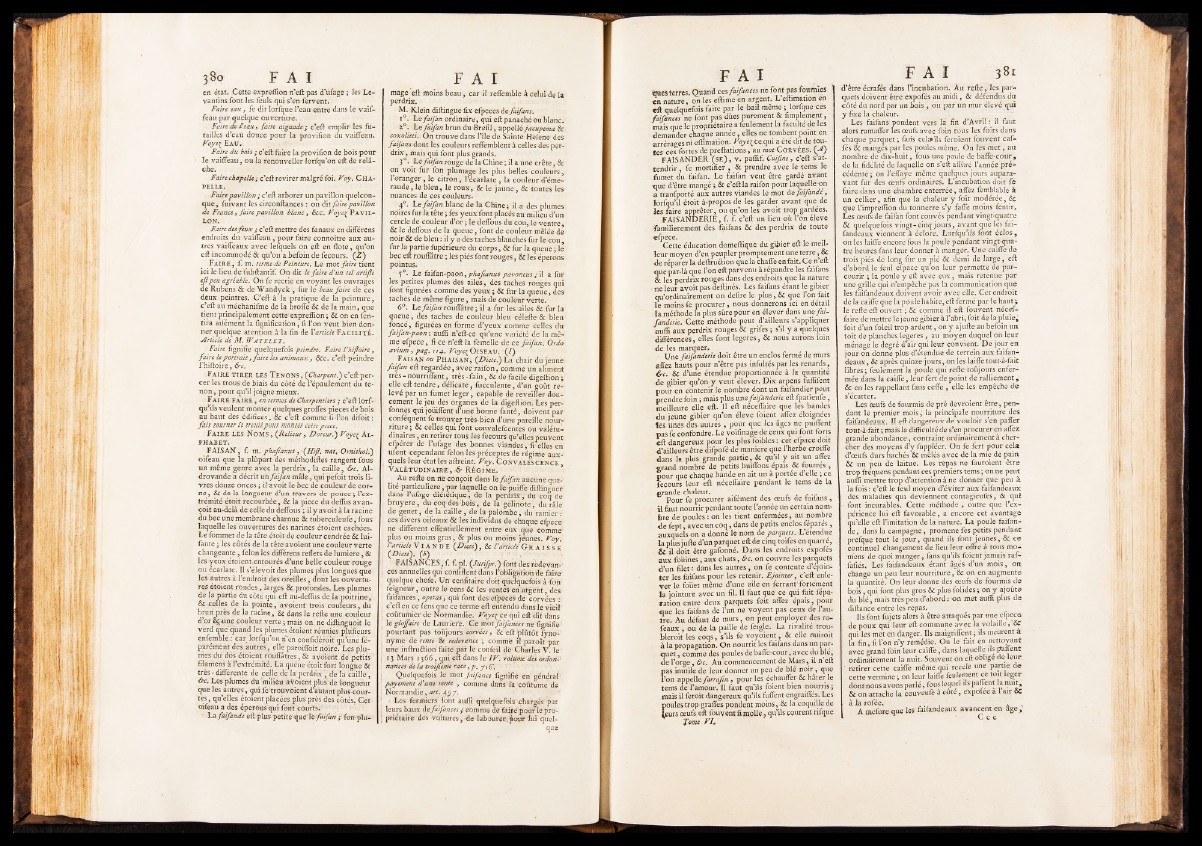
I
380 F A I en état. Cette expreflion n’eft pas d’ufage ; les Levantins
font les feuls qui s’én fervent.
Faire tau, fe dit lorfque l’eau entre dans le vaif-
feau par quelque ouverture.
Faire de Veaufaire aiguade ; c’eft emplir les futailles
d’eau douce pour la provifion du vaiffeau.
Voye^ Ea u .
Faire du bois ; c’eft faire la provifion de bois pour
le vaiffeau, ou la renouveller lorfqu’on eft de relâche.
F aire.chapelle ; c’efl re virer malgré foi. Voy. CHAPELLE.
Faire pavillon ; c’eft arborer un pavillon quelconque
, fuivant les circonftances : on dit faire pavillon
de France , faire.pavillon blanc , 8cc. Voye^ PAVILLON.
Faire des feux ; c’eft mettre des fanaux en différens
endroits du vaiffeau,' pour faire connoître aux autres
vaiffeaux avec -lefquels on eft en flote, qu’on
eft incommodé & qu’on a befoin de fecours. (Z )
F a i r e , f. m. terme de Peinture. Le mot faire tient
ici le lieu de fubftantif. On dit Le faire d'un tel artifie
ejlpeu agréable. On fe recrie en voyant les ouvrages
de Rubens & de \Fandyck , fur le beau faire de ces
deux peintres. C ’efl à la pratique de la peinture,
c ’efl au méchanifme de la broffe 8c de la main, que
tient principalement cette' expreflion ; & on en fen-
tira aifément la lignification, fi l’on veut bien donner
quelque atention_à la fin de l'article Fa c i l i t é .
Article de M. Wa t e l e t .
Faire lignifie quelquefois peindret Faire L'kifloire ,
faire Le portrait, faire les animaux & c . c’éfl peindre
l ’hifloire, &c.
Fa ir e t ir e r le s T e n o n s , {Charpenté) c’efl percer
les trous de biais du côté de Pépaulement du tenon,
pour qu’il joigne mieux.
Fa ir e f a ir e , en termes de Charpentiers ; c’efl lorf-
qu’ils veulent monter quelques groffes pièces dé bois
au.haut des édifices, 8c c’efl comme fi l’on drfoit :
fais tourner le treuilpour monter cette piece.
F a ir e LES N o m s , {Relieury Doreur.) Voye^ ALPHABET.
FAISAN, f. m. phafîanus,• (Hifl. nat. Ornithol.)
oifeau que la plupart des méthodifles rangent fous
un même genre avec la perdrix, la caille, &c. Al-
drovande a décrit un faifan mâle, qui pefoit trois livres
douze onces ; il avoit le bec de couleur de corn
e , & de la longueur d’un travers de pouce ; l’extrémité
étoit recourbée, & la piece du deffus avan-
çoit au-delà de celle du deffous ; il y avoit à la racine
du bec une membrane charnue & tuberculeufe, fous
laquelle les ouvertures des narines étoient cachées.
Le fômmet de la tête étoit de couleur cendrée & lui-
fante ; les côtés de la tête avoient urte couleur verte
changeante, félonies différens reflets de lumière, &
les yeux étoient,entourés d’une belle' couleur-rouge
ou ecarlate. Il s’élevoit des plumes plus longuéS-que
les autres à l’endroit des oreilles, dont les ouvertures
etoient rondes ^larges & . profondes. Les plumes
de la partie du côté qui efl au-deffus de. la poitrine.,
& ' celles de la pointe, avoient' trois couleurs, du ;
brun près de la racine., 8c dans le refie une couleur
d’or une^couleur yerte ; mais on ne diftingqoit le
verd que quand les plumes, étoient réunies plusieurs
enfemble.: car lorfqu’on n’en confidéfôit qu’uiie fé-
paréliient dés: autres, elléparoiffoit poire. Les plu-
nte^'dp 3ôs étoient fôuffatres, & ayôiént dé petits '’
fiîamens à l’extrémité. Là quelle étoit.fort longüe &
très - différente de celle de la perdrix r,: de' là 'caillé,
ôc. Les plumes dü miliéu àVoièfit plus de longueur
que les autres, qui fe 'troifvoient d’ahtant-plus courtes,
qu’elles étoient placées plus près des côtés. Cet
oifeau a des épejtô$s'igjrô font courts: ’
La faifande' eflpluspetite-qué' Xe'faifan j'foU plu-1
F A I
mage efl moins beau , car il reffemble à celui de la
perdrix.
M. Klein diftingue fix efpeces de faifans.
i° . Lefaifan ordinaire, qui efl panaché ou blanc.
UH h t faifan brun du B refil, appelle jacupema &
coxolitti. On trouve dans I’île de Sainte Helene des
faifans dont les couleurs reffemblent à celles des perdrix
, mais qui font plus grands.
30. Le faifan rouge de la Chine ; il a u ne crête, &
on voit fur fon plumage les plus belles-couleurs,
l’oranger , le citron, l’écarlate , la couleur d’émeraude,
le bleu, le roux, & le jaune, 8c toutes les
nuances de ces couleurs.
40. Le faifan blanc de la Chine; il a des plumes
noires fur la tête ; fes yeux font placés au milieu d’un
cercle de couleur d’o r ; le deffous du cou, le ventre ,
& le deffous de la queue, font de couleur mêlée de
noir & de bleu : il'y a des taches blanches fur le cou ,
fur la partie fupérieure du corps, & fur la queue ; le
bec efl r.ouffâtre ; les piés font rouges, 8c les éperons
pointus.
50. Le faifan-paon, phafanus pavoneus ; il a fur
lés petites plumes des ailes, des taches rouges qui
font figurées comme des yeux ; 8c fur la queue, des
taches de même figure, mais de couleur verte.
6° i Le faifan rouffâtre ; il a fur les ailes & fur la
queue, des taches de couleur bleu célëfle & bleu
foncé, figurées en forme d’yeux comme celles du
faifan-paon : aufii n’efl-ce qu’une variété de la même
efpece, fi ce n’efl la femelle de ce faifan. Ordo
avium, pag. 114. Voye^ OlSEAU. (/)
Fa i s a n ou P h a i s a n , (D ie te .) La chair du jeune
faifan efl regardée, avec raifon, comme un aliment
très - nourriffant, très - fain, & de facile digeflion ;
elle efl tendre, délicate, fucculènte, d’un goût relevé
par un fumet leger, capable dé reveiller doucement
le jeu des organes de la digeflion. Les per-
fonnes qui joiiiffent d’une bonne fanté, doivent par
conféquentfe trouver très-bien d’une pareille nourriture
; 8c celles qui font convalefcentes ou valétudinaires
, en retirer tous, les fecours'qu’elles peuvent
efpérêr de l’ufage des bonnes viandesy fr elles en
ufent cependant félon les préceptes de régime aux-
, quels leur état les aftreint. Voy. C o n v a l e s c e n c e
V a l é t u d in a ir e , ^ R é g im e .
Au refie on riè ■ conçoit dans le faifan aucune qualité
particulière, par laquelle on le piiiffe diffinouer
dans l’ufage diététique, de la perdrix1, du'coq de
. bruyere, du coq des bois, de là gélinote , du râlé
de genet, de la ca ille, de la palombe , du ramier :
ces divers oifeatix & les individus de chaque efpece
ne different efféntiellement entre éiix qtie comme
plus ou moins gras, & plus ou moins jeunes. Voy.
L'article V IA N D E (Dicté) , 8c L'article' G r a i s s e
(pieté), (b) • - ' '
FAISANCES, f. f. pi. ( J u r i fp r ,) font dés rédevan-'
ces annuelles qui confident dans l’dbligàtioh de faire
quelque chofe. Un cerifïtaire doit quelquefois à-fon
fëigneür, outre le céns 8c les rentés'en iargeht, des
fàifaneès, o p é ra s y qui font des efpécés de corvées :
c’efl en ce fens que ce forme efl entéridu dans le vieil
coutumier de Normandie. V o y e ç c e qui eft dit dans
lé -g lo ffa ir e de Làuriefo. Ce mot f a i fa n c e s ne fignifie
pourtant pas toujours c o r v é e s , 8c efl plûtôt fyno-
nÿmé de ren te Se r ed ev a n c e ; comme il pàroît par
une inflruélion faite par le eonfeil de Charles V. l e 1
13 Mars 1366, qui efl dans le I V . v o lum e d e s o r d o n
nàH'ces -de l a tr o if iem e ra c e y p , yy '6Y-'-'-* -
Quelquefois le mot faifance fignifié en général
payement d'une rente , comme dans’iâ coutume de
Normandie, art. 40y.
■ Les fermiers font aufii quelquefois'chargés par
leurs baux de faifances$ éohime dèfaife'pôùrle propriétaire
des voitUrés, -de làbourér-pour lui quelque
F A I
toi és terres. Quand ces f a i f a n c e s ne font pas fournies
*n nature, on les eflime en argent. L’eflimation en
e fl quelquefois faite par le bail meme ; lorfque ces.
f a i fa n c e s ne font pas dues purement & Amplement,
mais que le propriétaire a feulement la faculté de les
demander chaque année, elles ne tombent point eh '
■ arrérages ni eflimâtioh. F'byé^ce qui a été dit de toutes
ces fortes de preflations, au m o t C o r v é e s . ( A )
FAISANDER ( s e ) , v . paflif. C u i f i n t , c’efl s attendrir
, fe mortifier , & prendre avec le teins le
fumet du faifan. Le faifan veut être gardé avant
que d?être mangé ; & e’efl la raifon pour laquelle-on
a tranfporté aux autres viandes le mot de f a i j n n d é ,
lorfqu’il étoit à-propos de -les garder avant que^ de
les faire apprêter, ou qu’on les avoit trop gardées.
f AISANDERIE, f. f. c’efl un lieu oii l’on éleve
'familièrement des faifans & des perdrix de toute
■ çfpece.
Cette éducation domeflrque du gibier efl le meilleur
moyen d’en peupler promptement une terre, &
de réparer la deflruftion que la chaffe en fait. Ce n’efl
que par-là que l’on efl parvenu à répandre les faifans
& les perdrix rouges dans des endroits que la nature
> ne leur avoit pas deftinés. Les faifans étant le gibier
qu’ordinairement on defire le plus, & que l’on-fait
le moins fe procurer, nous donnerons ici en détail
la méthode la plus sûre pour en élever dans u n e f a i -
fa n d e r i e . Cette méthode peut d’ailleurs s’appliquer
aufii aux perdrix rouges &: grifes ; s’il y a quelques
différences, elles font legeres, •& nous aurons foin
de les marquer.
- Une fa i fa n d e r i e doit être un enclos fermé de murs
allez hauts, pour n’être pas infultés par les renards,
& c . & d’une étendue proportionnée à la quantité
de gibier qu’on y veut élever. Dix arpens fuffifent
pour en contenir le nombre dont un faifandier peut
prendre foin ; mais plus une fa i fa n d e r i e efl fpatieufe,
/ meilleure elle efl. Il eft néceffaire que les bandes
du jeune gibier qu’on éleve foient affez éloignées
les unes des autres , pour que les âges ne puiffent
pas fe confondre. Le voifinage de ceux qui font forts
eft dangereux pour les plus fbibles : cet efpace doit
d’ailleurs être difpofé de maniéré que l’herbe croifle
dans la plus grande partie, & qu’il y ait un affez
grand nombre de petits buiffons épais fourrés ,
pour que chaque bande en ait un à portée d’elle ; ce,
fecours leur eft néceffaire pendant le tems dé la
grande chaleur. r » c -r
Pour fe procurer aifément des cfeufs de faifans ,
i l fout nourrir pendant toute l’année un certain nombre
de poules : on les tient enfermées, au -nombre
de fept, avec un co q , dans de petits enclos féparés,
auxquels on a donne le nom de p a r q u e t s . L’étendue
la plus jufte d’un parquet eft de cinq toifes en quarré,
& il doit être .gafonné. Dans les endroits expofés
aux foiiines, aux chats, &c. on couvre les parejuets
d’un filet : dans les autres, on fe contente d’éjoin-
ter les faifans pour les retenir. E j o in t e r , c'eft enlev
er le fouet même d’une aile en ferrant1 fortement
la jointure avec un fil. Il faut que ce qui fait fépa-
ration entre deux parquets foit affez épais, pour
que les faifans de l’un ne voyent pas ceux de l’autre.
Au défaut de murs, on peut employer des ro-
feaux , ou de la paille de feigle. La rivalité troublerait
les coqs, s’ils fe voyoient, & elle nuirait
à la propagation. On nourrit les faifans dans un parquet
, comme des poules de baffe-cour, avec du ble,
de l’orge, & c . Au commencement de Mars, il n eft
pas inutile de leur donner un peu de ble noir^, que
l’on appelle f a r r a f i n , pour les échauffer & hâter le
tems de l’amour. Il faut qu’ils foient bien nourris;
mais il ferait dangereux qu’ils fuffent engraifles. Les
poules trop graffes pondent moins, &: la coquille de
fgurs oeufs, eft fouyent û molle, qu’ils courent rifque
J'orne VI,
F A ï 381
d'être ècrafés dans Tincubation. Au refte, les parquets
doivent être expofés au midi, & défendus du
côté du nord par un bois , ou par un mur élevé qui
y fixe la chaleur.
Les faifans pondent vers là fin d’Âvril : il faut
alors ramàfler les oeufs avec, foin tous lesfoirs dans
chaque parquet ; fans cela^ils feraient fouvent caf-
fés & manges par les poules même. On les met, au
nombre de dix-huit, fous une poule de bafle-cour ,
de la.fidélité de laquelle on s’eft affûré l’année précédente
; on l’effaye même quelques jours, auparavant
fur des oeufs ordinaires. L’incubation doit fé
faire dans une chambre enterrée , affez femblable à
un cellier, afin que la chaleur y foit modérée, 8c
que l’impreflïon du tonnerre s’y fafle moins fentir.
Les oeufs de faifan font couvés pendant vingt-quatre
8c quelquefois vingt-cinq jours, avant que les fai-
fandeaux viennent à éclore. Lorfqu’ils font éclos ,
on les laiffe encore fous la poule pendant vingt-quatre
heures fans leur donner à manger. Une caille de
trois piés de long für un pié 8c demi de large, eft
d’abord le foui efpace qu’on leur permette de parcourir
; la.poule y eft avec eux, mais retenue par
une grille qui n’empêche pas là communication que
les faifandeaux doivent avoir avec elle. Cet endroit
de la caiffe que la poule habite, eft fermé par le haut;
le refte eft ouvert ; 8c comme il eft fouvent néceffaire
de mettre le jeune gibier à l’abri, foit de la pluie j
foit d’un foleil trop ardent, on y ajufte au befoin un
toit de planches legeres, au moyen duquel on leur
ménage le' degré d’air qui leur convient. De jour en
jour ôn donne plus d’étendue de terrein aux faifandeaux,
8c après quinze jours, ôn les laiffe tout-à-fait
libres ; feulement la poule qui refte toujours enfermée
dans la caiffe, leur fort de point de ralliement,
8c en les rappellant fans ceffe , elle les empêche de
s’écarter.
Les oeufs de fourmis de pré devraient être, pendant
le premier mois; la principale nourriture des
faifandeaux. Il eft dangereux de vouloir s’en paffer
tout-à-fait ; mais la difficulté de s’en procurer en affez
grande abondàncë, contraint ordinairement à chercher
des moyens d’y fuppléer. On fe fort pour cela
d’oeufs durs hachés 8c mêlés avec de la mie de pain
8c un peu de laitue. Les repas ne fauroient être
trop fréquens pendant ces premiers tems ; on ne peut
aufii mettre trop d’attention à ne donner que peu à
la fois : c’eft le feul moyen d’éviter aux faifandeaux
des maladies qui deviennent contagieufes, & qui
font incurables. Cette méthode , outre que l’expérience
lui eft favorable, a encore cet avantage
qu’elle eft l’imitation de la nature. La poule faifan-
de, dans la campagne, promene fes petits pendant
prefque tout le jou r, quand ils font jeunes, 8c ce
continuel changement de lieu leur offre à tous mo-
mëns de quoi manger, fans qu’ils foient jamais raf-
fafiés. Les faifandeaux .étant âgés d’un mois, on
change un peu leur nourriture, 8c on en augmente
la quantité. On leur donne des oeufs de fourmis de
b çis, qui font plus gros 8c plus folides ; on y ajoûte
du blé, mais très peu d’abord: -on met aufii plus de
diftance entre les repas. .
Ils font fujets alors à être attaqués par une efpece
de poux qui leur eft commune avec la volaille,'8c
qui les met en danger. Ils maigriffent ; iis meurent à
la fin, fi l’on n’y remédie. On le fait en nettoyant
avec grand foin leur caiffo, dans laquelle ils pafient
ordinairement la nuit. Souvent on efl obligé de leur
' retirer cette caiffe même qui recele une partie de
cette vermine ; on leur laiffe feulement ce toit leger
dont nous avons parlé, fous lequel ils paflent la nuit,
8c on attache la couveufe à côté, expolee à 1 air oc
à la rofée. .
A mefure que les faifandeaux avancent en âge ,
n ' ' C c c