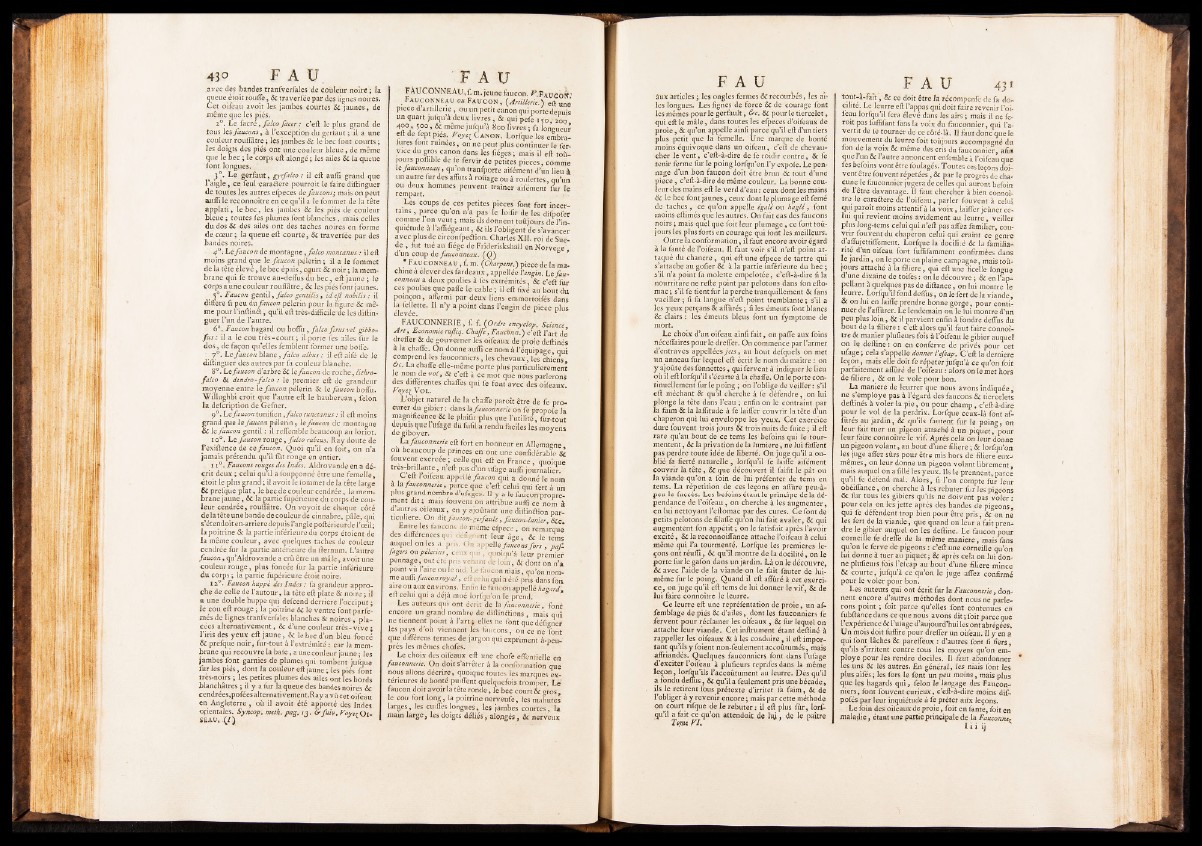
avec des bandes tranfverfales de co'üleur noire ; la
queue étoit rouffe, & traverfée par des lignes noires.
Cet oifeau avoir les jambes courtes 6c jaunes, de
.même que les pies.
z°. Le facré , falco facer: c’eft le plus grand de
fous les faucons, à l’exception du gerfaut ; il a une
couleur rouffâtre ; les jambes & le bec font courts ;
les doigts des pies ont une couleur bleue, de même
que le bec ; le corps eft alongé ; les ailes 6c la queue
‘font longues. ‘
3°. Le gerfaut, gyrfalco : il eft aufli grand que
l ’aigle, ce feul caraôere pourroit le faire diftinguer
de toutes les autres efpeces de faucons; mais on peut
aufli le reconnoître en ce qu’il a le fommet de la tête
applati, le bec , les jambes 6c les pies de couleur
bleue ; toutes fes plumes font blanches, mais celles
du dos 6c des ailes ont des taches noires en forme
de coeur ; la queue eft courte, 6c traverfée par des
bandes noires. 4°t Lé faucon de montagne, falco montanus : il eft
moins grand que le faucon pèlerin ; il a le fommet
de la tête é le v é , le bec épais, c^urt 6c noir ; la membrane
qui fe trouve au-deffus du bec, eft jaune ; le
corps a une couleur rouflatré, 6c les pies font jaunes.
J°. Faucon gentil, falco gentilis , id ejl nobilis : il
différé fi peu du faucon pèlerin pour la figure 6c même
pour l’inftinâ, qu’il eft très-difficile de les diftinguer
l ’un de l’autre.
6°,. Faucon hagard ou boflii, falco férus vel gibbo-
Jus: il a le cou très-court; il porte fes ailes fur le
dos, de façon qu’elles femblent former une boffe.
• 7°. Le faucon blanc, falco albus : il eft aifé de le
diftinguer des autres par fa couleur blanche.
8°. Le faucon d’arbre 6c le faucon de roche, lithro-
falco & dendro-falco : le premier eft de grandeur
moyenne entre le faucon pèlerin & le faucon boflu.
Willughbi croit que l’autre eft le haubereau, félon
la defcription de Gefner.
9°. Le faucon tunifien, falco tunetanus : il eft moins
grand que le faucon pèlerin, le faucon de montagne
& le faucon gentil : il reflemble beaucoup au loriot.
io ° . Le faucon rouge, falco rubeus. Ray doute de
l ’exiftence de ce faucon. Quoi qu’il en foit, on n’a
jamais prétendu qu’il fût rouge en entier.
1 1 ° . Faucons rouges des Indes. Aldrovande en a décrit
deux ; celui qu’il a foupçonné être une femelle,
étoit le plus grand ; il a voit le fommet de la tête large i
6c prefque plat, le bec de couleur cendrée, la membrane
jaune, 6c la partie fupérieure du corps de couleur
cendrée, rouffâtre. On voyoit de chaque côté
de la tête une bande de couleur de cinnabre, pâle, qui
s’étendoiten-arriere depuis l’angle poftérieurde l’oeil;
la poitrine & la partie inférieure du corps étoient de
la même couleur, avec quelques taches de couleur
cendrée fur la partie antérieure du fternum. L’autre
faucon, qu’Aldrovande a crû être un m âle, a voit une
couleur rouge, plus foncée fur la partie inférieure
du corps ; la partie fupérieure étoit noire.
12.°- Faucon huppé des Indes : fa grandeur approche
de celle de l’autour, la tête eft plate & noire ; il
a une double huppe qui defcend derrière l’occiput ;
le cou eft rouge ; la poitrine 6c le ventre font parfe-
més de lignes tranfverfales blanches & noires , placées
alternativement, 6c d’une couleur très-vive ;
l ’iris des yeux eft jaune, & le bec d’un bleu foncé
6c prefque noir, fur-tout à l’extrémité; car la membrane
qui recouvre la bafe, a une couleur jaune ; les
jambes font garnies de plumes qui tombent jufque
fur les piés, dont la couleur eft jaune ; les piés font
très-noirs ; les petites plumes des ailes ont les bords
blanchâtres ; il y a fur la queue des bandes noires 6c
cendrées,pofées alternativement.Ray a vû cet oifeau
en Angleterre, où il avoit été apporté des Indes
orientales. Syncop. meth. pag. / j . 6* fuiy, Foyer OISEAU,
.(/ )
FAUCONNEAU, f. iïi. jeune faucon. A*. FAücbt*'
Fa u c o n n e a u x Fa u c o n , (Artillerie.) eft une
piece d’artillerie , ou un petit canon qui porte depuis
un quart julqu’à deux livres, & qui pele 1 50,-200
400, 500, & même jufqu’à 800 livres ; fa longueur
eft de fept prés. Eoye{ C a n o n . Lorfque les embra-
lures font ruinées, on ne peut plus continuer le fer-
vice du gros canon dans les fiéges ; mais il eft tou- '
jours poffible de fe fervir de petites pièces, comme
le fauconneau, qu’on transporte aifément d’un lieu à
un autre fur des affûts à rouage ou à roulettes, qu’un
ou deux hommes peuvent traîner aifément fur le
rempart.
Les coups de ces petites pièces' font fort incertains,
parce qu’on n’a pas le lbifir de les difpoféf
comme l’on veut ; mais ils donnent toûjours de l ’in-
quietude a l’afliégeant, 6c ils l’obligent de s’avancer
avec plus de circopfpeôion. Charles XII. roi de Sué*
de , fut tué au fiége de Frideriskshall en Norvège
d’un coup de fauconneau. (Q)
* Fa u c o n n e a u , f. mi (Charpente) piece de la machine
à élever des fardeaux, appellée l’engin. Le fau*
conneau a deux poulies à fes extrémités, 6c c’eft fur
ces poulies que paffe le cable ; il eft fixé au bout du
poinçon, affermi par deux liens emmortoifés dans
la fe llette. Il n’y a point dans l’engin de piece plus
elevée. r
FAUCONNERIE, f. f. (Ordre encyéiop-, Science.
A r t, Economie ruftiq. ChaJJe.Faiidmn,.) c’eft l’art de
dreffer & dé gouverner les oifeaux de proie deftinéi
à la chaffe. Qn donne auffi ce nom à Fequipage, qui
comprend les fauconniers, les chevaux, les chiens,
6c. La chaffe elle-même porte plus particulièrement
r voi’ & c’e® à ce mot que nous parlerons
des differentes chaffes qui fe font avec des oifeaux.
V°yt{ V o l .
L’objet naturel de la chaffe paroît être de fe procurer
du gibier : dans la fauconnerie on fe propofe la
magnificence 6c le plaifir plus que l ’utilité, fur-tout
depuis que 1 ufage du fufil a rendu faciles les moyens
degiboyer. •
x L z fauconnerie eft fort en honneur en Allemagne ,
ou beaucoup de princes en ont une confidérable &
fouvent exercee ; celle qui eft en France , quoique
tres-bnllante, n’eft pas d’un ufage auffi journalier*
C eft 1 oifeau appelle faucon qui a donné le nom
ï\.z fauconnerie, parce que c’eft celui qui fert à un
plus grand nombre d’ufages. Il y a le faucon proprement
dit ; mais fouvent on attribue auffi ce nom à
d’autres oifeaux, en y ajoûtant une diftinélion particulière.
On dit faucon-gerfault, faucon~lanier, 6co.
Entre les faucons de même efpece, on remarque
des différences qui défignent leur âge, & le tems
auquel on les a pris. On appelle faucons fors , paf-
fagers ou pèlerins, ceux q ui, quoiqu’à leur premier
pennage, ont été pris venant dé loin, & dont on n’a
point vû l’aire ou le nid. Le faucon niais, qu’on nomme
znffi faucon royal, eft celui qui a été pris dans fon
aire ou aux environs. Enfin le faucon appellé hagard,
eft celui qui a déjà mué lorfqu’on le prend.
Les auteurs qui ont écrit de la fauconnerie, font
encore un grand nombre de diftimftions , mais qui
ne tiennent point à l’art $ elles ne font que défigner
les pays d’où viennent les faucons, ou ce ne font
que différens termes de jargon qui expriment à-peu-
près les mêmes chofes.
Le choix des oifeaux eft une chofe effentielle en
fauconnerie. On doit s’arrêter à la conformation que
nous allons décrire, quoique toutes les marques extérieures
de bonté puiffent quelquefois tromper. Le
faucon doit avoir la tête ronde, le bec court 6c gros ,
le cou fort long, la poitrine nerveufe, les mahutes
larges, les cuiffes longues, les jambes courtes, la
main large, les doigts déliés, alongés, & nerveux
âux Articles ; les ongles fermes 6c recourbés, les ailes
longues. Les Agnes de force 6c de courage font
les mêmes pour le gerfault, &c. 6c pour le tiercelet,
qui eft le mâle, dans toutes les efpeces d’oifeaux de
proie, & qu’on appelle ainfi parce qu’il eft d’un tiers
plus petit que la femelle. Une marque de bonté
moins équivoque dans un oifeau, e’eil de chevaucher
le v ent, c’eft-à-dire de fe roidir contre, & fe
tenir ferme fur le poing lorfqu’on l’y expolè. Le pennage
d’un bon faucon doit être brun 6c tout d’une
piece, c’eft-à-dire de même couleur. La bonne cou*
leur des mains eft le verd d’eau : ceux dont les mains
6c le bec font jaunes, ceux dont le plumage eft femé
de taches , ce qu’on appelle égalé ou haglé $ font
moins eftimés que les autres. On fait cas des faucons
noirs ; mais quel que foit leur plumage, ce font toûjours
les plus forts en courage qui font les meilleurs.
Outre la conformation, il faut encore avoir égard
à la fanté de l’oifeau. Il faut voir s ’il n’eft point attaqué
du chancre, qui eft une efpece de tartre qui
s’attache au gofier & à la partie inférieure du bec ;
s’il n’a point fa molette empelotée, c’eft-à-dire fi la
nourriture ne refte point par pelotons dans fon efto-
mac ; s’il fe tient fur la perche tranquillement & fans
vaciller ; fi fa langue n’eft point tremblante ; s’il a
les yeux perçans & affûrés ; fi les émeuts font blancs
6c clairs ; les émeuts bleus font un fymptome de
mort.
Le choix d’un oifeau ainfi fait, on paffe aux foins
néceffaires pour le dreffer. On commence par l’armer
d’entraves appellées je ts , au bout defquels on met
un anneau fur lequel eft écrit le nom du maître : on
y ajoute des fonnettes, qui fervent à indiquer le lieu
où il eft lorfqu’il s’écarte à la chaffe. On le porte continuellement
fur le poing ; on l’oblige de veiller : s’il
eft méchant & qu’il cherche à fe défendre, on lui
plonge la tête dans l’eau ; enfin on le contraint par
la faim & la laflltude à fe laiffer couvrir la tête d’un
chaperon qui lui enveloppe les yeux. Cet exercice
dure fouvent trois jours 6c trois nuits de fuite ; il eft
rare qu’au bout de ce tems les befoins qui le tourmentent
, 6c la privation de la lumière, ne lui faffent
pas perdre toute idée de liberté. On juge qu’il a oublié
fa fierté naturelle, lorfqu’il fe laiffe aifément
couvrir la tête, & que découvert il faifit le pat ou
la viande qu’on a foin de lui préfenter de tems en
tems. La répétition de ces leçons en affûre peu-à-
peu le fuccès* Les befoins étant le principe delà dépendance
de l’oifeau, on cherche à les augmenter,
en lui nettoyant l’eftomac par des cures.. Ce font de
petits pelotons de filaffe qu’on lui fait avaler, 6c qui
augmentent fon appétit ; on le fatisfait après l’avoir
excité, & la reconnoiflance attache l’oileau à celui
même qui l’a tourmenté. Lorfque les premières le*
çons ont réuffi, 6c qu’il montre de la docilité, on le
porte furie gafon dans un jardin. Là on le découvre,
6c avec l’aide de la viande on le fait fauter de lui-
même fur le poing. Quand il eft affûré à cet exercic
e , on juge qu’il eft tems de lui donner le v if , 6c de
lui faire connoître le leurre.
Ce leurre eft une repréfentation de proie, un af*
femblage de piés 6c d’ailes, dont les fauconniers fe
fervent pour réclamer les oifeaux , 6c fur lequel on
attache leur viande. Cet infiniment étant deftiné à
rappeller les oifeaux & à les conduire, il eft important
qu’ils y foient non-feulement accoûtumés, mais
affriandés. Quelques fauconniers font dans l’ufage
d’exciter l’oifeau à plufieurs reprifes dans la même
leçon, lorfqu’ils f accoutument au leurre. Dès qu’il
a fondu demis, 6c qu’il a feulement pris une bécade,
ils le retirent fous prétexte d’irriter la faim, & de
l’obliger à y revenir encore ; mais par cette méthode
on court rifque de le rebuter : il eft plus fûr, lorfqu’il
a fait ce qu’on attendoit de lq j, de le paître
To/pc F7,
toüt-à-faït, 6c ce doit être la récompenfc de fa docilité.
Le leurre eft l’appas qui doit faire revenir Foi-
leau lorfqu’il fera élevé dans les airs ; mais il ne feront
pas fuffifant fans la voix du fauconnier, qui l’avertit
de le tourner de ce côté-là. Il faut donc que le
mouvement du leurre foit toûjours accompagné du
fon de la voix 6c même des cris du fauconnier, afin
que l’un & l’autre annoncent enfemblc à l’oifeau que
les befoins vont être foulagés. Toutes ces leçons doivent
être fouvent répétées, 6c par le progrès de eha-
cuneje fauconnier jugera de celles qui auront befoitz
de l’être davantage. Il faut chercher à bien connoître
le cara&ere de l’oifeau, parler fouvent à celui
qui paroît moins attentif à la v o ix , laiffer jeûner celui
qui revient moins avidement au leurre, veiller
plus long-tems celui qui n’eft pas affez familier, cou-
v,rb‘ fouvent du chaperon celui qui craint ce genre
d’affujettiffement. Lorfque la docilité 6c la familia-
rite d’un oifeau font fuffifamment confirmées dans
le jardin, on le porte en plaine campagne, mais toujours
attaché à la filiere, qui eft une ficelle longue
d’une dixaine de toifes : on le découvre ; & en Vap*
pellant à quelques pas de diftance, on lui montre le
leurre. Lorfqu’il fond deffus, on le fert de la viande,
& on lui en laiffe prendre bonne gorge, pour continuer
de l’affûrer. Le lendemain on le lui montre d’un
peu plus loin, 6c il parvient enfin à fondre deffus du
bout de la filiere : c’eft alors qu’il faut faire connoître
& manier plufieurs fois à l’oifeau le gibier auquel
on le deftine ; on en conferve de privés pour cet
ufage; cela s’appelle donner l’efeap. C ’eft la derniers
leçon, mais elle doit fe répéter jufqu’à ce qu’on foit
parfaitement affûré de l’oifeau : alors on le met hors
de filiere, & on le vole pour bon*
La maniéré de leurrer que nous avons indiquée ,
né s’employe pas à l’égard des faucons 6c tiercelets
deftinés à voler la pie, ou pour champ, c’eft-à-dire
pour le vol de la perdrix. Lorfque ceux-là font af-
fiires au jardin, 6c qu’ils fautent fur le poing, on
leur fait tuer un pigeon attaché à un piquet, pour
leur faire connoître le vif. Après cela on leur donne
un pigeon volant, au boiit d’une filiere ; & lorfqu’on
les juge affez sûrs pour être mis hors de filiere eux-
mêmes , on leur donne Un pigeon volant librement
mais auquel on a fillé les yeux. Ils le prennent, parce
qu’il fe défend mal. Alors, fi l’on compte fur leur
©béiffance, on cherche à les rebuter fur les pigeons
6c fur tous les gibiers qu’ils ne doivent pas voler ;
pour cela on les jette après des bandes de pigeons,
qui fe défendent trop bien pour être pris, 6c on ne
les fert de la viande, que quand on leur a fait prendre
le gibier auquel on les deftine. Le faucon pour
corneille fe dreffe de la même maniéré, ipais fans
qu’on le ferve de pigeons ; c’eft une corneille qu’on
lui donne à tuer au piquet; & après cela on lui don*
ne plufieurs fois l’efeap au bout d’une filiere mince
6c courte, jufqu’à ce qu’on le juge affez confirmé
pour le voler pour bon*
Les auteurs qui ont écrit fur la Fauconnerie , don*
nent encore d’autres méthodes dont nous ne parlerons
point ; foit parce qu’elles font contenues en
fubftânce dans ce que nous avons dit ; foit parce que
l’expérience & l’ulage d’aujourd’hui les ont abrégées.
Un mois doit fuffire pour dreffer un oifeau. Il y en a
qui font lâches 6c pareffeux ; d’autres font fi fiers,
qu’ils s’irritent contre tous les moyens qu’on employé
pour les rendre dociles. Il faut abandonner
les uns 6c les autres. En général, les niais font les
plus aifés ; les fors le font un peu moins, mais plus
que les hagards qui, félon le langage des Fauconniers,
font fouvent curieux, c’eft-à-dire moins dif-
pofés par leur inquiétude à fe prêter aüx leçons.
Le loin des oifeaux de proie, foit en fanté, foit en
maladie, étant une partie principale de la Fauconru*
I i i ij