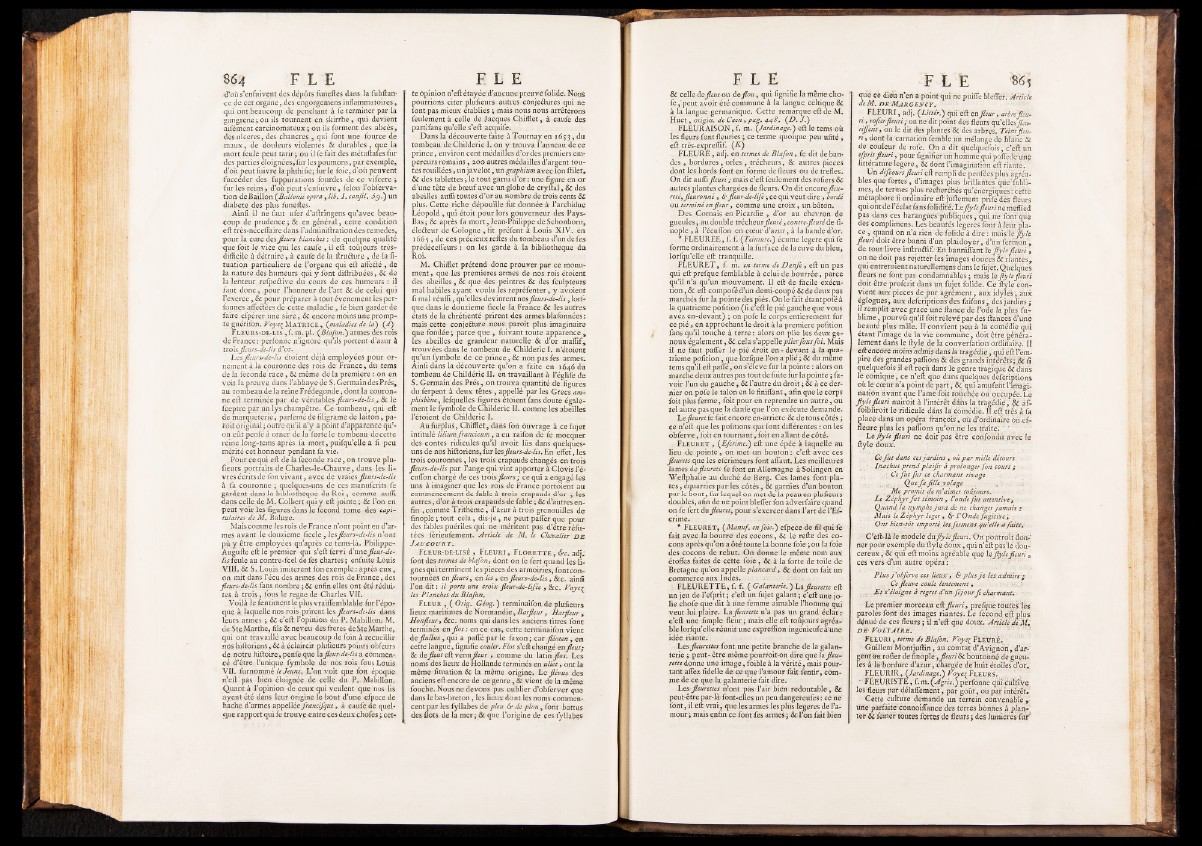
d’où s’enfuivent des dépôts funeftes dans la fubftan-
ce de cet organe, des engorgemens inflammatoires,
qui ont beaucoup de penchant à fe terminer par la
gangrené ; ou ils tournent en skirrhe, qui devient
aifément carcinomateux ; ou ils forment des abcès,
des ulcérés, des chancres , qui font une fource de
•maux , de douleurs violentes & durables , que la
mort feule peut tarir; pu il fe fait des métaftafesfur
des parties éloignées, fur les poumons, par exemple,
d’où peut fuivre la phthifie; fur le foie, d’où peuvent
fuccéder des fuppurations fourdes de ce vifcere ;
fur les reins , d’où peut s’enfuivre, félon Fobferva-
tion de Bâillon ( Ballonii opéra, lib. I . confit. J5».) un
diabete des plus funeftes.
Ainfi il ne faut ufer d’aftringens qu’avec beaucoup
de prudence ; & en général, cette condition
eft très-néceffaire dans radniiniftration des remedes,
pour la cure des fleurs blanches : de quelque qualité
que foit le vice qui les caufe , il eft toujours très-
difficile à détruire, à caufe de la ftruûure , de la fi-
tuation particulière de l’organe qui eft affeélé , de
la nature des humeurs qui y font diftribuées, 8c de
la lenteur refpeélive du cours de ces humeurs : il
faut donc , .pour l’honneur de l’art 8c de celui qui
l’exerce, 8c pour préparer à tput événement les personnes
affectées de cette m.aladie , fe bien garder de
faire efpérer une sûre,, 8ç encore moins une prompte
guéril'on. Voye^ M a t r i c e ,, ( m aladies de la ) ( a )
Fleürs-de-lis ,f. m. pl. (Blafon.) armes des rois
de France: perfonne n’ignore qu’ils portent d’azur à
troisfieurs-de-lis à’or. _
Les fleursrde-ïis étoient déjà employées pour ornement
à la couronne des rois de France, du tems
de la fécondé race, 8c même de la première : on en
voit la preuve dans l’abbaye de S. Germain des Prés,
au tombeau:de la reine Frédegonde, dont la couronne
eft terminée par de véritables f ie u r s -d e -lis& le
fceptre par un lys champêtre. Ce - tombeau, qui eft
de marqueterie, parfemé de filigrame de laiton, paraît
original ; outre qu’il n’y a point d’apparence qu’on
eût penfé à orner de la forte le tombeau de cette
reine long-tems après fa mort, puifqu’elle à li peu
mérité cet honneur pendant fa vie.
Pour ce qui eft de la fécondé race, on trouve plufieurs
portraits de Charles-le-Chauve, dans les livres
écrits de' fon vivant, avec de vraies fleurs-de-lis
à fa couronne ; quelques-uns de ces manufcrits fe
gardent dans la bibliothèque du R oi, comme aulli
dans celle de M. Colbert qui y eft jointe ; 8c l’on en
peut voir les figures dans le fecpnd tome des capitulaires
de M . Baluze.
Mais comme les rois de France n’ont point eu d’armes
avant le douzième fiecle, lesfieurs-de-lis n’ont
pû y être employées qu’après ce tems-là. Philippe—
Àugufte eft le premier qui s’eft fervi d’une fieur-de-
l i s i e ule au contre-fcei de fes chartes ; enfuite Louis
OTL 8c S. Louis imitèrent fon exemple après eux,
on mit dans l’écu des armes des rois de France, des
fleurs-dp-lis fans nombre ; 8c enfin elles ont été.rédui-
tes. à trois, fous le régné de Charles VIL
Voilà le Sentiment le plus vraiffemblable fur l’époque
à laquelle nos rois prirent les fieurs-de-lis dans
leurs armes ; 8c c’eft, l’opinion du P. Mabillon. M.
de SteMarthe, fils & neveu desfreres deSteMarthe,
qui ont travaillé avec beaucoup de foin à recueillir
nos hiftoriens, & à éclajrcir plufieurs points obfçurs
de notre hiftoire, penfe que la fieur-de-lis a commencé..
d’être l’unique Symbole de nos rois fous Louis,
VIL furnommé le jeu n tt L’on voit que fon époque
n’eft .pas. bien éloignée de celle du P. Mabillon.
Quant à l’opinion de ceux qui veulent que nos lis
ayent été dans leur origine le bout d’une efpece de
hache d’armes appellée fra n çifq u e, à caufe.de quelque
rapport qui le trouve entre ces deux chofes ; cette
Opinion n’eft étayée d’aucune preuve folide. Noué
pourrions citer plufieurs autres conjectures qui ne
font pas mieux établies ; mais nous nous arrêterons
feulement à celle de Jacques'Chifflet, à caufe des
parti fans qu’e.lle s’eft acquife.
Dans la découverte faite à Tournay en 1653, du
tombeau de Childerie I. on y trouva l’anneau de ce
prince, environ cent médailles d’or des premiers empereurs
romains, 200 autres médailles d’argent toutes
rouillées, un javelot, un graphium avec fon ftilet,
& des tablettes ; le tout garni d’or : une figure en or
d’une tête de boeuf avec un globe de cryftal, & des
abeilles auffi toutes d’or au nombre de trois cents 8c
plus. Cette riche dépouille fut donnée à l’archiduc
Léopold , qui étoit pour lors gouverneur des Pays-
Bas; 8c après fa mort, Jean-Philippe deSchonborn,
éle&eur de Cologne , fit prélent à Louis XIV. en
16.6 5 > de ces précieux relies du tombeau d’un de fes
prédéceffeurs : on les garde à la bibliothèque du
Roi.
M. Chifflet prétend donc prouver par ce monument
, que les premières armes de nos rois étoient
des abeilles, 8c que des peintres & des fculpteurs
mal habiles ayant voulu les repréfenter, y avoient
fi mal réuffi, qu’elles devinrent nos fieurs-de-lis, lorl-
que dans le douzième fiecle la France 8c les autres
états de la chrétienté prirent des armes blafonnées:
mais cette conjecture nous, paraît plus imaginaire
que fondée ; parce que , fuivant toute apparence ,
les abeilles de grandeur naturelle & d’or maffif,
trouvées dans le tombeau de Childerie I. n’étoient
qu’un fymbole de ce prince , 8c non pas fes armes.
Ainfi dans la découverte qu’on a faite en 1646 du
tombeau de Childéric II. en travaillant à l’églife de
S. Germain des Prés, on trouva quantité de figures
du ferpent à deux têtes , appellé par les Grecs am-
pkisbène , lefquelles figures étoient fans doute également
le fymbole de Childerie II. comme les abeilles
l’étoient de Childerie I.
Au fur plus, Chifflet, dans fon ouvrage à ce fujet
intitulé lilium francicum, a eu raifon de fe mocquer
des contes ridicules qu’il avoit lûs dans quelques-
uns de nos hiftoriens, lur les fieurs-de-lis. En effet, les
trois couronnes, les trois crapauds changés en trois
fieurs-de-lis par l’ange qui vint apporter à Clovis l’é*
euffon chargé de ces trois fleurs; ce qui a engagé les
uns à imaginer que les rois de France portoient au
commencement de fable à trois crapauds d’or ; les
autres, d’or à trois crapauds de fable ; & d’autres enfin
, comme Trithème, d’azur à trois grenouilles de
finople ; tout cela, dis-je, ne peut paffer que pour
des fables puériles qui ne méritent pas d’être réfutées
férieufement. Article de M. le Chevalier d e
J a u c o u r t .
F l e u r -d e -l i s é , F l e u r i , F l o r e t t e , & c. adj.'
font des termes de blafon, dont on fe fert quand les lignes
qui terminent les pièces des armoiries; font contournées
en fieurs, en lis , en fieurs-de-lis , &c. ainfi
l’on dit : i l porte une croix fieurrde-lifée , &c. Voyeç
les Planches du Blafon.
F l e u r , ( Orig. Géog. ) terminaifon de plufieurs
lieux maritimes de Normandie, Barfleur , Harfieur ,
Honfieur, 8c c . noms qui dans les anciens titres font
terminés en flo t : en ce cas, cette terminaifon vient
de fluctus, qui a paffé par le faxon ; car fléoten, en
cette langue, lignifie couler. Flot s’eft changé en f i t ut;
& d e fitu t eft venu fleur , .comme du latin flo s. Les
noms des lieux de Hollande terminés en u lie t, ont la
même fituation 8c la même origine. Le flévus des
anciens eft encore de ce genre, & vient de la même
fouche..Nous ne devons pas oublier d’obferver que
dans le bas-breton, les lieux dont les noms commencent
par les fyllabes de pieu & de p lo u , font battus
des flots de la mer; & que l’origine de ces fyllabes
8c celle de fleut ou deflou , qui lignifie la même cho-
fe ,’peut avoir été commune à la langue celtique 8c
à la langue germanique. Cette remarque eft de M.
Huet, origin. de Caen , pag. 4 48. (D. J .) ,
FLEÜRAISON, fi m. ('Jardinage.) eft le tems où
les fleurs font fleuries ; ce terme quoique peu ufité,
eft très-expreflif. (K )
. FLEURÉ, adj. en termes de Blafon, fe dit de bandes.,
bordures, orles , trécheurs, & autres pièces
dont les bords font en forme de fleurs ou de trefles.
On dit auffi fleuri ; mais c’eft feulement des rofîers 8c
autres plantes chargées de fleurs. On dit encore fieu-
reté, fleuronné, & fleur-dedifé ; ce qiii veut dire 9 bordé
ou terminé en fleu r , comme unê croix, .un-bâtôn.
Des Cornais en Picardie , d’or au chevron, de
gueules ; au double ttécheurfleuré ,contre-fieuré de lh
nople, à l’écuffon en coeur d’azur, à la bande d’or.
* FLEURÉE, f. f. (Teinture.) écume legere qui fe
forme ordinairement à la furface de la cuve du bleu,
lorfqu’elle eft tranquille.
FLEURET, f. m. en terme de D a n fe , eft un pas
qui eft prefque femblable à celui de bourrée, parce
qu’il n’a qu’un mouvement. Il eft de facile exécution
, 8c eft compofé d’un .demi-coupé 8c de deux pas
marchés fur la pointe des piés. On le fait étant pofé à
la quatrième pofition (fic’eft le pié gauche que vous
avez en-devant) ; on pofe le corps entièrement fur
ce pié , en approchant le droit à la première pofition
fans qu’il touche à terre :• alors on plie les deux genoux
également, 8C cela.s’appelle plier fous f o i . Mais
il ne faut paffer le pié droit en-devant à la quatrième
pofition, que lorfque l’on a plié ; 8c du meme
tems qu’il eft paffé, on s’élève fur la pointe : alors on
marche deux autres pas tout de fuite fur la pointe ; fa-
voir l’un du gauche, 8c l’autre du droit ; 8c à ce dernier
on pofe le talon en le finiffant, afin que le corps
foit plus ferme, foit pour en reprendre un autre, ou
tel autre pas que la danfe que l’on exécute demande.
L e fleuret (e fait encore en-arriére 8c de tous côtés ;
ce n’eft que les pofitions qui font différentes : on les
obferve,,.fe>it en tournant ,.foit en allant de côté.
Fleuret , (Efcrime.) eft une épée à laquelle au
lieu de pointe, on met un. bouton : c’eft avec ces
fleurets que les eferimeurs font affaut. Les meilleures
lames de fleurets fefbnt en Allemagne à-Solingen en
Weftphalie au duché de Berg. Ges lames font'plates,
équarries parrles côtés , & garnies d’ûn botitori
par le bout, fur lequel on met de la peau en plufieurs
doubles, afin de ne point bleffer fon adverfairé quand
on fe fert du flèuret, pour s’exercer dans l’art de l’Ef-
crime.
* FLEURET, (Manuf. en fo ie .) efpece de fil qui fe
fait avec la bourre des cocons, 8c le refte des cocons
après qu’on a ôté toute la bonne foie ;ou la foie
des cocons de rebut. On donne le même nom aux
étoffes faites de cette foie, & à la forte de toile de
Bretagne qu’on appelle plancard, &c dont on fait un
commerce aux Indes. > :
FLEURETTE, fi f. ( Galanterie.) La fleurette eft
un jeu de l’efprit ; c’eft un fujet galant ; c ’eft une jolie
chofe que dit à une femme aimable l’homme qui
veut, lui plaire. La fleurette n’a pas un grand éclat ::
c’eft une fimple fleur ; mais elle eft toûjours agréable
lorfqu’elle réunit une expreffion ingénieufeà une
idée riante.'
Le s fteürettes fo n t une petite branche de la galanterie
; peut-être même pourroit-on dire que la fleurette
donne une image, foible à la vérité, mais pourtant
affez fidelle de çë que l’amour fait fentir, comme
de ce que la galanterie fait dire.
Les.fleurettes n’ont pàs: l’aif bién redoutable, &
peut-être par-làTont-élles un peu dangereüfës : cè ne
font, il eft vrai, que les armes les plus legeres de l’amour;
mais enfin ce font fes armes ; &• l’on fait bien
qùe ce dieu n’en-a point qui he pùiffe bleffer ; Article
de M . d e M a r g e n c y .
FLEURI, adj. ( L i t t ê r f quieft en fleur , àrbre?fleii.
r i; rafler fleur i; on he dit point des fleurs qu’elles ƒ w-
rijfent, 6n le dit dfes plantes & des arbres, Teint f in i ,
■ ri, doht la 'carnation femble iin mélange de blähe &
de couleur de rofe. On à dit quelquefois, c’èft un
efprit fleur i, pour lignifier Un homme qui po'ffedë'unp
littérature legere, & dont l’imagination eft riante.
Un dij,cours fleuri eft rempli de p e n fé e s :p lus; à gïé a-
bles que fortes , d’images plus brillantes qiùrfübli-
mes, de termes phis rècheréhés qu’énefgiqués} fcéttè
métaphore fi ordinaire eft jùftemènt prifé dès fleurs
qui ont de l’éclat fans lblidifé.' Lèfiylefleuri rte meflîed
pas dans ces harangüës pïibliques, qui ne fdnf qûè
dés COmplimens. Les béàutés legereS font à leur place
, quand on n’a riéri-dé folide à dire': fçÉt$l\è fiy lc
fleuri doit être banni d’un plaidoyer, d’un'fer mon,
de tout livre inftruÔif.'En bahniffant l'e f i f le fle u r i,
on ne doit pas rejettèfles; images douces &fra H tés ,
qui entreraient naturellemens dans le. fujet, Quelques
fleurs ne fönt pas condamnables ; mais le fiy le fleuri
doit être proferit dans Un fujet folide. Ce ftyle convient
aux pièces de pur agrément, aux idÿles; aux
églogues, aux deferiptioris des faifons,. des jardins ;
il remplit avec grâce une ftance de l’odé là plus fu-
blime, pdurvû qu’il foit rele vé par des fiances d’une
beauté plus mâle. Il Convient peu à la cohiédiè qui
étant l’image de la vie .commune, doit être généralement
dans le ftyle de là converfation' ördihaife. Il
eft encore moins admis dans la tragédie, qui éft l’ëm-
pire des grandes paffions & dès grands inté fê tf^ô c à
quelquefois il eft reçu dans le genre tragicjüe 8t dans
le comique, ce n’eft que dans quelques dèfcriptions
où le coeur n’a point départ , 8c qui amufefitTîmâgi-
natiön avant que l’ame foit touchée ou occupée. Le
fiy le fleuri nuirait à l’intérêt dàhs la tragédiè, & âf-
fôibliroit le ridiculé däns ‘la* comédie. Il eft ttès à fa
placé dans un opéra frânçois; où d’ordiriaire ôn ef-
fleure plus les paffions qu’ôn'ne les traiter ' '
L e ß y le fleuri ne doit pas être confondu avec le
ftyle doux.
Ce,fut dans ces jardins où par mille détours .
. : . Ipachus prend, plaïfir à prolonger fo n cours. ; >. 1.
. ; Ce fu t fu r ce charmant rivage
S Qj**-fafiflt'éKQfoge ■ y H M a g j
Me promit de ni aimer toâjojirs,. f ..
Le Zéphyr fu t témoin , l\onde fu t attentive
Quand la nymphe ju ra de ne changer jamais ;
. Mais le Zéphyr leger , & VOnde fu g itiv e j :
Ont bien-tôt emporté. je$ fe r mens qu'elle a faits
C’eft-Ià le modele du fiyle fleuri: On pOiitrait donner
pour exemple dü ftyle doux, qui n’eft pasple doucereux
, 8c qui eft moins agréable que ie fiy le fleu r i,
ces vers d’un autre opéra : .
P lu s j'obferve ces lieu x , & plus j e les-, admire■ ;
, Ce fleuve coule lentement,
... E t f éloigne à regret fü n f é jo u r f l charmants -
Le. premier morceau eft f le u r i, prefque tôu tës lès
paralèsffôht des images riantes. Le fécond èft'plus
déhué de ces fleurs ; il n’eft que donic. À f t îd i dt.M,
D E' V o i t A IR E .
FlèuEï , -terme de Blafon. Koye^ Fleuré.
Güillem Moritjuftin, au comtat d’Avignon,'d’argent
^uröfier de nnôple, fleuri 8c boutonné de gueules
ä lä'bordure d’azur,-chargée déliuit ètoile$ d^ôr.
FLEURIR, (Jardinage.) F'ôy«£.FLEURS.
■ FLeÜRFSTE , fi m. (fig ric.) perfonfte qüiçuitive
les'fleuris jfar délaffement, par goût, ou par intérêt.
Cette culture demande un terrein coqyenäble ,
une1 parfaite connoiffance des terres bônhes à, planter
& feàiier'toutes fortes-de fleurs ; des lumiet'es ftir