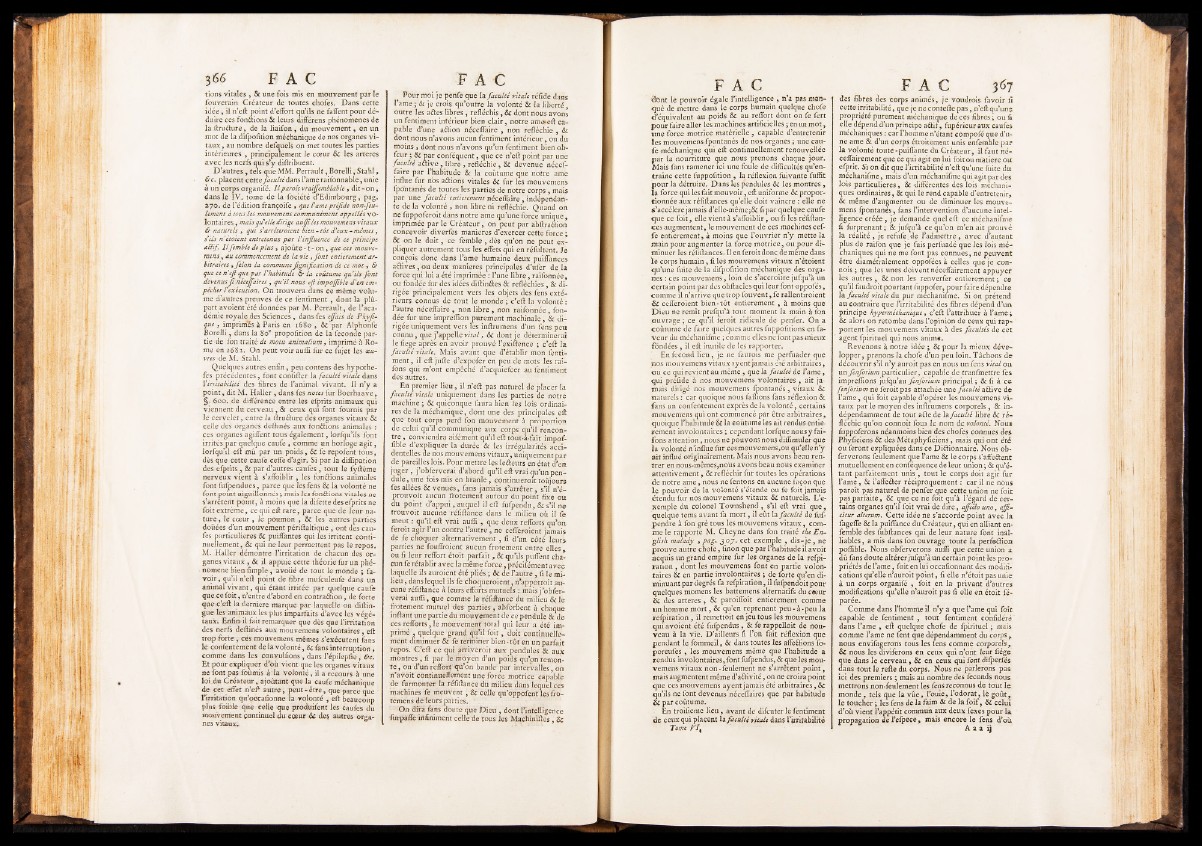
3<S6 F A C
tions vitales , & une fois mis en mouvement par le
fouverain Créateur de toutes chofes. Dans cette
idée , il n’eft point d’effort qu’ils ne faffent pour déduire
ces fondions & leurs différens phénomènes de
la ftrudure, de la liaifon, du mouvement, en un
mot de la difpofition méchanique de nos organes v itaux
, au nombre defquels on met toutes les parties
intérieures , principalement le coeur 8c les arteres
avec les nerfs qui s’y diftribuent.
D ’autres, tels que MM. Perrault, Borelli, Stahl,
6’c. placent cette faculté dans l’ame raifonnable, unie
à un corps organifé. ILparoîtvraijfemblable, d it-on ,
clans le IV. tome de la fociété d’Edimbourg, pag.
270. de l’édition françoife , que Famé préjîde non-feulement
à tous les mouvemens communément appelles vo lontaires
» mais qiFeLlt dirige au f i les mouvemens vitaux
& naturels , qui s*arrêteraient bien - tôt d'eux - mêmes ,
s'ils n étoient entretenus par l'influence de ce principe
a3i f I l femble de plus , ajoûte - 1 - on, que ces mouvemens
, au commencement de la vie, font entièrement arbitraires
y félon la commune Jignification de ce mot, &
que ce n'efi que par l'habitude & la coutume qu'ils font
devenus Jinéceffaires , qu'il nous efl impofjible d'en empêcher
l'exécution. On trouvera dans ce même volume
d’autres preuves de ce fentiment , dont la plû-
part avoient été données par M. Perrault, de l’ académie
royale des Sciences , dans fes ejfais de Phyji-
que, imprimas à Paris en 1680 , 8c par Alphonfe
Borelli, dans la 80e propofition de la fécondé partie
de fon traité de motu animalium, imprimé à Rome
en 1682. On peut voir aufli fur ce fujet les oeuvres
de M. Stahl.
Quelques autres enfin, peu contens des hypothe-
fes précédentes, font confifter la faculté vitale dans
l’irritabilité des fibres de l’animal vivant. Il n’y a
point, dit M. Haller , dans fes notes fur Boerhaave,
§ . 600. de différence entre les efprits animaux qui
viennent du cerveau, & ceux qui font fournis par
le cervelet, entre la ftruéture des organes vitaux 8c
celle des organes deftinés aux fondions animales :
ces organes a giflent tous également, lorfqu’ils font
irrités par quelque caufe , comme un horloge agit,
lorfqu’il efl mû par un poids, 8c fe repofent tous,
dès que cette caufe ceffe d’agir. Si par la diflipation
des efprits, & par d’autres caufes , tout le fyftème
nerveux vient à s’affoiblir , les fondions animales
font fufpendues, parce que les fens 8c la volonté ne
font point aiguillonnés; mais les fondions vitales ne
s’arrêtent point, à moins que la difette des efprits ne
foit extrême, ce qui efl rare, parce que de leur nature
, le coeur, le poumon , & les autres parties
douées d’un mouvement périftaltique , ont des caufes
particulières 8c puiffantes qui les irritent continuellement,
& qui ne leur permettent pas le repos.
M. Haller démontre l’irritation de chacun des organes
vitaux, & il appuie cette théorie fur un phénomène
bien Ample, avoué de tout le monde ; fa-
v o ir , qu’il n’eft point de fibre mufculeufe dans un
animal v ivant, qui étant irritée par quelque caufe
que ce foit, n’entre d’abord en contradion, de forte
que c ’eft la demiere marque par laquelle on diftin-
gue les .animaux les plus imparfaits d’avec les végétaux.
Enfin il fait remarquer que dès que l’irritation
des nerfs deftines aux mouvemens volontaires, eft
trop forte ; ces mouvemens mêmes s’exécutent fans
le confentement de la volonté, 8c fans interruption,
comme dans les conyulfions , dans l’épifepAe f &c.
Et pour expliquer d’où vient que les organes vitaux
ne font pas fournis à la volonté, il a recours à une
loi.du Créateur, ajoutant que la caufe méchanique
de cet effet n’eft autre, peut-être, que parce que
l’irritation qn’odcafionne la volonté , eft beaucoup
plus foible que celle que produifent les caufes du
mouvement continuel du coeur & de$ autres organes
vitaux.
F A C
Pour moi je penfe que la faculté vitale réfide dans
Pâme ; & je crois qu’outre la volonté & la liberté
outre les ades libres, réfléchis, 8c dont nous avons
un fentiment intérieur bien clair, notre ame^eft capable
d’une adion néceffaire , non refléchie , &
dont nous n’avons aucun fentiment intérieur, ou du
moins, dont nous n’avons qu’un fentiment bien ob-
fcur ; 8c par conféquent, que ce n’eft point par une
faculté a d iv e , libre , refléchie, 8c devenue néceffaire
par l’habitude & la coutume que notre ame
influe fur nos adions vitales 8c fur les mouvemens
fpo'ntanés de toutes les parties de notre corps , mais
par une faculté entièrement néceffaire , indépendante
de la volonté , non libre ni refléchie. Quand on
ne fuppoferoit dans notre ame qu’une force unique ,
imprimée par le Créateur, on peut par abftradion
concevoir diverfes maniérés d’exercer cette force ;
& on le do it, ce femble, dès qu’on ne peut expliquer
autrement tous les effets qui en réfultent. Je
conçois donc dans l’ame humaine deux puiffances
ad ives, ou deux maniérés principales d’ufer de la
force qui lui a été imprimée : l’une libre, raifonnée,
ou fondée fur des idées diftindes & refléchies, & dirigée
principalement vers les objets des fens extérieurs
connus de tout le monde ; c’eft la volonté:
l’autre néceffaire , non libre , non raifonnée, fondée
fur une impreflion purement machinale, & dirigée
uniquement vers les inftrumens d’un fens peu
connu, que j’appelle vital, 8c dont je déterminerai
le fiege après en avoir prouvé i’exiftence ; c’eft la
faculté vitale. Mais avant que d’établir mon fentiment
, il eft jufte d’expofer en peu de mots les rai-
fons qui m’ont empêché d’acquiefcer au fentiment
des autres.
Eii premier lieu , il n’eft pas naturel de placer la
faculté vitale uniquement dans les parties de notre
machine ; 8c quiconque faura bien les lois ordinaires
de la méchanique, dont une des principales eft
que1 tout cOrps perd fon mouvement à proportion
de celui qu’il communique aux corps qu’il rencontre
, conviendra aifément qu’il eft tout-à-fait impof-
fible d’expliquer la durée & les irrégularités accidentelles
de nos mouvemens vitaux, uniquement par
de pareilles lois. Pour mettre les le&eurs en état d’en
juger , j’obferverai d’abord qu’il eft vrai qu’un pendule,
une fois»mis en branle, continuerait toûjours
fes allées 8c venues, fans jamais s’arrêter, s’il n’é-
prouvoit aucun frotement autour du point fixe ou
du point d’appui, auquel il eft fufpendu, 8c s’il ne
trouvoit aucune réfiftance dans le milieu où il fè
meut : qu’il eft vrai aufli , que deux refforts qu’on
feroit agir l’un contre l’autre , ne cefferoient jamais
de fe choquer alternativement , fi d’un côté leur«;
parties ne fouffroient aucun frotement entre elles „
ou fi leur reffort étoit parfait , & qu’ils puffent chacun
fe rétablir avec la même force, précifément avec
laquelle ils auroient été pliés ; 8c de l’autre , fi le milieu
, dans lequel ils fe choqueraient, n’apportoit aucune
réfiftance à leurs efforts mutuels : mais j ’obferverai
aufli, que comme la réfiftance du milieu 8c le
frotement mutuel -des partiès , abforbent à chaque
inftant une partie du mouvement de ce pendule & de
ces refforts, le mouvement' tétai qui leur a été imprimé
, quelque grand qù’il1 fo i t , doit continuellement
diminuer 8c fe terminer bien-tôt en un parfait
repos. C ’eft ce qui arriverait aux pendules & aux
montres , fi par le moyen d’un poids qu’pn remont
e , ou d’un reffort qu’on bande par intervalles, on
n’avoit continuellement une force motrice capable
de furmonter la réfiftance du milieu dans lequel ces
machines fe meuvent ; & celle qu’oppofent les fro-
temens de leurs parties. r .
On dira fans doute que Dieu , dont l’intelligence
furpâffe infiniment celle de tous les Machinïftes, 8c
F A C
Ütent lè pouvoir égale l’intelligence , n’a pas manqué
de mettre dans le corps humain quelque chofe
d’équivalent au poids 8c au reffort dont on fe fert
pour faire aller les machines artificielles ; en un m ot,
une force motrice matérielle, capable d’entretenir
les mouvemens Spontanés de nos organes ; une caufe
méchanique qui eft continuellement renouvellée
par la nourriture que nous prenons chaque jour.
Mais fans ramener ici une foule de difficultés qu’entraîne
cette fuppofition , la réflexion fuivante fuffit
pour la détruire. Dans les pendules 8c les montres,
fa force qui les fait mouvoir, eft uniforme 8c proportionnée
aux réfiftances qu’elle doit vaincre : elle ne
s’accélère jamais d’ëlle-même ;8c fi par quelque caufe
que ce foit, elle vient à s’afFoiblir, ou fi les réfiftances
augmentent, le mouvement de ces machines cef-
fe entièrement, à moins que l’ouvrier n’y mette la
main pour augmenter la force motrice, ou pour d iminuer
les réfiftances.Il en feroit donc de même dans
le corps humain, fi les mouvemens vitaux n’etoient
qu’une fuite de la difpofition méchanique des organes
: ces mouvemens, loin de s’accroître jufqu’à un
certain point par des obftacles qui leur font oppofés,
comme il n’arrive que trop fouvent, fe rallentiroient
& cefferoient bien-tôt entièrement , à moins que
Dieu ne remît prefqu’à tout moment la main à fon
ouvrage ; ce qu’il lèroit ridicule de penfer. On a
coutume de faire quelques autres fuppofitions en faveur
du méchanifme ; comme elles ne font pas mieux
fondées , il eft inutile de les rapporter.
En fécond heu, je ne faürois me perfuader que
nos mouvemens vitauxayent jamais été arbitraires,
ou ce qui revient au même, que la faculté de l’ame,
qui préfide à nos mouvemens volontaires , ait jamais
dirigé nos mouvemens fpontanés, vitaux 8c
naturels : car quoique nous faflions fans réflexion &
fans un confentement exprès de la volonté, certains
mouvemens qui ont commencé par être arbitraires,
quoique l’habitude 8c la coutume les ait rendus entièrement
involontaires; cependantlorfquenousÿfai-
fons attention, nous ne pouvons nous diflîmuler que
la volonté n’influe fur ces mouvemens,ou qu’elle n’y
ait influé originairement. Mais nous avons beau rentrer
en nous-mêmes,nous avons beau nous examiner
attentivement, 8c réfléchir fur toutes les opérations
de notre ame, nous ne fentons en aucune façon que
le pouvoir de la volonté s’étende ou fe foit jamais
étendu fur nos mouvemens vitaux 8c naturels. L’exemple
du colonel Townshend , s’il eft vrai que,
quelque tems avant fa mort, il eût la faculté de fuf-
, pendre à fon gré tous les mouvemens v itaux, comme
le rapporte M. Cheyne dans fon traité the En-
glish malady » pag* 307. cet exemple , d is - je , ne
prouve autre chofé, finon que par l’habitude il avoit
acquis un grand empire fur les organes de la refpi-
ration, dont les mouvemens font en partie volontaires
8c en partie involontaires ; de forte qu’en diminuant
par degrés fa refpiratiôn, il fufpendoit pour
quelques momens les battemens alternatifs du coeur
& des arteres , 8c paroiffoit entièrement comme
un homme m ort, 8c qu’en reprenant peu - à-peu la
refpiratiôn , il remettoit en jeu tous les mouvemens
qui avoient été fufpendus , & fe rappelloit de nouveau
à la vie. D ’ailleurs fi l’on fait réflexion que
pendant lé fommeil, & dans toutes les affe£lions fo-
poreufes , les mouvemens même que l’habitude a
rendus involontaires, font fufpendus, 8r que les mouvemens
vitaux non-feulement ne s’arrêtent point,
mais augmentent même d’a&ivité, on ne croira point
que ces mouvemens ayent jamais été arbitraires, 8c
qu’ils ne font devenus néceffaires que par habitude
& par coutume.
En troifieme lieu , avant de difcuter le fentiment
de ceux qui placent la faculté vitale dans l’irritabilité
Tome VIi
F A C 367
des fibres des corps animés, je voudrais favoir fi
cette irritabilité, que je ne contefte pas, n’eft qu’unç
propriété purement méchanique de ces fibres ; ou fi
elle dépend d’un principe aétir, fiipérieur aux caufes
méchaniques : car l’homme n’étant cômpofé que d’une
ame & d’un corps étroitement unis enfemble par
la volonté toute-puiffante du Créateur, il faut né-
ceffairement que ce qui agit en lui foit ou matière ou
efprit. Si on dit que l’irritabilité n’eft qu’une fuite du
mechanifme, mais d’un méchanifme qui agit par des
lois particulières, & différentes des lois méchaniques
ordinaires, & qui le rend capable d’entretenir,
8c même d’augmenter ou de diminuer les mouvemens
fpontanés, fans l’intervention d’aucune intelligence
créée, je demande quel eft ce méchanifme
fi furprenant ; 8c jufqu’à ce qu’on m’en ait prouvé
la réalité , je refufe.de l’admettre , avec d’au.tant
plus de raifon que je fuis perfuadé que les lois méchaniques
qui ne me font pas connues, ne peuvent
être diamétralement oppofées a celles que je con-
nois ; que les unes doivent néceffairement appuyer
les autres , 8c non les renverfer entièrement ; ce
qu’il faudrait pourtant fuppofer, pour faire dépendre
la faculté vitale du pur mechanifme. Si on prétend
au contraire que l’irritabilité des fibres dépend d’un
principe hyperméchanique, c’eft l’attribuer à l’ame ;
8c alors on retombe dans l’opinion de ceux qui rap*
portent les mouvemens vitaux à des facultés de cet
agent fpirituel qui nous anime.
Revenons à notre idée ; 8c pour la mieux développer,
prenons la chofe d?un peu loin. Tâchons de
découvrir s’il n’y aurait pas en nous un fens vital ou
un fenforium particulier, capable de tranfmettre fes
impreflions julqu’au fenforium principal ; 8c fi à ce
fenforium ne feroit pas attachée une faculté aftive de
l’ame, qui foit capable d’opérer les mouvemens vitaux
par le moyen des inftrumens corporels, 8c indépendamment
de tout aéle de la faculté libre 8c réfléchie
qu’on connoît fous le nom de volonté. Nous
fuppoferons néanmoins bien des chofes connues des
Phyficiens 8c des Métaphyficiens, mais qui ont été
ou feront expliquées dans ce Di&ionnaire. Nous ob-
ferverons feulement que l’ame 8c le corps s’affe&ent
mutuellement en confequence de leur union ; 8c qu’étant
parfaitement unis , tout le corps doit agir fur
l’ame, 8t i’affeûer réciproquement : car il ne nous
paroît pas naturel de penfer que cette union ne foit
pas parfaite, 8c que ce ne foit qu’à l ’égard de certains
organes qu’il foit vrai de dire, ajfeclo uno, aff-
citur alterum. Cette idée ne s’accorde point avec la
fageffe 8c la puiffance du Créateur, qui en alliant enfemble
des fubftances qui de leur nature font inal-
liables, a mis dans fon ouvrage toute la perfeélion
poflible. Nous obferverons aufli que cette union a
dû fans doute altérer jufqu’à un certain point les propriétés
de l’ame, foit en lui occafionnant des modifications
qu’elle n’aurait point, fi elle n’étoit pas unie
à un corps organifé , foit en la privant d’autres
modifications qu’elle n’auroit pas fi elle en étoit fé-
parée.
Comme dans l’homme il n’y a tjue l’ame qui foit
capable de fentiment , tout fentiment confidéré
dans l’ame , eft quelque chofe de fpirituel ; mais
comme l’ame ne fent que dépendamment du corps ,
nous envifagerons tous les fens comme corporels,
8c nous les diviferons en ceux qui n’ont leur liège
ue dans le cerveau, 8c en ceux qui font difperfés
ans tout le refte du corps. Nous ne parlerons pas
ici des premiers ; mais au nombre des féconds nous
mettrons noh-feulement les fens reconnus de tout le
monde, tels que là v u e , I’ouie, l’odorat^ lè goût,
le toucher ; les fens de la faim & de la foir, 8c celui
d’où vient l’appétit commun aux deux fexes pour la
propagation de l’efpece, mais encore le fens d’où,