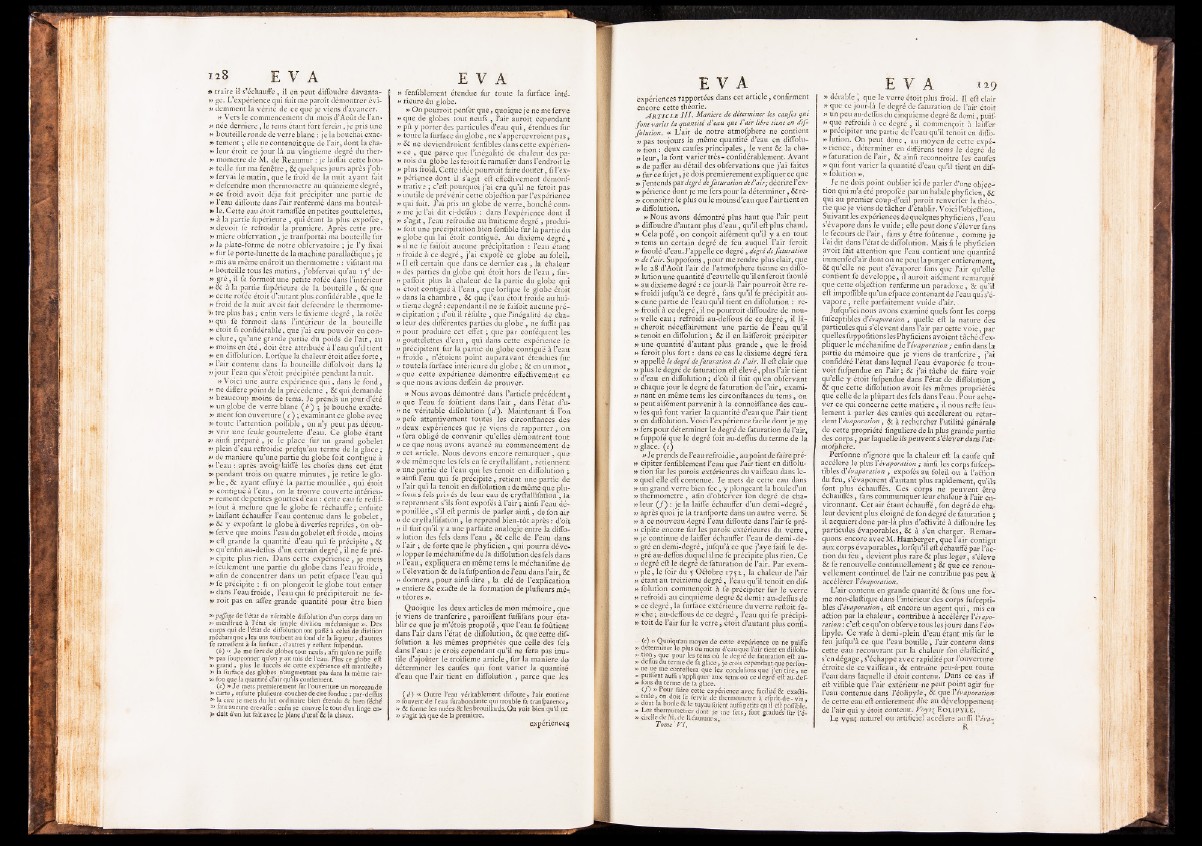
f> traire il-s’échauffe, il eh peut diffoudre davanta-
» ge. L’expérience qui fuit me paroît démontrer évi-
» demment la vérité de ce que je viens d’avancer.
» Vers le commencement du mois d’Août de l’an-
» née derniere, le tems étant fort ferein, je pris une
» bouteilleronde de verre blanc : je la bouchai exac-
» tement ; elle ne contenoit que de l’air, dont la cha-
» leur étoit ce jour là au vingtième degré dti ther-
» mometre de M. de Reaumur : je laiffai cette bou-
» teille fur ma fenêtre, 8c quelques jours après j’ob-
» fervai le matin, que le froid de la nuit ayant fait
» delcendre mon thermomètre au quinzième degré,
» ce froid avoit déjà fait précipiter une partie de
» l ’eau diffoute dans l’air renfermé dans ma bouteil-
» le. Cette eau étoit ramaffée en petites gouttelettes,
» à la partie fupérieure , qui étant la plus expofée,
» devoit fe refroidir la première. Après cette pre-
» miere obfervation, je tranfportai ma bouteille fur
» la plate-forme de notre oblervatoire ; je l’y fixai
» fur le porte-lunette de la machine parallaûique ; je
» mis au même endroit un thermomètre : vilitant ma
» bouteille tous les matins, j’obfervai qu’au i çe de-
» gré, il fe formoit une petite rofée dans l’intérieur
w & à la partie fupérieure de la bouteille , 8c que
» cette rofée étoit d’autant plus confidérable, que le
» froid de la nuit avoit fait defcendre le thermome-
>> tre plus bas ; enfin vers le fixieme degré , la rofée
»qui fe formoit dans l’intérieur de la bouteille
» étoit fi confidérable, que j’ai cru pouvoir en con-
» dure, qu’une grande partie du poids de Pair, au
» moins en été., doit être attribuée à Peau qu’il tient
» en diffolution. Lorfque la chaleur étoit affez forte,
» Pair contenu dans la bouteille diflolvoit dans le
» jour Peau qui s’étoit précipitée pendant la nuit.
» Voici une autre expérience q ui, dans le fond,
» ne différé point de la précédente , & qui demande
» beaucoup moins de tems. Je prends un jour d’été
» un globe de verre blanc (A) ; je bouche exaûe-
» ment fon ouverture ( c ) ^examinant ce globe avec
» toute l’attention poffible, on n’y peut pas décou-
»> yrir une feule gouttelette d’eau. Ce globe étant
9> ainfi préparé , je le place fur un grand gobelet
» plein d’eau refroidie prefqu’au terme de la glace ;
» de maniéré qu’une partie du globe foit contiguë à
» Peau : après avoij^ laiffé les chofes dans cet état
w pendant trois ou quatre minutes, je retire le glo-
» b e , 8c ayant effuyé la partie mouillée , qui étoit
9> contiguë à Peau, on la trouve couverte intérieu-
» rement de petites gouttes d’eau : cette eau fe redifi
» fout à mefure que le globe fe réchauffe ; enfuite
» laiffant échauffer l’eau contenue dans le gobelet,
P 8c y expofant le globe à diverfes reprifes, on ob-
» ferve que moins Peau du gobelet efl froide, moins
» eft grande la quantité d’eau qui fe précipite , 8c
» qu’enfin au-deffus d’un certain degré, il ne fe pré-
» cipite plus rien. Dans cette expérience , je mets
» feulement une partie du globe dans Peau froide,
» afin de concentrer dans un petit efpace Peau qui
» fe précipite : fi on plongeoit le globe tout entier
» dans Peau froide, Peau qui fe précipiteroit ne fe-
» roit pas en affez- grande quantité pour être bien
» paffage de l’état de véritable difiolution d’un corps dans un
menftrue à l’état de timple divifion méchanique ». Des
corps qui de l’état de diffolution ont paffé à celui de divifion
méchanique, les uns tombent au fond de la liqueur, d’autres
fe ramaffent à fa furface, d’autres y relient fulpendus.
(b) « Je me fers de globes tout neufs, afin qu’on ne puiffe
» pas foupçonner qu’on y ait mis de l’eau. Plus ce globe eft
» grand, plus le fuccès de cette expérience eft manifefte,
» la furface des globes n’augmentant pas dans la même rai-
>> fbn que la quantité d’air qu’ils contiennent. ‘
(c) »Je mets premièrement fur l’ouverture un morceau de
>> carte, enfuite plufieurs couches de cire fondue ; par-deffus
a> la cire je mets du lut ordinaire bien étendu & bien féché
35 fans aucune crevaffe : enfin je couvre le tout d’un linge en-
f* duit d’un lut fait avec le blanç d’oeuf & la chaux.
» fenfiblement étendue fur toute la furface inté-
» rieure dii globe.
» On pourroit penfer que, quoique je ne me ferve
» que de globes tout neufs , Pair auroit cependant
» pû y porter des particules d’eau qui, étendues fur
» toute la furface du globe, ne s’apperçevroient pas,
» & ne deviendroient fenfibles dans cette expérien-
» ce , que parce que l’inégalité de chaleur des pa-
» rois du globe les feroit fe ramaffer dans l’endroit le
» plus froid. Cette idée pourroit faire douter, fil’ex-
» périence dont il s’agit eft effefrivement démonfi
» trative ; c’eft pourquoi j’ai cru qu’il ne feroit pas
» inutile de prévenir cette,objeâion par l’expérience
» qui fuit. J’ai pris un globe de verre, bouché com-
» me je l’ai dit ci-deffus : dans l’expérience dont il
» s’agit, Peau refroidie au, huitième degré , produi-
» foit une précipitation bien fenfible fur la partie du
» globe qui lui étoit contiguë. Au dixième degré ,
» il ne fe faifoit aucune précipitation : Peau étant
» froide à ce degré, j’ai expoié ce globe au foleil.
» Il eft certain que dans ce dernier cas , la chaleur
» des parties du globe qui étoit hors de Peau , fur-
» paffoit plus la chaleur de la partie du globe qui
» étoit contiguë à l’eau , que lorfque le globe étoit
» dans la chambre , 8c que Peau étoit froide au hui-
» tieme degré : cependant il ne fe faifoit aucune pré-
» cipitation ; d’où il réfulte , que l’inégalité de cha-
» leur des différentes parties du globe , ne fuffit pas
» pour produire cet effet ; que par conféquent les
»gouttelettes d’e a u , qui dans cette expérience fe
» précipitent fur la partie du globe contiguë à Peau
» froide , n’étoient point auparavant étendues fur
» toute la furface intérieure du globe ; 8c en un mot y
» que cette expérience démontre effectivement ce,
» que nous avions deffein de prouver.
» Nous avons démontré dans l’article précédent,
» que Peau fe foûtient dans Pair , dans l’état d’u-
» ne véritable diffolution (d ) . Maintenant fi l’on
» pefe attentivement toutes les circonftances des
» deux expériences que je viens de rapporter, ont
» fera obligé de convenir qu’elles démontrent tout
» ce que nous avons avancé au commencement de
» cet article. Nous devons encore remarquer , que
» de même que les fels en fe cryftallifant, retiennent
» une partie de Peau qui les tenoit en diffolution ;
» ainfi Peau qui fe précipité, retient une partie de
» l’air qui la tenoit en diffolution : de même que plu-
» fieurs fels privés de leur eau de cryftallifation , la
» reprennent s’ils font expofés à Pair ; ainfi Peau dé-
» pouillée, s’il eft permis de parler ainfi, de fon air
» de cryftallifation, le reprend bien-tôt après : d’où
» il fuit qu’il y a une parfaite analogie entre la diffo-
» lution des tels dans Peau , 8c celle de Peau dans
» Pair ; de forte que le phyficien, qui pourra déve-
» lopper le méchanifme de la diffolution des fels dans
» l’eau, expliquera en même tems le méchanifme de
» l’élévation & de lafufpenfion de Peau dans Pair, 8c
» donnera , pour ainfi dire , la clé de l’explication
» entière 8c exaCte de la formation de plufieurs mé-
» téores ».
Quoique les deux articles de mon mémoire, que
je viens de tranfcrire,blir ce que je m’étois p rpoaprooifféfe, nqtu feu fPfiefaanus f ep ofouûrt iéetnat
dans Pair dans l’état de diffolution, 8c que cette diffdoalnust
ilo’ena ua : ljees cmroêims ceesp pernodparniét tqéus’ iql unee cfeerllae pdaess infeuls
tile d’ajouter le troifieme article, fur la maniéré de
dd’éetaeurm qiunee rP aleirs tcieanufte es n qduiif fofoluntti ovna r, iepra rlcae qquuaen tlietés
( d ) « Outre l’eau véritablement diffoute, l’air contient
» fouvent de l’eau furabondante qui trouble fa tranfparence»
» & forme les nuées 8c les brouillards. Oa voit bien qu'il ne
» s’agit ici que de la première.
expériences
Expériences rapportées dans cet article, confirment
encore cette théorie.
A r t ic l e I II. Manière de déterminer les caufes qui
font varier la quantité d'eau que l'air libre tient en diffolution.
« L’air de notre atmofphere ne contient
» pas toujours la même quantité d’eau en diffolu-
» tion : deux caufes principales,' le vent &c la cha-
» leur, la font varier très- confidérablement. Avant
»» fduer p caef ffeurj eatu, jdeé dtaoiils dperse mobièferervmaetinotn esx pqluieq uj’eari c fea qituees » j’entends par degré de faturation de l'air; décrire Pex-
»» pcoérninenocîter ed loen ptl jues moue lfee rms opionusr d l’eaa dué qteurem Pianier tri,e &ntr een-
» diffolution.
» Nous avons démontré plus haut que Pair peut
» diffoudre d’autant plus d’eau, qu’il eft plus chaud.
» Cela pofé, on conçoit aifément qu’il y a en tout
» tems un certain degré de feu auquel Pair feroit
» faoulé d’eau. J’appelle ce degré, degré de faturation
» de L'air. Suppofons, pour me rendre plus clair, que
» le 28 d’Août Pair de l’atmofphere tienne en diffo-
» lution une quantité d’eautelle qu’il en feroit faoulé
» au dixième degré : ce jour-là Pair pourroit être re-
» froidi jufqu’à ce degré, fans qu’il fe précipitât au-
» cune partie de Peau qu’il tient en diffolution : re-
» froidi à ce degré, il ne pourroit diffoudre de nou-
» velle eau ; refroidi au-deffous de ce degré, il lâ-
» cheroit néceffairement une partie de l’eau qu’il
» tenoit en diffolution ; & il en laifferoit précipiter
» une quantité d’autant plus grande, que le froid
» feroit plus fort : dans ce cas le dixième degré fera
» appelle le degré de faturation de l'air. Il eft clair que
» plus le degré de faturation eft élevé, plus Pair tient
» d’eau en diffolution ; d’où il fuit qu’en obfervant
» chaque jour le degré de faturation de l’air, exami-
» nant en même tems les circonftances du tems, on
» peut aifément parvenir à la connoiffance des cau-
» les qui font varier la quantité d’eau que l’air tient
» en diffolution. Voici l’expérience facile dont je me
» fers pour déterminer le degré de faturation de l’air,
» fuppofé que le degré foit au-deffus du terme de la
»glace, (c)
» Je prends de Peau refroidie, au point de faire pré-
» cipiter fenfiblement l’eau que Pair tient en diffolu-
» tion fur les parois extérieures du vaiffeau dans le-
» quel elle eft contenue. Je mets de cette eau dans
» un grand verre bien fe c , y plongeant la boule d’un
» thermomètre , afin d’obferyer Ion degré de cha-
» leur (ƒ ) : je la laiffe échauffer d’un demi-degré,
» après quoi je la tranfporte dahs un autre verre. Si
» à ce nouveau degré Peau diffoute dans Pair fe pré-
» cipite encore fur les parois extérieures du verre,
» je continue de laiffer échauffer Peau de demi-de-
» gré en demi-degré, jufqu’à ce que j’aye faifi le de-
» gré au-deffus duquel il ne fe précipité plus rien. C e
» degré eft le degre de faturation de Pair. Par exem-
» p ie , le foir du 5 Ofrobre 1752, la chaleur de Pair
» étant au treizième degré, Peau qu’il tenoit en dif-
» ifolution commençoit à le précipiter fur le verre
» refroidi au cinquième degré & demi : au-deffus de
» ce degré, la furface extérieure du verre reftoit fe-
» che ; au-deffous de te degré , Peau qui fe précipi-
» toit de Pair fur le verre, étoit d’autant plus confi-
- (e) » Quoiquîau moyen de cette expérience on ne puiffe
» déterminer le plus ou moins d’eau que l’air tient en diilolu-
- j°/r’ <?ue Pour ^es tems où le degré de faturation eft au-
» demis du terme de fa glace , je crois cependant que perlbn-
» ne ne me conteftera que les conclufions que j’én tire, ne
» puiilent au(fi s’appliquer aux tems où ce degré eft au défi
» lous du terme de là glace.
■ ” ^0ur Pjufl cette expérience avec facilité & exaéfci-
» tude, on doit fe fervïr de thermomètre à efprit-de - vin,
» dont la boule & le tuyau fbient auflî petits qu’il eft poffible.
» Les thermomètres dont je me fers, font gradués fur l’é-
» ehelle de M. de Uéaumur ».
Tome' F I .
» dérable , que le verre étoit plus froid. Il eft clair
» que ce jour-là le degré de faturation de Pair étoit
» un peu au-deffus du cinquième degré & demi, puif-
» que refroidi à ce degre , il commençoit à laiffer
» précipiter line partie de l’eau qu’il tenoit en diffo-
» lution. On peut donc , au moyen de cette expé-
» rience, déterminer en différens tems le degré de
» faturation de Pair, 8c ainfi reconnoître les caufes
» qui font varier la quantité d’eau qu’il tient en dif-,
» lolution ».
Je ne dp,is point oublier ici de parler d’une objection
qui m’a été propofée par un habile phyficien 8c
qui au premier coup-d’oeil paroît renverfer lathéo-.
rie que je viens de tâcher d’établir. Voici l’objeftion.
Suivant les expériences de quelques phyficiens, Peau
s’évapore dans le vuide; elle peut donc s’élever fans
le fecotirs de Pair, fans y être foûtenue , comme je
l’ai dit dans l’état de diffolution. Mais fi le phyficien
avoit fait attention que Peau contient une quantité
immenfe d’air dont on ne peut la purger entièrement,
8c qu’elle ne peut s’évaporer fans que Pair qu’elle
contient fe développe, il auroit aifément remarqué
que cette obje&ion renferme un paradoxe, & qu’il
eft impoffible qu’un efpace contenant de Peau qui s’évapore
, refte parfaitement vuide d’air. -
Jufqu’ici nous avons examiné quels font les corps
fufceptibles d’évaporation, quelle eft la nature des
particules qui s’élèvent dans Pair par cette v o ie , par
quelles fuppofitions les Phyficiens avoient tâché d’expliquer
le méchanifme de l’évaporation ; enfin dans la
partie du mémoire que je viens de tranfcrire, j’at
confidéré l’état dans lequel Peau évaporée fe trou-
voit fufpendue en Pair ; 8c j’ai tâché de faire voir
qu’elle y étoit fufpendue dans l’état de diffolution ,
& que cette diffolution avoit les mêmes propriétés
que celle de la plûpart des fels dans Peau. Pour achever
ce qui concerne cette matière, il nous refte feulement
à parler des caufes qui accélèrent ou retardent
l’évaporation , & à rechercher l’utilité générale
de cette propriété finguliere de la plus grande partie
des corps, par laquelle ils peuvent s’élever dans l ’at-
mofp here.
Perfonne n’ignoré que la chaleur eft la caüfe qui
accéléré le plus ¥ évaporation ; ainfi les corps fufceptibles
d’évaporation , expofés au foleil ou à l’aftion
du feu, s’évaporent d’autant plus rapidement, qu’ils
font plus échauffés. Ces corps ne peuvent être
échauffés, fans communiquer leur chaleur à Pair environnant.
Get air étant échauffé, fon degré de chaleur
devient plus éloigné de fon degré de mturation ;
il acquiert donc par-là plus d’aâivité à diffoudre les
particules évaporables, 8c à s’en charger. Remarquons
encore avec M. Hamberger, que l’air contigu
aux corps évaporables, lorfqu’il eft échauffé par l’action
du feu , devient plus rare & plus léger, s’élève
8c fe renouvelle continuellement ; & que ce renouvellement
continuel de Pair ne contribue pas peu à'
accélérer ¥ évaporation.
L’air contenu en grande quantité 8c fous une forme
non-élaftique dans l’intérieur des corps fufceptibles
d’évaporation, eft encore un agent qui, mis en
aftion par la chaleur, contribue à accélérer ¥ évaporation
: c’eft ce qu’on obferve tous les jours dans l’éo-
lipyle. Ce vafe à demi-plein d’eau étant mis fur le
feu jufqu’à ce que Peau bouille, Pair contenu dans
cette eau recouvrant par la chaleur fon élafticité ,
s’en dégage, s’échappe avec rapidité par l’ouverture
étroite de ce vaiffeau, 8c entraîne peu-à-peu toute
Peau dans laquelle il étoit contenu. Dans ce Cas il
eft vifîbleque Pair extérieur ne peut point agir fur
Peau contenue dans l’éolipyle, 8c que ¥ évaporation
de cette eau eft entièrement due au développement
de l’air qui .y étoit contenu. Voyt^ Eo l ip y l e . .
Le vent naturel ou artificiel accélere aufli l'éva-
R