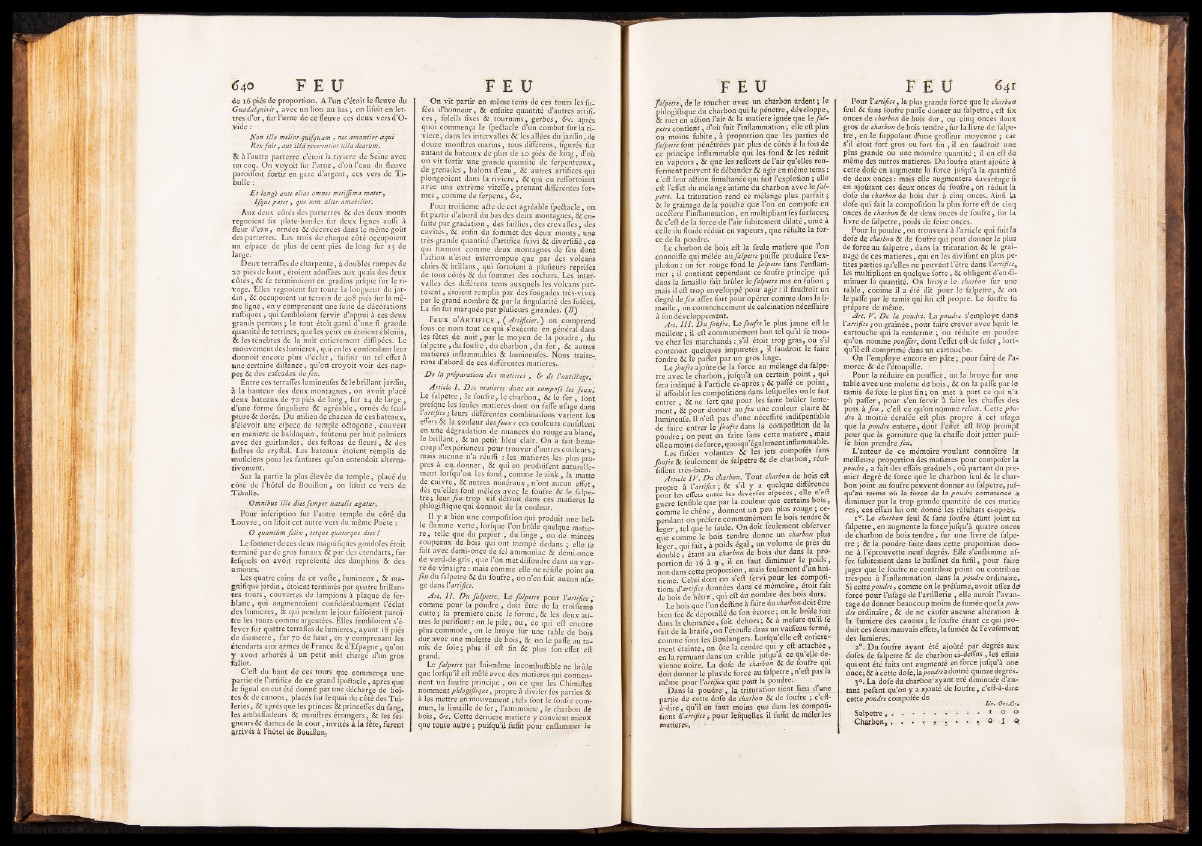
sf i h
1 1|
de 16 pies de proportion. A l’un c’étoît le fleuve du
Guadalquivir, avec un lion au bas ; on lifoit en lettres
d’o r , fur l’urne de ce fleuve ces deux vers d’O-
yide :
Non illo melior quif quant, me amantior a qui
Rex fuit t aut illd r.everentior ulla dearum.
& à l’autre parterre c’étoit la ,rîyiere de Seine avec
un coq. On voyoit fur l’urne, d’oii l’eau du fleuve
paroifloit fortir en gaze d’argent, ces vers de Ti-
bulle :
E t longé ante, alias omnes mitiffima mater,
I f que pater , qup non alter amabilior.
Aux deux côtés des parterres & des deux monts
regnoient fix plate-bandes fur deux lignes aufli à
fleur d’eau, ornées & décorées dans le même goût
des parterres. Les trois de chaque côté occupoient
tin efpace de plus de cent piés de long fur 15 de
large.
Deux terrafles de charpente, à doubles rampes de
ao piés de haut, étoient adoflees aux quais des deux
côtés, & fe terminoient en gradins jufque fur le rivage.
Elles regnoient fur toute la longueur du jardin
, & occupoient un terrein de 408 piés fur la même
ligne, en y comprenant une fuite de décorations
ruftiques , qui fembloient fervir d’appui à ces deux
grands perrons; le tout étoit garni d’une fi grande
quantite de terrines, que les yeux en étoieht éblouis,
& les ténèbres de la nuit entièrement diflipées. Le
mouvement des lumières, qui en les confondant leur
donnoit encore plus d’é c la t , faifoit un tel effet à
une certaine diftance, qu’on croyoit voir des nappes
& des cafcades de feu.
Entre ces terrafles lumineufes & le brillant jardin,
à la hauteur des deux montagnes, on avoit placé
deux bateaux de 70 piés de long, fur 14 de large ,
d’une forme finguliere & agréable, ornés de fcul-
pture & dorés. Du milieu de chacun de ces bateaux,
s’élevoit une efpece de temple oâogone, couvert
en maniéré de baldaquin , foûtenu par huit palmiers
avec des guirlandes, des feftons de fleurs, & des
luftres de cryftal. Les bateaux étoient remplis de
muficiens pour les fanfares qu’on entendoit alternativement.
Sur la partie la plus élevée du temple, placé du
côté de l ’hôtel de Bouillon, on lifoit ce vers de
Jibulle.
Omnibus ille dies femper natalis agatur.
Pour infeription fur l’autre temple du côté du
Louvre, on lifoit cet autre vers du même Poëte :
O quantum felix , terque quaterque dies !
Le fommet de ces deux magnifiques gondoles étoit
terminé par de gros fanaux & par des étendarts, fur
lefquels on avoit repréfenté des dauphins & des
amours.
Les quatre coins de ce vafte, lumineux, & magnifique
jardin, étoient terminés p^ar quatre brillantes
tours, couvertes de lampions à plaque de fer-
blanc , qui augmentoient confidérablement l’éclat
des lumières, & qui pendant le jour faifoient paroî-
tre les tours comme argentées. Elles fembloient s’élever
fur quatre terrafles de lumières, ayant 18 piés
de diamètre, fur 70 de haut, en y comprenant les
étendarts aux armes de France & d’Efpagne, qu’on
y avoit arborés à un petit mât chargé d’un gros
lallot.
C ’eft du haut de ces tours que commença une
partie de l’artifice de ce grand fpeâacle, après que
le fignal en eut été donné par une décharge de boîtes
& de canons, placés fur le quai du côté des Tuileries,
& après que les princes & princeffes du fang,
les ambafladeurs & miniftres étrangers, & les fei-
gneurs & dames de la cour, invités à la fête, furent
arrivés à l’hôtel de Bouillon.
On vît partir en même tems de ces 'tours lès fuj
fées d’honneur, & enfuite quantité ■ d’autres artifices
, foleils fixes & tournahs, gerbes, &c. après
quoi commença le fpeftacle d’un combat fur la rivière,
dans les intervalles & les allées du jardin , de
douze monftres marins, tous différons, figurés fur
autant de bateaux de plus de 20 piés de long, d’où
on vit fortir une grande quantité de férpenteaux,
de grenades , balons d’eau, & autres artifices qui
plongeoient dans la riviere, & qui en reflbrtoient
avec une extrême vîtefle, prenant différentes formes
, comme de ferpens, &c.
Pour troifieme aûe de cet agréable fpeétacle, on
fit partir d’abord du bas des deux montagnes, & en-
fuite par gradation, des faillies, des crèyafles, des
cavités, & enfin du fommet des deux monts, une
très-grande quantité d’artifice fuivi & diverfifié, c©
qui lormôit comme deux montagnes de feu dont
l’a&ion n’étoit interrompue que par des VÔIçaris
clairs & brillans, qui fortoient à plufieurs reprifes
de tous côtés & du fommet des rochers. Les intervalles
des différens tems auxquels les volcans par-
toient, étoient remplis par des fougades très-vives
par le grand nombre & par la Angularité des fitfé,es.
La fin fut marquée par plufieurs girandesl (5 )
Feux d’Ar t if ic e , ( Artificier. ) on comprend
fous ce nom tout ce qui s’exécute en général dan^
les fêtes de nuit, par le moyen de la poudre , du
falpetre , du foufre, du charbon , du fe r , & autres
matières inflammables & lumineufes. Nous traite-,
rons d’abord de ces différente? matière?.
De lu préparation des matières , & de ïoutillage:
Article I. Dis matières dont on compofe les feux
Le falpetre, le foufre, le charbon, & le.fer ,. font
prefque les feules matières dont on faffe ufage dans
I artifice ; leurs différentes combinaifons varient les
effets & la couleur des feux : ces couleurs confident
en une dégradation de nuances du rouge au blanç,
le brillant, & un petit bleu clair. On a fait beaucoup
d’expériences pour trouver d’autres couleurs,;
mais aucune n’a réufli : les matières les plus propres
à en, donner, & qui en produifent naturellement
lorfqu’on les fond, comme le zink, la matt-e
de cuivre, & autres minéraux, n’ont aucun effet,
dès qu’elles font mêlées avec le foufre & le, falpetre
; leur feu trop v i f détruit dans ces matières le
phlogiftique qui donnoit de la couleur.
Il y a bien une compofition qui produit une belle
flamme verte, lorfque l’on brûle quelque matière
, telle que du papier , du linge , ou de minces
coupeaux de bois qui ont trempé dedans ; elle fe
fait avec demi-once de fel ammoniac & demi-once
de verd-de-gris, que l’on met diffoudre dans un verre
de vinaigre : mais comme elle ne réfifte point au
feu du falpetre & du foufre, on n’en fait aucun ufage
dans Y artifice.
Art. I I . Du falpetre. Le falpetre pour Y artifice;
comme pour la poudre , doit être de la troifieme
cuite ; la première cuite le forme, & les deux autres
le purifient : on le pile, o u , ce qui eft encore
plus commode, on le broyé fur une table de bois
dur avec une molette de bois, & on le paffe au tamis
de foie ; plus il eft fin & plus Ion effet eft
grand.
Le falpetre par lui-même incombuftible ne brûle
que lorfqu’il eft mêlé avec des matières qui contiennent
un foufre principe , ou ce que les Chimiftes
nomment phlogiftique, propre à divifer fes parties &
à les mettre en mouvement ; tels font le foufre commun,
la limaille de fer, l’antimoine , le charbon de
bois, &c. Cette derniere matière y convient mieux
que toute autre ; puifqu’ii fuflit pour enflammer le
falpcirc\ dele toucher avec un charbon ardent ; le
phlogiftique du charbon qui le pénètre, développe,
& met en aûion l’air & la matière ignée que le fa l -
petré contient, d’où fuit l’inflammation ; elle eft plus
ou moins fiibitè, à proportion que les parties de
falpetre font pénétrées par plus de côtés à la fois de
ce principe inflammable qui les fond & les réduit
en vapeurs , & que les reflorts de l’air qu’elles renferment
peuvent fe débander & agir en même tems :
c ’eft leur aftion fimultanée qui fait l’explofion ; elle
eft l’effet du mélange intime du charbon avec \e falpetre.
La trituration rend ce mélange plus parfait ;
& le grainage delà poudré que l’on en compofe en
accélère l’inflammation, en multipliant fes furfaces;
& c’eft de la force; de l’air fubitement dilaté, unie à
celle du fluide réduit en vapeurs, que réfulte la force
de la poudre.
Le charbon de bois eft la feule matière que l’on
connoiffe qui mêlée au falpetre puifle produire l’explofion
: un fer rouge fond le falpetre fans l’enflammer
; il contient cependant ce foufre principe qui
dans la limaille fait brûler le falpetre mis en fufion ;
mais il eft trop enveloppé pour agir : il faifdïôit un
degré de feu affez fort pour opérer comme dans Ia li-
maille, un commehcement de calcination néceflaire
à fon développement.
Art. I I I . Du fotfire. Le foufre le plus jaune eft le
meilleur; il eft communément bon tel qu’il fe trouve
chesTlès marchands : .s’il .étpit trop gras, ou s’il
contenoit quelques impuretés , il faudroit le faire
fondre & lê paffer par un grps. linge.
Le foufre ajoûte de la force au mélange du falpetre
avec le charboh, jufqu’à un certain point, qui
fera indiqué à l’article ci-apr.es. ; & paffe ce .point,,
il affoiblit les compofitions dans lefquelles on le fait
entrer , & ne fertl que pour les faire brûler lente-.
ment, & pour donner au feu une couleur claire &
lumineüfe. Il n’eft pas d’une néceflité indifpenfable
de faire entrer le foufre dans la compofition de la
poudre ; on peut en faire fans cette matière, mais
elle a moins de force, quoiqu’également inflammable.
Les fufées volantes & les jets compofes latas
foufre & feulement de falpetre & de charbon, reul-
fiffent très-bien. ! , , , , . A
Article IV . Du Charbon. Tout charbon de bois eit
propre à Y artifice | & s’il y a quelque différence
pour les effets entée les diverfes efpèces, elle n eft
euere fenfible que par la couleur que certains bois,
comme le chêne, donnent un peu plus rouge ; cependant
on préféré commitnéipe.nt le bois teqdre 8c
feger tel que le ftule. On doit feulement oÇfervpr
que comme le bois tendre donne, un dmrbop plps
leeer, qui fait, à pbids égal, un .volume, de mes du
double , étant au charbon de bois dur dans la pro-
portion de 1 à 9 , il en faut diminuer le poids,
non dans cette proportion, mais feulement d un huitième.
Celui dont on s’eft fervi pour les'compofi-
tions S artifice données dans ce mémoire, etoit fait
de bois de hêtre', qui, eft du nombre des bois durs;-
Le bois que l’on deftine à faite du ckarton: doit être
bien fec & dépouillé de fon écorce ; on le braie fort
dans la cheminée, foit dehors ; & à mefure qu il fe
fait de la braife, oh l’étouffe daus un vaifleau termé,
comme font, les Boulangers. Lorfqu’elle eft entièrement
éteinte, on ôte la cendre qui y eft attache^ ,
en la remuant dans un crible jufquà ce qu die devienne
noire. La dofe de charbon & de foufre qui
doit donner le plus de force au falpetre, n eft pas la'
même pour Yartifice que pouf la poudre*. ■ ^ -
Dans la poud relà. trituration tient lieu d une
partie de cette.dofe de charbon & de foufre ; c’eft-
à-dîre', qu’il en faut .moins que dans les compOfi-
tions à'artifice > pour lefquelles il fuflit de mêler les;
matières.' î
Pour Y artifice, la phis grande force que le charbon
feul & fans foufre puiffe donner au falpetre, eft fix
onces dé charbon de bois dur, ou cinq onces deux
gros de-charbon de bois tendre, fur la livre de falpetre
, en le fuppofant dHine groffeur moyenne ; car
s’il étoit fort gros ou fort fin , il en faudroit une
plus grande ou une moindre quantité ; il en eft de
mêihe des autres matières. Du foufre étant ajoûté à
cette dofe en augmente la force jufqu’à la quantité
de deux onces : mais elle augmentera davantage fi
en âjoûtant ces deux onces de foufre, on réduit la
dofe du charbon de bois dur à cinq onces. Ainfi La
dofe qui fait la compofition la plus forte eft de cinq
onces de charbon & de deux onces de foufre, fur la
livre de falpetre, poids de feize onces.
Pour la poudre, on trouvera à l’article qui fuit la
dofe de charbon & de foufre qui peut donner le plus
de force au falpetre, dans la trituration & le grainage
de ces matières, qui en les divifant en plus petites
parties qu’elles ne peuvent l’être dans l’artifice>
les multiplient en quelque, forte 9 & obligent d’en diminuer
la quantité. Oh broyé le charbon fur une
table, comme il a été dit pouf lé Falpetre, & on
le paffe par le tamis qui lui eft propre. Le fôufre fe
prépare de même.
Art. V. De la poudre. La poudre s’employe danS
Y artifice ; ou gf ainée, pour faire crever avec D£uit le
cartouche qui la renferme. ; -ou réduite en poudre
qu’on nomme poujjier, dont l’effet çft de fu fet, lorfqu’il
eft comprimé dans un cârtojiche.
Oji l’employe encore en pâte. ; .pour faire de l’a*
morce & de l’etoupille. ?
Pour la réduire en poitflief,, oji la broyejiir une
table a vec une molette dé bo^s., &.on la pafle par le
tamis de foie;le plus fin;î>n met à part ce qui n’a
pû paffer , pour s’en, fervir à faire les chafies des
pots à feu , c’eft ce qu’ôn nqmme relien. Cette pôu*
dre à moitié écrafée eft phis propre à cet ufage
que la poudre entière > dont l ’effet eft trop prompt
pour que la garniture que la chafte doit jettér puiffe
bien prendre feu.
L ’âuteùf de ce mémo,ire-voulant connaître la
meilleure proportion des matières pour compofer la
poudre, a fait1 dès effâis graduels ; où partant :du premier
degré de force que le charbon feul ôc le charbon
joint au foufre peuvent donner au falpetre, juf-
qu’au terme où la force de la poudre commence a
diminuer par la trop grande quantité de ces. matie*
res, ces effais lui ont donné;les réfultats ci-kprès.
i ° .L e charbon feul & .fans foufre étant joint au
falpetre, en augmente la force jufqu’à quatre onces
de charbon de bois tendre, fur une livre de falpetre
; & la poudre faite dans cette proportion donne
à l’éprouvette neuf degrés. Elle s’enflamme a ffez
fubitement dans le baffinet du fiifil, pour faire
juger que le foufre ne contribue point ou cohtribue
très-peu à l’inflammation dans la poudre ordinaire.
Si cette poudre, comme on le préfume, avoit affez de
force pour l’ufage de l’artillerie , elle auroit l’avantage
de donner beaucoup moins de fumée que la poudre
ordinaire, & de ne càufer -aucune altération à
la lumière des canons ; le foufre étant ce qèi produit
ces deux mauvais effets, la fumée & l’évafement
des lumières.
2°. Du foufre ayant été àjoûté par degrés aux
dofes de falpetre & de charbon çi-deflùs , les effais
qui ont été faits ont augmenté en force jufqü’à une
once; & à cette dofe, la poudread onné quinze degrés J
3°.-La dofe du charbomayant été diminuéè d’au*-
tant pefant qu’on y a ajoute de foufre f c eft-à-dire
cette poudre compofée de ^ ^
S a lp ê t r e ,.............................. • • • 1 ° ^
Charbon, . • • f i -ri- ' t • •- t 0 1 0 !