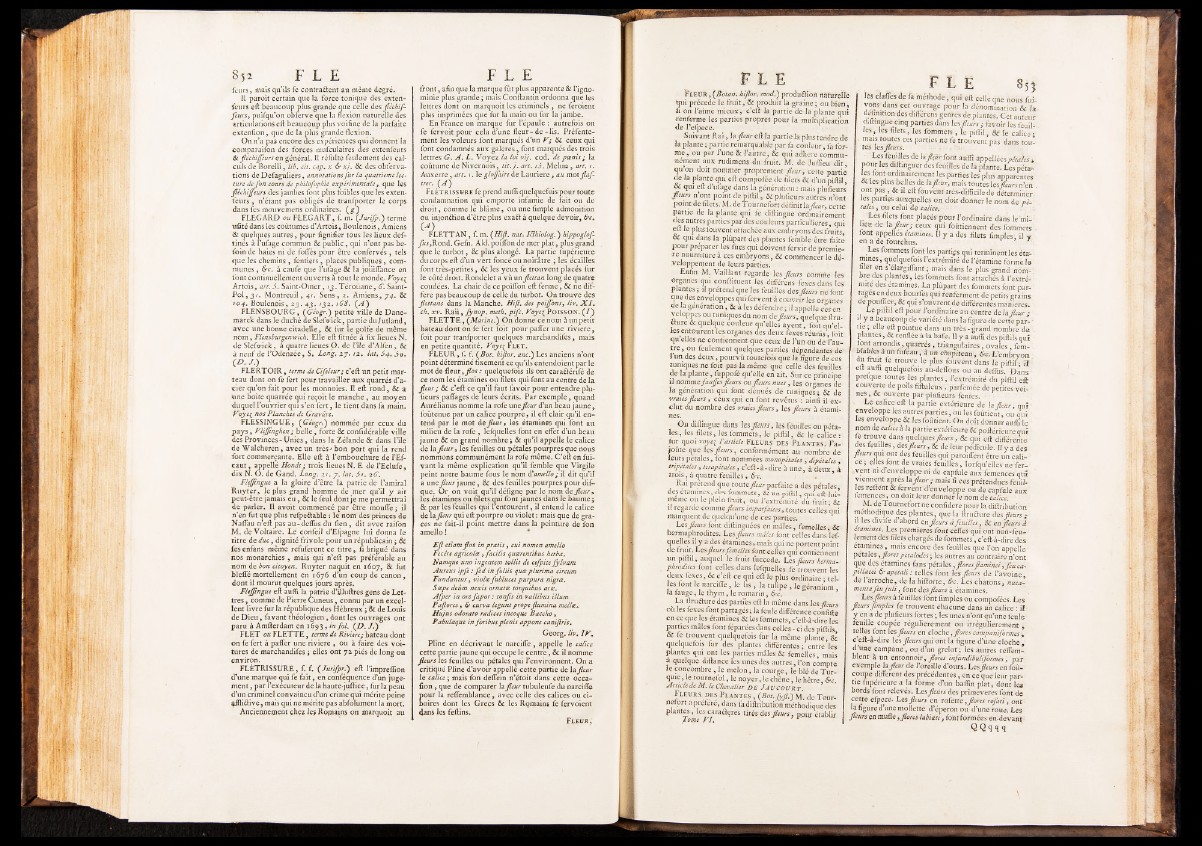
852 F L E leurs, mais qu’ils fe contraûent au même degré.
Il paroît certain que la force tonique des exten-
l'eurs eft beaucoup plus grande que celle des fléchif-
feurs, puifqu’on obferve que la flexion naturelle des
articulations eft beaucoup plus voifine de la parfaite
cxtenflon, que de la plus grande flexion.
On n’a pas encore des expériences qui donnent' la
comparaifon des forces mufculaires des extenfeurs
& fléchiffeurs en général. Il réfulte feulement des calculs
de Borelli, lib. cit. cap. x & x j . 6c des obferva-
tions de Defaguliers, annotations fu r la quatrième lecture
de fo n cours de philofophie expérimentale, que les
fléchijfeurs des jambes font plus foibles que les extenfeurs
, n’étant pas obligés de tranfporter le corps
dans les mouvemens ordinaires. ( g )
FLEGARD ou FLEGART, f. m. ('Jurifp.) terme
ufité dans les coutumes d’Artois, Boulenois, Amiens
& quelques autres, pour lignifier tous les lieux def-
tines à l’ufage commun 6c public, qui n’ont pas be-
foin de haies ni de fofles pour être confervés , tels
que les chemins , fentiers, places publiques, communes
, & c. à caufe que l’ufage 6c la joiiiflance en
l'ont continuellement ouverts à tout le monde. Voye£
Artois, art. 5 . Saint-Omer, 13. Téroiiane, <T. Saint-
Pol,^/. Montreuil, 41. Sens, 2 . Amiens, 74. 6c
104. Boulenois, 29. 4 3 . 132. 168. (A )
FLENSBOURG, ( Géogr.) petite ville de Dane-
marck dans le duché de Slefwick, partie du Jutland,
avec une bonne citadelle, 6c fur le golfe de même
nom, Flensburgenwich. Elle eft fituée à fix lieues N.
de SlelVick, à quatre lieues O. de File d’Alfen, &
à neuf de l’Odenzée, S. Long. 2 7 . 12. lut. 64 . 60.
(D . /.)
FLERTOIR, terme de Cifeleur; c’eft un petit marteau
dont on fe fert pour travailler aux quarrés d’acier
qu’on fait pour les monnoies. Il eft rond, & a
une boite quarrée qui reçoit le manche, au moyen
duquel l’ouvrier qui s’en fert, le tient dans fa main.
Voye{ nos Planches de Gravure.
FLESSINGUE, {Géogr.) nommée par ceux du
pays, VliJJinghen; belle, forte 6c confidqrable ville
des Provinces-Unies, dans la Zélande & dans File
de "Walcheren, avec un très'bon port qui la rend
fort commerçante. Elle eft à l’embouchure de l’Ef-
caut, appellé Hondt ; trois lieues N. E de l’Eclufe,
dix N. O. de Gand. Long. 2 1 . y . lat. â i . zG.
FleJJîngue a la gloire d’être la patrie de l’amiral
Ruyter, le plus grand homme de mer qu’il y ait
peut-être jamais eu, & le feul dont je me permettrai
de parler. Il avoit commencé par être moufle ; il
n’en fut que plus refpeftable : le nom des princes de
Naflau n’eft pas au-deflus du lien, dit avec raifon
M. de Voltaire. Lé confeil d’Efpagne lui donna le
titre de duc, dignité frivole pour un républicain ; 6c
fes enfans même refuferent ce titre, fi brigué dans
nos monarchies , mais qui n’eft pas préférable au
nom de bon citoyen. Ruyter naquit en 1607, & fut
bleffé mortellement en 1676 d’un coup de canon,
dont il mourut quelques jours après.
FleJJîngue eft aufli la patrie d’Uluftres gens de Lettres
, comme de Pierre Cuneus, connu par un excellent
livre fur la république des Hébreux ; 6c de Louis
de Dieu, favant théologien, dont les ouvrages ont
paru à Amfterdam en 1693, in fo l. (D . J .)
FLET ou FLETTE, terme de Riviere; bateau dont
on fe fert à pafler une riviere , ou à faire des voitures
de marchandifes ; elles ont 71 piés de long ou
environ.
FLÉTRISSURE, f. f. (Jurifpr.) eft l’imprelfion
d’une marque qui fe fait, en conféquence d’un jugement
, par l’exécuteur de la haute-juftice, fur la peau
d’un criminel convaincu d’un crime qui mérite peine
^ffliftive, mais qui ne mérite pas abfolument la mort.
Anciennement chez le? Romains on marquoit au
F L E front, afin que la marque fût plus apparente & l’ignominie
plus grande ; mais Conftantin ordonna que les
lettres dont on marquoit les criminels , ne feroient
plus imprimées que fur la main ou fur la jambe.
En France on marque fur l’épaule : autrefois on
fe fervoit pour cela d’une fleur-de-lis. Préfente-
ment les voleurs font marqués d’un V ; 6c ceux qui
font condamnés aux galeres, font marqués des trois
lettres G . A . L . Voyez la loi vij. cod. de pcenis; la
coûtume de Nivernois, t i t . j . art. tS. Melun, art. 1.
Auxerre, art. 1. le glojfaire de Lauriere , au mot flaf-
trer. ( A )
F l é t r i s s u r e f e p ren d a u fli q u e lq u e fo is p o u r toute
co n d am n a t io n q u i em p o r te in fam ie d e fa i t o u d e
d r o i t , c om m e le b l âm e , o u u n e ûm p le a dm o n itio n
o u in jo n ô io n d ’ê t r e p lu s exaft à q u e lq u e d e v o i r , &c.
H
FLETTAN, f. m. (H iß . nat. IWiiolog. ) hippoglof-
fu s ,Rond. Gefn. Aid. poiflbn de mer plat, plus grand
que le turbot, 6c plus alongé. La partie fupérieure
du corps eft d’un vert foncé ou noirâtre ; les écailles,
font très-petites, & les yeux fe trouvent placés fur
le côté droit. Rondelet a vû un flettan long de quatre
coudées. La chair de ce poifîon eft ferme, & ne différé
pas beaucoup de celle du turbot. On trouve des
flettans dans la Manche. Hiß . des poiffons, Uv. X I .
ch. xv . Raii, fynop. meth. pife. Voye^ P o i s s o n . (/ )
FLETTE, (Marine.') On donne ce nom à un petit
bateau dont on fe fert foit pour pafler une riviere ,
foit pour tranfporter quelques marchandifes, mais
en petite quantité. Voye\_ Flet.
FLEUR, f. f. (B ot. hiflor. anc.) Les anciens n’ont
point déterminé fixement ce qu’ils entendoient par le
mot de fleur, f lo s : quelquefois ils ont caraôérifé de
ce nom les étamines ou filets qui font au centre de la
fleur ; 6c c’eft ce qu’il faut favoir pour entendre plu-
fieurs paflages de leurs écrits. Par exemple, quand
Aurélianus nomme la rofe unefleur d’un beau jaune,
foûtenue par un calice pourpre, il eft clair qu’il entend
par le mot de fleur , les étamines qui font au
milieu de la rofe, lefqttelles font en effet d’un beau
jaune 6c en grand nombre ; & qu’il appelle le calice
de la fleur y les feuilles ou pétales pourpres que nous
nommons communément la rofe même. C’eft en fui-
vant la même explication qu’il femble que Virgile
peint notre baume fous le nom d'amello ; il dit qu’il
a une fleur jaune, 6c des feuilles pourpres pour dif-
que. Or on voit qu’il défigne par le nom de fleur ,
les étamines ou filets qui font jaunes dans le baume ;
& par les feuilles qui l’entourent, il entend le calice
de la fleur qui eft pourpre ou violet : mais que de grâces
ne fait-il point mettre dans la peinture de fon
amello !
E fl etiamflos in pratis , cui nomen amello
Fecêre agricoles, facilis quoerentibus herba.
hlunique uno ingentem tollit de cefpite fylvam
Aureus ipfe : f e d in foliis quee plurima circum
Funduntur, vio lie fublucet purpura nigrce.
Scepe deûm nexis ornatee torquibus ara.
Afper in ore fapor: tonfis in vallibus ilium
Paflores , & curva legunt propeflumina niella.
Hujus odorato radices incoque Baccho,
Pabulaque in foribus plenis appone canif ris.
Georg. Uv. I V .
Pline en décrivant le narcifle, appelle le calice
cette partie jaune qui occupe le centre, & il nomme
fleurs les feuilles ou pétales, qui l’environnent. On a
critiqué Pline d’avoir appelle cette partie de la fleur
le calice ; mais fon deffein n’étoit dans cette occa-
fion, que de comparer la fleur tubuleufe du narcifle
our la reflemblance, avec celle des calices ou ci-
oires dont les Grecs 6c les Rçmains fe fervoient
dans les feftins.
F l e u r ,
F L E ÉleUR , (Botan> hiflor. mod.) produéliôn naturelle
qui précédé le fruit, 6c produit la graine ; ou bien,
il on l’aime mieux , c’eft la partie de la planté qui
■ renferme les parties propres pour la multiplication
de l’efoece.
Suivant Rai, la fleur eft la partie là plus tefidre dé
la plante ; partie remarquable par fa couleur', fa for
me, ou par l’une & l’autre, 6c qui adhéré communément
aux rudimens -du fruit. M. de JuflWdit,
qu’on doit nommer proprement fleu r , cette partie
de la plante qui eft compofée de filets & d’un piftii,
& qui eft d’ufage dans la génération : mais plufieurs
fleurs n’ont point de piftii, & plufieurs autres n’bnt
point de filets. M. de Totirnefort définit lafleur, cettê
partie de la plante qui fe diftingue ordinairement
des autres parties par des couleurs particulières, qui
eft le plus louvent attachée aux embryons des fruits,
6c qui dans la plupart des plantes femble être faite
pour préparer les fucs qui doivent fervir de première
nourriture à ces embryons, 6c commencer le développement
de leurs parties.
Enfin M. Vaillant regarde les fleurs comme les
organes qui conftituent les différens fexes dans lés
plantes ; il prétend que les feuilles des fleurs ne'font
que des enveloppes qui fervent à couvrir les Organes
de là génération, & à les défendre ; il appelle ces enveloppes
ou tuniques du nom de fleurs, quelque ftru-
f ure & quelque couleur qu’elles ayent, foit qu’elles
entourent les organes des deux fexes réunis, foit
qu elles ne contiennent que ceux de l’un ou de l’autre
, ou feulement quelques parties dépendantes de
l’un, des deux, pourvu toutefois que la figure de ces
tuniques ne foit pas la même que celle des feuilles'
de la plante, fuppofé qu’elle en ait. Sur ce principe
il nomme fauffes fleurs ou fleurs nues , les Organes de
la génération qui font dénués dé tuniques; & de
vraies fleurs , céux qui en font revêtus : ainfi il Exclut
du nombre des vraies fleur s , les fleurs à étami-
F L E 8 5 3
On diftingue-dans les p u r s , lesfeuilles on pétales,
les filets, lesfommets, le piftii, & le calice :
fur quoi vçyt{ l'arthh Fleurs des Plan t es . J’a-
joûte. .que les jk u r s , conformément au. nombre de
leurs.pétalés, font nommées Màiwpétales ;dipètalt$ ,
tripétaUs. terapêtales, cleft - à - dire à une, à'deux, à
trois, à: quatre feuilles-, & c .
Rai prétend que toute p u r parfaite a despétales,
des étamines, des fommets, & un piftii, qui eft lui-
qieme oit le plein fruit, ou l ’extrémité du fruit ; êc
il regarde comme/«,« imparfaites, toutes celles’qui
manquent de quelqu’une de ces parties! .
L es p u r s f o n t d i f t in g u é e s e n m â l e s ; , f e m e l l e s , &
h e rm a p h r o d i t e s . L e s / , a r a mâles f o n t c e lle s * d a n s lè f - :
q u e l l e s i ! y a d e s e t a m i n e s , m a ï s q u i n e p o r t e n t p o in t
d e f r u i t . L espursfemelles f o n t c e l l e s q u i c o n t i e n n e n t
u n p i f t i i , a u q u e l l e f r u i t f u c c e d e . Les p u r s hermaphrodites
f o n t c e l l e s d a n s l e f q u e l l e s f e trouvent* l e s !
d e u x f e x e s , & c ’ e f t c e q u i e f t l e p lu s O r d in a i r e •: t e l l
e s f o n t l e n a r c i f f e , l e l i s , l a t u l i p e , l e g é r a n iu m
l a f a u g e , l e t h y m , l e r o m a r i n , &c.
x La ftruéhire des parties eft la même dans l e s fleurs
oîi les fexes font partagés; la feule différence cdnfifte
en ce que les étamines & les fommets, c’eft-à-dire les
parties mâles font féparéesdans celles - ci des piftils
& fe trouvent quelquefois fur la même plante, ôc
quelquefois fur des plantes différentes ; entré les
plantes qui ont les parties mâles & femelles, mais
à quelque diftance les unes des autres, l’on compte
le concombre, le melon, la courge, le blé de Turquie,
le tournefol, le noyer, le chêne, le hêtre, &c.
Article de M. le Chevalier DE J A u COURT.
Fleur^ des Plantes Tournetort
a préféré, dans fa diftribution méthodique des
tiré.desp u r s , pour établir.
! lès cla ffe’s de fa méthode , qui* eft celle mie nous fui-
■ t t lH H n ouvrage pour la dénomination & la-
ij detm$K>n/es difërepj gehHürde plante*. Cèriiifeufr
diftînguécinq parties dans les/orfr y. fàVoir les fèu it.
les’, lesMéts., les fommets , le piftii, Se le calice t
, mais toutes cês parties, ne fe trouvent pas dans tou’ -
tes les fleurs.
■ Les fouilles de hifl^ür forit auffi àppellées pétales ,
pour les diftmguer dés feüillés de là plante. Les péta-
5 . v of d'haitement lès* parties les pltiS apparentes
oêTesplùs'bellès dè-ra/enr/maisfoiitès les p a r i n’en .
ont pas , & il eft fouvent très-difficile de déterminer
les parties auxquelles on doit donner le nom de p i-
taies, où celùi de calice-, - :
Lès filets font placés pôur l’ordinaire dans léûni-
lieu de la fleur; ceux qui foûtiennent des fommets .
font appelles etamines. Il y a des filets Amples; il v
en a de fourchus-. .
Les fommets font les parties qui terminènt les éta-
mmes, quelquefois l’extrémité de l’étamine formé, le
filét en s elargiflant ; mais dans le plus grand nom-,
bre des plantes; les fommets font attachés à l’extré-
mite des etamines. La plupart des fommets font partages
en deux bourfes qui renferment de petits grains
de.poufliêr, 6c qui s’ouvrent de differentes maniérés^
Le piftii eft pouf l’ordinaire au centre de la fleur •
. y a beaueoüp de variété dans la figure dè cette par- '
ne ; elle eft pointue dans un très - grand nombre de .
plantés, 6c renflée à la bafe. Il y a aufli des piftils qui
font arrondis, quarrés /triangulaires, ovales , fem-
Mab/es â un fiifeau, à un chapiteau-, &c. L ’embryon
n tfU/ï fe trouve. le plus, fou vent dans le piftiF; i|
eft aufli quelquefois au-deffoûs ou au deflus. Dans -
prelque toutes les plantes , l’extrémité du piftii eft
couverte de poils fiftuleüx, parfemée dè petites vei-
nes, 6c ouverte par -plufieurs fentes. • *
Le calice eft la partie extérieure de la fleu r , q u i'
enveloppe les autres parties, oùl e s foûtient, ou qui
les enveloppe & les foûtient. On doit donner aufli le
nom de calice à la partie extérieure & poftérieure qur
fe trouve dans quelques fleurs, & qui eft différente
des feuilles, des fleurs, 6c de leur pédifcule. Il y a des
fleurs qui ont des feuilles qui paroiflent être un calice
; elles font dé v r a i e s f e u i l l e s , lorfqu’ëlles ne fer-
: vent ni d enveloppe ni de capfule aux femences qur
viennent apres la fle u r ; mais fi ces prétendues feuilles
feftent & fervent d’enveloppe ou de capfule aux
fomences, on d o i t leur donner le nom de calice.
M. de Tournefort ne confidere pour la diftributiôn
méthodique des plantes, que la ftrufhire des fleurs
il les divife d’abord en fleurs à feuilles, & en fleurs à
etamines. Les premières font celles qui ont non-feulement
dès filets chargés de fommets, c’eft-à-dire des
etamines, mais encore des feuilles que l’on appelle
petales, flores pitalodes ; lés autres au contraire n’ont
que des étamines fans pétales, floresftàminei, feuca-
pillacei & apetâli : telles font les fleurs de l’avôine
dé l’arroche, de la biftofte, ère. Les chatons, nuca-
menta f e u ju li , font des fleurs à étamines.
- Les fleurs à feuilles font fimples Ou compofées. Les
leurs Jîmples fe trouvent chacune dans un calice : il
y én a de plufieurs fortes ; les unes n’ont qu’une feule
Feuille coupée régulièrement ou irrégulièrement -
telles font les fleurs en cloche, flores campaniformes ;
~ eft-à-dire les fleurs qui ont la figure d’une cloche 1
’une campane, ou d’un grelot-; les autres reffem-
blent à un entonnoir, flores infundibulijormes, par
exemple la fleur de l’oreille d’ours. Les fleurs en fou-
coupe different des précédentès, en ce que leur partie
fupérieure a la forme d’un baffin plat; dont les
bords font relevés. Les fleürs des primevères font de
cette efpece. Les fleurs en r o fet te, flores rofati, ont
la figure d’une mollette d’éperon ou d’une roue. Les
fleurs en mufle, flores labiati, font formées ôn-devanf
Q Q. q q q
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■