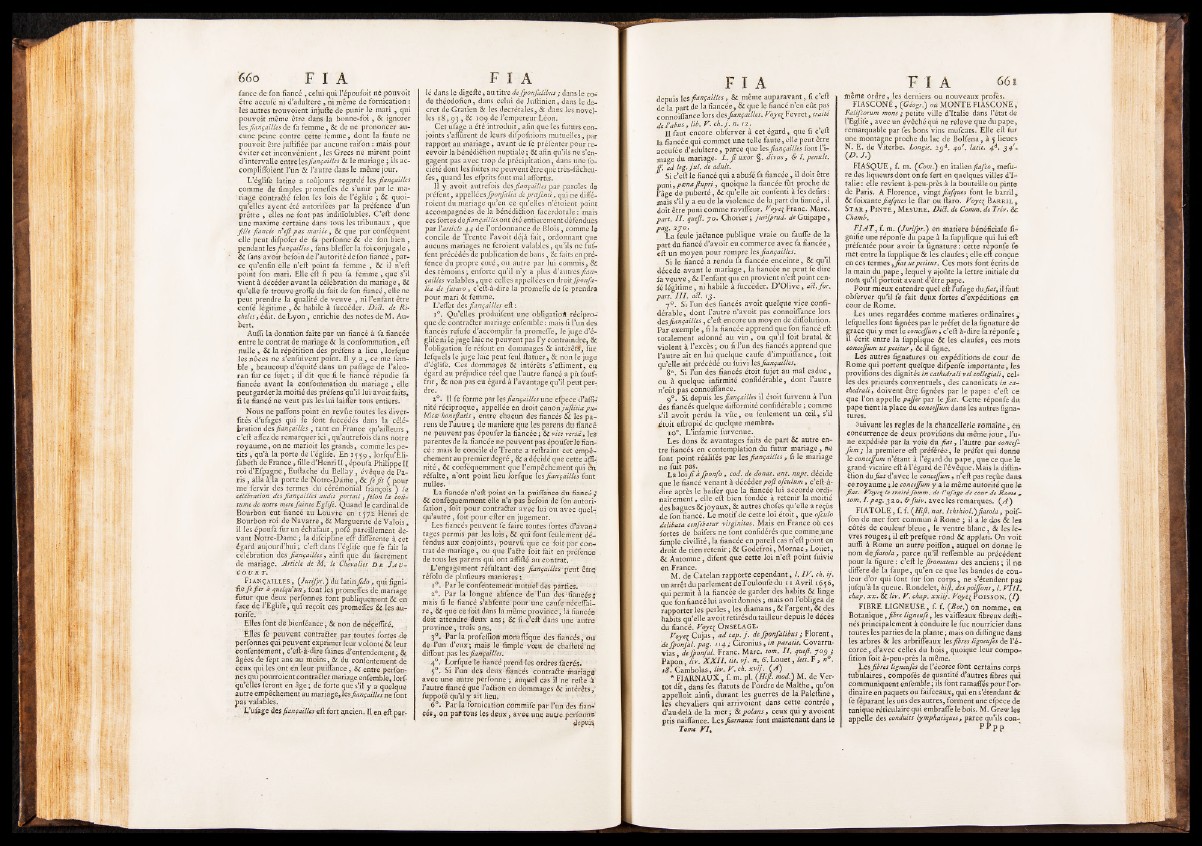
660 F I A
fance de fon fiancé , celui qui l’époufoit ne pouvoit
être accufé ni d’adultere , ni même de fornication :
les autres trouvoient injufte de punir le mari , qui
pouvoit même être dans la bonne-foi, & ignorer
les fiançailles de fa femme, & de ne prononcer aucune
peine contre cette'femme, dont la faute ne
pouvoit être juftifiée par aucune raifon : mais pour
éviter cet inconvénient, les Grecs ne mirent point
d’intervalle entre lésfiançailles & le mariage ; ils ac-
complifloient l’un & l’autre dans le même jour.
L ’églife latine a toujours regardé les fiançailles
comme de fimples promefles de s’unir par le ma-
riagë contràûé félon les lois de l’églife ; 8c quoiqu’elles
ayent été autorifées par la préfence d’un
• prêtre , elles ne font pas indiffolubles. C ’eflrdonc
une maxime certaine dans tous les tribunaux , que
fille fiancée n'éjl pas mariée, 8c que par conféquent
elle peut difpofer de fa-perforine 8c de fon bien ,
pendant les fiançailles, fans bleffer la foi conjugale ,
ôc fans avoir befoin de l’autorité de fon fiancé, parce
qu’enfin elle n’eft point fa femme , & il n’eft
point fon mari. Elle eft fi peu fa femme , que s’il
vient à décéder avant la célébration du mariage, 8c
qu’elle fe trouve groffe du fait de fon fiancé, elle ne
peut prendre la qualité de veuve , ni l’enfant être
cenfé légitime , 8c habile à fuccéder. Dicl. de Ri-
chelet, édit, dé L y on , enrichie des notes de M. Aubert.
Aufli la donation faite par un fiancé à fà fiancée
entre le contrat de mariage & la confommation, eft
nulle , 8c la répétition des préfens a lieu , lorfque
les noces ne s’enfuivent point. Il y a , ce me fem-
ble , beaucoup d’équité dans un paffage de l’alco-
ran fur ce fujet ; il dit que fi le fiancé répudie fa
fiancée avant la confommation du mariage , elle
peut garder la moitié des préfens qu’il lui avoit faits,
fi le fiancé ne veut pas les lui laiffer tous entiers.
Nous ne paffons point en revue toutes'les diver-
fités d’ufages qui fe font, fuccédés dans la célébration
des fiançailles , tant en,France qu’ailleurs ,
c ’eft allez de remarquer ic i , qu’autrèfois'dans notre
royaume, on ne marioit les grands, comme les petits
, qu’à la porte de l’églife. En 1 559, Iorfqu’Eli-
fabeth de France, fille d’Henri I I , époufa Philippe II
roi d’Efpagne, Euftache du Bellay, évêque de Paris
, alla à:la porte deNotreJDàdie, & fie fit ( pour
me fervir des termes du cérémonial françois ) ta
célébration des fiançailles audit portail, fielon la coutume
de notre merefiainte Eglifie. Quand le cardinal de
Bourbon eut fiancé au Louvre en 1 j y i Henri de
Bourbon roi de Navarre, 8c Marguerite dé Valois,
il les époufa fur un échafaut, pôfé pareillement devant
Notre-Dame ; la difcipliné ëftr différente à cet
egard aujourd’hui ; c’eft. dans l’églife que fè fait la
célébration des fiançailles, ainfi que du facrement
de mariage. Article de M . le Chevalier D m J a V -
C O U R T .
F i a n ç a i l l e s ., (Jurifipf.'j du latinfido, qui figni-
Üe fie fier à quelqu'un , font les promeïfes de mariage
futur que deux perfonries font publiquement 8c en
fae.e de l’Egiifé, qui reçoit ces promeïfes & les au-
tôrifê.
Elles font de bienféance ; & non de néçèflité.
Elles fe peuvent contrarier par Routes fortes de
perfonnes qui peuvent'exprimer leur volonté 8c leur
fconfentement, c’eft-à-dire faines, d’entendement &
âgées de fept ans au moins, & du confentement de
ceux qui les ont en leur puiffance, & entre perfonnes
qui pourroient contrarier mariage enfemble, lorf-
qü’ èllés feront ëri âge ; de forte que s’il y a quelque
autre empêchement au mariage, les fiançailles ne font
pas valables.
L’ufcge des fiançailles eft fort ancien. U en eft par-
F I A lé dans le digefte, au titre defiponfialibus ; dans le co^
de théodofien, dans celui de Juftinien, dans le decret
de Gratien & les décrétales, & dans les novel-
les 18, 93 , 8c 109 de l’empereur Léon.
Cet ufage a été introduit, afin que les futurs conjoints
s’affurent de leurs difpofitions mutuelles, par
rapport au mariage, avant de fe préfenter pour recevoir
la bénédiction nuptiale ; 8c afin qu’ils ne s’engagent
pas avec trop de précipitation, dans une fo-
cieté dont les fuites ne peuvent être que très-fâcheu-
fes, quand les efprits font mal afforfis.
Il y avoit autrefois des fiançailles par paroles do
préfent, appellées fiponfialia de proefienti, qui ne diffé-
roient du mariage qu’en ce qu’elles n’étoient point
accompagnées de la bénédiftion facerdotale : mais
ces fortes de fiançailles ont été entièrement défendues
par Yarticle 44 de l’ordonnance de Blois, comme 1©
concile de Trente l’avoit déjà fait, ordonnant que
aucuns mariages ne feroient valables, qu’ils ne fut-
fent précédés de publication de bans, 8c faits en préfence
du propre curé, ou autre par lui commis, 8c
des témoins; enforte qu’il n’y a plus d’autres fiançailles
valables, que celles appellées en droit fiponfialia
de fiuturo, c’eft-à-dire la promeffe de fe -prendra
pour mari & femme.
L’effet des fiançailles eft :
i° . Qu’elles produifent une obligation récipro-'
que de contracter mariage enfemble : mais fi l’un des
fiancés refufe d’accomplir fa promeffe, le juge d’é-
glife ni le juge laïc ne peuvent pas l’y contraindre, &
l’obligation fe réfout en dommages 8t intérêt#, fur
lefquels le juge laïc peut feul ftatuer, 8t. non le juge
d’églife. Ces dommages 8c intérêts s’eftiment, eu
égard au préjudice réel que l’autre fiancé a pû fouf-,
frir, 8c non pas eu: égard à l’avantage qu’il peut perdre.
2P. Il fe forme par les fiançailles une efpeced’affi-'
nité réciproque, appellée en droit canon jufiitiapud.
blicoe honejlatis , entre chacun des fiancés & les pa-
rens de l’autre ; de maniéré que les parens du fiancé
ne peuvent pas époufer la fiancée ; 8c vice versa, les
parentes de la fiancée ne peuvent pas époufer le fian-;
cé : mais le concile de Trente a reftraint cet empêchement
au premier degré, 8c a décidé que cette affi-;
nité, 8c conféquemment que l’empêchement qui eri
réfùlte, n’ont point lieu lorfque les fiançailles font
nulles. '
La fiancée n’eft point en la puiffance du fiancé }
8c conféquemment elle n’ a pas befoin de fon autori-
fation, foit pour contrafrer avec lui ou avec quel-'
qu’ autre, foit pour efter en jugement.
Les fiancés, peuvent fe faire toutes fortes d’avantages
permis par les lois, 8t qui font feulement défendus
aux conjoints, pourvù que ce foit par contrat
de mariage-, ou que l’afte. foit fait en préfence
de tous les parens qui ont aflïfté au contrat.
L’engagement rèfultant des fiançailles-peut être
réfolu dé plufieurs manières : ■
i V Par lé confentemetif mutùél dés parties. •
2°. Par la longue abfence de l’uri des:fi‘âncés£
mais fi le fiancé s’àbfentë . pour Une caufe néceffair
re ,-8c-que ce foit dans là même province, là fiancée
doit attendrédeüx ans; 8c fi ée ft dans une autre
province , trois ans.
1°. Parla profeflîon moriaftique des fiancés, 'ou
de'-l’un d’eux; mais le fimplevceu de chafteté nq
diffout pas les fiançailles.
40. Lorfque le fiancé prend-lës ordres facrés.
ç°. Si l’un des deux fiancés contraéle mariagé
avec une atttre perfonne ; auquel cas il ne refte à
l’autre fiancé que l’ariioh en dommages 8c intérêts ,1'
fuppofé qu’il y ait lieu.
6°. Par la fornication commife par l’un des fiancés
, ou pat tou? les deux, avec une auore-perfonne
depuis
F I A depuis les fiançailles, 8c même auparavant, fi c’eft
de la part de la fiancée, 8c que le fiancé n’en eût pas
connoiffance lors des fiançailles. Voye^ Fevret, traité
de l'abus , lib. V. ch. J. n .12 . f i
I l f a u t e n c o r e o b f e r v e r à c e t e g a r d , q u e f i c e l t
l a f i a n c é e q u i c o m m e t u n e t e l l e f a u t e , e l l e p e u t ê t r e
a c c u f é e d ’ a d u l t e r e , p a r c e q u e l e s fiançailles f o n t l ’ i m
a g e d u m a r ia g e * L . J i nxor § . divus , & l. penult.
fifi. ad leg.jul. de àdtilt. ^
Si c’eft le fiancé qui a abufé.fa fiancée, il doit être
puni,panafitupri, quoique la fiancée fût proche de
Page de puberté, 8c qu’elle ait confenti à fes defirs :
mais s’il y a eu de la violence de la.part du fiancé, il
doit être puni comme raviffeur. Voye{ Franc. Marc.
part. I I . quefi. jo . Chorier ; jurifiprud. de Guipape,
pag. 2.J0.
La feule jaftance publique vraie ou fauffe de la
part du fiancé d’avoir eu commerce avec fa fiancée,
eft un moyen pour rompre les fia n ça ille s .
Si le fiancé a rendu fa fiancée enceinte, 8c qu’il
décédé avant le mariage, la fiancée ne peut fe dire
fa v eu ve, 8c I’enfaiit qui en provient n’eft point cenfé
légitime, ni habile à fuccéder. D ’OJive, ael.for.
part. I I I . acl. 13.
7 0. Si l’un des fiancés avoit quelqüe vice confi- ,
dérable, dont l’autre n’avoit pas connoiffance lors I
des fiançailles, c’eft encore un moyen de diffolution.
Par exemple, fi la fiancée apprend que fon fiancé eft
totalement adonné au v in , ou qu’il foit brutal 8c
violent à l ’excès ; ou fi l’un des fiancés apprend que
l’autre ait en lui quelque caufe d’impuiffance, foit
qu’elle ait précédé ou fuivi les fiançailles.
8°. Si l’un des fiancés étoit fujet au mal caduc,
ou à quelque infirmité confidérable, dont l’autre
n’eût pas connoiffance.
90. Si depuis les fiançailles il étoit furvenu à l’un
des fiancés quelque difformité confidérable ; comme
s’il avoit perdu la vû e , ou feulement un oe il, s’il
Étoit eftropié de quelque membre.
io ° . L’infamie furvenue.
Les dons 8c avantages faits de part 8c autre entre
fiancés en contemplation du futur mariage, ne
font point réalifés par les fiançailles , fi le mariage
ne fuit pas.
La loi f i à fponfo , cod. de donat. ant. nupt. décide
que le fiancé venant à décéder pofi ofculum, c’eft-à-
dire après le baifer que la fiancée lui accorde ordinairement
, elle eft bien fondée à retenir la moitié
des bagues 8c joyaux, 8c autres chofes qu’elle a reçus
de fon fiancé. Le motif de cette loi étoit, que ofeulo
delibata cenfebatur virginitas. Mais en France où ces
fortes de baifers ne font confidérés que comme.une
fimple civilité, la fiancée en pareil cas n’eft point en
droit de rien retenir ; 8c Godefroi, Mornac , Loiiet,
8c Automne, difent que cette loi n’eft point fuivie
en France.
M. de Catelan rapporte cependant, l. IV . ch. ij.
un arrêt du parlement deTouloufe du 11 Avril 1656,
q u i p e rm i t à l a f i a n c é e d e g a r d e r d e s h a b i t s 8 c l in g e
q u e f o n f i a n c é l u i a v o i t d o n n é s ; m a i s o n l ’o b l i g e a d e
r a p p o r t e r l e s p e r l e s , l e s d i a m a n s , 8 c l ’ a r g e n t , 8 c d e s
h a b i t s q u ’ e l l e a v o i t r e t i r é s d u t a i l l e u r d e p u i s l e d é c è s
d u f i a n c é . Voye£ O n s e l a g e .
Voye[ Cujas, ad cap. j . de fiponfialibus ; Florent,
de fiponfial. pag. 114; Cironius, in paratit. Covarru-
via s , de fiponfial. Franc. Marc. tom. II. quefi. jo $ ;
Papon, liv. X X I I . tit. vj. n. C. L ouet, lett. F , n°.
18. Cambolas, liv. V. ch. xvij. ( A )
* FIARNAUX, f. m. pl. (JHfi mod.) M. de Ver-
tot d ft, dans fes ftatuts de l’ordre de Malthe, au’on
appelloit ainfi, durant les guerres de la Paleftine,
les chevaliers qui arrivoient dans cette contrée,
d’au-delà de la mer ; 8c polans, ceux qui y avoient
pris naiffance. Les fiarnaux font maintenant dans le
Tome FI»
U I A 66ï
même ordire, les derniers ou nouveaux profès.
FIASCÔNÉ, (Géogr.) ou MONTE F IASCONE,
Faificorum mons ; petite ville d’Italie dans l’état de
l’Eglife, àvéc un évêché qui rie releve que du pape,
remarquable par fes bons vins mufcàts. Elle eft fur
une montagne proche du lac de Bolfena, à 5 lieues
N. E. de Viterbe. Longit. 29d. 401. latit. 4 d. J 4 /-.
{D. J.)
FIASQUE, f. m. ( Com.) en italienfiafico, mefu-
re des liqueurs dont on fe fert en quelques villes d’Italie
: elle revient à-peu-près à la bouteille ou pinte
de Paris. A Florence, vingt fiafiques font le barril,
8c foixantefiafiques le ftar ou ftaro. Voye{ B a r r i l ,
S t a r , P i n t e , M e s u r e . Dicl. de Comm. de Trév. 8c
Chamb.
F IA T , f. ni. ( Jurifpr.) en matière bénéficiai lignifie
une réponfe du pape à la fupplique qui lui eft
préfentée pour avoir la fignature : cette reponfe fe
met entre la fupplique 8c les claufes ; elle eft conçue
en ces termes ,fiat utpetitur. Ces mots font écrits de
la main du pape, lequel y ajoute la lettre initiale dit
norti qu’il portoit avant d’être pape.
Pour mieux entendre quel eft l’ufage du fiat, il faut
obferver qu’il fe fait deux fortes d’expéditions en
cour de Rome.
Les unes regardées coirime matières ordinaires ,
lefquelles font lignées par le préfet de la fignature de
grâce qui y met le concejfium, c’eft à-dire la réponfe ;
il écrit entre la fupplique 8c les claufes, ces mots
concejfium ut petitur, 8c il ligne.
Les autres fignatures ou expéditions de Couf de
Rome qui portent quelque difpenfe importante, les
provifions des dignités in cathedrali vèl collegiali, celles
des prieurés conventuels, des eanonicats in ca+
thedrali, doivent être lignées par le pape t è’eft ce
que l’on appelle pajfier par le fiat. Cette réponfe du
pape tient la place du concejfium dans les autres fignatures.
Suivant lès fegles dè la dhabcellerié romaine, eri
concurrence de deux provifions du même jour, l’une
expédiée par la voie du jia t, l’autre par concefi-
fium ; la première eft préférée, le préfet qui donné
le concejfium n’étant à l’égard du pape, que ce que le
grand-vicaire eft à l’égard de l’évêque. Mais la diftin-
étion du jiat d’avec le concejfium, n’eft pas reçûe dans
ce royaume ; le concejfium y a la même autorité que le
fiat. Voyeç_ le traité fiomm. de Tufiage de cour de Rome >
tom. I.pag. 320. &fiuiv. avec les remarques. (*4)
FIATOLE, f. f. ( Hiß. hat. Ichthiol.^fiatolà , poif-
fon de mer fort commun à Rome ; il a le dos 8c les
côtés de couleuf bleue, le ventre bland, & les lèvres
rouges ; il eft prefqüe rond 8c applati. On voit
aufli à Rome un autre poiffon, auquel on donne le
nom de jiatola , parce qu’il reuemble au précédent
pour la figure : c’eft le firomateus des anciens ; il né
différé de la faupe, qu’en ce que les bandes de couleur
d’or qui font fur fon corps, ne s’étendent pas
jufqu’à la queue. Rondelet, hiß. despoijfions, l. V III.
chap. x x . 8c liv. V. chap. xx iij. Voyè{ P o i s s o n . (/)
FIBRE LIGNEUSE, f. f. (Bot.') on nomme, en
Botanique, fibre ligneufie, les vaiffeaux fibreux defti-
nés principalement à conduire le fuc nourricier dans
toutes les parties de la plante ; mais on diflingue dans
les arbres 8c les arbriffeaux les fibres ligneufies de l’écorce
, d’avec celles du bois, quoique leur compo-
fition foit à-peu-près la même.
Les fibres ligneufies de l’écorce font certains corps
tubulaires, compofés de quantité d’autres fibres qui
communiquent enfemble ; ils font ramaffés pour l’ordinaire
en paquets ou faifeeaux, qui en s’étendant 8c
fe féparant les uns des autres, forment une efpece de
tunique réticulaire qui embraffe le bois. M. G rew les
appelle des conduits lymphatiques, parce qu’ils con-
** D D __ H