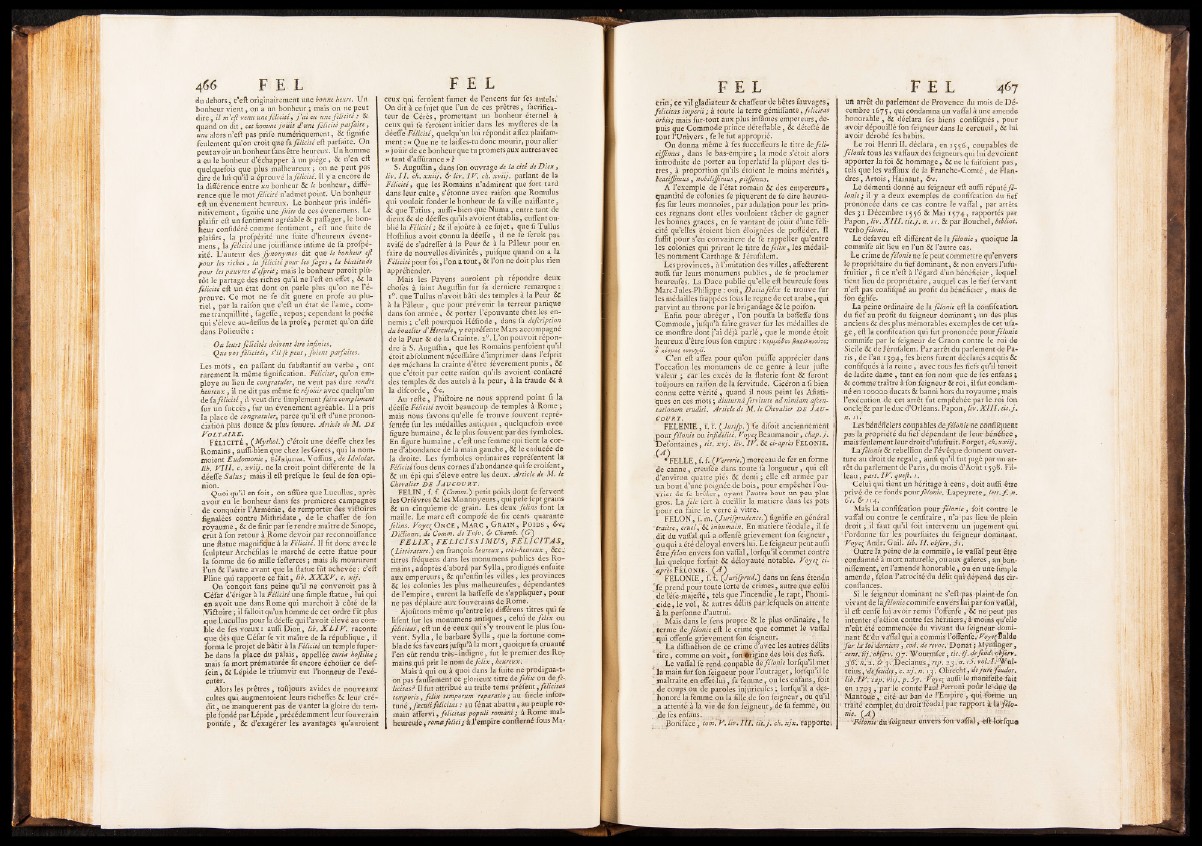
du d eh o r s c ’eft originairement une bonne heurt. Un
bonheur v ient, on a un bonheur ; mais on ne peut
dire , il m'efivenu une félicité, j'a i eu une félicité : &
quand on dit, cet homme jouit d'une félicité parfaite,
une alors n’ eft pas prife.numériquement, & lignifie
feulement qu’on croit que fa félicité eft parfaite. On
peutavoirun bonheur fans être heureux. Un homme
sl eu le bonheur d’échapper à un piège , & n’en eft
quelquefois que plus malheureux ; on ne peut pas
aire de lui qu’il a éprouvé la félicité. Il y a encore de
la différence entre un bonheur & le bonheur, différence
que le mot félicité n’admet point. Un bonheur
eft un événement heureux. Le bonheur pris indefi-
nitivement, fignifie une fuite de ces évenemens. Le
plaifir eft un fentiment agréable & paffager, le bonheur
conlidéré comme fentiment, eft une fuite de
plaifirs, la profpérité une fuite d’heureux évenemens
, la félicité une joiiiffance intime de fa profpérité.
L’auteur des fynonymes dit que le bonheur ejl
pour les riches , la félicité pour les fages, la béatitude
pour les pauvres d'efprit ; mais le bonheur paroît plutôt
le partage des riches qu’il ne l’eft en effet, & la
félicité eft un état dont on parle plus qu’on ne l’éprouve.
Ce mot ne fe dit guere en profe au pluriel
, par la raifon que c’eft un état de l’ame, comme
tranquillité, fageffe, repos ; cependant la poélie
qui s’élève au-dèlïus de la profe $ permet qu’on dife
dans Polieuûe :
Ou leurs félicités doivent être infinies. ■
Que vos félicités, s'il fe peut, fiaient parfaites.
Les mots , en paffant du fubftantif au verbe , ont
rarement la même fignification. Féliciter, qu’on employé
au lieu de congratuler, ne veut pas dire rendre
heureux, il ne dit pas même fe réjouir avec quelqu’un
de (a félicité, il veut dire Amplement faire compliment
fur un fuCcès, fur un événement agréable. Il a pris
la place de congratuler, parce qu’il eft d’une prononciation
plus douce & plus fonore. Article de M. DE
V o l t a i r e .
Fé l ic it é , (Mythol.) c’étoitune déeffe chez les
Romains, aufli-bien que chez les Grecs, qui la nom-
moient Eudomonie, BiiS'ai/xovia. Voflîus, de Idololat.
lib. V III. c. xviij. ne la croit point différente de la
déeffe Salus; mais il eft prefque le feul de fon opinion.
Quoi qu’il en foit, on allure que Lucullus, après
avoir eu le bonheur dans fes premières campagnes
de conquérir l’Arménie, de remporter des viftoires
Signalées contre Mithridate, de le chaffer de fon
royaume, & de finir par fe rendre maître de Sinope,
crut à fon retour à Rome devoir par reconnoiffance
une ftatue magnifique à la Félicite. Il fit donc avec le
fculpteur Archéfilas le marché de cette ftatue pour
la fomme de 60 mille fefterces ; mais ils moururent
l ’un & l’autre avant que la ftatue fût achevée : c’eft
Pline qui rapporte ce fait, lib. X X X V . c, xij.
On conçoit fans peine qu’il ne convenoit pas à
Céfar d’ériger à la Félicité une fimple ftatue, lui qui
en avoit une dans Rome qui marchoit à côté de la
(Vi£toire ; il falloit qu’un homme de cet ordre fît plus
que Lucullus pour la déeffe qui l’avoit élevé au comble
de fes voeux: aufli Dion, lib. X L I V . raconte
?iue dès que Céfar fe v it maître de la république, il
ôrma le projet de bâtir à la Félicité un temple fuper-
be dans la place du palais, appellée curia hoflilia;
mais fa mort prématurée fit encore échoiier ce def-
fein, & Lépide le triumvir eut l’honneur de l’exé-
cutër.
Alors les prêtres, toûjours avides de nouveaux
cultes qui. augmentaient leurs richeffes & leur crédit
, ne manquèrent pas de vanter la gloire du temple
fondé par Lépide, précédemment leur fouverain
pontife , & d’exagérer les avantages qu’auroient
ceux qui feroient fumer de l’encens fur fes autels.'
On dit à ce fujet que l’un de ces prêtres, facrifica-
teur de Cérès, promettant un bonheur éternel à
ceux qui fe feroient initier dans les myfteres de la
déeffe Félicité, quelqu’un lui répondit affez plaifam-
ment : « Que ne te laiffes-tu donc mourir, pour aller
»joiiir de ce bonheur que tu promets aux autres avec
» tant d’affûrance » )
S. Auguftin, dans fon ouvrage de la cité de Dieu,
liv. I I . ch. xxiij. & liv. IV . ch. xviij. parlant de la
Félicité, que les Romains n’admirent que fort tard
dans leur culte, s’étonne avec raifon que Romulus
qui vouloit fonder le bonheur de fa ville naiffante,
& que T alius, aufli-bien que Numa, entre tant de
dieux & de déeffes qu’ils avoient établis, euffent oublié
la Félicité; & il ajoute à ce fujet, que fi Tullus
Hoftilius avoit connu la déeffe , il ne le feroit pas
avifé de s’^dreffer à la Peur & à la Pâleur pour en
faire de nouvelles divinités, puifque quand on a la
Félicité pour fo i, l’on a touf, & l’on ne doit plus rien
appréhender.
Mais les Payens auroient pu répondre deux
chofes à faint Auguftin fur fa derniere remarque :
i° . que Tullus n’avoit bâti des temples à la Peur &
à la Pâleur, que pour prévenir la terreur panique
dans fon armée, & porter l’épouvante chez les ennemis
; c’eft pourquoi Héfiode , dans fa defcription
du bouclier d'Hercule, y repréfente Mars accompagné
| de la Peur & de la Crainte. 2°. L’on poüvoit répondre
à S. Auguftin, que les Romains penfoient qu’il I étoit abfolument néceffaire d’imprimer dans l’efprit
des méchans la crainte d’être féverement punis, ÔC
que c’était par cette raifon qu’ils avoient confacré
des temples & des autels à la peur, à la fraude & à
la difcorde, &c.
Au refte, l’hiftoire ne nous apprend point fi la
déeffe Félicité avoit beaucoup de temples à Rome ;
mais nous favons qu’elle fe trouve fouvent repré-
fentée fur les médailles antiques , quelquefois avec
figure humaine, & le plus fouvent par des fymboles»
En figure humaine, c’ eft une femme qui tient la corne
d’abondance de la main gauche, & le caducée de
la droite. Les fymboles ordinaires repréfentent la
Félicité fous deux cornes d’abondance qui fe croifent,
& un épi qui s’élève entre les deux. Article de M. le
Chevalier D E J A U COU R T .
FELIN, f. f. (Comm.) petit poids dont fe fervent
les Orfèvres & les Monnoyeurs, qui pefe fept grains
& un cinquième de grain. Les deux félins font la
maille. Le marc eft compofé de fix cents quarante
félins. Voye{ O n c e , Ma r c , G r a in , P o id s , &c
Dicüonn. de Comm. de Trév. & Chamb. (G)
F E L I X , F E L IC IS S I M U S , F E L IC IT A S ,
( Littérature.) en françois heureux, tris-heureux, &c„‘
titres fréquens dans les monurnens publics des Romains
, adoptés d’abord par Sylla, prodigués enfuite
aux empereurs ■, & qu’enfin'les villes, les provinces
& les colonies leis plus malheureufes, dépendantes
de l’empire, eurent la baffeffe de s’appliquer , pour
ne pas déplaire au* fouverains de Rome.
Ajoûtons même qu’entre les différens titres qui fe
lifent fur les monurnens antiques, celui de felix ou
félicitas, eft un de ceux qui s’y trouvent le plus fou-
vent. S ylla , le barbare Sylla , que la fortuné combla
de fes faveurs jufqu’à la mort, quoique fa cruauté
l’eri eût fendu très-indigne , fut le premier.des Romains
.qui prit le nom de fe lix , heureux.
Mais'à qui ou à quoi dans la fuite ne prodigua-t-
on pas fauffement ce glorieux titre de fe lix ou d.e félicitas?
Il fut attribué au trifte tems préfent, félicitas
temporis, felix temporum reparatio ; au fiecle infortuné
,fceculi félicitas : au fénat abattu, au peuple romain
âffervi, félicitas populi romani ; àRome mal-
heureufe, romctfelici; à l ’empire confterné fous Ma-
Crin," ce v il gladiateur & chaffeur de bêtes fauvages
félicitas imperii ; à toute la terre gémiflantè, félicitas
orbis; mais fur-tout aux plus infâmes empereurs, depuis
que Commode prince déteftable, & détefté de
tout l’Univers, fe le fut approprié.
On donna même à fes fuccèffeurs le titre de feli-
tifjîmus, dans le bas-empire ; la mode s’étoit alors
introduite de porter au fiiperlatif la plûpart des titres,
à proportion qu’ils étoient le moins mérités,
‘beatïfjimus, nobïlifjimus, piifjimus.
A l’exemple de l’état romain & des empereurs,
quantité de colonies fè piquèrent de fe dire heureu-
fes fur leurs monnoies, par adulation pour les princes
regnans dont elles vouloient tâcher de gagner
les bonnes grâces, en fe vantant de joiiir d’une félicité
qu’elles étoient bien éloignées de pofféder. Il
fuflît pôur s’en convaincre de fe rappeller qu’entre
les colonies qui prirent le titre de fe lix , les médailles
nomment Carthage & Jérûfalem.
Les'pfôvirtce's, à l’imitation des villes, affefterent
âufli fur leurs monurnens publics, de fe proclamer
heureufes. La Dace publie qu’elle eft heureufe fous
Marc-J ules-Philippe : oui, Dada felix fe trouve fur
les médailles frappées fous le règne dë cet arabe, qui
parvint au throne parle brigandage & le poifon.
Enfin pour abréger , 'l’on pouffa la baffeffe fous j
‘Commode, jufqü’à faire graver fur les médailles de ;
ce monftre dont j’ai déjà parlé, que le monde étoit ;
heureux d’être fous fon empire ‘. Kofxpéé'ou fiaaiXivovro; 0 K0&/JL0Ç ivjvyfi.
C ’en eft àffèz pour qu’on puiffe apprécier dans
i ’occafion les monurnens de ce genre à leur jufte i
'valeur ; car les excès de la flaterie font & feront i
toûjours en raifon de la fervitude. Cicéron a fi bien !
connu cette vérité , quand il nous peint lès Afiati- •'
ques en ces mots ; diuturnâ fervitute ad nimiam afcen- ;
tationem éruditi. Article de M. le Chevalier d e J AU- .
C O U R T .
FELENIE, f. f. (.Jurifp. ) fe difoit anciennement i
■ pour félonie ou infidélité. Voye^ Beaumanoir, chap. j . j
T)efontaines, tit. xvj. liv. IV , & ci-aprls FELONIE. ■
(A )
*TELLE, f. f. (Verrerie.) morceau de fer en forme \
de cànne, creufée dans toiite fa longueur, qui eft l
^d’environ quatre pies &: demi ; elle eft armée par :
lin bout d’une poignée de bois , pour empêcher l’ou-
yrier de fe brûler, ayant l’autre bout un peu plus j
gros. La fêleTert à cueillir la matière dans les pots !
"pour en. faire le verre à vitre.
FELON, f. m. ( Jurifprudence.) fignifie en,général :
-traître, c ru e lin h um a in . En matière féodale, il fe j
, dit du vaffal qui- a offenfé grievement fon feigneur, j
^ouqui a é,té déloyal envers lui. Le feigneur peut aufli i
être félon envers fon vaffal, lorfqu’ii commet contre I
lui quelque forfait-& déloyauté notable. V6ye^ ci- j
apres FÉLONIE. , (A )
FELONIE, f. f. (Jurifpriid.) dans un fens étendu j
fe prend pour toute forte de crimès, autre que çélùi ;
Üe léfe-majefté, tels que l’ïncendiq, le rapt , t’homi- !
eide, le vol , & autres délits pàr lefquels on attente :
à la perïbnne d’ autrui. . . . ^ .
Mais dans le fens propre' & le plus ordinaire,' le |
. terme de félonie eft le crime que commet le Vai&l
qui offénfe, grièvement fon.feigneur. !
La diftinftion de ce crime tTayec les autres délits i
t ire , comme on- v o it , fon <irigine.des lois dës'fiéfs. |
■ Le vaffal fe rend coupamè dffélonie lorfqu’ilinet !
la'main fur fonieigneur pour l’outrager, loïfqu’il le :
maltraite en effet;lui, fa'fein.rrvfî,»' où les enfâns, fôit •
.de coups ou de paroles injûfiëufes;lorfqu’il adès-j
honoré lafèmme ou la.fill,erde.fpn feigneur, Ou qu’il|
a attenté à la vie de fon feigneur,:.de fa femme, Ou
-de fes enfaîns. ^
. ; ,'bonifàce, tomfV. livi ÏIT, tît.j. "ch. x jx, fàppOftei
un arrêt du parlement de Provence du mois de Décembre
1675, condamna un vaffal à une amende
honorable , & déclara fes biens confifqués , pour
avoir dépouillé fon feigneur dans le cercueil, & lui
avoir dérobé fes habits.
Le roi Henri II. déclara, en 1556, coupables de
félonie tous les vaffaux des feigneurs qui lui dévoient
apporter la foi & hommage, & ne le faifoient pas,
tels que les vaffaux de la Franche-Comté, de Flandres
, Artois, Hainaut, &c.
Le démenti donné au feigneur eft aufli réputé/2-
lonie; il y a deux exemples de confifcation du fief
prononcée dans ce cas contre le vaffal, par arrêts
des 31 Décembre 15 56 & Mai 1574, rapportés par
Papon, liv. X I I I . tit.j. n. 11. & par Bouchel, bibliot.
verbo félonie.
Le defaveu eft différent de \a félonie, quoique la
commife ait lieu en l’un & l’autre cas.
Le crime de félonie ne fe peut commettre qu’envers
le propriétaire du fief dominant, & non envers l’ufu-
fruitier, fi ce n’eft à l’égard d’un bénéficier, lequel
tient lieu de propriétaire, auquel cas le fief fervant
n’eft pas confifqué au profit du bénéficier, mais de
fon églife.
La peine ordinaire de la félonie eft la confifcation.
du fief au profit du feigneur dominant ; un des plus
anciens & des plus mémorables exemples de cet ufa-
g e , eft la confifcation qui fut prononcée pour félonie
commife par le feigneur de Craon contre le roi de
Sicile & de Jérûfalem. Par arrêt du parlement de Paris
, de l’an 1394, fes biens furent déclarés acquis &
confifqués à la reine, avec tous les fiefs qu’il tenoit
de ladite dame, tant en fon nom que de fes enfans ;
& comme traître à fon feigneur & ro i, ilfut condam-
-né en 100000 ducats & banni hors, du royaume ; mais
l’exécution .de cet arrêt fut empêchée par le^roi fon
oncle,&par le duc d’Orléans. Papon, liv. X I I I .t it .j.
n. il.
Les bénéficiers coupables de félonie neconfifquent
pas la propriété du fief dépendant deleurbénéfice ,
mais feulement leur droit d’ufufruit. Forget, dh. xxiij.
Lz félonie & rébellion de l’évêque donnent ouverture
au droit de regale, ainfi qu’il fut jugé, par un arrêt
du parlement de Paris, du mois d’Août 15 98. Fil-
'leau , part. IV. quefi. 1. \
Celui qui tient un héritage à cens, doit aufîi êtîe
' privé de ce fonds pour félonie, Lapeyrere,. lett.-f.ji.
Ci. &1 14.
Mais la confifcation pour félonie, foit contré le
vaffal ou contre le cenfitaire, n’a pas lieu de plein
droit ;Til ,faut qu’il foit intervenu un jugement qui
T’ordonne fur les . pourfuites du feigneur dominant.
' 'Voyvi ‘Andr^ Gail. lib. II. obferv. f i i .
Outre'laspeinedeIa commife, le vaffal peutêtre
^ condamné à mort naturelle, où aux galeres , au: bah-
niffement, en l’amende honorable , ou en une-fimple
amende, félon l’atrocité du délit qiiidépend des cir-
conftances*
Si ,1e feigneur dominant ne s’efbpas plaint-de fon
vivant delzfélonie commife enversTüi par fôn!vaffal,
il eftcertfé lui avoir remisf’offenfe , & ne;peut pas
intenter d’aéfion contre fes.héf.itiers,‘ à; moins qu’elle
fi’eûf élé commencéedu vivant du feignéurdomi-
nant & d u vàffal qui a commis l’offenfe.' Voyefôalde
fur, lit loldernifre, frrd. de' fevoç. Donât ; MÿfifitJger ,
centfŸf^olferV. g jiWovtqTLler, titAj.^fidd-i fVfefv.
'^-.tPe.cianu's, rep. zy. n. rS-. vol.TPfif^td-
teiuç, Qffeudf, lc. x j.fi. i f . OÜrévht, fie jure fèudor.
■ libylv~.‘cap. >éiij. p. Sy. 'Voye^ anfii'le nianzfefte-fàit
en 1703 , 'paf le comté Paul Perroni pour le'due de
Mantoqe citë.'-àu' ban de f’Empire', qui forme un
trkité cOmpleVdu.droitféodal par rapport à- là^ye/onie.
(Aj) . ';r?
-^Fclàme ddfeigneur énv^fsfon-vâffal, eft-kÀrfqu®