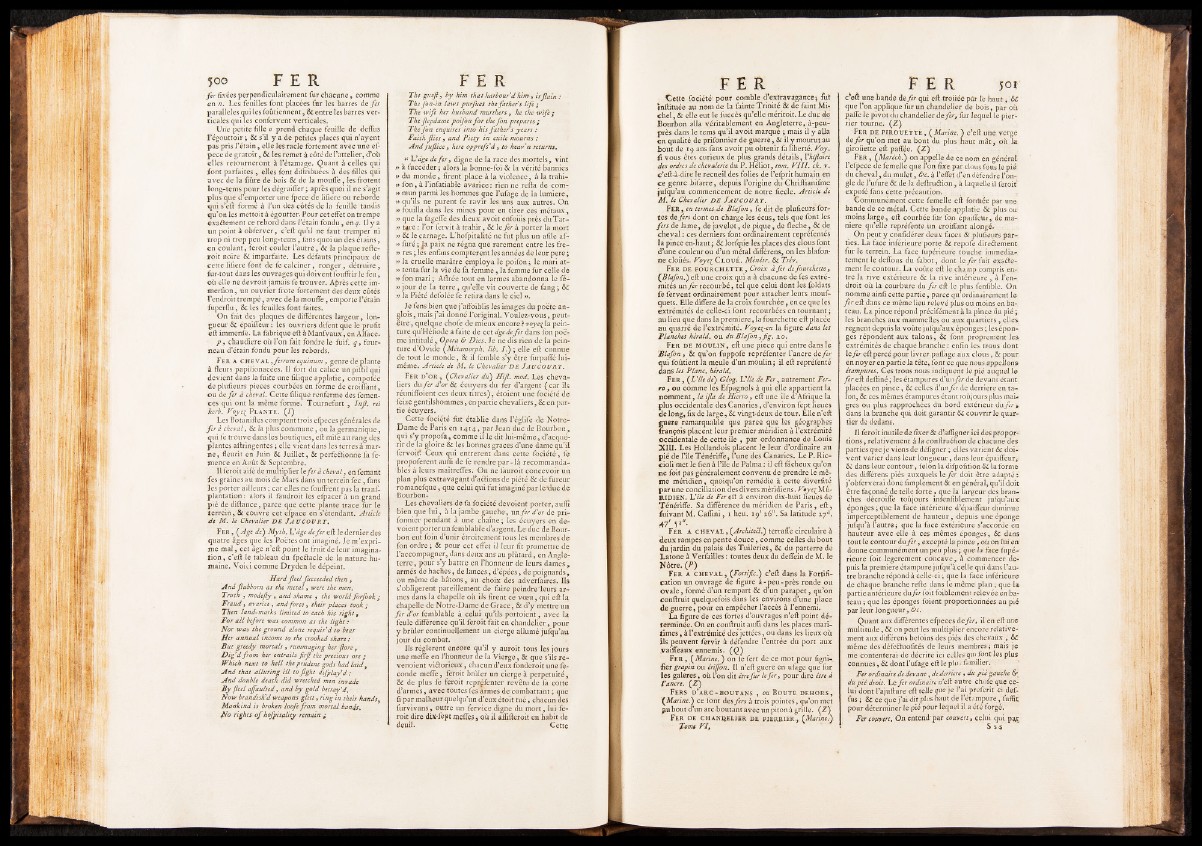
fe r fixées perpendiculairement fur chacune, comme
en n. Les feuilles font placées fur les barres de fer
parallèles qui les foûtiennent, & entre les barres verticales
qui les confervent verticales.
Une petite fille o prend chaque feuille de deffus
l ’égouttoir ; & s’il y a de petites places qui n’ayent
pas pris l’étain, elle les racle fortement avec une ef-
pece de gratoir, & les remet à côté de l’attelier, d’oii
elles retourneront à l’étamage. Quant à celles qui
font parfaites , elles font diftribuées à des filles qui
avec de la liûre de bois & de la moufle, les frotent
long-tems pour les dégraiffer ; apres quoi il ne s’agit
plus que d’emporter une fpece de lifiere ou reborde
qui s’ell formé à l’un des côtés de la feuille tandis
qu’on les mettoit à égoutter. Pour cet effet on trempe
exactement ce rebord dans l’étain fondu, en q. Il y a
un point à obferver, c’eft qu’il ne faut tremper ni
trop ni trop peu long-tems, fans quoi un des étains,
en coulant, feroit couler l’autre, & la plaquerefte-
roit noire & imparfaite. Les défauts principaux de
cette lifiere font de fe calciner, ronger, détruire ,
fur-tout dans les ouvrages qui doivent fouffrir le feu,
oii elle nedevroit jamais fe trouver. Aftrès cette im-
merfion, un ouvrier frote fortement des deux côtés
l’endroit trempé, avec de la moufle, emporte l’étain
fuperflu, & les feuilles font faites.
On fait des plaques de différentes largeur, longueur
êt épaiffeur : les ouvriers difent que le profit
eft immenfe. La fabrique eft à Manfvaux, en Alface.
■ p , chaudière o iil’on fait fondre le fuif. q , fourneau
d’étain fondu pour les rebords.
Fer a ch e v a l ,ferrum eqüinum , genre de plante
à fleurs papilionacées. Il fort du calice un piftil qui
devient dans la fuite une filique applatie, compofée
de plufieurs pieces courbées en forme de croiffant,
ou de fer à cheval. Cette filique renferme des femen-
ces qui ont la même forme. Tournefort , Injl. rei
herb. Voye^ Plante, (ƒ)
Les Botaniftes comptent trois efpeces générales de
fer à cheval, & la plus commune, ou la germanique,
qui fe trouve dans les boutiques, eft mife au rang des
plantes aftringentes ; elle vient dans les terres à marne,
fleurit en Juin & Juillet, & perfe&ionne fa fe-
mence en Août & Septembre.
Il feroit aifé de multiplier le fer a cheval, en femant
fes graines au mois de Mars dans un terrein fe e , fans
les porter ailleurs ; car elles ne fouffrent pas la tranf-
plantation : alors il faudroit les efpacer à un grand
pié de diftance, parce que cette plante trace fur le
terrein, & couvre cet efpace en s’étendant. Article
de M. le Chevalier DE JAUCO V r t .
F er , (Age de) Myth. U age de fer eft le dernier des
quatre âges que les Poëtes ont imaginé. Je m’exprime
mal, cet âge n’eft point le fruit de leur imagination
, c’eft le tableau du fpe&acle de la nature humaine.
Voici comme Dryden le dépeint.
Hard Jleel fucceeded then ,
And fiubborn as the metal, were the men.
Truth , modefty , and shame , the world forfook j
Fraud , avarice , and force , their places took ;
Then land-marks limited to each his right t
For a ll before was common as the light :
Nor was the ground alone requir'd to bear
Her annual income to the crooked share :
But greedy mortals , rummaging her 'flore ,
Dig'd from her entrails firfi the precious ore ;
Which next to hell the prudent gods had laid,
And that alluring ill to fight difplay'd :
And double death did wretched men invade
By ft eel ajfaulted, and by gold betray'd. •
Now brandish'd weapons g lut, ring in their hands,
Mankind is broken loofe from mortal bands.
No rights o f hofpitality remain i
The guefl, by him that liarbour'd him-, isfiain :
The fon-in laws purfues the father's Ufe ;
The wife her husband murthers , he the wife ;
The fiepdame poifon for the fon préparés ;
The fon enquires into his father's years :
Faith fiies , and Piety in exile mourns :
And jufiiee , here opprefs'd, to heav'n returns.
« L'âge de fer, digne de la race des mortels, vint
» à fuccéder ; alors la bonne-foi & la vérité bannies
» du monde, firent place à la violence, à la trahi-
» fon, à l’infatiable avarice : rien ne refta de com-
» mun parmi les hommes que l’ufage de la lumière,
» qu’ils ne purent fe ravir les uns aux autres. On
» fouilla dans les mines pour en tirer ces métaux,
» que la fageffe des dieux avoit enfouis près du Tar-
» t^re : l’or fervit à trahir, & le fer à porter la mort
» & le carnage. L’hofpitalité ne fut plus un afile af-
» furé ; la paix ne régna que rarement entre les fre-
» res ; les enfans comptèrent les années de leur pere ;
>> la cruelle marâtre employa le poifon ; le mari at-
» tenta fur la vie de fa femme, la femme fur celle de
« fon mari ; Aftrée tout en larmes abandonna le fé-
» jour de la terre, qu’elle vit couverte de fang ; &
» la Piété defolée fe retira dans le ciel ».
Je fens bien que j’affoiblis les images du poëte an-
glois, mais j’ai donné l ’original. Voulez-vous, peut-
être, quelque chofe de mieux encore ? voyei la peinture
qu’Héfiode a faite de cet âge de fer dans fon poë-
me intitulé, Opéra & Dies. Je ne dis rien de la peinture
d’Ovide (Métamorpli. lib. I .) ; elle eft connue
de tout le monde, & il femble s’y être furpafle lui-
même. Article de M. le Chevalier D E J A U CO U R T .
Fer d’o r , {Chevalier dit) Hifi. mod. Les chevaliers
du fer d'or & écuyers du fer d’argent ( car ils
réuniffoient ces deux titres), étoient une fociété de
feize gentilshommes, en partie chevaliers, ôc en partie
écuyers.
Cette fociété fut établie dans l’églife de Notre-
Dame de Paris en 1414, par Jean duc de Bourbon,
qui s’y propofa, comme il le dit lui-même, d’acquérir
de la gloire & les bonnes grâces d’une dame qu’il
fervoirt Ceux qui entrèrent dans cette fociété, fe
propoferent aufli de fe rendre par - là recommandables
à leurs maîtreffes. On ne fauroit concevoir un
plan plus extravagant d’aftions de piété & de fureur
romanefque, que celui qui fut imaginé par le'duc de
Bourbon.
Les chevaliers de fa fociété dévoient porter, auflî
bien que lu i, à la jambe gauche, un fer d'or de pri-
fonnier pendant à une chaîne ; les écuyers en dévoient
porter un femblable d’argent. Le duc de Bourbon
eut foin d’unir étroitement tous les membres de
fon ordre ; & pour cet effet il leur fit promettre de
l’accompagner, dans deux ans au plûtard, en Angleterre
, pour s’y battre en l’honneur de leurs dames ,
armés de haches, de lances, d’épées, de poignards,
ou même de bâtons, au choix des adverfaires. Ils
s’obligèrent pareillement de faire peindre'leurs armes
dans la chapelle où ils firent ce voeu , qui eft la
chapelle de Notre-Dame de G râce, & d’y mettre un
fer fo r femblable à celui qu’ils portoient, avec la
feule différence qu’il feroit fait en chandelier, pour
y brûler continuellement un cierge allumé jufqu’au
jour du combat.
Ils réglèrent encore qu’il y auroit tous les jours
une meffe en l’honneur de la Vierge, & que s’ils re-
venoient v iâorieux, chacun d’eux fonderoit une fécondé
meffe, feroit brûler un cierge à perpétuité,
& de plus fe feroit repréfenter revêtu de fa cotte
d’armes, avec toutes fes armes de combattant ; que
fi par malheur quelqu’un d’eux étoit tué, chacun des
furvivans, outre un fervice digne du mort, lui feroit
dire dix-fept meffes, où il aflifteroit en habit de
deuil. Cette
Cette fociété- pour comble d’extravagance ; fut
inftituée au nom de la fainte Trinité & de faint Mich
el, & elle eut le fuccès qu’elle méritoit. Le duc de
Bourbon alla véritablement en Angleterre, à-peu-
près dans le tems qu’il avoit marqué ; mais il y alla
en qualité de prifonnier de guerre, & il y mourut au
bout de 19 ans fans avoir pu obtenir fa liberté, Foy.
ii vous êtes curieux de plus grands détails, l'hifioire
des ordres de chevalerie du P. Héliot, tom. V III. ch. y.
c ’efbà-dire le recueil des folies de l’efprit humain en
ce genre bifarre, depuis l’origine du Chriftianifme
jufqu’au commencement de notre fiecle. Article de
M. le Chevalitr D E J a u c o v r t .
F e r , en termes.de Blafon, fe d it d e p lu fie u r s fo r t
e s d e fers d o n t o n c h a r g e le s é c u s , te ls q u e fo n t le s
fers d e lam e , d e j a v e l o t , d e p iq u e , d e f l é c h é , & de
c h e v a l : ce s d e rn ie r s fo n t o rd in a ir em e n t r ep r é fen té s
l a p in c e e n-haut.; & lo r fq u e le s p la c e s d e s c lo u s fo n t
d ’u n e c o u le u r o u d’ un m é ta l d iffé r en s , o n le s b la fo n -
n e c lo u é s . Foye^ C l o u é . Mènétr. & Trév.
F e r DE f o u r c h e t t e , Croix a fer de fourchette ,
(Blafon.') eft une croix qui a à chacune de fes extrémités
un fer recourbé, tel que celui dont les (pldats
fe fervent ordinairement pour attacher leurs mouf-
quets. Elle différé de la croix fourchée, en ce que les
extrémités de celle-ci font recourbées en tournant ;
au lieu que dans la première, la fourchette eft placée
au quarré de l’extrémité. Voyeç-en la figure dans les
Planches herald, ou du Blafon , fig. 20.
Fe r d e m o u l i n , e ft u n e p ie c e q u i e n t re dans le
'Blafon, & q u ’ o n fu p p o fe r ep r é fen te r l ’a n c r e d e fer
q u i fo û t ie n t la m e u le d ’ u n m o u lin ; i l e ft r ep r é fen té
d an s les Plane, herald.
F e r , (L'île de) Géog. Vile de Fer, autrement Fer-
ro , ou comme les Efpagnols à qui elle appartient la
nomment, la ijla de Hierro, eft une île d’Afrique la
plus occidentale des Canaries, d’environ fept lieues
de long, fix de large, & vingt-deux de tour. Elle n’eft
guère remarquable que parce que les géographes
irançois placent leur premier méridien à l’extrémité
occidentale de cette île , par ordonnance de Louis
XIII. Les Hollandois placent le leur d’ordinaire au
pié de l’île Ténériffe, l’une des Canaries. Le P. Ric-
cioli met le fien à l’île de Palma : il eft fâcheux qu’on
fie foit pas généralement convenu de prendre le même
méridien, quoiqu’on remédie à cette diverfité
par une conciliation des divers méridiens. Faye^ M é r
i d i e n . Vile de Fer eft à environ dix-huit lieues de
Ténériffe. Sa différence du méridien de Paris, eft,
fuivant M. Caflini, 1 heu. 19' 26". Sa latitude 27d.
a 'f S B
F e r a c h e v a l , (Architecî.) terraffe circulaire à
deux rampes en pente douce, comme celles du bout
du jardin du palais des Tuileries, & du parterre de
Latone à Verfailles : toutes deux du deffein de M. le
Nôtre. (P )
F e r a c h e v a l , (Fortifie.) c ’ e f t d an s la F o r t i f ic
a t io n u n o u v r a g e d e fig u r e a - p e u - p r è s ro n d e o u
o v a l e , fo rm é d ’ u n rem p a r t & d’ un p a r a p e t , q u ’o n
c o n f t ru i t q u e lq u e fo is d an s le s e n v ir o n s d ’u n e p la c e
d e g u e r r e , p o u r en em p ê ch e r l ’a c c è s à l ’en n em i.
La figure de ces fortes d’ouvrages n’eft point déterminée.
On en conftruit aufli dans les places maritimes
, à l’extrémité des* jettées, ou dans les lieux où
ils peuvent fervir à défendre l’entrée du port aux
yaifleaux ennemis. (Q )
F e r , ( Marine. ) on le fert de ce mot pour figni-v
fier grapin ou ériffon. Il n’eft guère en ufage que fur
les galeres, où l’on dit être fur le fer, pour dire être à
l'ancre. (Z )
F e r s d ’ a r c - b o u t a n s , ou B o u t e d e h o r s ,
(Marine.) ce font des fers à trois pointes, qu’on met
jfiu bout d’un arc-boutant avec un piton à grille. (Z )
F e r d e c h a n c e l i e r d e p i e r r i e r ., (Marine.)
fomt VI,
c’eft une bande dtfer qüi eft troiiéé par le haut, 66
que l’on applique fur un chandelier de bois, par où
paffe le pivot du chandelier àt fer, fur lequel le pierrier
tourne. (Z )
Fer de p ir o u e t te , ( Marine. ) c’eft uhe vergé
de fer qu’on met au bout du plus haut mât, où la
girouette eft paflee. (Z )
Fer , (Maréch.) on appelle de ce nom en général
l’efpece de femelle que l’on fixe par clous fous le pie
du cheval, du mulet, &c. à l’effet çl’en défendre l’ongle
de i’ufuré & de la deftruftion, à laquelle il feroit
expofé fans cette préeàutioni
Communément cette femelle eft formée par une
bande de ce métal. Cétte bande applatie & plus ou
moins large, eft courbée fur fon épaiffeur, de maniéré
qu’elle repréfente un croiffant alongé.
On peut y confidérer deiix faces & plufieurs parties.
La face inférieure’porte & repofe directement
fur le terrein. La face fupérieur'e touche immedia-,
tement le deffous du fabot, dont -le fer fuit exactement
le contour. La voûte eft le champ compris entre
la rive extérieure & la rive intérieure ,. à l’endroit
où la courbure du fer eft le. plus fenfible. On
nomme ainfi cette partie, parce qu’ordinairement le
fer eft dans ce même lieu relevé plus ou moins en bateau.
La pince répond précifément à la pince du pié ;
les branches aux mammelles ou aux quartiers, elles,
régnent depuis la voûte julqu’aux éponges ; les éponges
répondent aux talons, & font proprement les.
extrémités de chaque branche ; enfin les trous dont
le fer eft percé pour livrer paffage aux clous, & pour
en noyer en partie la tête, font ce que nous appelions
êtampures. Ces trous nous indiquent le pié auquel le
fer eft deftiné ; les êtampures d’un fer de devant étant
placées en pince, & celles d’un fer de derrière en talon,
& ces mêmes êtampures étant toûjoursplus maigres
ou plus rapprochées du bord extérieur éixfir,
dans la branche qui doit garantir & couvrir le quartier
de dedans.
Il feroit inutile de fixer & d’afligner ici des proportions
, relativement à la conftruCtion de chacune des
parties que je viens de défigner ; elles varient & doivent
varier dans leur longueur, dans leur épaiffeur,--
& dans leur contour, félon la difpofition Sc la forme
des différens piés auxquels le fer doit être adapté i
j’obferverai donc Amplement & en général, qu’il doit
être façonné de telle forte, que la largeur des branches
décroiffe toûjours inlenfiblement jufqu’aux
éponges ; que la face intérieure d’épaiffeur diminue
imperceptiblement de hauteur, depuis une éponge
jufqu’à l’autre ; que la face extérieure s’accorde en
hauteur avec elle à ces mêmes éponges, & dans
tout le contour du fe r, excepté la pince , où on lui en
donne communément un peu plus ; que la face fupé--
rieure foit legerement concave, à commencer depuis
la première étampure jùfqü’à celle qui dans l’autre
branche répond à celle-ci ; que la face inférieure
de chaque branche refte dans le même plan ; que la
partie antérieure du fer foit foiblement relevée en bateau
; que les éponges foient proportionnées au pié
par leur longueur , &c.
Quant aux différentes efpèces de fer, il en eft une
multitude, & on peut les multiplier encore relativement
aux différens befoins des piés des chevaux , ÔC
même des défeétuofités de leurs membres; mais je
me contenterai de décrire ici celles qui font les plus
connues, & dont l’ufage eft le plu.» familier.' .
Fer ordinaire de devant, de derrière, du pié gauche &
du pié droit. Le fer ordinaire n’éft autre chofe que celui
dont l’ajufture eft telle que je l’ai preferit ci-def-
fus ; & ce que j’ai dit plus haut de l’étampure, fuflit
pour déterminer le pié pour lequel il a été forgé.
Ftr couvert. On entend' par couvert3 celui qui p^r
S s«