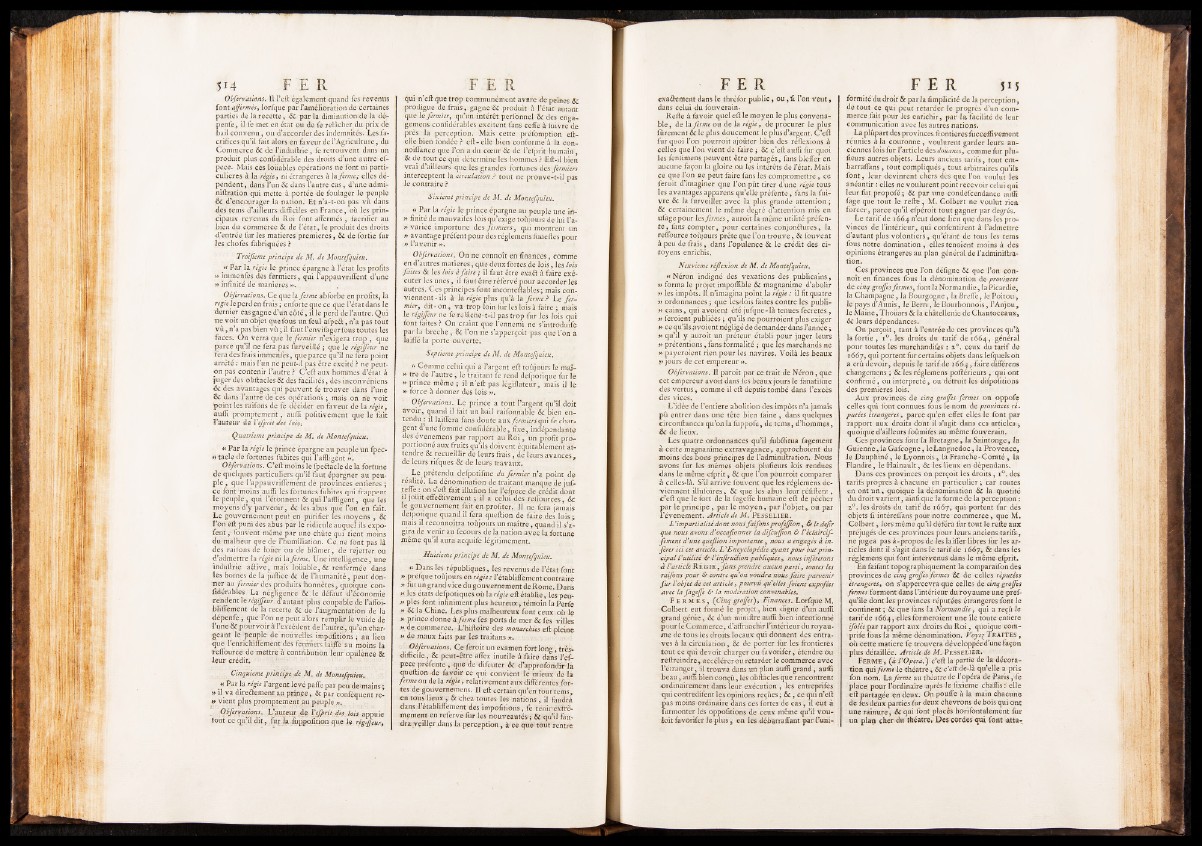
Obfervations. Il l’eft également quand fes revenus
font affermés, lorfque par l’amélioration de certaines
parties de la recette, 8c par la diminutiomde la dé-
penfe, il fe met en état ou de fe relâcher, du prix de
bail convenu, ou d’accorder des indemnités. Les fa-
crifices qu’il fait alors en faveur de l'Agriculture, du
Comnjçrçe 8c de l’induftrie, fe retrouvent dans un
produit plus confidérable des droits d’une autre ef-
pece. Mais ces loüables opérations ne font ni particulières
à la régie, ni étrangères à la ferme; elles dépendent,
dans l’un 8c dans l’autre cas, d’une admi-
niftration qui mette à portée de foulager le peuple
8c d'encourager la nation. Et. n’a-t-on pas vu dans
des tems d’ailleurs difficiles.en France, où les principaux
revenus du Roi font affermés , facrifier au
bien du commerce & de l ’état, le produit des droits
d’entrée, fur les matières premières, 8c de fortie fur
les chofes fabriquées ?
Troijîeme principe de M. de Montefquieu.
« Par la régie le prince épargne à l’état les profits
>> immerifés des fermiers, qui Pappauvrillent d’une
» infinité de maniérés'»./..
Obfervations. Ce que la ferme abforbe en profits, la
rtgie le perd en frais ; enforte que ce que l’état dans le
dernier cas gagne d’un côté, il le perd de l’autre. Qui
me voit un objet que fous un feul afpéft, n’a pas tout
v î i , n’a pas bien vu ; il faut l’envifager fous toutes les
faces. On verra que le fermier n’exigera trop , que
parce qu’il ne fera pas furveillé ; que le régiffeur ne
fera des frais immerifes, que parce qu’il ne fera point
arrêté : mais l’un ne peut-il pas être excité ? ne peut-
on pas contenir l’autre ? C ’eft aux hommes d’état à
juger des obftacles 8c des facilités, des inconvéniens
8c des avantages qui peuvent fe trouver dans l’une
8c dans l ’autre de ces opérations ; mais on ne voit
point les raifons de fe décider en faveur de la régie,
auffi promptement, aufli pofitivement que le fait
l ’auteur de Yefprit des lois.
Quatrième principe de M. de Montefquieu.
« Par la régie le prince épargne au peuple un fpec-
»> tacle de fortunes fubjtes qui l’affligent ».
Obfervations. C’eft moins le fpeâade de la fortune
de quelques particuliers qu’il faut épargner au peuple
, que l ’appauvriffement dé provinces entières ;
ce font moins auffi les fortunes fubites qui frappent
le peuple, qui l’étonnent & qui l’affligent, que les
moyens d’y parvenir, 8c les abus que l’on en fait.
Le gouvernement peut en purifier les moyens , 8c
l’on èft puni des abus par le ridicule auquel ils expo-
fent ,• fouvent même par une chute qui tient moins
du malheur que de l’humiliation. Ce. rie font pas là
des raifons de louer ou de blâmer, de rejetter ou
d’admettre la régie ni la ferme. Une intelligence, une
indiiftrie a â iv e , mais loiiable, 8c renfermée dans
les bornes de la juftice 8c de l’humanité, peut don-
mer au fermier des produits honnêtes, quoique con-
iidérables La négligence 8c. le défaut d’économie
rendent le régiffeur- d’autârit plus coupable de l’affoi-
bliffement de la recette 8c de l’augmentation de la
depenfe, que l’on ne peut alors remplir le vuide de
l’une 8c pourvoir à l’excédent de l’autre, qu’en.char-
geant lé peuple de’ nouvelles irnpdfmons ; au lieu
que l’enrichiffement' dès fermiers laijflfe:au moins la
reffource de mettre à contribution leur opulence 8c
leur crédité
Cinquième principe de M. de Montefquieu.
« Par la régie l’argent levé paffe par peu demains ;
» il va dire&ement au prince-, 8ç par conféquent re-
» vient plus promptement au peuple », . . .
- 'QtyïïfP*°.ns' -de Y efprit,.fes. lois, appuie
tout ce qu’il dit, fur la .fuppofition que le régiffeur,
qui n’eft que trop communément avare de peines 8c
prodigue de frais , gagne'8c produit à l’état autant
que le fermier, qu’un intérêt perfonnel 8c des enga-
gemens confidérables excitent fans ceffe à iiiivre de
près la perception» Mais cette préfomption eft-
elle bien fondée ? eft-elle bien conforme à la con-
noiflance que l’on a du coeur 8c de l’efprit humain ,
8c de tout ce qui détermine les hommes ? Eft-il bien
vrai d’ailleurs que les grandes fortunes des fermiers
interceptent la circulation ? tout ne prouve-t-il pas
le contraire ?
Sixième principe de M. de Montefquieu.
s « Par la régie le prince épargne au peuple tine iri-
» finité de mauvaifes lois qu’exige toûjours de lui l’a-
» varice importune des fermiers, qui montrent un
» avantage préfent pour des réglemeris funeftes pour
» l’avenir ».
Obfervations. On ne connoît en financés, comme
en d’autres matières, que deux fortes de lois, les lois
faites 8c les lois à faire ; il faut être exaû à faire exécuter
les unes, il faut être réfervé pour accorder les
autres. Ces principes font inconteftables; mais conviennent
- ils à la régie plus qu’à la ferme ? Le fermier
> dit-on, va trop loin fur les lois à faire ; mais
le régiffeur ne fe relâche-t-il pas trop fur lés lois qui
font faites ? On craint que l’ennemi ne s’introduife
par la breche, 8c l’on ne s’apperçoit pas que l’on a
laiffé la porte ouverte.
Septième principe de M. de Montefquieu.
« Comme celui qui a l’argent eft toûjours le maî-
» tre de l’autre, le traitant fe rend defpoîique fur lé
» prince même il n’eft pas légiflateur, mais il le
» forcé à donner des lois ».
Obfervations. Le prince a tout l’argent qu’il doit
avoir, quand il fait un bail raifonnable 8c bien entendu
: il laiffera fans doute aux fermiers qui fe chargent^
d’une fomme confidérable, fixe, indépendante
des évenemens par rapport au Roi, un profit proportionné
aux fruits qu’ils doivent équitablement attendre
8c recueillir de leurs frais, de leurs avances,
de leurs rifques 8c de leurs travaux,
g Le prétendu defpotifme du fermier n’a point de
réalité. La dénomination de traitant manque de juf-
î efie: on s’eft fait illufion fur l’efpece de crédit dont
il joiiit effe&ivement pii a celui des reffources, 8c
le gouvernement fait en. profiter. Il ne fera jamais
dëipotique quand il fera queftion de faire des lois ;
mais il reconnoîtra toûjours un maître, quand il s’agira
de venir au fe cours de la nation avec la fortune
même qu’il aura acquife légitimement.
Huitième principe de M. de Montefquieu.
« Dans les républiques, les revenus.de l’état font
» préfque toûjours en régie: l’établiffement contraire
>> fut un grand vice du gouvernement de Rome. Dans
» les états defpotiques oii la régie eft établie, les peu*.
» pies font infiniment plus heureux , témoin la Perfe
» 8c la Chine. Les plus malheureux font Ceux où le
# prince donne à,ferme fes ports de mer 8c fes villes
»/de commerce. L’hiftoire des monarchies eft pleine
» de inaux faits par les traitans »;. g
■ J- Obfervations. Ce feroit un examen fort long, très-
difficile , 8c peut-être affez inutile à faire dans Tef-
pece préfente , que de difeuter 8c d’approfondir la
queftion -de favoir ce qui convient le mieux de la
ferme ou de la régie, relati vement aux différentes for-
fes.de goüvernemens. Il eft certain qu’en tout tems,
en tatûs lieux chez toutes les nations , il faudrâ
dans, l’établiffement des impofitions, fe fénirexiVè-
mement en refervê fur les nOuveautéfcp & qu’il fau-
drayçiller dans la perception, à ce que‘ tout‘rentré
exaftemeflt dans le thréfor public, ou , f i l’on v eu t,
dans celui du fonverain.
Refte à favoir quel eft le moyen le plus convenable
, de la ferme ou de la régie, de procurer le plus
fûrement 8c le plus doucement le plus d’argent. C ’eft
fur quoi l’on pourroit ajoûter bien des réflexions , à
celles que l’on vient de faire ; 8c c ’eft auffi fur quoi
les fentimens peuvent être partagés, fans bleffer en
aucune façon la gloire ou les intérêts de l’état. Mais
ce que l’on ne peut faire fans les compromettre, ce
feroit d’imaginer que l’on pût tirer d’une régie tous
les avantages apparens qu’elle préfente, fans la fui-
vre 8c la lurveiller avec la plus grande attention ;
8c certainement le même degré d’attention mis en
ufage pour les fermés, auroit la même utilité préfente
, fans compter, pour certaines conjonûures, la
reffource toûjours prête que l’on trouve, 8c fouvent
à peu de frais, dans l’opulence 8c le crédit des citoyens
enrichis.
Neuvième réflexion de M. dt Montefquieu.
« Néron indigné des vexations des publicains,
» forma le projet impoffible 8c magnanime d’abolir
» les impôts. Il n’imagina point la régie : il fit quatre
» ordonnances j que lesdois faites contre les publi-
» cains, qui avoient été jufque-là tenues fecretes ,
» feroient publiées ; qu’ils ne pourroient plus exiger
» ce qu’ils avoient négligé de demander dans l’année ;
» qu’il y auroit un préteur établi pour juger leurs
» prétentions, fans formalité ; que les marchands ne
» payeroient rien pour les navires. Voilà les beaux
?> jours de cet empereur ».
Obfervations. Il paroît par ce trait de Néron, que
cet empereur avoit dans les beaux jours le fanatiime
des vertus, comme il eft depuis tombé dans l’excès
des vices.
L ’idée de l’entiere abolition des. impôts n’a jamais
pû entrer dans une tête bien faine , dans quelques
circonftances qu’on la fuppofe, de tems, d’hommes,
8c de lieux.
Les quatre ordonnances qu’il fubftitua fagement
à cette magnanime extravagance, approchoient du
moins des bons principes de l’adminiftration. Nous
avons fur les mêmes objets plufieurs lois rendues
dans le même efprit, 8c que l’on pourroit comparer
à celles-là. S’il arrive fouvent que les réglemens deviennent
illufoires, 8t que les abus leur réfiftent,
c ’eft que le fort de la fageffe humaine eft de pécher
par le principe, par le m oyen, par l’objet, ou par
î ’évenement. Article de M. PESSELIER.
L'impartialité dont nousfaifons profjjion, & le dejir
que nous avons d'occajionner la difcujjion & Véclaircif-
fement d'une quefiion importante , nous a engagés à inférer
ici cet article. L'Encyclopédie ayant pour but principal
l'utilité & l'inftruction publiques , nous inférerons
à l'article RÉGIE r funs prendre aucun parti, toutes les
raifons pour & contre qu'on voudra nous faire parvenir
fur l'objet de cet article, pourvu qu'elles foient expofées
avec la fageffe & la modération convenables.
F e r m e s , (Cinq groffes'), Finances. Lorfque M.
Colbert eut formé le projet., bien digne d’un auffi
grand génie, 8c d’un miniftre auffi bien intentionné
pour le Commerce, d’affranchir l’intérieur du royaume
de tousiles droits locaux qui donnent des entraves
à la circulation,' 8c de porter fur les frontières
tout ce qui devoit charger ou favorifer, étendre ou
reftreindre, accélérer ou retarder le commerce avec
l ’étranger, il trouva dans ;un plan auffi grand, auffi
beau, auffi bien conçû, les obftàcles que rencontrent
-ordinairement dans leur exécution , les entreprifes
qui contredirent les opinions reçûes ; 8c, ce qui n’eft
pas moins ordinaire dans ces fortes de ca s, il eut à
iurmonter le's oppofitions de ceux même qu’il vou-
loit favorifer le plus a en les dëbarraffant par l’unifôrmité’dudroit
8t parla fimplicité de la perception,
de tout ce qui peut retarder le progrès d’un commerce
fait pour les enrichir, par la facilité de leur
communication avec'les autres nations.
ILa plupart des provinces frontières fucceffivement
reunies à la couronne , voulurent garder leurs anciennes
lois fur l’article des douanes, comme fur plufieurs
autres objets. Leurs anciens tarifs, tout em-
barraffans , tout compliqués, tout arbitraires qu’il*
fon t, leur devinrent chers dès que l’on voulut les
anéantir : elles ne voulurent point recevoir celui qui
leur fut propofé ; 8c par une condefcendance auffi
fage que tout le refte , M. Colbert ne voulut rien
forcer, parce qu’il efpéroit tout gagner par degrés.
Le tarif de 1664 n’eut donc lieu que dans les provinces
de l’intérieur, qui confentirent à l’admettre
d’autant plus volontiers, qu’étant de tous les tems
fous notre domination , elles tenoient moins à des
opinions étrangères au plan général de l’adminiftration.
Ces provinces que l’on défigne 8c que l’on connoît
en finances fous la dénomination de provinces
de cinq groffes fermes, font la Normandie, la Picardie,
la Champagne, la Bourgogne, la Breffe, le Poitou',
le pays d’Aunis, le Berri, le Bourbonnois, l’Anjou,
le Maine, Thoiiars & la châtellenie de Chantoceaux,
8c leurs dépendances.
On perçoit, tant à l’entrée de ces provinces qu’à
la fortie, i° . les droits du tarif de 1664, général
pour toutes les marchandifes : 20. ceux du tarif de
1667, portent fur certains objets dans lefquels on
a crû devoir, depuis le tarif de 1664, faire différens
changemens ; 8c les réglemens poftérieurs , qui ont
confirmé, ou interprété, ou détruit les difpofitions
des premières lois.
Aux provinces de cinq groffes fermes on oppofe
celles qui font connues fous le nom de provinces ré.
putées étrangères, parce qu’en effet elles le font par
rapport aux droits dont il s’agit dans ces articles.,
quoique d’ailleurs foûmifes au même fouverain.
Ces provinces font la Bretagne, la Saintonge, la
Guienne, la Gafcogne, le Languedoc, la Provence,
le Dauphiné, le Lyonnois, la F ranche-Comté , la
Flandre, le Hainault, 8c les lieux en dépendans.
Dans ces provinces on perçoit les droits, i° . des
tarifs propres à chacune en particulier ; ca-r toutes
en ont u n , quoique la dénomination 8c la quotité
du droit varient, ainfi que la forme de la perception :
20. les droits du tarif de 1667, qui portent fur dés
objets fi intéreffans pour notre commerce, que M.
Colbert, lors même qu’il déféra fur tout le refte aux
préjugés de ces provinces pour leurs anciens tarifs,
ne jugea pas à-propos de les laiffer libres fur les articles
dont il s’agit dans le tarif de 1667, & dans les
réglemens qui font intervenus dans le même efprit.
En faifant topographiquement la comparaifon des
provinces de cinq groffes fermes 8c de celles réputées
étrangères, on s’appercevra que celles de cinq groffes
fermes forment dans l’intérieur du royaume une pref-
qu’île dont les provinces réputées étrangères font le
continent ; 8c que fans la Normandie, qui a reçu le
tarifée 1664, elles formeroient une île toute entière
, ifolée par rapport aux droits du R o i, quoique com-
prifefous la même dénomination. Voye{ T r a it e s ,
où cette matière fe trouvera développée d’une façon
plus détaillée. Article de M. P e s s e l i e r .
Fe rm e , (à l'Opera.) c’eft la partie de la décoration
qui ferme le théâtre, 8c c ’eft de-là qu’elle a pris
fon nom. La ferme au théâtre de l’opera de Paris , fe
place pour l’Ordinaire après le fixieme chaffis : elle
eft partagée en deux. On pouffe à la main chacune
de lès deux parties fur deux chevrons de bois qui ont
une rainure, 8c qui font placés horifontalement fur
un plan cher du théâtre, Des cordes qui font atta