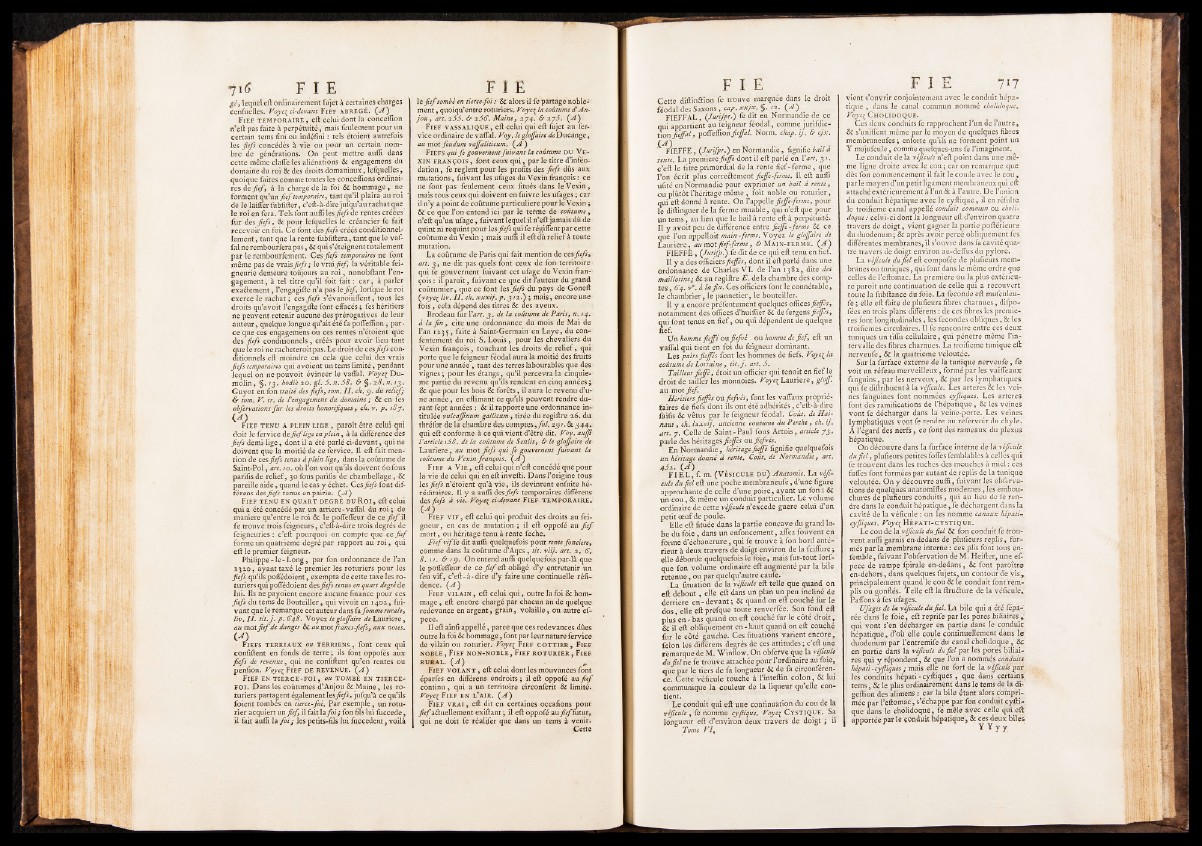
gé, l e q u e l e f t o r d in a i r e m e n t f u j e t à c e r t a in e s c h a r g e s
c e n f u e l l e s . Voyt{ ci-devant F i e f a b r é g é . ( ^ )
F i e f t e m p o r a i r e , e f t C e lu i d o n t l a c o n c e l î i o n
n ’ e f t p a s f a i t e à p e r p é t u i t é , m a is f e u l em e n t p o u r u n
c e r t a i n t em s f in i o u in d é f i n i : t e l s é t o i e n t a u t r e f o i s
les fiefs concédés à vie ou pour un certain nombre
de générations. On peut mettre aufii dans
cette même claffe les aliénations & engagemens du
domaine du roi & des droits domaniaux, lefquelles ,
quoique faites comme toutes les concefîions ordinaires
de fief> à la charge de la foi & hommage, ne
forment qu’un fie f temporaire, tant qu’il plaira au roi
de le laitier fubfifter, c’eft-à-dire jufqu’au rachat cjue
le roi en fera. Tels font aufii les fiefs de rentes créées
fur des fiefs, & pour lefquelles le créancier fe fait
recevoir en foi. Ce font des fiefs créés conditionnel-1
lement, tant que la rente fubfiftera, tant que le vaf-
fal ne rembourfera pas, & qui s’éteignent totalement
par le rembourfement. Ces fiefs temporaires ne font
même pas de vrais fiefs; le vrai fief, la véritable fei-
gneurie demeure toujours au ro i, nonobftant l’engagement
, à tel titre qu’il foit fait : ca r, à parler
exactement, l’engagifte n’a pas le fief, lorfque le roi
exerce le rachat; ces fiefs s’évanoiiiffent, tous lès
droits qu’a voit l’engagifte font effacés ; fes héritiers
ne peuvent retenir aucune des prérogatives de leur
auteur, quelque longue qu’ait été fa pofleflion, par-
ce que ces engagemens ou ces rentes n’étoient que
des fiefs conditionnels, créés pour avoir lieu tant
que le roi ne racheteroitpas. Le droit de ces fiefs conditionnels
eft moindre en cela que celui des vrais
fiefs temporaires qui a voient un tems limité, pendant
lequel on ne pouvoit évincer le vaflal. Voye^ D u-
molin, § . i3 . hodiè 20. gl. 5.n .58. & § . z8. n. 13.
Guyot en fon traité des fiefs, tom. I I . ch. (). dit relief;
& tom. V. tr. de rengagement du domaine ; & en fes
obfervations fur les droits honorifiques, ch. v. p. 18y. Bsa! mm H
F i e f t e n u a p l e i n l i g e , paroit etre celui qui
doit le fervice de fieflige en plein, à la différence des
fiefs demi-lige, dont il a été parlé ci-devant, qui ne
doivent que la moitié de ce fervice. Il eft fait mention
de ces fiefs tenus à plein lige, dans la coutume de
Saint-Pol, art. 10. où l’on voit qu’ils doivent 60fous
parifis de relief, 30 fous parifis de chambellage, &
pareille aide, quand le cas y échet. Ces fiefs font différens
des fiefs tenus en pairie. (A")
F i e f t e n u e n q u a r t d e g r é d u Ro i , eft celui
qui a été concédé par un arriere-vaffal du roi ; de
maniéré qu’entre le roi & le poffeffeur de ce fie f il
fe trouve trois feigneufs, c’eft-à-dire trois degrés de
feigneuries : c’eft pourquoi on compte que ce fie f
forme un quatrième degré par rapport au ro i, qui
eft le premier feigneur.
Philippe - l e - Long, par fon ordonnance de l’an
1320, ayant taxé le premier les roturiers pour les
fiefs qu’ils poffédoient, exempta de cette taxe les roturiers
qui poffédoient des fiefs tenus en quart degré de
lui. Ils ne payoient encore aucune finance pour ces
fiefs du tems de Bouteiller, qui vivoit en 1402, fui-
vant que le remarque cet auteur dans fa fomme rurale,
liv. II. tit.j. p . G48. Voyez le gloffaire de Lauriere,
au mot fie f de danger & au mot francs-fiefs, aux notes. .00F i e f s t e r r i a u x ou t e r r i e n s , font ceux qui
confiftent en fonds de terre ; ils font oppofés aux
fiefs de revenue, qui ne confiftent qu’en rentes ou
penfion. Voye{ F i e f d e r e v e n u e . (A )
F i e f e n t i e r c e - f o i , ou t o m b é e n t i e r c e -
f o i . Dans les coûtumes d’Anjou & Maine, les roturiers
partaient également les fiefs, jufqu’à ce qu’ils
ioient tombes en tierce-foi. Par exemple, un roturier
acquiert un fief, il fait la fo i; fon fils lui fuccede,
il fait auifi la fo i; jes petits-fils lui fuccedent, voilà
lè fie f tombé en tierce-foi : & alors il fe partage noble*
ment, quoiqu’entre roturiers. Voye^ la coutume d'Anjo
u , art. z65. & %5G. Maine, 274. & zy5. {A')
Fief v a s sa l iq u e , eft celui qui eft fujet au fervice
ordinaire de vâffal. Voy. le gloffaire ^cDucange,
au mot feudum vaffaliticum. {A )
Fiefs qui fe gouvernent fuivant ta coutume DU V e-
Xin François , font ceux qui, par le titre d’inféodation
, fe règlent pouf les profits des fiefs dûs aux
mutations, fuivant les ufages du Vexin françois : ce
ne font pas feulement ceux fitués dans le V exin,
mais tous ceux qui doivent en fuivre les ufages ; car
il n’y a point de coutume particuliere pour le Vexin ;
& ce que l’on entend ici par le terme de coutume,
n’eft qu’un u fage, fuivant lequel il n’eft jamais dû de
quint ni requint pour les fiefs qui fe régiflent par cette
coûtume du Vexin ; mais aufii il eft dû relief à toute
mutation.
La coûtume de Paris qui fait mention de ces fiefs,
art. g , ne dit pas quels font ceux de fon territoire
qui fe gouvernent fuivant cet ufage du Vexin françois
: il paroît, fuivant ce que dit l’auteur du grand
coûtumier, que ce font les fiefs du pays de Goneft
(yoye{ liv. II. ch. xxxij. p. g /a.) ; mais , encore une
fois , cela dépend des titres & des aveux.
Brodeau fur Y art. 3 . de la coûtume de Paris, n. 14.
à la fin , cite une ordonnance du mois de Mai de
l’an 1235, faite à Saint-Germain en La ye, du con-
fentement du roi S. Louis, pour les chevaliers du
Vexin françois, touchant les droits de relief, qui
porte que le feigneur féodal aura la moitié des fruits
pour une année , tant des terres labourables que des
Vignes ; pour les étangs, qu’il percevra la cinquième
partie du revenu qu’ils rendent en cinq années ;
& que pour les bois & forêts, il aura le revenu d’une
année, en eftimant ce qu’ils peuvent rendre durant
fept années : & il rapporte une ordonnance in*>
titillée vulcajfinum gallicum, tirée du regiftre 26. du
thréfor de la chambre des comptes, fol. zg 1.81344.
qui eft conforme à ce qui vient d’être dit. Voy. aufiji-
l'article i58. de la coûtume de Sentis, & le gloffaire de-
Lauriere, au mot fiefs qui fe gouvernent fuivant la
coûtume du Vexin françois. (A )
Fief a V ie , eft celui qui n’eft concédé que pour
la v ie de celui qui en eft invefti. Dans l’origine tous
les fiefs n’étoient qu’à v ie , ils devinrent enfuite héréditaires.
Il y a aufii des fiefs temporaires différens
des fiefs à vie. Voye{ ci-dfvant Fief TEMPORAIRE.
Wm n . . . ,
Fief v if , eft celui qui produit des droits au feigneur,
en cas de mutation ; il eft oppofé au fie f
mort, ou héritage tenu à rente feche.
Fief vifie dit aufii quelquefois pour rente foncière,
comme dans la coûtume d’Aqcs, tit. viij. art. z . G.
8. n . & ig . On entend aufii quelquefois par-là que
le poffeffeur de ce fie f eft. obligé d’y entretenir un
feu v if , c’eft-à-dire d’y faire une continuelle réfi-
dence. (A )
Fief vilain , eft celui qui, outre la foi & hommage
, eft encore chargé par chacun an de quelque
redevance en argent, grain, volaille, ou autre ef-
pece.
Il eft ainfi appelle, parce que ces redevances dûes
outre la foi & hommage, font par leur nature fervice
de vilain ou roturier. Voye^ Fief c o t t ie r , Fief
noble , Fief non-noble , Fief ro tu rier , Fief
RURAL. (A } „
Fief vo la n t , eft celui dont les mouvances font
éparfes en différens endroits ; il eft oppofé au fief
continu, qui a un territoire circonfcrit & limité.
Voyei Fief en l’air. ( A )
Fief vrai , eft dit en certaines occafions pour
fie f aûuellement exiftant ; il eft oppofé au fie f futur,
qui ne doit fe réalifer que dans un tems à venir.
Cette
Cette diftmaion fe trouv.e marquée dans le droit
féodal des Saxon s , caj>..xxjx. § . iz . ( J )
F I E F F A L , ( Jurifpr.) fe dit en Normandie de ce
qui appartient au leigneur féodal, comme jurifdic-
tion fieffal, pofleflion fieffal. Norm. chap.ij. & cjx.
\a )
FIEFFE, ([furijpr. ) en Normandie, fignifie bail a
rente. La premier e fieffe dont il eft parlé en Y art. 31.
c ’eft le titre primordial de la.rènte fief-ferme, que
l’on écrit plus corre&ement fieffe-ferme. Il eft aufii
ûfité en Normandie pour exprimer un bail à rente,
ou plûtôt l’héritage même , l’oit noble ou roturier ,
qui eft donné à rente. On l’appelle fieffe-ferme, pour
le diftinguer de la ferme muable, qui n’eft que pour
un tems, au lieu que le bail à rente eft à perpétuité.
Il y avoit peu de différence entre fieffe-ferme & ce
que l’on appelloit main-ferme. Voyez le gloffaire de
Lauriere, au mot fief-ferme, & Main-ferme. ([A )
FIEFFÉ, ( Jurifpl) le dit de ce qui eft tenu en fief.
Il y a des ofiiciers fieffés, dont il eft parlé dans une
ordonnance de Charles V I . de l’an 1382, dite des
maillotins; & au regiftre E. de la chambre des comptes
, G4. v°. à la fin. Ces ofiiciers font le connétable,
le chambrier, le pannetier, le bouteiller.
Il y a encore préfentement quelques offices fieffés,
notamment des offices d’huiflier & de fergens fieffés,
qui font tenus en f ie f, ou qui dépendent de quelque
nef. I
Un homme fieffé ou fiefvé. ou homme de fief, eft un
yaffal qui tient en foi du feigneur dominant.
Les pairs fieffés font les hommes de fiefs. Voye{ la
coûtume de Lorraine , t it .j. art.5. ; , •
Tailleur fieffé, étoit un officier qui tenoit en fief le
droit de tailler les monnoies. Voyei Lauriere, gloff.
au mot fief. . ,
Héritiers fieffés ou fiefvés, font les vaffaux proprietaires
de fiefs dont ils ont été adhérités, c’eft-à-dire
faifis & vêtus par le feigneur féodal. Coût, de Uni-
haut , ch. Ixxvij. ancienne coutume du Perche , ch. ij.
art. y. Celle de Saint-Paul fous Artois, article y3.
parle des héritages fieffés ou fiefvés.
' En Normandie, héritage fieffé fignifie quelquefois
un héritage donne à rente. Coût, de Normandie, art. 4-5z . (A ) .
F IE L , f. m. (VÉSICULE î>u) Anatomie. La vefi-
cule du fiel eft une poche membrarieufe, d’une figure
approchante de celle d’une poire , ayant un fond &
un cou, & même un conduit particulier. Le volume
ordinaire de cette vèficule n’excede guere celui d’un
petit oe uf de poule.
Elle eft fituée dans la partie concave du grand lobe
du fo ie , dans un enfoncement, affez fouvent en
formé d’échancrure, qui fe trouve à fon bord antérieur
à deux travers de doigt environ de la fciffure ;
elle déborde quelquefois le foie, mais fur-tout lorfque
fon volume ordinaire eft augmenté par la bile
retenue, ou par quelqu’autre caul'e.
La fituation de la véficuleeft telle que quand on
eft debout, elle eft dans un plan un peu incliné de
derrière en-devant ; & quand on eft couché fur le
dos, elle eft prefque toute renverfée. Son fond eft
plus* en - bas qùand on eft couché fur le côté droit,
& il eft obliquement en-haut quand on eft couché
fur le côté gauche. Ces fituations varient encore,
félon les différens degrés de ces attitudes ; c’eft une
remarque de M. Winflow. On obferve que la vèficule '
du fiel ne fe trouve attachée pour l’ordinaire au foie1,
que par le tiers de fa longueur & de fa circonférence.
Cette vèficule touche à l’inteftin colon, & lui
communique la couleur de la. liqueur qu’elle contient.
Le conduit qui eft une continuation du cou de la
vèficule , fe nomme cyfiique. Voye[ C y s t iq u e . Sa
longueur eft d’environ deux travers de doigt ; il
Tome VIA
vient s’ouvrir conjointement avec le conduit hépatique
, dans le canal commun nommé cholidoque.
Voye^ C holidoque.
Ces deux conduits fe rapprochent l ’un de l’autre,
& s’uniffent même par le moyen de quelques fibres
membraneufes ; enforte qu’ils ne forment point un
Y majufcule, comme quelques-uns fe l’imaginent.
Le conduit de la vèficule n’eft point dans une même
ligne droite avec le cou ; car on remarque que
dès fon commencement il fait le coude avec le cou,
parle moyen d’un petit ligament membraneux qui eft
attaché extérieurement à l’un & à l’autre. De l’union
du conduit hépatique avec le cyftique, il en réfulte
le troifieme canal appellé conduit commun ou cholidoque
: celui-ci dont la longueur eft d’environ quatre
travers de doigt, vient gagner la partie poftérieure
du duodénum; & après avoir percé obliquement fes
différentes membranes, il s’ouvre dans fa cavité quatre
travers de doigt environ au-deffus du pylore.
La vèficule du fiel eft compofée de plufieurs membranes
ou tuniques, qui font dans le même ordre que
celles de l’eftomac. La première ou la plus extérieure
paroît une continuation de celle qui a recouvert
toute la fubftance du foie. La fécondé eft mufculeu-
fe ; elle eft faite de plufieurs fibres charnues, difpo-
fées en trois plans différens : de ces fibres les premières
font longitudinales, les fécondés obliques, & les
troifiemes circulaires. Il fe rencontre entre ces deux
tuniques un tiffu cellulaire, qui pénétré même l’intervalle
des fibres charnues. La troifieme tunique eft
nerveufe, & la quatrième veloutée.
Sur la furface externe de la tunique nerveufe, fe
voit un réfeau merveilleux, formé par les vaiffeaux
fanguins, par les nerveux, & par les lymphatiques
qui fe diftribuent à la vèficule. Les arteres & les veines
fanguines font nommées cyfiiqües. Les arteres
font des ramifications de l’hépatique, & les veines
vont fe décharger dans la veine-porte. Les veines
lymphatiques vont fe rendre au refervoir du chyle*
A l’égard des nerfs, ce font des rameaux du plexus
hépatique.
On découvre dans la furface interne de la vèficùle
du fie l, plufieurs petites foffes femblables à celles qui
fe trouvent dans les ruches des mouches à miel : ces
foffes font formées par autant de replis de la tunique
veloutée. On y découvre aufii, fuivant les obferva-
tions de quelques anatomiftes modernes, les embouchures
de plufieurs conduits, qui au lieu de fe rendre
dans le conduit hépatique, fe déchargent dans la
cavité de la vèficule : on les nomme canaux hèpati-
cyftiques. Voye[ H É P A T I -C Y S T IQ U E .
Le cou de la vèficule du fiel & fon conduit fe trouvent
aufii garnis en-dedans de plufieurs replis, for-
■ més par la membrane interne : ces plis font tous en-
femble, fuivant l ’obfervation de M. Heifter, une ef-
pece de rampe fpirale en-dedans, & font paroître
en-dehors, dans quelques fujets, un contour de y isr
principalement quand le cou & le conduit font remplis
ou gonflés. Telle eft la ftruéiure de la vèficule.
Paffons à fes ufages.
Ufages de la vèficule du fiel. La bile qui à été fépa-'.
rée dans le foie, eft reprife par les pores biliaires f
qui vont s’en décharger en partie dans le conduit
hépatique, d’où elle coule continuellement dans le
. duodénum par l’entremife du canal cholidoque, &
en partie dans la vèficule du fiel par les pores biliaires
qui y répondent, & que l’on a nommés conduits
hèpati - cyfiiqües ; mais elle ne fort de la vèficule par
les conduits hèpati - cyftiques , que dans certains
tems, & le plus ordinairement dans le tems de la di-
geftion des alimens : car la b ile étant alors comprimée
par l’eftomac, s’échappe par fon conduit cyftique
dans le cholidoque, fe mêle avec celle qui eft
apportée par le conduit hépatique, & ces deux biles