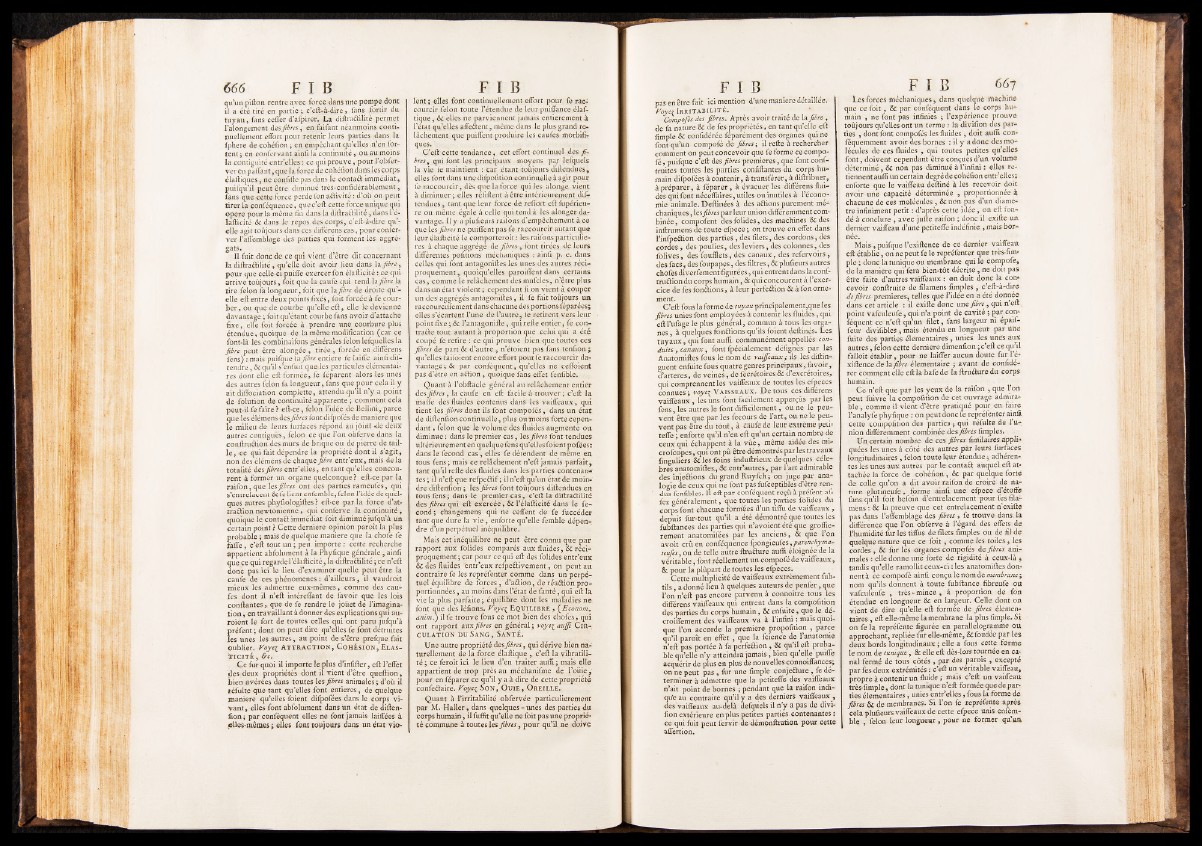
qu’un pifton rentre avec force dans une pompe dont
il a été tiré en partie ; c’eft-rà-dire>. fans ^brtir du
tuyau , fans ceffer d’afpirer-. La diftraéiilité permet
l’alongement des fibres, en faifant néanmoins continuellement
effort pour retenir leurs parties dans la
fphere de eohéfion ; en empêchant qu’elle^-.rt’en for-
tent; en confervant ainfi la continuité, pu au moins
la contiguïté entr’elles:■ ce qui prouve, pour l ’obfer-
Ver en paffant, que laforce de eohéfion dans les corps
élaftiques, ne confifte.pas dans le contaél immédiat,
puifqu’il peut être diminué très-confidérab.lement,
fans que cette force perde fon aélivité : d’oît on peut
tirer la conféquence, que c’eft cette force unique qui
opéré pour la même fin dans la diftraélilite, dans l’e-r
lafticité & dans le repos, des corps, c’eft-à-dire qu’elle
agit toûjours dans ces différens cas, pour confer-
ver l’afl'emblage des parties qui forment les aggré?
gats.
Il fuit donc de ce qui vient d’être dit concernant
la diftra&ilité, qu’elle doit avoir lieu dans la fibre,
pour que celle-ci puiffe exercer fon élafticité :ç e qui
arrive toûjours, (oit que la caufe qui tend la fibre la
tire félon l'a longueur, foit que la fibre de droite qu’elle
eft entre deux points fixés, foit forcée à fe courber,
ou que de courbe qu’elle eft, elle le devienne
davantage ; foit qu’étant courbe fans avoir d’attache
fixe, elle foit forcée à prendre une courbure plus
étendue, quoique de la même modification (car ce
font-là les combinaifons générales félon lefquelles la
fibre peut être alongée , tirée , forcée en différens
fens) : mais puifque la fibre entière fe laiffé ainfi distendre
, & qu’il s’enfuit quelles particules élémentaires
dont elle eft formée, fe féparent alors les unes
des autres félon fa longueur, fans que pour cela il y
ait diffociation complette, attendu qu’il n’y a point
de folution de continuité apparente ; comment cela
peut-il fe faire ? eft-ce, félon l’idée de Bellini., parce
que les élémens des fibres font difpofés de maniéré que
le milieu de leurs furfaces répond au joint -de deux
autres contiguës, félon ce que l’on obferve dans. la
eonftruftion des murs de brique ou de pierre de taille
, ce qui fait dépendre la propriété dont il s’agit»
non des éléméns de chaque fibre entr’eux, mais de la
totalité des fibres entr’ elles, en tant qu’elles concourent
à former un organe quelconque? eft-ce.par la
raifon, que les fibres ont des parties rameufes, qui
s’entrelacent & fe lient enfemble, félon l’idée de quelques
autres phyfiqlogiftes ? eft-ce par la force d’at-
tra&ion newtonienne, qui conferve la continuité,
quoique le contaft immédiat foit diminué jufqu’à un
certain point ? Cette derniere opinion paroît la plus
probable ; mais de quelque maniéré que la chofe fe
fa ffe, c’eft tout un ; peu importe : cette recherche
appartient abfolument à la Phyfique générale , ainfi
que ce qui regarde l’élafticité, la diftraûilité ; ce n’eft
donc pas ici le lieu d’examiner quelle peut être la
caufe de ces phénomènes : d’ailleurs, il vaudroit
mieux les admettre eux-mêmes, comme des cau-
fes dont il n’eft intéreffant de favoir que les lois
confiantes, que de fe rendre le joiiet de l’imagination
» en travaillant à donner des explications qui au-
roient le fort de toutes celles qui ont paru jufqu’à
préfent ; dont on peut dire qu’elles fe font détruites
les unes les autres, au point de s’être prefque fait
oublier. Voye^ At t r a c t io n , C o h é s io n , Elast
i c i t é , & c .
Ce fur quoi il importe le plus d’infifter, eft l ’effet
des deux propriétés dont il vient d’être queftion,
bien avérées dans toutes les fibres animales ; d’oii il
réfulte que tant qu’elles font entières, de quelque
maniéré qu’elles foient difpofées dans le corps v ivant,
elles font abfolument dans un état de diften-
fion ; par conféquent elles ne font jamais laiffées à
•elles-mêmes ; elles font toujours dans un état violent
; elles font continuellement effort pour fe raccourcir
félon toute l’étendue de leur puiffance élaf-
tiqtie, & elles ne parviennent jamais entièrement à
l'état qu’elles affeûent, même dans le plus grand relâchement,
que puiffent produire les caufes morbifi?
ques. '
O’eftcétte tendance, cet effort continuel- ides fibres,
q\ii font les principaux moyens paf jlefquels
la vie le maintient : car étant toujours diftendues,
elles font dans une difpofition continuelle à agir pour
le raccourcir, dès que laforce qui les- alonge, vient
à diminuer; elles réfiftent à être intérieurement diftendues
, tant que leur force de reffdrt eft fupérieu-
re ou même égale à celle qui tend à les alonger davantage.
Il y a plufieurs rail'ons d’empêchement à ce
que les fibres ne puiffent pas fe raccourcir autant que
leur élafticité le comporteroit : les raifons particulières
à chaque aggrégé de fibres , font tirées..de leurs
différentes polirions méchaniques : ainfi p. e. dans
.celles qui font antagoniftes les unes des autres réciproquement
, quoiqu’elles paroiffent dans certains
cas, comme le relâchement desmufcles, n’être plus
dans un état violent ; cependant fi on vient à couper
un des aggrégés antagoniftes, il fe fait toûjours un
raccourciffement dans chacune des portions féparées;
elles s’écartent l’une de l’autre, lé retirent vers leur
point fixe ; & l’antagonifte, qui refte entier, fe contrarie
tout autant à proportion que celui qui a été
coupé fe retire : ce qui prouve bien que toutes ces
fibres de part & d’autre , n’étoient pas fans tenfion »
qu’elles faifoient encore effort pour fe raccourcir davantage
; & par conféquent, qu’elles ne ceffoient
pas d’être en aétiori, quoique fans effet fenfible. -
Quant à l’obftacle général au relâchement entier
des fibres, la caufe en eft facile à trouver ; c’eft la
mafl'e des fluides contenus dans les vaiffeaux, qui
tient les fibres dont ils font compofés, dans un état
de diftenfion continuelle, plus ou moins forte cependant
, félon que le Volume des fluides augmente ou
diminue : dans le premier cas, les fibres font tendues
ultérieurement eh quelque fens qu’ellesfoient pofées:
dans lé fécond ca s , elles fe détendent de même en
t'ous fens; mais ce relâchement n’eft jamais parfait,
tant qu’il refte des fluides dans les parties contenant
tes ; il n’eft que refpeûif > il n’eft qu’un état de moindre
diftenfion ; les fibres font toujours diftendues en
tous fens; dans le premier ca s , c’eft la diftra&ilité
des fibres qui eft exercée, & l’élafticité dans le fécond
; chângemens qui ne cèffent de fe fuccéder
tant que dure la v i e , enforte qu’elle femble dépendre
d’un perpétuel inéquilibre.
Mais cet inéquilibre ne peut être connu que par
rapport aux folides comparés aux fluides, & réciproquement;
car pour ce qui eft des folides entr’eux
& des fluides êntr’eux refpe&ivement, on peut au
contraire fe les repréfenter comme dans un perpétuel
équilibre de forces , d’aélion, de réaftion proportionnées
, au moins dans l’état de fanté, qui eft la
vie la plus parfaite ; équilibre dont les maladies ne
font que des léfions. Voye{ E q u i l i b r e , ( Econom.
anim.) ilfe trouve fous ce mot bien des cnôfes, qui
ont rapport aux fibres en général ; voye^ aufli C i r c
u l a t i o n d u S a n g , S a n t é .
Une autre propriété desfibres, qui dérive bien naturellement
de la force élaftique , c’eft la vibratili-
té ; ce feroit ici le lieu d’en traiter aufli ; mais elle
appartient de trop près au méchanifme de l’oiiie
pour en féparer ce qu’il y a à dire de cette propriété
confeélaire. Voyeç Son, Ouïe, Oreille.
Quant à l’irritabilité obfervée particulièrement
par M. Haller, dans quelques - unes des parties du
corps humain, il fuffit qu’elle ne foit pas une propriété
commune à toutes les fibres, pour qu’il ne doive
pas en être fait ici mention d’une maniéré détaillée.
Koyeç Ir r it a b il it é -, ■ 1 ^ t , * , :
Compofés des fibres. Après avoir traité de la fibre ,
de fa nature & de fes propriétés, en tant qu’elle eft
fimple & confidérée féparément des organes qui ne
font qü’un compofé de fibres -, il refte à rechercher
comment on peut concevoir que fe forme ce compo-
f é , puifque c’eft des fibres premières, que font construites
toutes les parties confiftantes du corps-humain
difpofées à contenir, à transférer, à diftribuer,
à préparer, à féparer, à évacuer les différens fluides
qui font néceflaires, utiles ou inutiles à l’économie
animale. Deftinées à des attions purement méchaniques
, lesfibres par leur union différemment combinée
, compofent des folides, des machines & des
inftrumens de toute efpece ; on trouve en effet dans
l’infpe&ion des parties, des filets, des cordons, des
cordes, des poulies, des leviers, des colonnes, des
fôlives , des foufflets, des canaux, des refervoirs,
des facs, des foupapes, des filtres, & plufieurs autres
chofesdiverfement figurées, qui entrent dans laconf-
truélion du corps humain, & qui concourent à l’exercice
de fes fondions,, à leur perfe&ion & à fon ornement.
C ’eft fous la forme de tu yau principalement,que les
fibres unies font employées à contenir les-fluides,.qui.
eftl’ufage le plus général, commun à tous les organes
, à quelques fondions qu’ils foient deftinés. Les
tuyaux, qui font aufli communément appellés cond
u its , c a n a u x , font fpécialement défignés par les
Anatomiftes fous le nom de v a iflea u x ; ils les diftin-
guent enfuite fous quatre genres principaux, favoir,
d’arteres, de veines, de fécrétoires & d’excrétoires,
qui comprennent les vaiffeaux de toutes les elpeces
connues; v o y e ç V aisseaux. D e tous ces différens
vaiffeaux, les uns font facilement apperçûs parles
fens, les autres le font difficilement, oune le peuvent
être que par les fecours de l’art, ou ne le peuvent
pas être du tout, à caufe de leur extrême peti-
teffe; enforte qù’il n’en eft qu’un certain nombre de
ceux qui échappent à la vu e , même aidée des mi-
crofcopes, qui ont pu êtredémontrés par les travaux
finguliers & les foins induftrieux de quelques célébrés
anatomiftes., & entr’autres, par l'art admirable
des injedions du grand Ruyfch ; on juge par analogie
de ceux qui ne font pas fufceptibles d’être rendus
fenfibles. I l eft par conféquent reçu à préfent af-
fez généralement, que toutes les parties folides du
corps font chacune formées d’un tiffu de vaiffeaux ,
depuis fur-tout qu’il a été démontré cjue toutes les
fubftances des parties qui n’avoient été que groflie-
rement anatomifées par les anciens, & que l’on
avoit crû en conféquence fpongieufes, parenchyma-
teufes, ou de telle autre ftruéture aufli éloignée de la
véritable, font réellement un compofé de vaiffeaux,
& pour la plupart de toutes les efpeces.
Cette multiplicité de vaiffeaux extrêmement fub-
tils , adonné lieu à quelques auteurs de penfer, que
l’on n’eft pas encore parvenu à connoître tous les
différens vaiffeaux qui entrent dans la compofitioii
des parties du corps humain, & enfuite, que le dé-
croiffement des vaiffeaux va à 1 infini : mais quoique
l’on accorde la première propofition , parce
qu’il paroît en effet , que la fcience de 1 anatomie
n’eft pas portée à fa perfe&ion , & qu’il eft probable
qu’elle n’y atteindra jamais, bien qu’elle puiffe
acquérir de plus en plus de nouvelles connoiffances;
on ne peut pas , fur une fimple conjeéture, fe déterminer
à admettre que la petiteffe des vaiffeaux
n’ait point de bornes ; pendant que la raifon indiqué
au contraire qu’il y a des derniers vaiffeaux ,
des vaiffeaux au-delà defquels il n’y a pas de divi-
fion extérieure en plus petites parties contenantes :
ce qui fuit peut fervir de démonftration pour cette
affertion.
Lés fofceà méchaniques » dans qtielqtté machine
que ce foit , & par conféquent dans le corps hu*
main , ne font pas infinies ; l’expérience prouvé
toujours qu’elles ont un terme : la divifioii des parties
, dont font compofés les fluides » doit aufli con*
féquemment avoir des bornes : il y a donc des molécules
de ces fluides , qui toutes petites qu’elles
font, doivent cependant être conçues d’un volume
déterminé, & non pas diminué à l’infini : elles re-
! tiennent aufli un certain degré de eohéfion entr’elles;
enforte que le vaiffeau deftiné à lés recevoir doit
avoir uriô capacité déterminée , proportionnée à
chacune de ces moléculês, êCnôn pas d’un diamètre
infiniment petit : d’après cette id ée, on eft fondé
à conclure , avec jufte raifon ; donc il exifte un
dernier vaiffeau d’une petiteffe indéfinie , mais bor-
née. HH
Mais , puifque l’ exiftence de ce dernier Vaiffeau
eft établie, on ne peut fe le repréfenter que très-fim*
pie ; donC-la tunique ou membrane qui le compofe,
de la maniéré qui fera bien-tôt décrite, né doit pas
être faite d’autres vaiffeaux : on doit donc la con*
cevoir conftruite de filamens (impies , c’eft-à-diré
; de fibres premières, telles que l ’idée en a été donnée
j dans cet article î il exifte donc une fibre , qui n’ eft
i| point vafculeiife » qui n’a point de cavité ; par con*
féquent ce n’eft qu’un file t, fans largeur ni epaif-
feur divifibles » mais étendu en longueur par ütié
( fuite des parties élémentaires , unies les unés aux
autres, félon cette derniere dimenfion ; c’eft ce qu’il
falloit- établir, pour-ne laiffer aucun doute fur l’e-
xiûence de lu fibre élémentaire ; avant de Confide-
| ter comment elle eft la bafe de la ftruâure du corps
humain;
C e n’eft que par lés yeux dé la raifort ; que l’ort
peut fliivre la compofition de cet ouvrage admira*
ble ; comme il vient d’être pratiqué pour éa faire
! l’analyfe phyfique : on peut donc fe repréfenter ainfi
cette compétition des parties » qui réfulte de l’union
différemment combinée des fibres Amples* . ;
Un certain nombre de ces fibres, fiiiiilairés âpplià
quées les unes à côté des autres pâr leurs furfaces
longitudinaires , félon toute leur etendhe ; adhéren-
: tes les unes aux autres par le caataâ; auquel eft attachée
la force de eohéfion, & par quelque forté
de colle, qu’on a dit avoir raifon de croire de nature
glutineufe, forme ainfi. une efpece d’étoffe
fans qu’il foit befoin d’entrelacement pour fes fila*
m'ens : & la preuve que cet entrelacement n’exifte
pas dans l’affemblage des fibres , fe trouve dans.la
différence que l’on obferve à l’égard des effets dé
l’humidité fur les tiffus de filets (impies ou de fil de
quelque nature que ce fo i t , comme les toiles, les
cordés , & fur les organes compofés àe. fibres animales
: elle donne une forte de rigidité à ceux-là ;
tandis qu’elle ramollit ceux-ci : les anatomiftes donnent
à ce compofé ainfi conçu le nom de membrane ;
nom qu’ils donnent à toute fubftance fibreufe ou
vafculeufe , très-mince , à proportion de fon
étendue en longueur &c en largeur. Celle dont ott
vient de dire qu’elle eft formée de fibres, élémentaires
, eft elle-même la membrane la plus fimple. S i
on fe la repréfente figurée en parallélogramme ou
approchant, repliée fur elle-même, &foudée par les
deux bords longitudinaux ; elle a fous cette forme
le nom de tunique, & elle eft dès-lors tournée en canal
fermé de tous côtés , par des parois , excepté
par fes deux extrémités : c’eft un véritable vaiffeau,
propre à contenir un fluide ; mais c eft un vaiffeau
très fimple, dont la tunique n’eft formée que de parties
élémentaires, unies entr’elles, fous la forme de
fibres & de membranes. Si l’on fe reprefente après
cela plufieurs vaiffeaux de cette efpece unis enfém-
ble félon leur longueur , pour ne former qu’un,
H