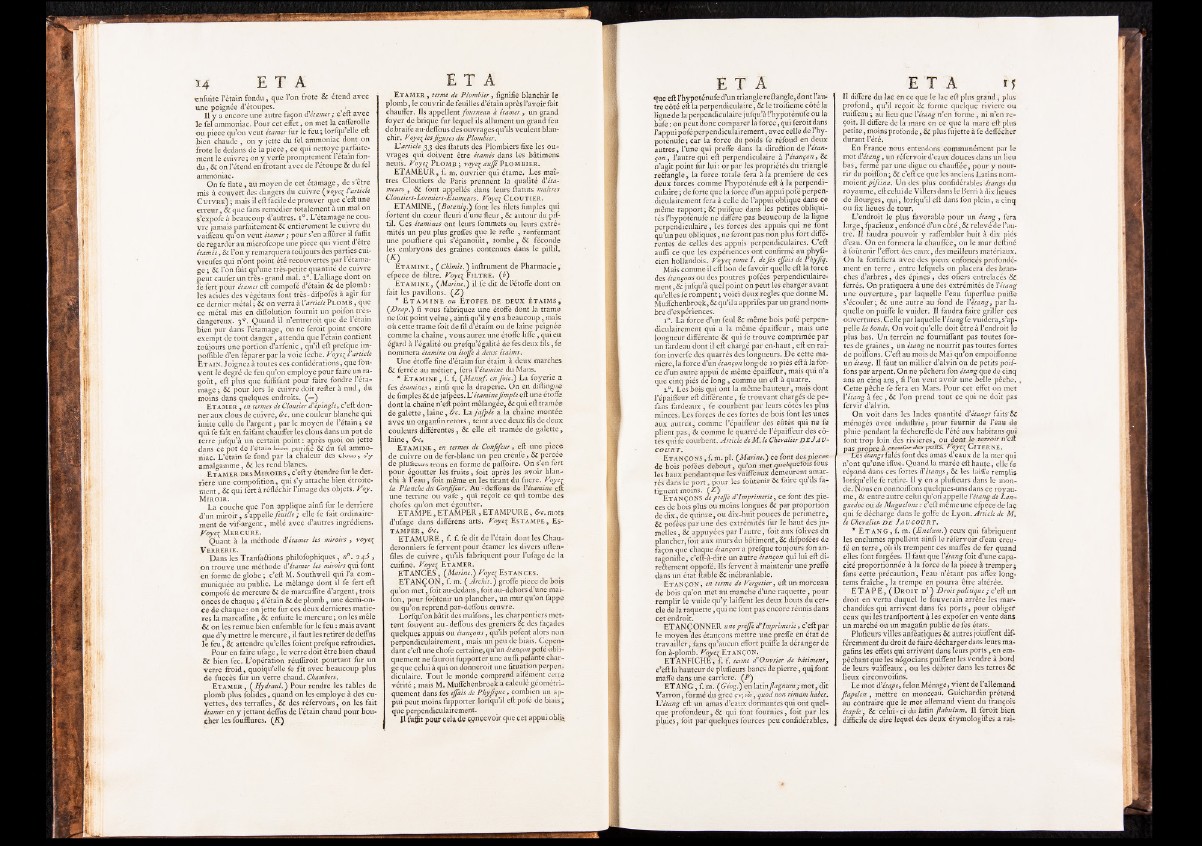
■ enfuite Pétain fondu, que Pon frote & etend avec
une poignée d’étoupes. i
Il y a encore une autre façon Rétamer; c’en: avec
le fel ammoniac. Pour cet effet, on met la cafferolle
ou piece qu’on veut étamer fur le feu; lorfqu’elle eft
bien chaude , on y jette du fel ammoniac dont on
frote le dedans de la piece, ce qui nettoye parfaitement
le cuivre ; on y verfe promptement l’étain fondu
, 8c on l’étend en frotant avec de l’étoupe & du fel
ammoniac. >A
On fe flate, au moyen de cet étamage, de s’etre
mis à couvert des dangers du cuivre (voyez l'article Cuivre) ; mais il eft facile de prouver que c’eft une
erreur, & que fans remédier totalement à un mal on
s’expofe à beaucoup d’autres. i° . L’étamage ne couv
re jamais parfaitement 8c entièrement le cuivre du
vaiffeau qu’on veut étamer ; pour s’en affûrer il fuffit
de regarder au microfcope une piece qui vient d’etre
étamee , 8c l’on y remarquera toujours des parties cui-
vreufes qui n’ont point été recouvertes par 1 étamage
; & l'on fait qu’une très-petite quantité de cuivre
peut caufer un très-grand mal. i° . L ’alliage dont on
fe fert pour étamer eft compofe d’etain & de plomb :
les acides des végétaux font très - difpofes à agir fur
ce dernier métal ; & on verra à l'article Plomb , que
ce métal mis en difïolution fournit un poifon très-
dangereux. 30. Quand il n’entreroit que de l’étain
bien pur dans l’étamage, on ne feroit point encore
exempt de tout danger, attendu que l’étain contient
îoûjours une portion d’arfenic, qu’il eft prefque im-
poflible d’en leparer par la voie feche. Voyez l'article Etain. Joignez à toutes ces confidérations, que fou-
vent le degré de feu qu’on employé pour faire un ragoût
, eft plus que fuffifant pour faire fondre l’étamage
; 8c pour lors le cuivre doit refter à nud, du
moins dans quelques endroits. (—) Etamer , en termes de Cloutier d'épingle y c’eft donner
aux clous de cuivre, &c. une couleur blanche qui
imite celle de l’argent, par le moyen de l’étain ; ce
qui fe fait en faifant chauffer les clous dans un pot de
terre jufqu’à un certain point : après quoi on jette
dans ce pot de l’étain tien purifie 8c du fel ammoniac.
L’étain fe fond par la chaleur des clwua,
amalgamme, 8c les rend blancs. •Etamer des Miroirs , c’eft y étendre fur le derrière
une compofition, qui s’y attache bien étroitement
, 8c qui fert à réfléchir l’image des objets. V?y.
Miroir. . . La couche que l’on applique ainfi fur le derrière
d’un miroir, s’appelle feuille ; elle fe fait ordinairement
de vif-argent, mêlé avec d’autres ingrédiens.
Voyez Mercure. Quant à la méthode Rétamer les miroirs 3 voyez Verrerie.
Dans les Tranfa&ions philofophiques, n°. 24S 9
on trouve une méthode Rétamer les miroirs qui font
en forme de globe ; c’eft M. Southwell qui l’a communiquée
au public. Le mélange dont il fe fert eft
compofé de mercure 8c de marcaflite d’argent, trois
onces de chaque ; d’étain & de plomb, une demi-onc
e de chaque : on jette fur ces deux dernieres matières
la marcaflite, 8c enfuite le mercure ; on les mêle
8c on les remue bien enfemble fur le feu : mais avant
que d’y mettre le mercure, il faut les retirer de deffus
le feu, 8c attendre qu’elles foient prefque refroidies.
Pour en faire ufage, le verre doit être bien chaud
& bien fec. L’opération réufliroit pourtant fur un
verre froid, quoiqu’elle fe fît avec beaucoup plus
de fuccès fur un verre chaud. Chambers. Etamer , ( Hydraul.') Pour rendre les tables de
plomb plus folides, quand on les employé à des cuvettes,
des terraffes, 8c des réfervoirs, on les fait
étamer en y jettant deflus de l’étain chaud pour boucher
les foufliures. (X )
ETAMER , terme de Plombier y fignifie blanchir le
plomb, le couvrir de feuilles d’étain après l’avoir fait
chauffer. Ils appellent fourneau à. étamer, un grand
foyer de brique fur lequel ils allument un grand feu
de braife au-deffous des ouvrages qu’ils veulent blanchir.
Voyez les figures du Plombier.
L'article 33 des ftatuts des Plombiers fixe les ouvrages
qui doivent être étamés dans les bâtimens
neuts. Voyez Plomb ; voyez aujji Plombier.
ETAMEUR, f. m. ouvrier qui étame. Les maîtres
Cloutiers de Paris prennent la qualité Rétameurs
, 8c font appellés dans leurs ftatuts maîtres
Cloutiers-Lormiers-Etameurs. Voyez CLOUTIER.
ETAMINE, (.Botaniq.) font les filets Amples qui
fortent du coeur fleuri d’une fleur, 8c autour du pif-
cil. Ces étamines ont leurs fommets ou leurs extrémités
un peu plus groffes que le refte , renfermant
une poufliere qui s’épanouit, tombe, 8c féconde
les embryons des graines contenues dans le piftil.
c*E) tamine, I . ( Chimie. ) infiniment de Pharmacie,
efpece de filtre. Voyez f*ILTRE* (J’ ) Etamine , (Marine.') il fe dit de T'étoffe dont on
fait les pavillons. (Z ) * E t a m in e ou Etoffe de deux étaims,
(Drap.) fi vous fabriquez une étoffe dont la trame
ne foit point velue, ainfi qu’il y en a beaucoup, mais
où cette trame foit de fil d’étaim ou de laine peignée
comme la chaîne, vous aurez une étoffe liffe, qui eu
égard à l’égalité ou prefqu’égalité de fes deux fils, fe
nommera étamine ou étoffe à deux étaims.
Une étoffe fine d’étaim fur étaim à deux marches
8c ferrée au métier, fera Kétamine du Mans. * Etamine , f. f. (Manuf. en foie.) La foyerie a
fes étamines, ainfi que la draperie. On en diftingue
de fimples 8c de jafpees. L’étamine (impie eft une étoffe
dont la chaîne n’eft point mélangée, 8c qui eft tramée
de galette, laine, &c. La jafpée a la chaîne montée
avec un organfin retors, teint avec deux fils de deux
couleurs différentes, 8c elle eft tramée de galette ,
laine, &c. _ Etamine, en termes de Confifeur, eft une piece
de cuivre ou de fer-blanc un peu creufe, 8c percee
de plufieurs trous en forme de paffoire. On s’en fert
pour égoutter les fruits, foit après les avoir blanchi
à l’eau, foit même en les tirant du fucre. Voyez
la Planche dit Confifeur. Au - deffous de Vétamine eft
une terrine ou vafe , qui reçoit ce qui tombe des
chofes qu’on met égoutter.
ETAMPE, ETAMPER, ETAMPURE, &c. mots
d’ufage dans différens arts. Voyez Estampe, Estamper,
&c.
ETAMURE, f. f. fe dit de l’étain dont les Chau-
deronniers fe fervent pour étamer les divers uften-
files de cuivre, qu’ils fabriquent pour l’ufage de la
cuifine. Voyez Etamer.
ETANCES, (Marine.) Voyez Es tan CES.
E T ANC O N , f. m. (Archit.) groffe piece de bois
qu’on met, foit au-dedans, foit au-dehors d’une mai-
fon, pour foûtenir un plancher, un mur qu’on fappe
ou qu’on reprend par-deffous oeuvre.
Lorfqu’on bâtit des maifons, les charpentiers mettent
fouvent au-deffous des greniers 8ç des façades
quelques appuis ou étançons , qu’ils pofent alors non
perpendiculairement, mais un peu de biais. Cependant
c’eft une chofe certaine, qu’un étançonpoié obliquement
ne fauroit fupporter une aufli pefante charge
que celui à qui on donneroit une fituation perpendiculaire.
Tout le monde comprend aifement cette
vérité ; mais M. Muflchenbroek a calculé géométriquement
dans fes effais de Phyjfiqu* > combien un appui
peut moins fupporter lorfqu’il eft pofe de biais ,
que perpendiculairement.
J1 fu$t pour cela de concevoir que cet appui oblfe
que eft Thypoténufe d’un triangle reftangle, dont l’autre
côté eft la perpendiculaire, 8c le troifieme côté la
ligne de la perpendiculaire jufqu’à Thypoténufe ou la
bafe : on peut donc comparer la force, qui feroit dans
l’appui pofé perpendiculairement, avec celle de l’hy-
poténule ; car la force du poids fe réfoud en deux
autres, Tune qui preffe dans la direfrion de Yétan-
çony l’autre qui eft perpendiculaire à l'étançon, 8c
n’agit point fur lui : or par les propriétés du triangle
reâangle, la force totale fera à la première de ces
deux forces comme Thypoténufe eft à la perpendiculaire
; de forte que la force d’un appui pofé perpendiculairement
fera à celle de l’appui oblique dans ce
même rapport ; 8c puifque dans les petites obliquités
Thypoténufe ne différé pas beaucoup de la ligne
perpendiculaire, les forces des appuis qui ne font
qu’un peu obliques, ne feront pas non plus fort différentes
de oelles dés appuis perpendiculaires. C’eft
aufli ce que les expériences ont confirmé au phyfi-
cien hollandois. Voyez tome I . de fes effais de Phyfiq.
Mais comme il eft bon de favoir quelle eft la force
des étançons ou des poutres pofées perpendiculairement
, 8c jufqu’à quel point on peut les charger avant
qu’elles fe rompent ; voici deux réglés que donne M.
Muflchenbroek, 8c qu’il a apprifes par un grand nom-,
bre d’expériences.
i° . La force d’un feul 8c même bois pofé perpendiculairement
qui a la même épaiffeur, mais une
longueur différente & qui fe trouve comprimée par
un fardeau dont il eft chargé par en-haut, eft en rai-
fon inverfe des quarrés des longueurs. De cette maniéré,
la force d’un étançon long de 1 o piés eft à Ia for-
ce d’un autre appui de même épaiffeur, mais qui n’a
que cinq piés de long, comme un eft à quatre.
z°. Les bois qui ont la même hauteur, mais dont
l’épaiffeur eft différente, fe trouvant chargés de pe-
fans fardeaux, fe courbent par leurs côtes les plus
minces. Les forces de ces fortes de bois font les unes
aux autres, comme l’épaiffeur des côtés qui ne fe
plient pas, & comme le quarré de l’épaiffeur des côtés
quife courbent. Article de M. le Chevalier D E J A U -
C O U R T . de Ebtoaisn pçooféness , df.e mb.o pult., (qMua’ornin me.)e tc qe ufeolnqtu deefos ipsi èlocue*s rleéss bdaaunxs lpee pndoarnt,t pqouue rl else sv afiofûfeteanüixr demeurent amar8c
taire qu ils fatigEuetnatn
mçooinnss. d(eZ p)re ffe d'imprimerie, ce font des piè'
ces de bois plus ou moins longues 8c par proportion
de dix, de quinze, ou dix-huit pouces de perimetre,
8c pofées par une des extrémités fur le haut des jumelles
, 8c appuyées par l’autre, foit aux folives du
plancher,foit aux murs du bâtiment, 8c difpoféeS de
façon que chaque étançon a prefque toujours fon an-
tagonifte, c’eft-à-dire un autre étançon qui lui eft directement
oppofé. Ils fervent à maintenir une preffe
dans un état ftable 8c inébranlable. Etançon, en terme de Vergetier, eft un morceau
de bois qu’on met au manche d’une raquette, pour
remplir lè vuide qu’y laiffent les deux bouts du cercle
de la raquette, qui ne font pas encore réunis dans
cet endroit. ETANCONNER une preffe d'imprimerie y c’eft par
le moyennes étançons mettre une preffe en état de
travailler, fans qu’aucun effort puiffe la déranger de
fon à-plomb. Voyez Et an çon .
ETANFICHE, f. f. terme d'Ouvrier de bâtiment,
c’eft la hauteur de plufieurs bancs de pierre, qui font
maffe dans une carrière. (P)
ETAN G , f. m. (Géog.) en latinfiagnum ; mot, dit
Varron, formé du grec çijvov, quod non rimamhabet.
L ’étang eft un amas d’eaux dormantes qui ont quelque
profondeur, 8c qui font fournies, foit par les
pluies, foit par quelques fources peu confiderables.
Il différé du lac en ce que le lac eft plus grand, plus
profond, qu’il reçoit 8c forme quelque riviere ou
ruiffeau ; au lieu que l’étang n’en forme, ni n’en reçoit.
Il différé de la mare en ce que la mare eft plus
petite, moins profonde, & plus fujette à fe deflecher
durant Tété.
En France nous entendons communément par le
mot R étang, un réfervoir d’eaux douces dans un lieu
bas, ferme par une digue ou chauffée, pour y nourrir
du poiffon; & e’eft ce que les anciens Latins nom-
moient pifeina. Un des plus considérables étangs du
royaume, eft celui de Villersdans le Berri à dix lieues
de Bourges, qui, lorfqu’il eft dans fon plein, a cinq
ou fix lieues de tour.
L’endroit le plus favorable pour un étang, fera
large, fpacieux, enfoncé d’un côté, 8c relevé de l’autre.
Il faudra pouvoir y raffembler huit à dix piés
d’eau. On en formera la chauffée,, ou le mur deftiné
à foûtenir l’effort des eaux, des meilleurs matériaux.
On la fortifiera avec des pieux enfoncés profondément
en terre , entre lefquels on placera des branches
d’arbres, des épines, des ofiers entrelacés 8c
ferrés. On pratiquera à une des extrémités de l'étang
une ouverture, par laquelle l’eau fuperflue puiffe
s’écouler ; 8c une autre au fond de l’étang, par laquelle
on puiffe le vuider. Il faudra faire griller ces
ouvertures. Celle par laquelle Y étang (e vuidera, s’appelle
la bonde. On voit qu’elle doit être à l’endroit le
plus bas. Un terrein ne fourniffant pas toutes fortes
de graines, un étang ne nourrit pas toutes fortes
de poinons. C’eft au rrçois de Mai qu’on empoiffonne
un étang. Il faut un millier d’alvin ou de petits poiffons
par arpent. On ne pêchera fon étang que de cinq
ans en cinq ans, fi Ton veut avoir une belle pêche.
Cette pêche fe fera en Mars. Pour cet effet on met
Y étang à fe c , 8c l’on prend tout ce qui ne doit pas
fervir d’alvin.
On voit dans les Indes quantité R étangs faits ôc
ménagés avec induftrié, pour fournir de l’eau de
pluie pendant la féchereffe de Tété aux habitans qui
lont trop loin des rivières, ou dont Je terroir n’eft paspropre.à cr*»E?x- Jcs puits. Voyez Citerne.
"EesTtangs Talés font des amas d.’eaux de la mer qui
n’ont qu’une iflùe. Quand la marée eft haute, elle fe
répand dans ces fortes Rétangs, 8c les laiffe remplis
lorfqu’elle fe retire. Il y en a plufieurs dans le monde.
Nous en connoiffons quelques-uns dans ce royaume,
& entre autre celui qu’on .appelle Y étang de Languedoc
ou de Maguelone : c’eft meme une efpece de Iaç
qui fe décharge dans le golfe de Lyon. Article de M.
le Chevalier- D E J A U CO U R T .
* E t an G , f. m. (Enclum.) ceux qui fabriquent
les enclumes appellent ainfi le réfervoir d’eau creu-
fé en terre, où ils trempent ces maffes de fer quand
elles font forgées; Il faut que Y étang foit d’une capacité
proportionnée à la force de la piece à tremper;
fans cette précaution, Teau n’étant pas affez long-
tems fraîche, la trempe en pourra être altérée.
E T A P E , ( Droit d’ ) Droit politique ; c’eft urt
droit en vertu duquel le fouverain arrête les mar-
chandifes qui arrivent dans fes ports, pour obliger
ceux qui les tranfportent à les expofer en vente dans
un marché ou un magafin public de fes états.
Plufieurs villes anféatiques & autres joiiiffent différemment
du droit de faire décharger dans leurs ma-
gafins. les effets qui arrivent dans leurs ports, en empêchant
que les ndgocians puiffent les vendre à bord
de leurs vaiffeaüx, ou les débiter dans les terrés 8c
lieux cir.convoifins.
Le mot R étape y félon Ménage* vient de l’allemand
fiapelen , mettre en monceau. Guichardin prétend
âu contraire que le mot allemand vient du françois
étaple, & celui-ci du latin (labulum. Il feroit bien
difficile de dire lequel des deux étymologiftes a rai