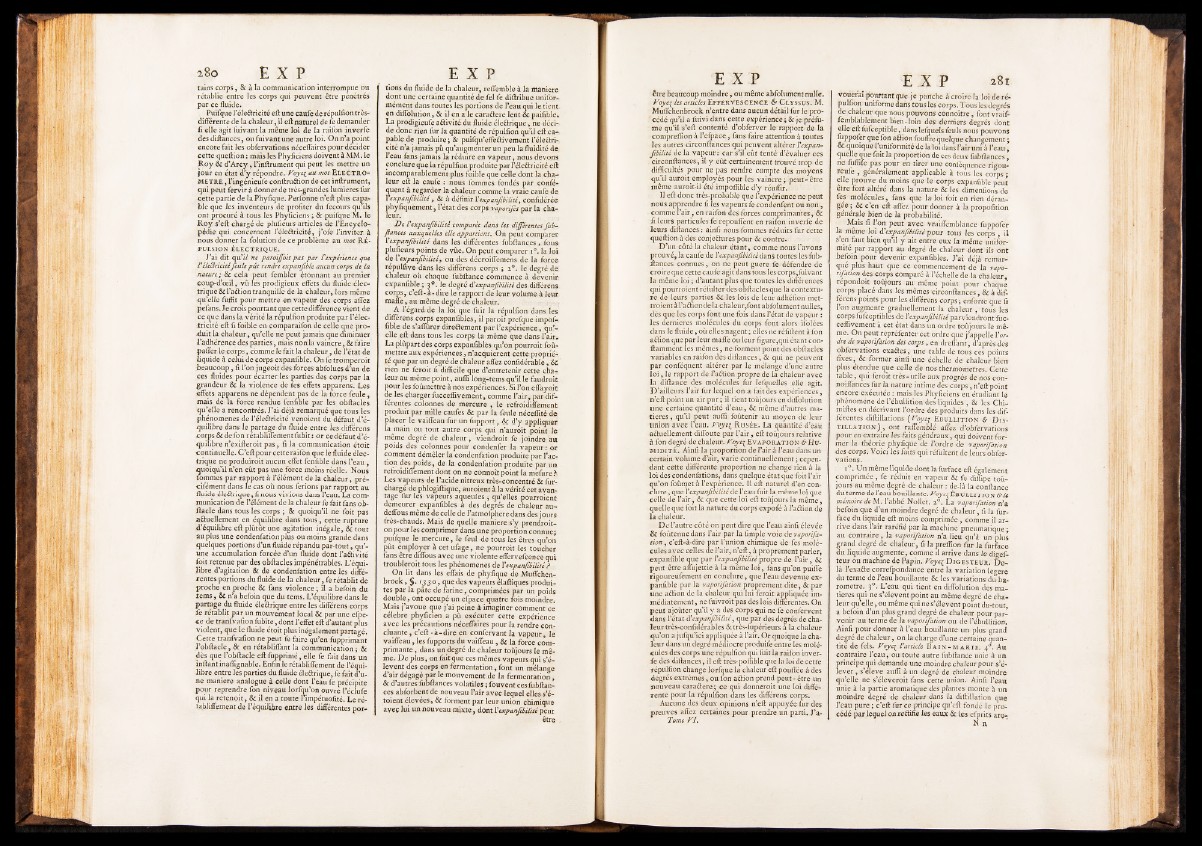
tains corps, & à la communication interrompue ou
rétablie entre les corps qui peuvent être pénétrés
par ce fluide.
Puifque l’éleâricité eft une caufe de répulfion très-
différente de la chaleur, il eft naturel de le demander
fi elle agit fuivant la même loi de la raifon inverfe
des diftanccs, ou fuivant une autre loi. On n’a point
encore fait les obfervations néceffaires pour décider
cette queftion : mais les Phyliciens doivent à MM. le
Roy & d’A r c y , l’ inftrument qui peut les mettre un
jour en état d y répondre. Foye^au mot E l e c t r o -
a ï Et r e , l’ingénieufe conftruftion de cet inftrument,
qui peut fervir à donner de très-grandes lumières fur
cette partie de la Phyfique. Per-lonne n’eft plus capable
que les inventeurs de profiter du fecours qu’ils
ont procuré à tous les Phyficiens ; & puifque M. le
R o y s’ell chargé de plufieurs articles de l’Encyclopédie
qui concernent l’éleâricité, j’ofe Finviter. à
nous donner la folution de ce problème au mot R ép
u l s io n ÉLECTRIQUE.
J’ai dit qu’il ne paroiJJoit pas par Vexpérience que
V électricité feule pût rendre expanjible aucun corps de la
nature; 6c cela peut fembler étonnant au premier
coup-d’oe il, vu les prodigieux effets du fluide électrique
6t l’aétion tranquille de là chaleur, lors même
qu’elle fuffit pour mettre en vapeur des corps affez
pefans. Je crois pourtant que cette différence vient de
ce que dans la vérité la repulfion produite par l’électricité
eft fi foible en comparaifon de celle que produit
la chaleur, qu’elle ne peut jamais que diminuer
l ’adhérence des parties, mais nonla vaincre, & faire
paffer le: corps, comme le fait la chaleur, de l’état de
liquide à celui de corps expanfible. On fe tromperoit
beaucoup, fi l’on jugeoit des forces abfolues d’un de
ces fluides pour écarter les parties des corps par la
grandeur 6c la violence de les effets apparens. Les
.effets apparens ne dépendent pas de la force feule,
mais de la force rendue fenfible par les obftacles
qu’elle a rencontrés. J’ai déjà remarqué que tous les
phénomènes de l’éleâricité venoient du défaut d’équilibre
dans le partage du fluide entre les différens
corps & de fon rétabliffement fubit ; or ce défaut d’équilibre
n’exifteroit pas, fi la communication étoit
continuelle. C ’eft pour cette raifon que le fluide électrique
ne produiroit aucun effet fenfible dans l’eau,
Îquoiqu’il n’en eût pas une force moins réelle. Nous
ommes par rapport à l’élément de la chaleur, pré-
cifément dans le cas oit nous ferions par rapport au
fluide éleélrique, fi nous vivions dans l’eau. La communication
de l’élément de la chaleur fe fait fans ob-
fiacle dans tous les corps ; & quoiqu’il ne foit pas
actuellement en équilibre dans tous, cette rupture
d’équilibre eft plûtôt une agitation inégale, 6c tout
au plus une condenfationplus ou moins grande dans
quelques portions d’un fluide répandu par-tout, qu’une
accumulation forcée d’un fluide dont l’aftivité
foit retenue par des obftacles impénétrables. L’équilibre
d’agitation & de condenfation entre les différentes
portions du fluide de la chaleur, fe rétablit de
proche en proche 6c fans violence ; il a befoin du
lems, & n’a befoin que du tems. L’équilibre dans le
partage du fluide éleôrique entre les différens corps
fe rétablit par un mouvement local & par une efpe*
«e de tranfvafion fubite, dont l’effet eft d’autant plus
violent, que le fluide étoit plus inégalement partagé.
Cette tranfvafion ne peut fe faire qu’en fupprimant
l’obftacle, & en rétabliffant la communication ; &
dès que l’obftacle eft fupprimé, elle fe fait dans un
inftantinaffignable. Enfin le rétabliffement de l’équilibre
entre les parties du fluide élettrique, fe fait d’une
maniéré analogue à celle dont l’eau fe précipite
pour reprendre fon niveau lorfqu’on ouvre l’éclufe
qui la retenoit, & il en a toute l’impétuofité. Le ré-
tabliffement de l’équilibre entre les différentes portions
du fluide de la chaleur, reffembîe à la maniéré
dont une certaine quantité de fel fe diftribue uniformément
dans toutes les portions de l’eau qui le tient,
en diffolution, & il en a le caraftere lent 6c paifible.
La prodigieufe aftivité du fluide éledrique, ne décide
donc rien fur la quantité de répulfion qu’il eft capable
de produire ; & puifqu’effeftivement l’éleclri-
cite n’a jamais pû qu’augmenter un peu la fluidité de
l’eau fans jamais la réduire en vapeur, nous devons
conclure que la répulfion produite par l’éleâricité eft
incomparablement plus foible que celle dont la,chaleur
eu la caufe : nous fommes fondés par confèr
e n t à regarder la chaleur comme la vraie caufe de
Yexpanfibilitè , & à définir Yexpanfibilitè, confidérée
phyfiquement, l’état des corps vaporifés par la chaleur.
De Cexpanfibilite comparée dans les différentes fub-
jlances auxquelles elle appartient. On peut comparer
Yexpanjîbilitè dans les différentes fubftançes ,1'ous
plufieurs points de vue. On peut comparer i° . la loi
de Yexpanjîbilitè, ou des décroiffemens de la force
répulfive dans les différens corps ; z°. le degré de.
chaleur où chaque fubftance commence à devenir
expanfible; 30. le degré Yexpanjîbilitè des différens.
corps, c’eft-à-dire le rapport de leur volume à leur
maffe, ait même degré de chaleur.
A l’égard de la loi que fuit la répulfion dans, lés
différens corps expanfibles, il paroît prefque impof-,
fible de s’affûrer direâement par l’expérience, qu’elle
eft dans tous les corps la même que dans i ’air.
La plupart des corps expanfiblès qu’on pourroit foû-
mettre aux expériences, n’acquierent cette propriété
que par un degré de chaleur affez confidérablè, 6c
rien ne feroit fi difficile que d’entretenir cette chaleur
au même point, auffi long-tems qu’il le faudrait
pour les foûmettre à nos expériences. Si l’on effayoit
de les charger fucceffivement, comme l’air, par différentes
colonnes de mercure , le refroidiffement
produit par mille caufes 6c par la feule néceflité de
placer le vaiffeau fur un fupport, 6c d’y appliquer
laAmain OR tout autre corps qui n’auroit point le
même degré de chaleur, viendroit fe joindre au
poids des colonnes pour condenfer la vapeur : or
comment démêler la condenfation produite par l’action
des poids, de. la condenfation produite par un
refroidiffement dont on ne connoît point la mefure ?
Les vapeurs de l ’acide nitreux très-concentré & fur-
chargé de phlogiftique, auraient à la vérité cet avantage
fur les vapeurs aqueufes ; qu’elles pourroient
demeurer expanfibles à des degrés de chaleur au-
deffous même de celle de l’atmofphere dans des jours
tres-chauds. Mais de quelle maniéré s’y prendroit-
on pour les comprimer dans une proportion connue;
puifque le mercure, le feul de tous les êtres qu’on
pût employer à cet ufage, ne pourroit les toucher
fans être diffous avec une violente effervefcence qui
troublerait tous les phénomènes de Yexpanjîbilitè?
On lit dans les effais de phyfique de Muffchen-
broek, § . 1,33 o , que des vapeurs élaftiques produites
par la pâte de farine, comprimées par un poids
double, ont occupé un efpace quatre fois moindre.
Mais j’avoue que j’ai peine à imaginer comment ce
célébré phyficien a pû exécuter cette expérience
avec les précautions néceffaires pour la rendre concluante,
c’eft - à-dire en confervant la vapeur, le
vaiffeau, les fupports du vaiffeau, & la force comprimante
, dans un degré de chaleur toûjours le même.
De plus, on fait que ces mêmes vapeurs qui s’élèvent
des corps en fermentation, font un mélange
d’air dégagé par le mouvement de la fermentation,
& d’autres fubftançes volatiles ; fouvent ces fubftan-
ces abforbent de nouveau l’air avec lequel elles s’é-
toient elevées, 6c forment par leur union chimique
avec lui un nouveau mixte, dont Yexpanjîbilitè peut
être beaucoup moindre, ou même abfolument nulle.
Voyelles articles Ef f e r v e s c e n c e & C l y s s u s . M.
Muffchenbroek h’entre dans aucun détail fur le pro-
’ cédé qu’il a fuivi dans cette expérience ; & je préfume
qu’il .s’eft contenté d’obferver le rapport de la
compreflion à l’efpace,, fans faire attention à toutes
les autres circonftances qui peuvent altérer Yexpan-
Jibilitè de la vapeur: car s’il eût tenté d’évaluer ces
circonftances; il y eût certainement trouvé trop de
difficultés pour ne pas rendre compte des moyens
qu’il aurait employés pour les vaincre ; peut-être
même aurait-il été impoffible d’y réuffir.
Il eft donc très-probable que 1 expérience ne peut
nous apprendre fi les vapeurs fe condenfent ou non,
comme l’air, en raifon des forces comprimantes, 6c
fi leurs particules fe repouffent en raifon inverfe de
leurs diftances : ainfi nous fommes réduits fur cette
queftion à des conje&ures pour & contre.
D ’un côté la chaleur étant, comme nous l’avons
prouvé, la caufe de Yexpanjîbilitè dans toutes les fub-
ftances connues, on ne peut guere fe défendre de
croire que cette caufe. agit dans tous les corps,fuivant
la même loi ; d’autant plus que toutes les différences
qui pourroient réfulter des obftacles que la contexture
de leurs parties 6c les lois de leur adhéfion metta
ien t à l’aûion de la chaleur,font abfolument nulles,
dès que les corps font une fois dans l’état de vapeur :
les dernieres molécules du .corps font alors ilolées
dans le fluide, où elles nagent; elles ne réfiftent à fon
aftion que par leur maffe ou leur figure,qui étant con-
ftamment les mêmes, ne forment point des obftacles
variables en raifon des diftances, & qui ne peuvent
par conféquent altérer par le mélange dfune autre
lo i , le rapport de l’aûion propre de la chaleur avec
la diftance des molécules fur lefquelles elle agit.
D ’ailleurs l’air fur lequel on a fait des expériences,
n’eft point un air pur ; il tient toûjours en diffolution
une certaine quantité d’eau, 6c même d’autres matières
, qu’il peut auffi foûtenir au moyen de leur
union avec l’eau. F o y e ^ R o sé e . La quantité d’eait
actuellement diffoute par l’air , eft toûjours relative
à fon degré de chaleur, F o y e { Ev a p o r a t io n & Hü-
MIDITÉ. Ainfi la proportion de l’air à l’eau dans un
certain volume d’air, varie continuellement ; cependant
cette différente, proportion ne change rien à la
loi des condenfations, dans quelque état que foit l’air
qu’on foûnjet à l’expérience. Il eft naturel d’en conclure
, que Yexpanjîbilitè de l’eau fuit la même loi que
celle de l’air, 6c que cette loi eft toûjours la même,
quelle que foit la nature du corps expofé à l’aétion de
la chaleur.
De l’autre côté on peut dire que l’eau ainfi élevée
& foûtenue dans l’air par la fimple voie de vaporifa-
tion, c’eft-à-dire par l’union chimique de fes molécules
avec celles de l’air, n’eft, à proprement parler,
expanfible que par Yexpanjîbilitè propre de l’air, 6c
peut être affujettie à la même lo i, fans qu’on puiffe
rigoureufement en conclure, que l’eau devenue expanfible
par la vaporifation proprement dite, & par
une aftion de la chaleur qui lui feroit appliquée immédiatement
, ne fuivroit pas des lois différentes. On
peut ajoûter qu’il y a des corps qui ne fe confervent
dans l’état Yexpanjîbilitè, que par des degrés de chaleur
très-confidérables &très-fupérieurs à la chaleur
qu’on a jufqu’ici appliquée à l’air. Or quoique la chaleur
dans un degré médiocre produife entre les molécules
des corps une répulfion qui fuit la raifon inverfe
des diftances, il eft très-poflible que la loi de cette
répulfion change lorfque la chaleur eft pouffée à des
degrés extrêmes, ou Ion aûion prend peut - être un
nouveau caraftere ; ce qui donneroit une loi différente
pour la répulfion dans les différens corps.
Aucune des deux opinions n’eft appuyée fur des
preuves affez certaines pour prendre un parti. J’a-
Tome FI.
vouerai pourtant que je panche à croire-la loi de répulfion
uniforme dans tous les corps. Tous les degrés
de chaleur que nous pouvons connoître, font vrail-
femblàblement bien-loin des derniers degrés dont
elle eft fufceptible , dans lefijuels feuls nous pouvons
fuppofer que fon aéfion fouffre quelque changement ;
&<quoique l’uniformité de la loi dans l’air uni à l’eau,
quelle que foit la proportion deces deux fubftançes,
ne fuffile pas pour en tirer une conféquence rigou-
reufe , généralement applicable à tous les corps ;
elle prouve du moins que le corps expanfible peut
être fort altéré dans la nature & les dimenfions de
fes molécules, fans que la loi foit en rien dérangée
; & c ’en eft affez pour donner à la propofition
générale bien de la probabilité.
Mais fi l’on peut avec vraiffemblançe fuppofer
la même loi Yexpanjîbilitè pour tous les corps , il
s’en faut bien qu’il y ait entre eux la même uniformité
par rapport au degré de chaleur dont ils Ont
befoin pour devenir expanfibles. J’ai déjà remarqué
plus haut que ce commencement de \?l vaporifation
des corps comparé à l ’échelle de la chaleur,
repondoit toûjours air même point pour chaque
corps placé dans lés mêmes circonftances, 6c à différens
points pour les différens corps ; enforte que fi
l’on augmente graduellement la chaleur , tous les
corps fufceptibles de Y expanjîbilité parviendront fucceffivement
à cet état dans un ordre toûjours le même.
On peut repréfenter cet ordre que j ’appelle Y ordre
de vaporifation des corps, en dreffant, d’après des
obfervations exactes, une table de tous ces points
fixes, 6c former ainfi une échelle de chaleur bien
plus étendue que celle de nos thermomètres. Cerre
table, qufferoit très-utile aux progrès de nos con-
noiffances fur la nature intime des corps, n’eft point
encore exécutée : mais.les Phyficiens en étudiant le
phénomène de l’ébullition des liquides , & les Chi-
miftes en décrivant l’ordre des produits dans les différentes
diftillations ( F o y e 1 E b u l l it io n & D is t
i l l a t io n ) , ont raffemblé affez d’obfervations
pour en extraire les faits généraux, qui doivent former
la théorie phyfique de l’ordre de vaporifation
•des corps'. Voici les faits qui réfultent de leurs obfervations.
i ° . Un même liquide dont la furface eft également
comprimée, fe réduit en vapeur 6c fe diflipe toûjours
au même degré de chaleur : de-là la confiance
du terme de l’eau bouillante. Foye^ Éb u l l it io n &U
mémoire de M. l’abbé Nolle't. 20. La vaporifation n’a
befoin que d’un moindre degré de chaleur, fi la fur-
face du liquide eft moins comprimée, comme il arrive
dans l’air raréfié par la machine pneumatique ;
au contraire, la vaporifation n’a lieu qu’à un plus
grand degré de chaleur, fi la preffion fur la furface
du liquide augmente, comme il arrive dans le digef-
teur ou machine de Papin. Foyeç D igesteur. Delà
l’exaâe correfpondance entre la variation le«ere
du terme de l’eau bouillante & les variations du baromètre.
30. L’eau qui tient en diffolution des matières
qui ne s’élèvent point au même degré de chaleur
qu’elle, ou même qui ne s’élèvent point du-tout,
a befoin d’un plus grand degré de chaleur pour parvenir
au terme de la vaporifation ou de l’ébullition.
Ainfi pour donner à l’eau bouillante un plus grand
degré de chaleur, on la charge d’une certaine quantité
de fels. Foye[ Üarticle Ba i n - m a r ie . 40. Au
contraire l’eau, ou toute autre fubftance unie à un
principe gui demande une moindre chaleur pour s’élever
, s’eleve auffi à un degré de chaleur moindre
qu’elle ne s’éleveroit fans cette union. Ainfi l’eau
unie à la partie aromatique des plantes monte à un
moindre degré de chaleur dans la diftillation que
Peau pure ; c’eft fur ce principe qu’eft fondé le procédé
par lequel on reûine les eaux 6c les elprits aro-
N n