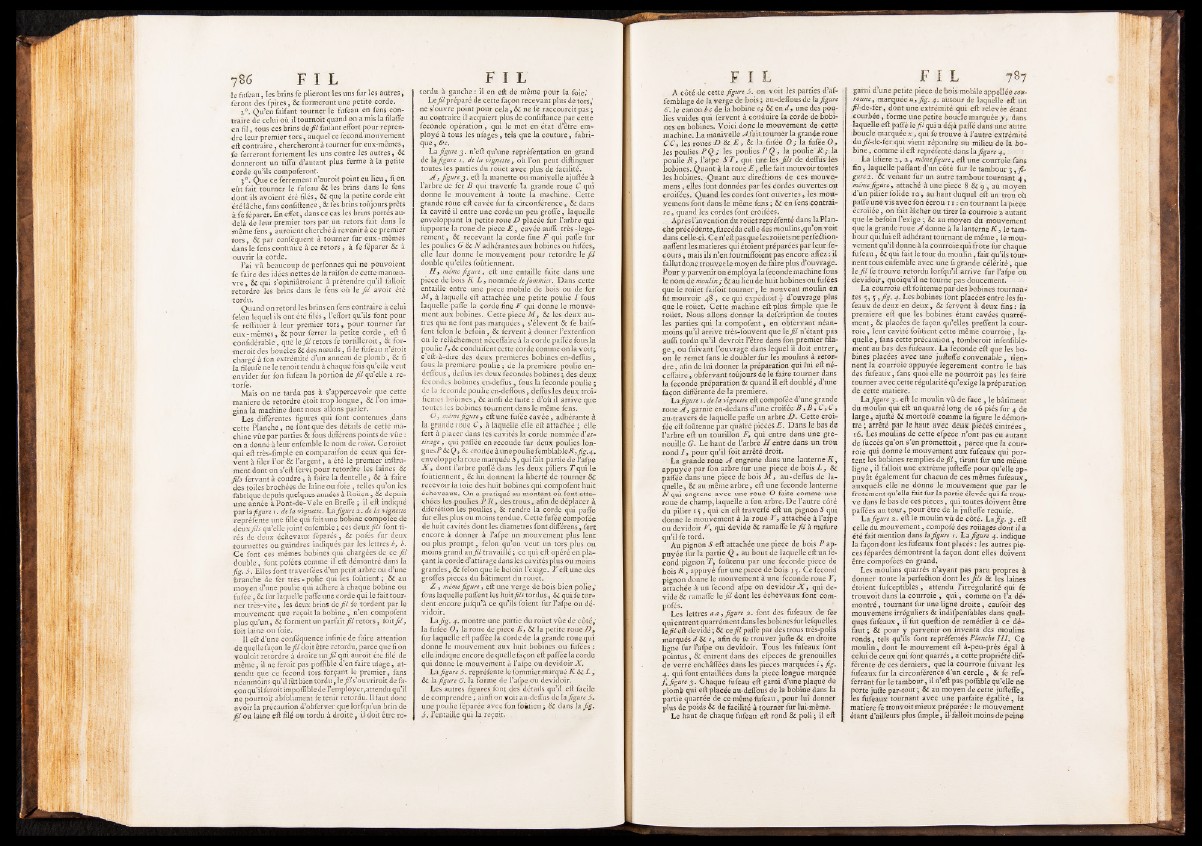
le fufeau, les brins fe plieront les uns fur les autres,
feront des fpires, & formeront une petite corde.
20. Qu’en faifant tourner le fufeau en fens contraire
de celui oii il tournoit quand on a mis la filaffe
«n fil, tous ces brins da-fil faifant effort pour reprendre
leur premier tors, auquel ce fecond-mouvement
efl contraire, chercheront à tourner fur eux-mêmes,
fe ferreront fortement les uns contre les autres, &
donneront un tiifu d’autant plus ferme à la petite
corde qu’ils compoferont.
30. Que ce ferrement n’auroit point eu lieu, fi on
eût fait tourner le fufeau & les brins dans -le fens
dont ils avoient été filés, & que la petite corde eût
été lâche, fans confiftence, & les brins toûjoursprêts
à fe féparer. En effet, dans ce c-as les brins portes au-
delà de leur premier tors par un retors fait dans le
même fens, auroient cherché à revenir à ce premier
tors, & par conféquent à tourner fur eux-mêmes
dans le fens contraire à ce retors, à fe féparer & à
ouvrir la corde.
.T’ai vû beaucoup de perfonnes qui ne pouvoient
fe faire des idées nettes de la raifon de cette manoeuvre
, & qui s’opiniâtroient à prétendre qu’il falloit
■ retordre les brins dans le fens où le f i l avoit été
tordu.
Quand on retord les brins en fens contraire à celui
félon lequel ils ont été filés, l’effort qu’ils font pour
fe reftituer à leur premier tors, pour tourner fur
eux-mêmes, & pour ferrer la petite corde , efl: fi
confidérable, que le f i l retors fe tortilleroit, & for-
meroit des boucles & des noeuds, fi le fufeau n’étoit
chargé à fon extrémité d’un anneau de plomb , & fi
la fileufe ne le tenoit tendu à chaque fois qu’elle veut
envider fur fon fufeau la portion de f i l qu’elle a re-
torfe.
Mais on ne tarda pas à s’appercevoir que cette
maniéré de retordre étoit trop longue, & l’on imagina
la machine dont nous allons parler.
Les différentes figures qui font contenues .dans
■ cette Planche, ne font que des détails de cette machine
vûe par parties & fous différens points de vue :
on a donné à leur enfemble le nom de rouet. Ceroiiet
■ qui efl très-fimple en comparaifon de ceux qui fervent
à filer l’or & l’argent, a été le premier infiniment
dont on s’eft fervi pour retordre les laines &
fils fervant à coudre, à faire la dentelle, & à faire
des toiles brochées de laine ou foie , telles qu’on les
fabrique depuis quelques années à Rouen, & depuis
une année à Pont-de-Vele en Breffe ; il efl: indiqué
par la figure 1. delà vignette. La figure 2 . de la vignette
repréfente une fille qui fait une bobine compofée de
deu x fils qu’elle joint enfemble ; ces deux fils font tirés
de deux échevaux féparés, 8c pofés fur deux
rournettes ou guindres indiqués par les lettres b} b.
■ Ce font ces mêmes bobines qui chargées de ce f i l
-double, font pofées comme il eft démontré dans la
fig. 6 . Elles font traverfées d’un petit arbre ou d’une
branche de fer très - polie qui les foûtient ; & au
moyen d’une poulie qui adhéré à chaque bobine ou
fufée, & fur laquelle paffeune corde qui le fait tourner
très-vite, les deux brins de f i l fe tordent par le
mouvement que reçoit la bobine, n’en compofent
plus qu’un, & forment un parfait f i l retors, loit f i l ,
l'oit laine ou foie.
Il eft d’une conféquence infinie de faire attention
de quelle façon le f i l doit être retordu, parce que fi on
vouloit retordre à droite un f i l qui auroit été file de
même, il ne feroit pas poflible d’en faire ufage, attendu
que ce fécond tors forçant le premier, fans
néanmoins qu’il fût bien tordu, le_/z/s’ouvriroit de façon
qu’il feroit impoflible de l’employer,attendu qu’il
ne pourront abfolument fe tenir retordu. Il faut donc
avoir la précaution d’obferver que lorfqu’un brin de
f il ou laine eft filé ou tordu à droite, il doit être retordu
à gauche : il en eft de même pour la foie.1
Le f i l préparé de cette façon recevant plus de tors,'
ne s’ouvre point pour cela, & ne fe raccourcit pas ;
au contraire il acquiert plus de confiftance par cette
fécondé opération, qui le met en état d’être employé
à tous les ufages, tels que la couture, fabrique
, &c.
La figure 3 . n’eft qu’une repréfentation en grand
de la figure 1. de la vignette, où l’on peut diftinguer
toutes les parties du roiiet avec plus de facilité.
A , figure 3 . eft la manette ou manivelle ajuftée à
l’arbre de fer B qui traverfe la grande roue C qui
donne le mouvement à toute la machine. Cette
grande roue eft cavée fur fa circonférence, 8c dans
fa cavité il entre une corde un peu groffe, laquelle
enveloppant la petite roue D placée fur l’arbre qui
fupporte la roue de piece E , cavée aufli très -lege-
rement, 8c recevant la corde fine F qui palfe fur
les poulies G 8c N adhérantes aux bobines ou fufées,
elle leur donne le mouvement pour retordre le f il
double qu’elles foûtiennent.
H , même figure, eft une entaille faite dans une
piece de bois K L , nommée le fommier. Dans cette
entaille entre une piece mobile de bois ou de fer
M , à laquelle eft attachée une petite poulie I fous
laquelle paffe la corde fine F qui donne le mouvement
aux bobines. Cette piece M , 8c les deux autres
qui ne font pas marquées, s’élèvent & fe baif-
fent lelon le befoin , & fervent à donner l’extenfion
ou le relâchement néceffaireà la corde paflee fous la
poulie I , 8c conduifentcette corde comme onia voitj
c’eft-à-dire des deux premières bobines en-deflus ,
fous la première poulie ; de la première poulie en-
deflous, deflus les deux fécondés bobines ; des deux
fécondés bobines en-deflus, fous la fécondé poulie ;
de la fécondé poulie en-deffous, defliis les deux troi»
fiemes bobines, 8c ainfi de fuite : d’où il arrive que
toutes les bobines tournent dans le même fens. .
O , même figure, eft une fufée cavée, adhérante à
la grande roue C , à laquelle elle eft attachée ; elle
fert à placer dans fes cavités la corde nommée d'at~
tirage , qui paflee en recoude fur deux poulies longues/’
&Q, 8c croilée à une poulie femblable/J, fig .4 ,
enveloppe la roue marquée S , qui fait partie de l’afpe
X , dont l’arbre pafle dans les deux piliers T qui le
foûtiennent, 8c lui donnent la liberté de tourner &
recevoir la ioie des huit bobines qui compofent huit
écheveaux. On a pratiqué au montant où font attachées
les poulies P R , des trous, afin de déplacer à
difcrétion les poulies, & rendre la corde qui pafle
fur elles plus ou moins tendue. Cette fufée compofée
de huit cavités dont les diamètres font différens, fert
encore à donner à l’afpe un mouvement plus lent
ou plus prompt, félon qu’on veut un tors plus ou
moins grand au f i l travaillé ; ce qui eft opéré en plaçant
la corde d’attirage dans les cavités plus ou moins
grandes, 8c félon que le befoin l’exige. Y eftune des
groffes pièces du bâtiment du roiiet.
Z y même figure, eft une verge de bois bien polie,’
fous laquelle paffent les huit fils tordus, & qui fe tordent
encore julqu’à ce qu’ils foient fur l’afpe ou dévidoir.
La fig. 4. montre une partie du roiiet vûe de côté,'
la fufée O , la roue de piece E , 8c la petite roue D ,
fur laquelle eft paflee la corde de la grande roue qui
donne le mouvement aux huit bobines ou fufées :
elle indique encore de quelle façon eft paflee la corde
qui donne le mouvement à l’afpe ou dévidoir X .
La figure 5 . repréfente le fommier marqué K 8 c L g
8c la figure Ç. la forme de l’afpe ou dévidoir.
Les autres figures font des détails qu’il eft facile
de comprendre ; a i n f i on voit au-defliis de la figure S .
une poulie féparée avec fon foûtien - & flans la fig»
â . l’entaille qui la reçoit, .
A côté dé cette figure 5 . on voit les parties d’àf-
femblage de la verge de bois ; au-deffous de U figure
è . le canon k c de la bobine e>* 8c en d , une des poq-
lies vuides qui fervent à conduire la corde de bobines
en bobines. Voici donc Te mouvement de cette
machine. La manivelle Xfait tourner la grande roue
C C , les roues D 8c E , 8c la fitféé O ; la fufée O ,
les poulies P Q j le s poulies P Q , la poulie'R .^la
poulie R y i’afp.e S T , qui tire les fils de defliisriés
bobines .iQuant à la roue E , elle fait mouvoir toutes
les bobines.. .Quant aux directions de ces mouvçr
mens, elles font données par les cordes ouvertes o#
croifées. Quand les cordes, font ouvertes, les mou-
yemens font .dans le même fens ; 8c en fens contraire
, quand les cordes font croifées.
_ Après l’invention du''roiiet repréfehté dans laPlan-
çhe précédente, fuccéda celle des moulins,qu’on voit
dans celle-ci. Ce n’eft pas que les roiiets neperfeûion-
naffen.t les matières qui étoient préparées par leur fe-
çours , mais ils n?en fourniffoient pas encore affez : il
fallut donc trouver le moyen de faire plus d’ouvrage.
Pour y parveniron employa la fécondé machine fous
le nom de moulin; 8c au lieu de huit bobines ou fufées
que le roiiet faifoit tourner, le nouveau moulin en
fit mouvoir 48 , ce qui expédioit j d’ouvrage plus
que le roiiet. Cette machine eft plus fimple que le
roiiet. Nous allons donner la description de toutes
les parties qui la compofent, en obfervant néanmoins
qu’il arrive très-fouvent que le fiiL n’étant pas
aufli tordu qu’il devroit l’être dans fon premier filar
ge, ou fuivarit:l’ouvrage dans lequel il doit entrer,
on le remet fans le doubler fur les moulins à retordre
, afin de lui donner la préparation qui lui eft né-
çefîaire, obfervant toujours; de le faire tourner dans
la fécondé préparation & quand il eft doublé, d’une
façon différente de la première.
La figure i.d e la vignette eft compofée d’une grande
roue A y garnie en-dedans d’une croifée B ,B yC , C ,
au-travers de laquelle paffe un arbre D . Cette croifée
eft foûtenue par quatre pièces E . Dans le bas de
l’arbre eft un tourillon F , qui entre dans une grenouille
G . Le haut de l’arbre H entre dans un trou
rond I , pour qu’il foit arrêté droit.
La grande roue A engrene dans une lanterne K ,
appuyée par fon arbre lur une piece de bois L , 8c
paflee dans une piece de bois M , au-deflus de laquelle,
8c au même arbre, eft une fécondé lanterne
N qui engrene avec une roue O faite comme une
roue de champ, laquelle a fon arbre. De l’autre côté
du pilier 15 , qui en eft traverfé eft un pignon S qui
donne le mouvement à la roue Y , attachée à l’alpe
ou dévidoir Vy qui dévidé 8c ramaffe le f i l à mefure
qu’il fe tord.
Au pignon S eft attachée une piece de bois P appuyée
fur la partie Q , au bout de laquelle eft un fécond
pignon T y loûtenu par une fécondé piece de
bois R y appuyé fur une piece de bois 15. Ce fécond
pignon donne le mouvement à une fécondé roue Y y
attachée à un fécond afpe ou dévidoir X , qui de-
vide & ramaffe le f i l dont les écheveaux font com-
pofés. ' 1
Les lettres a a , figure 2 . font des fufeaux de fer
qui entrent quarrément dans les bobines fur lefquelles.
le f i l eft dévidé ; & c e f i l paffe par des trous très-polis
marqués d&c e 9 afin de fe trouver jufte & en droite
ligne fur l’afpe ou dévidoir. Tous les fufeaux font
pointus, & entrent dans des efpeces de grenouilles
de verre enchâflees dans les pièces marquées i , fig.
4. qui font entaillées dans la piece longue marquée
f 9 figure 3. Chaque fufeau eft garni d’une plaque de
plomb qui eft placée au-deffous de la bobine dans la
partie quarrée de ce même fufeau, pouf lui donner
plus de poids & de facilité à tourner fur lui-même.
Le haut de chaque fufeau eft rond & poli; il eft
garni d’une petite piece de bois mobile appellée couronne
, marquée u , f ig . 4. autour de laquelle eft un
fil-.derfer., dont une extrémité qui eft relevée étant
:courbée, forme une petite boucle marquée y , dans
laquelle eft paffé le f i l qui a déjà pafle dans une autre
1 boucle marquée a:, qui fe trouve à l’autre extrémité
du j?/-de-fer.qui vient répondre au milieu de là bobine,
comme il eft représenté'dan? la fig u re 4. %
La iifiere 1 , x , même figure y eft une courroie fans
fin, laquelle paffant d’un côté fur le tambour 3 , f i g
u r e z . &c venant fur un autre tambour tournant 4 ,
même f ig u r e , attaché à une piece 8 & 9 , au moyen
d’un pilier folide 10 , au haut duquel eft un trou où
paffe une visavec fon écrou 11 : en tournant la piece
écroiiée, on fait lâcher ou tirer la courroie 2 autant
que le befoin l’exige ; & au moyen du mouvement
que la grande;f que A donne à la lanterne K , le tambour
qui luieft adhérant tournant de même, le mouvement
qu’il dqnne à la courroiequi frbte fur chaque
fufeau, 8c qui fait le tour du moulin, fait qu’ils tournent
tous enfemble avec une fi grande célérité, que
le f i l fe trouve retordu lorfqu’il arrive fur l’afpe ou
dévidoir, quoiqu’il ne tourne pas doucement.
La courroie eft foûtenue par des bobines tournantes
5, 5 f f ig . 4. Les bobines font placées entre les fufeaux
de deux en deux, & fervent à deux fins : la
première eft que les bobines étant cavées quarré-*
ment, & placées de façon qu’elles preffent la courroie
, leur cavité foûtient cette même courroie, laquelle
, fans cette précaution, tomberoit infenfible-
ment au bas des fufeaux. La fécondé eft que les bobines
placées avec une juftefle convenable, tiennent
la courroie appuyée Iegerement contre le bas
des fufeaux, fans quoi elle ne pourroit pas les faire
tourner avec,cette régularité qu’exige la préparation
de cette matière.
La figure j . eft le moulin vû de face, le bâtiment
du moulin qui eft un quarré long de 16 piés fur 4 de
large, ajufté & mortoifé comme la figure le démontre
; arrêté par le haut avec deux pièces cintrées ,
16. Les moulins de cette efpece n’ont pas eu autant
de fuccès qu’on s’en promettoit, parce que la courroie
qui donne le mouvement aux fufeaux qui portent
les bobines remplies de f i l , tirant fur une même
ligne, il falloit une extrême juftefle pour qu’elle appuyât
également fur chacun de ces mêmes fufeaux,
auxquels elle ne donne le mouvement que par le
frotement qu’elle fait fur la partie élevée qui fe trouve
dans le bas de ces pièces, qui toutes doivent êtr®
paffées au tour, pour être de la jufteffe requife.
La figure 2 . eft le moulin vû de côté . La f ig . 3 . eft
celle du mouvement, compofé des roiiages dont i l a
été fait mention dans la figure 1. La figure 4. indique
la façon dont les fufeaux font placés : les autres pièces
féparées démontrent la façon dont elles doivent
être compofées en grand.
Les moulins quarrés n’ayant pas paru propres à
donner toute la perfeâion dont les f i l s & les laines
étoient fufceptibles , attendu l’irrégularité qui fe
trouvoit dans la courroie , qui, comme on l’a démontré
, tournant fur une ligne droite, caufoit des
mouvemens irréguliers & indifpenfables dans quelques
fufeaux, il fut queftion de remédier à ce défaut
; & pour y parvenir on inventa des moulins
ronds, tels qu’ils font repréfentés Plan ch e I I I . Ce
moulin, dont le mouvement eft à-peu-près égal à
celui de ceux qui font quarrés, a cette propriété différente
de ces derniers, que la courroie fuivant les
fufeaux fur la circonférence d’un cercle , & fe ref-
ferrant fur le tambour, il n’eft pas poflible qu’elle ne
porte jufte par-tout ; &c au moyen de cette jufteffe,
les fufeaux tournant avec une parfaite égalité, la
matière fe trouvoit mieux préparée: le mouvement
étant d’ailleurs plus fimple, il-falloit moins de peine