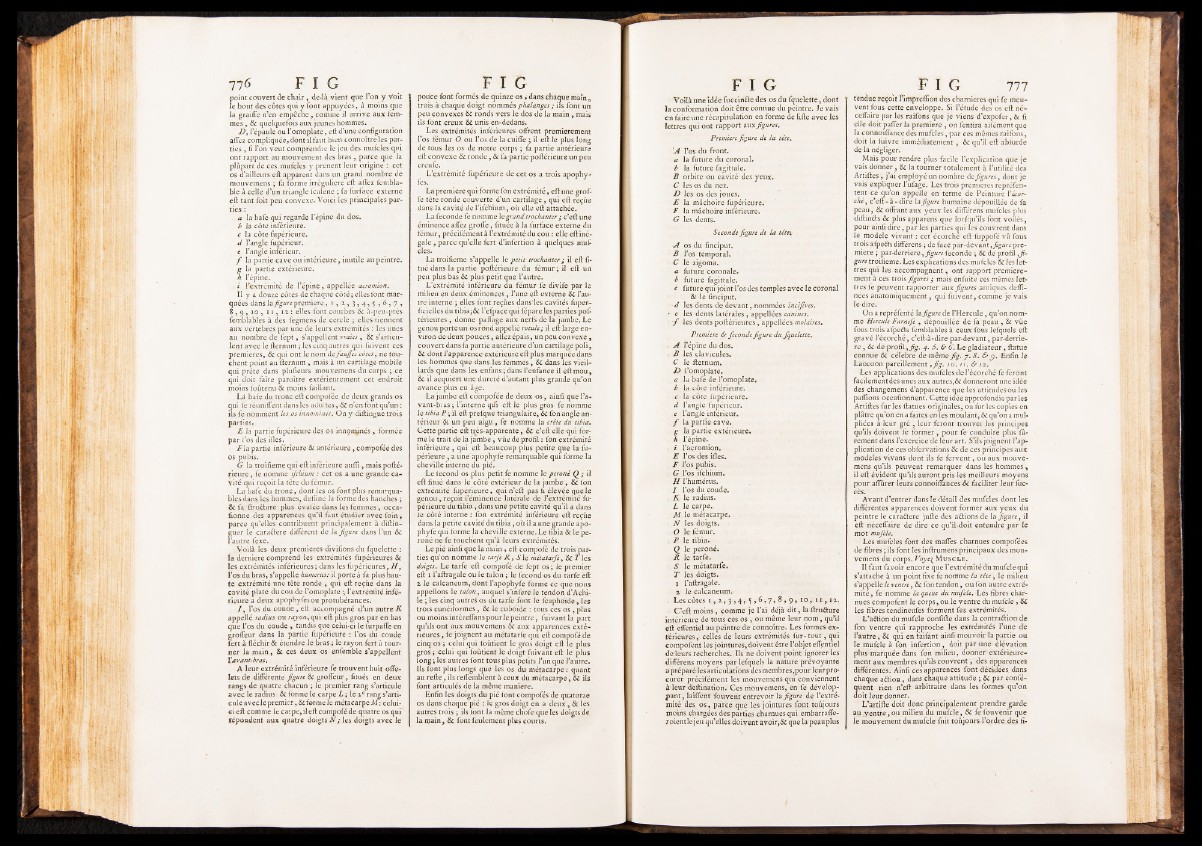
77*5 F I G
point couvert de chair, -de-là. vient que l’on y Voit 1
le bout des côtes qui y font appuyées, à moins que
la graiffe n’en empêche , comme il arrive aux femmes
, & quelquefois aux jeunes hommes.
D , l’épaule ou l’omoplate, eft d’une configuration
affez compliquée, dont il faut bien connoîtreles parties
, fi l’on veut comprendre le jeu des mufcles qui
ont rapport au mouvement des bras , parce que la
plupart de ces mulcles y prenent leur origine : cet
os d’ailleurs eft apparent dans un grand nombre de
mouvemens ; ;fa forme irrégulière eft affez fembla-
ble à celle d’un triangle fcalene ; fa furface externe
eft tant foit peu convexe. Voici les principales parties
:
a la bafe qui regarde l’épine du dos.
b la côte inférieure.
c la côte fupérieure.
d l’angle fupérieur.
e l’angle inférieur.
ƒ la partie cave ou intérieure, inutile au peintre.
g la partie extérieure.
h l’épine.
• i l’extrémité de l’épine, appellée acromion.
Il y a douze côtes de chaque côté; elles font mar?
quées dans la figure première, i , 2 , 3 ,4 , 5 , 6 , 7 ,
8 ,9, 10, 11 , 12 : elles font courbes 6c à-peu-près
femblables à des fegmens de cercle ; elles tiennent
aux vertèbres par une de leurs extrémités : les unes
au nombre de fept, s’appellent vraies , 6c s’articulent
avec le fternum ; les cinq autres qui fuivent ces
premières, & qui ont le nom de fiauffes côtes y ne touchent
point au fternum , mais à un cartilage mobile
qui prête dans plufieurs mouvemens du corps ; ce
qui doit faire paroître extérieurement cet endroit
moins foûtenu & moins faillant.
Là bafe du tronc eft compofée de deux grands os
qui fe réunifient dans les adultes,6 c n’en font qu’un :
ils fe-nomment Les os innommés. On y diftingue trois
parties.
E la partie fupérieure des os innonÿnés , formée
par i’os des ifles.
.Fia partie inférieure & antérieure, compofée des
os pubis.
G la troifieme qui eft inférieure aufli, mais poftérieure
, fe nomme ifehium : cet os a une grande cavité
qui reçoit la tête du fémur.
La bafe du tronc, dont les os font plus remarquables
dans les hommes, defîîne la forme des hanches ;
& fa ftruânre plus évalée dans les femmes, occa-
lionne des apparences qu’il faut étudier avec foin,
parce qu’elles contribuent principalement à diftin-
guer le çaraôere différent de la figure dans l’un 6c
l ’autre fexe.
Voilà les deux premières divifions du fquelette :
la derniere comprend les extrémités fupérieures &
les extrémités inférieures ; dans les fupérieures, H y
l’os du bras, s’appelle humérus: il porte à fa plus haute
extrémité une tête ronde , qui eft reçue dans la
cavité plate du cou de l’omoplate ; l’extrémité inférieure
a deux apophyfesou protubérances.
1 y l’os du coude , eft accompagné d’un autre K
appellé radius ou rayon,qui eft plus gros par en bas
que l’os du coude , tandis que celui-ci le furpaffe en
groflëur dans la partie fupérieure : l’os du coude
fert à fléchir & étendre le bras ; le rayon fert à tourner
la main, & ces deux os enfemble s’appellent
Xavant-bras.
A leur extrémité inférieure fe trouvent huit offe-
lets de différente figure 6c groffeur, fitués en deux
rangs de quatre çhacun ; le premier rang s’articule
avec le radius 6c forme le carpe L , le 2d rang s’articule
avec le premier, 6c forme le métacarpe M : celui-
ci eft comme le carpe, il eft compofé de quatre os qui
répondent aux quatre doigts N ; les doigts avec le
F I G
pouce font formés de quinze os, dans chaque maîn -
trois à chaque doigt nommés phalanges ; ils font un
peu convexes 6c ronds vers le dos de la main, mais
ils font creux 6c unis en-dedans.
Les extrémités inférieures offrent premièrement
l’os fémur O ou l’os de la cuiffe ; il eft le plus long
de tous les os de notre corps ; fa partie antérieure
eft convexe & ronde, & fa partie poftérieure un peu
creufe.
L’extrémité fupérieure de cet os a trois apophy-*
fes. La première qui forme fon extrémité, eft une grof-
fe tête ronde couverte d’un cartilage, qui eft reçue
dans la cavité de l’ifehium, oii elle eft attachée.
La fécondé fe nomme le grand trochanter ; c’eft une
éminence affez groffe, fituée à la furface externe du
fémur, précifément à l’extrémité du cou : elle eft inégale
, parce qu’elle fert d’infertion à quelques muf
clés.
La troifieme s’appelle 1 e petit trochanter ; il eft fi-
tué dans la partie poftérieure du fémur ; il eft un
peu plus bas 6c plus petit que l’autre.
L’extrémité inférieure du fémur fe divife par le
milieu en deux éminences, l’une eft externe 6c l’autre
interne ; elles font reçûes dans'les cavités fuper-
ficielles du tibia;& l’efpace qui fépare les parties postérieures
, donne paffage aux nerfs de la jambe. Le
genou porte un os rond appellé rotule; il eft large environ
de deux pouces, affez épais, un peu convexe ,
couvert dans fa partie antérieure d’un cartilage poli,
6c dont l’apparence extérieure eft plus marquée dans
les hommes que dans les femmes, 6c dans les vieillards
que dans les enfans ; dans l’enfance il eft mou ,
6c il acquiert une dureté d’autant plus grande qu’on
avance plus en âge.
La jambe eft compofée de deux os, ainfi. que l’a-
vant-bras ; l’interne qifi eft le plus gros fe nomme
le tibia P ; il eft prefque triangulaire, 6c fon angle antérieur
& un peu aigu , fe nomme la crête du tibia.
Cette partie eft très-apparente, 6c c’eft elle qui forme
le trait de la jambe, vue de profil : fon extrémité
inférieure , qui eft beaucoup plus petite que la fupérieure
, a une apophyfe remarquable qui forme la
cheville interne du pié.
Le fécond os plus petit fe nomme le péroné Q ; il
eft fitué dans le côté extérieur de la jambe , 6c ion
extrémité fupérieure, qui n’eft pas fi élevée que le
genou, reçoit l’éminence latérale de l’extrémité fupérieure
du tibia, dans une petite cavité qu’il a dans
le côté interne : fon extrémité inférieure eft reçue
dans la petite cavité du tibia, oit il a une grande apophyfe
qui forme la cheville externe. Le tibia & le péroné
ne fe touchent qu’à leurs extrémités.
Le pié ainfi que la main, eft compofé de trois parties
qu’on nomme le tarfe R , S le métatarfe, 6c T les
doigts. Le tarfe eft compofé de fept os ; le premier
eft 1 l’aftragale ou le talon ; le fécond os du tarfe èft
2 le calcanéum, dont l’apophyfe forme ce que nous
appelions le talon, auquel s’inféré le tendon d’Achi-
le ; les cinq autres os du tarfe font le feaphoïde, les
trois cunéiformes, 6c le cuboïde : tous ces os , plus
ou moins intéreffans pour le peintre, fuivant la part
qu’ils ont aux mouvemens 6c aux apparences extérieures
, fe joignent au métatarfe qui eft compofé de
cinq os ; celui qui foûtient Je gros doigt eft le plus
gros ; celui qui foûtient le doigt fuivant eft le plus
long ; les autres font tous plus petits l’un que l’autre.
Ils font plus longs que les os du métacarpe : quant
au refte, ils reffemblent à ceux du métacarpe, oc ils
font articulés de la même maniéré.
Enfin les doigts du pié font compofés de quatorze
os dans chaque pié : le gros doigt en a deux, & les
autres trois ; ils tont la même chofe que les doigts de
la main, 6c font feulement plus courts.
F I G Voilà une idée fuccin&e des os du fquelette, dont
ïa conformation doit être connue du peintre. Je vais
en faire une récapitulation en forme de lifte avec les
lettres qui ont rapport aux figures.
Première figure de la tête.
A l’os du front.
a la future du coronaï;
b la future fagittale.
B orbite ou cavité des yeux.
C les os du nez.
D les os des joues.
E la mâchoire fupérieure.
F la mâchoire inférieure.
G les dents.
Seconde figure de la têtes
\A os du finciput.
B l’os temporal.
C le zigoma.
a future coronale.
b future fagittale. •
c future qui joint l’os des temples avec le coronal
& lé finciput.
d les dents de devant, nommées incijives.
* e les dents latérales , appellées canines.
; f i les dents poftérieures, appellées molaires.
Première & fécondé figure du. fquelette.
. A l’épine du dos.
. B les clavicules.
C le fternum.
;l’qmoplate.
a la bafe de l’omoplate.
b la. côte inférieure.
c la cote fupérieure.
d l’angle fupérieur.
e l’angle inférieur.
ƒ la partie cave,
g la partie extérieure,
h l’épine.
- i l’acromion.
E l’os des ifles.
F l’os pubis.
G l’os ifehium.
H l’humérus.
I l’os du, coude.
: K le radius.
L le carpe.
M le métacarpe,
■ N les doigts. ;
0 le fémur.
- P le tibia.
Q le péroné.
R le tarfe.
• S le métatarfe.
T les doigts.
1 l’aftragale.
2 le calcanéum.
. Les côtes 1 ,2 , 3 ,4 , 5 9 6 ,7 ,8 ,9 , 10, 11 ,12 .
- C ’eft moins, comme je l’ai déjà dit, laftruâure
intérieure de tous ces os , ou même leur nom, qu’il
eft efferttiel au peintre de connoître. Les formes ex térieures,
celles de leurs extrémités fur-tout, qui
compofent les jointures, doivent être l’objet effentiel
deleurs recherches. Ils ne doivent point ignorer les
différens moyens par lefquels la nature prévoyante
a préparé les articulations dès membres ,pour leur pro-
curèr précifément les mouvemens qui conviennent
à leur deftination. Ces mouvemens, en fe développant,
laiffent fouvent entrevoir la figure de l’extrémité
des os, parce que les jointures font toûjours
moins chargées des parties charnues qui embarraffe-
roientlejeu qu’elles doivent avoir,& que la peauplus
F I G 777 tendue reçoit Pimpreffion des charnières qui fe meuvent
fous cette enveloppe. Si l’étude des os eft né-
ceffaire par les raifons que je viens d’expofer, & fi
elle doit paffer la première , on fentira aifément que
la connoiffance des mufcles, par ces mêmes raifons,
doit la fuivre immédiatement, & qu’il eft abfurde
de la négliger.
Mais pour rendre plus facile l’explication que je
vais donner, 6c la tourner totalement à l’utilité des
Artiftes, j’ai employé un nombre de figures, dont je
vais expliquer l’ufage. Les trois premières repréfen-
tent ce qu’on appelle en terme de Peinture Xécor-
ché, c’eft-à-dire la figure humaine dépouillée de fa
peau, 6c offrant aux yeux les différens mufcles plus
diftinfts 6c plus apparens que lorfqu’ils font voilés,
pour ainfi dire, par les parties qui les couvrent dans
le modèle vivant : cet écorche eft fuppofé vu fous
trois afpe&s différens ; de face par-devant, figure première
; par-derriere , figure fécondé ; 6c de profil,f i gure
troifieme. Les explications des mufcles & les lettres
qui les accompagnent, ont rapport premièrement
à ces trois figures ,* mais enfuite ces mêmes lettres
fe peuvent rapporter aux figures antiques deffi-
nées anatomiquement, qui fuivent, comme je vais
lé- dire.
On a repréfenté lafigure de l-’Hercule, qu’onnom-
me Hercule Famefe , dépouillée de fa peau , & vue
fous trois afpefts femblables à ceux fous lefquels eft
gravé l’écorché, c’eft-à-dire par-devant, par-derrie-
re , & de profil, fig. 4 .6 . & G. Le gladiateur, ftatue
connue 6c célébré de même fig. y . 8. & £ . Enfin le
Laocoon pareillement ,fig . 10. //. & t z .
Les applications des mufcles de l’écorché fe feront
facilement des unes aux autres,& donneront une idée
des chàngemens d’apparence que les attitudes ou les
pallions oecafionnent. Cette idée approfondie par les
Artiftes fur les ftatues originales, ou fur les copies en
plâtre qu’on en a faites en les moulant, 6c qu’on a mul-
pliées à-leur gré , leur feront-trouver les principes
qu’ils doivent fe former, pour fe conduire plus fû-
rement dans l’exercice de leur art. S’ils joignent l’application
de ces obfervations & de ces principes' aux
modèles vivans dont ils fe fervent , ou aux mouvemens
qu’ils peuvent remarquer dans- les. hommes ,
il eft évidënt qu’ils auront pris les meilleurs moyens
pour affurer leurs connoiffances 6c faciliter leur fuc-
cès.A
vant d’entrer dans le détail des mufcles dont les
différentes apparences doivent former aux yeux du
peintre le caraôere jufte des attions de la figure, il
eft néceffaire de dire ce qu’il.doit entendre par le
mot mufcle.
Les mufcles font des maffes charnues compofées
de fibres ; ils font les inftrumens principaux des mouvemens
du corps. Voyt{ M u s c l e .
Il faut favoir encore que l’extrémité du mufcle qui
s’attache à un point fixe fe nomme la tête, le milieu
s’appelle le ventre, 6c fon tendon, ou fon autre extrémité
, fe nomme la queue du mufcle. Les fibres charnues
compofent le corps, ou le ventre du mufcle, 6c
les fibres tendineufes forment fes extrémités.
L’aétion du mufcle confifte dans la contraâion de
fon ventre qui rapproche les extrémités l’une de
l’autre, 6c qui en faifant ainfi mouvoir la partie ou
le mufcle à fon infertion , doit par une élévation
plus-marquée dans fon milieu, donner extérieurement
aux membres qu’ils couvrent, des apparences
différentes; Ainfi ces apparences font décidées, dans
chaque attion, dans.chaque attitude ; 6c par conféüent
rien n’eft arbitraire dans les formes qu’on
oit leur donner.
L’artifte doit donc principalement prendre garde
au ventre, ou milieu du mufcle, 6c fe fouvenir que
le mouvement du mufcle fuit toûjours l’ordre des fi