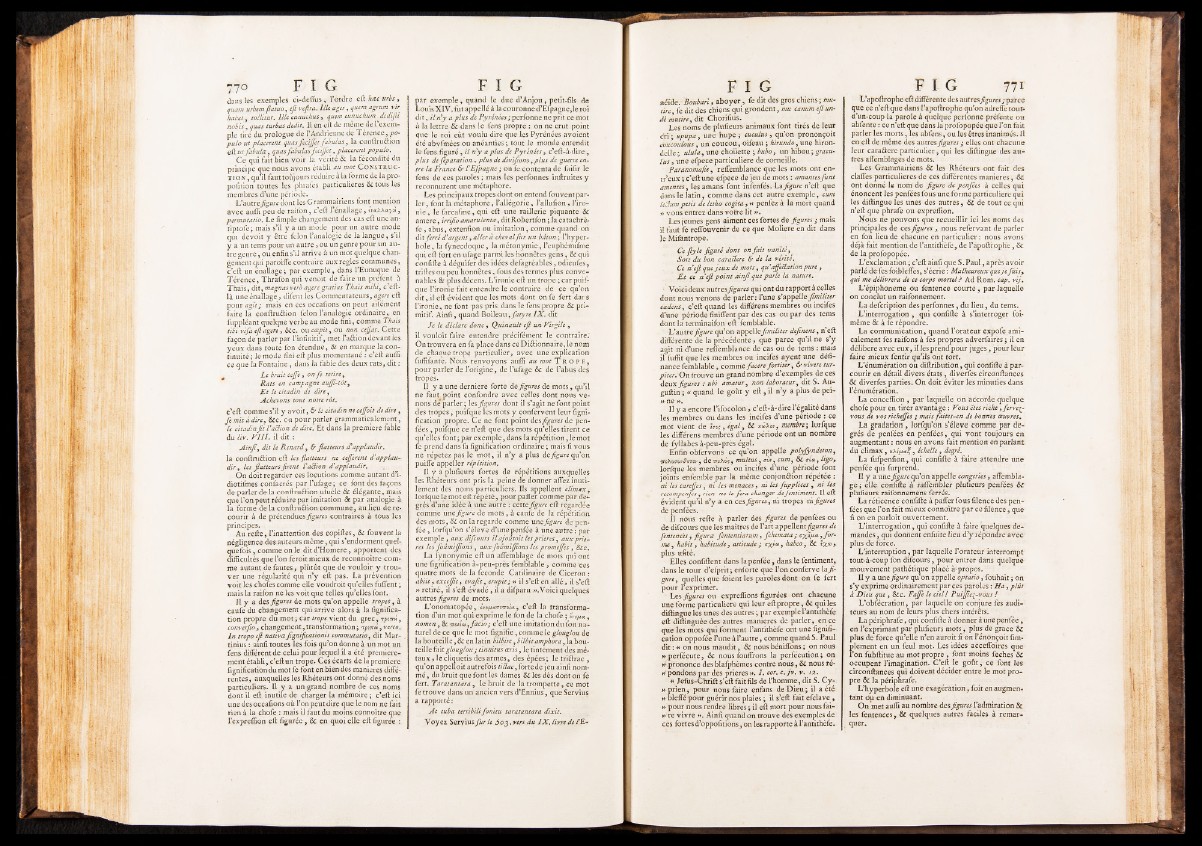
dans les exemples ci-deffus, l’ordre eft hac urbs,
quam urbem flatuo, cji vefira. llle ager, quem agrum vir
habit, toLlitur. Ille tunuchus, quem eunuchum dedijii
nobis, quas turbas dédit. Il en eft de meme de l exemple
tiré du prologue de l’Andrienne de Térence, populo
ut placèrent quas fecijfet fabulas, la conftruûion
eft ut fa b u la , quas fabulas fecijfet, placèrent populo.
Ce qui fait bien voir la vérité & la fécondité du
principe que nous avons établi o.u mot C o n s t r u c t
i o n , qu’il fauttoûjours réduire àla forme de la proportion
toutes les phrafes particulières 8c tous les
membres d’une période. . .. ' ; ;
L’autre figure dont les Grammairiens font mention
avec aufli peu de raifon, c’eft l’enallage, iva.xxa.yn ,
permutatio. Le fini pie changement des cas eft une ân-
tiptofe; mais s’il y a un mode pour un autre mode
qui devoit y être félon l’analogie de la langue, s’il
y a un tems pour un autre, ou un genre pour un autre
genre, ou enfin s’il arrive à un mot quelque changement
qui paroiffe contraire aux réglés communes,
c’eft un énallage ; par exemple, dans l’Eunuque de
Térence, Thrafon qui venoit de faire un préfent à
Thaïs, dit, magnas vero agere gratias Thaïs mihi, c’eft-
là une énallage, difent les Commentateurs, agere eft
pour agit; mais en ces occafions on peut ailement
faire la conftru&ion félon l’analogie ordinaire, en
fuppléant quelque verbe au mode fini, comme Thaïs
tibi vifa ejl agere , ôcc. ou coepit, ou non cejjat. Cette
façon de parler par l’infinitif, met l’aâion devant les
yeux dans toute fon étendue, & en marque la.continuité
; le mode fini eft plus momentané : c’eft aufli
ce que la Fontaine, dans la fable des deux rats, dit :
Le bruit cejfe , on fe retire,
Rats en campagne aujjî-tôt,
E t le citadin de dire,
Achevons tout notre rôt.
c’eft comme s’il y avoir, & le citadin ne cejfoit de dire ,
f e mit à dire, Ôcc. ou pour parler grammaticalement,
le citadin f it Vaction de dire. Et dans la première fable
du liv. V IH . il dit :
A in fi, dit le Renard, & flatteurs et applaudir.
la conftru&ion eft les flatteurs ne cejferent d'applaudir
, les flatteurs firent Vaction d'applaudir.
On doit regarder ces locutions comme autant d’i-
diotifmes confacrés parl’ufage; ce font des façons
de parler de la conftruâion ufuèle 8c élégante, mais
que l’on peut réduire par imitation & par analogie à,
la forme de la conftruâion. commune, au lieu de recourir
à de prétendues figures contraires à tous les
principes.
Au refte, l’inattention des copiftes, 8c fouventla
négligence des auteurs même, qui s’endorment quelquefois
, comme on le dit d’Homere, apportent des
difficultés que l’on feroit mieux de reconnoître comme
autant de fautes , plûtôt que de vouloir y trouver
une régularité qui n’y eft pas. La prévention
voit les chofes comme elle voudroit qu’elles fuffent ;
mais la raifon ne les voit que telles qu’elles font.
Il y a des figures de mots qu’on appelle tropes, à
caufe du changement qui arrive alors à la lignification
propre du mot ; car trope vient du grec, ipoir»,
converfio, changement, transformation ; , verto.
In tropo ejl nativa fignificationis commutatio, dit Mar-
tinius : ainfi toutes les foi6 qu’on donne à un mot un
fens différent de celui pour lequel il a été premièrement
établi, c’eft un trope. Ces écarts de la première
fignificatïon du mot fe font en bien des maniérés différentes,
auxquelles les Rhéteurs ont donné des noms
particuliers. U y a un grand nombre de ces noms
dont il eft inutile de charger la mémoire ; c’eft ici
une des occafions où l’on peut dire que le nom ne fait
rien à la chofe : mais il faut du moins connoître que
l’expreffion eft figurée, ôc en quoi elle eft figurée :
par exemple, quand le duc d’Anjou, petit-fils de
Louis XIV. fut appellé à la couronne d’Efpagne,le roi
dit, i l n'y a plus de Pyrénées; perfonne ne prit ce mot
à la lettre & dans le fens propre : on ne crut point
que le roi eût voulu dire que les Pyrénées avoient
été abyfmées ou anéanties ; tout le monde entendit
le fens figuré, U n y a plus de Pyrénées, c’eft-à-dire,
plus de feparation, plus de divifions, plus de guerre entre
la France & CEfpagne ; on fe contenta de faifir le
fens de ces paroles ; mais les perfonnes inftruites y
reconnurent une métaphore.
Les principaux tropes dont on entend fouvent parler
, font la métaphore, l’allégorie, l’allufion, l’ironie,
le farcafme, qui eft une raillerie piquante &
amere, irrifio amarulenta, dit Robertfon ; la catachrè-
fe , abus, extenfion ou imitation, comme quand on
dit ferré d'argent, aller à chevalfur un bâtons l’hyperbole,
la fynecdoque, la métonymie, l’euphémifme
qui eft fort en ufage parmi les honnêtes gens, 8c qui
confifte à déguifer des idées defagréables, odieufes,
triftes ou peu honnêtes, fous des termes plus convenables
& plus décens. L’ironie eft un trope ; car puif-
que l’ironie fait entendre le contraire de ce qu’on
dit, il eft évident que les mots dont onfe fert dar s
l’ironie, ne font pas pris dans le fens propre 8c primitif.
Ainfi, quand Boileau ,fatyre IX . dit
Je le déclare donc, Quinaült ejl un Virgile ,
il vouloit faire entendre précifément le contraire.'
On trouvera en fa place dans ceDiéfionnaire, le nom
de chaque trope particulier, avec une explication
fuffifante. Nous renvoyons aufli au mot T r o p e ,
pour parler de l’origine, de l’ufage 6c de l’abus des
tropes.
Il y a une derniere forte de figures de mots, qu’il
ne faut point confondre avec celles dont nous venons
de parler ; les figures dont il s’agit ne font point
des tropes, puifque les mots y confervent leur lignification
propre. Ce ne font point des figures de pen-
fées, puifque ce n’eft que dès mots qu’elles tirent ce
qu’elles font ; par exemple, dans la répétition, le mot
fe prend dans fa lignification ordinaire ; mais fi vous
ne répétez pas le mot, il n’y a plus àefigure qu’on
puiffe appeller répétition.
Il y a plufieurs fortes de répétitions auxquelles
les Rhéteurs ont pris la peine de donner affez inutilement
des noms particuliers. Ils appellent climax,
lorfque le mot eft répété, pour palier comme par déférés
d’une idée à une autre : cette figure eft regardée
comme une figure de mots, à caufe de la répétition
des mots, 6c on la regarde comme une figure de pen-
fée, lorfqu’on s’élève d’une penfée à une autre : par
exemple , aux difcours i l ajoûtoit les prières, aux prières
les foumijfions, aux foûmiffions les promcjfes, 6cc.
La ifynonymie eft un affemblage de mots qui ont
une lignification à-peu-près femblable , comme "ces
quatre mots de la fécondé Catilinaire de Cicéron :
abiit , exceffit, evafit, erupit; *< il s’eft en allé, il s’eft
» retiré, il s’eft évadé , il a difparu ».Voici quelques
autres figures de mots.
L’onomatopée, ei'OyuetTOTro/a, c’eft la transformation
d’un mot qui exprime le fon de la chofe ; ovopia,
nomen, 8c 7ioilo ,fa c io ; c’eft une imitation du fon naturel
de ce que le mot lignifie, comme le glouglou de
la bouteille, 6c en latin bilbire, bilbit amphora, la bouteille
fait glouglou j tinnitus otris, le tintement des métaux
, le cliquetis des armes, des épées; le triélrac ,
qu’on appelloit autrefois ticlac, forte de jeu ainfi nommé
, du bruit que font les dames 6c les dès dont on fe
fert. Taratantara, le bruit de la trompette, ce mot
fe trouve dans un ancien vers d’Ennius, que Servius
a rapporté:
A t tuba terribili fonitu taratantara dixit.
Voyez Servius fu r le 5 03. vers du IX . livre de /’Enéïde
. Boubari , aboyer, fe dit des gros chiens ; mu-
tire y fe dit des chiens qui grondent, mu canum ejl un-
de mutire, dit Chorifiüs.
Les noms de plufieurs animaux font tirés de leur
cri • upupa, une hupe ; cuculus , qu’on prononçoit
cOucoulous, un coucou, oifeau ; hirundo, une hirondelle;
ulula, une choiiette ; bubo, un hibou ; gracu-
lu s , une efpece particulière de corneille.
Paranomafie, reffemblance que les mots ont en-
tr’eux ; c’eft une efpece de jeu de mots. : amantes fun t
ameutes, les amans font inl’enfés. La figure n’eft que
dans le latin, comme dans cet autre exemple, cum
leclum petis de letho cogita,« penfez à la mort quand
» vous entrez dans votre lit ».
Les jeunes gens aiment ces fortes dè figures ; mais
il faut fe reffouvenir de ce que Moliere en dit dans
le Mifantrope.
Ce fly le figuré dont on fa it vanité,
Sort du bon caractère & de la vérité,.
Ce n'ejl que je u x de mots,, qu'affectation pure ,
E t ce n eft point ainfi que parle la nature.
■ Voici deux autres figures qui ont du rapport à celles
dont nous venons de parler: l’une s’appelle fimiliter
cadens, c’eft quand les différens membres ouincifes
d’une période finiffent par des cas ou par des tems
dont la terminaifon eft femblable.
L’autre figure qu’on appelle fimiliter definens, n’eft
différente de la précédente, que parce qu’il ne s’y-
agit ni d’une reffemblance de cas ou de tems : mais
il fuffit que les membres ou incifes ayent une définance
femblable, comme facere fortiter, &vivere tur-
p ite r .O a trouve un grand nombre d’exemples de ces
deux figures : ubi amatur, non laboratur, dit S. Au-
guftin ; « quand le goût y eft , il n’y a plus de pei-
» ne ». • . ‘ ,
Il y a encore l’ifocolon , c’eft-àJ dire l’e^alité dans
les membres ou dans les incifes d’une période : ce
mot vient de ’iaoç, égal, 8t k£\ov9 membre ; lorfque
les différens membres d’une période ont un nombre
de fyllabes à-peu-près égal.
Enfin obiervons ce qu’on appelle polyfyndeton9
•ffoXvevvS'vrov , de ji.oXvç 9 multus , <rw9 cum9 &C <nu9 ltgo9
lorfque les membres ou incifes d’une période font
joints enfemble par la même conjon&ion répétée :
ni les carejjes, ni les menaces , ni les J'upplices , ni les
recompenfes, rien ne le fera changer de Jentiment. Il eft
évident qu’il n’y a en ces figures, ni tropes m figures
de penfées.
Il nous refte à parler des figures de penfées ou
de difcours que les maîtres de l’art appellent/gam de
fentences 9 figura fententiarum, fchemata ; cyf/xa., for me
y habit, habitude , attitude ; ax*a 9 bubeo, ÔC t%u ,
plus ufité.
Elles confiftent dans la penfée, dans le fentiment,
dans le tour d’efprit ; enforte que l’on eonferve la f i gure,
quelles que foient les paroles dont on fe fert
pour l’exprimer.
■ Les figures ou expreflïons figurées ont chacune
une forme particulière qui leur eft propre, & qui les
diftingue les unes des autres ; par exemple l’antithèfe
eft diftinguée des autres maniérés de parler, en ce
que les mots qui forment l’antithèfe ont une lignification
oppofée l’une à l’autre, comme quand S. Paul
dit : « on nous maudit, & nous béniffons ; on nous
» perfécute, & nous fouffrons la perfécution; on
»‘ prononce des blafphèmes contre nous, & nous ré-
tf pondons par des prières ». I . cor. c. jv . v. 12.
« Jefus-Chrift s’eft fait fils de l’homme, dit S. Cy-.
» prien, pour nous faire enfans de Dieu ; il a été
» bleffé pour guérir nos plaies ; il s’eft fait efclave ,
» pour nous rendre libres ; il eft mort pour nous fai-
» re vivre ». Ainfi quand on trouve des exemples de
ces fortes d’oppofitions, on les rapporte à l’antithèfe.
L’apoftrophe eft différente des autres figures ; parce
que ce n’eft que dans l’apoftrophe qu’on adreffetour-
d’un-coup la parole à quelque perlbnne préfente ou
abfente : ce n’eft que dans la profopopée que l’on fait
parler les morts, les abfens, ou les êtres inanimés. Il
en eft de même des autres figures ; elles ont chacune
leur caraâere particulier , qui les diftingue des autres
affemblages de mots.
Les Grammairiens & les Rhéteurs ont fait des
claffes particulières de ces différentes maniérés, ôc
ont donné le nom de figure de penfées à celles qui
énoncent les penfées fous une.forme particulière qui
les diftingue les unes des autres, & de tout ce qui
n’eft que phrafe ou expreffion.
Nous ne pouvons que recueillir ici les noms des
principales de ces figures , nous refervant de parler
en fon lieu de chacune en particulier : nous avons
déjà fait mention de l’antithèfe, de l’apoftroph’e , 6c
de la profopopée.
L’exclamation ; c’eft ainfi que S. Paul, après avoir
parlé de fes foibleffes, s’écrie : Malheureux que j e fu is ,
qui me délivrera de ce corps mortel ? Ad Rom. cap. vij.
L’épiphoneme ou fentence courte, pan laquelle
on conclut un raifonnement.
La defeription des perfonnes, du lieu, du tems.
L’interrogation , qui confifte à s’interroger foi-
même 6c à fe répondre.
La communication, quand l’orateur expofe amicalement
fes raifons à fes propres adverfaires ; il en
délibéré avec eux, il les prend pour jugés, pour leur
faire mieux fentir qu’ils ont tort.
L’énumération ou diftribution, qitl Confifte à parcourir
en détail divers états, diverfés circonftances
6c diverfes parties. On doit éviter les minuties dans
l’énumération.
La conceffion , par laquelle On accorde quelque
chofe pour en tirer avantage : Vous êtes ritht ,ferveç-
vous de vos richejfes ; mais faites-en de bonnes oeuvres.
La gradation, lorfqü’ôn s’élève comme par degrés
de penfées en periféès , qui vont toujours en
augmentant : nous en avons fait mention en parlant
du climax, Y.xip.a.%, échelle, degré.
La fufpenfion, qui confifte à faire attendre une
penfée qui furprena.
Il y a Une figure qu’on appelle congeries , affemblage
; elle confifte à fàfferiibler plufieurs penfées 6c
plufieurs raifonnemens ferrés.
La réticence confifte à paffer fous filence des penfées
que l’on fait mieux connoître par ce filence, que
fi on en parloit ouvertement.
L’interrogation, qui confifte à faire quelques demandes
, qui donnent enfuite lieu d’y répondre avec
plus de force.
L’interruption, par laquelle l’orateur interrompt
tout-à-coup fon difcours, pour entrer dans quelque
mouvement pathétique placé à-propos.
Il y a une figure qu’on appelle optatio, fouhait ; on
s’y exprime ordinairement par ces parolës : H a , plût
à D ieu que , 8cc. Faffe le c ie l! Puijfieq-vous !
L’obfécration, par laquelle on conjure fes auditeurs
au nom de leurs plus chers intérêts.
La périphrafe, qui confifte à donner à une penfée,
en l’exprimant par plufieurs mots, plus de grâce 6c
plus de force qu’elle n’en auroit fi On I’énOnçoit Amplement
en un feul mot. Les idées acceffoires que
l’on fubftitue au mot propre , font moins feches ôc
occupent l’imagination. C’eft le goût, ce font les
circonftances qui doivent décider entre le mot propre
ôc la péripnralè.
L’hyperbole eft une exagération, foit en augmentant
du en diminuant.
On met aufli au nombre des figures l’admiration 6c
les fentences, 6c quelques autres faciles à remarquer.