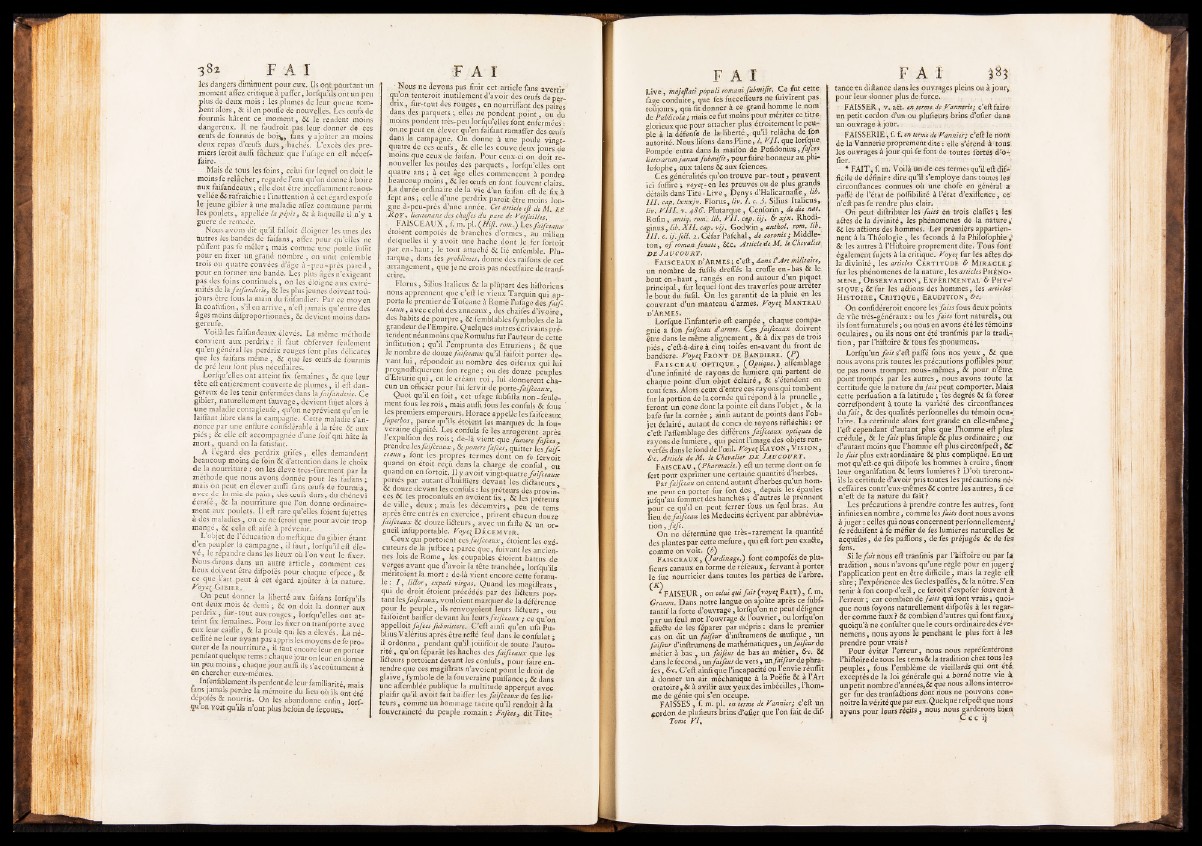
382 F A I
les dangers diminuent pour eux» Ils ont pourtant un
moment allez critique à paffer, lorfqu’ils.ontun peu
.plus de deux mois : les .plumes de leur çjueue tombent
alors, & il en pouffe de nouvelles! Les oeufs de
fourmis hâtent ce moment, & le rendent moins
dangereux. Il ne faudroit, pas leur donner de ces
çeuis de fourmis de boi^, fans y ajoûter au moins
deux repas d’oeufs durs ? hachés. L’excès des. premiers
feroit aufii fâcheux que l ’ufage en eff nécef-
iaire. H H j
Mais de tous les foins, celui fur lequel on doit le
moins fe relâcher, regarde l’eau qu’on donne à boire
aux faifandeaux ; elle doit être inceffamment renou-
vellée & rafraîchie : l’inattention à cet égard expofe
le jeune gibier à une maladie affez commune parmi
les poulets, àppeliée la pépie, ôc à laquelle il n’y a
guere de remede.
Nous avons dit qu’il falloit éloigner les unes des
autres les bandes de faifans, affez pour qu’elles ne
pûffent pas fe mêler ; mais comme une poule fuffit
pour en fixer un grand nombre , on unit enfemble
trois ou quatre couvées d’âge à-peu-près pareil,
pour en former une bande. Les plus âgés n’exigeant
pas des foins continuels, on les éloigne aux extrémités
de la faifanderie, & lès plus jeunes doivent toû-
jours etre fous la main du faifandier. Par ce moyen
la confuûon, s’il en arrive, n’eft jamais qu’entre des
âges moins difproportionnés, 6c devient moins dan-
gereufe.
Voila les faifandeaux élevés. La même méthode
convient aux perdrix : il faut obferver feulement
qu’en général les perdrix rouges font plus délicates
que les faifans même, & que les oeufs de fourmis
de pré leur font plus, néceffaires.
Lorfqu’elles ont atteint fix femaines , & que leur
tête eff entièrement couverte de plumes, il eff dangereux
de les tenir enfermées dans la faifanderie. Ce
gibier, naturellement fauvage, devient fujet alors à
line maladie contagieufe, qu’on ne prévient qu’en le
laiffant libre dans la campagne. Cette maladie s’annonce
par une enflure confidérable à la tête 6c aux
pies ; 6c elle eft accompagnée d’une foif qui hâte la
mort, quand on la fatisfait.
A l’égard des perdrix grifes, elles demandent
beaucoup moin§ de foin 6c d’attention dans le choix
de la nourriture : on les éleve très-fûrement par la
méthode que nous avons donnée pour les . faifans ;
mais on peut en élever aufli fans oeufs de fourmis
avec de la mie de pain, des oeufs durs, du chénevi
éc rafé, 6c la nourriture que l’on donne ordinairement
aux poulets. Il eff rare qu’elles foient fujettes
à des maladies, ou ce ne feroit que pour avoir trop
mangé, 6c cela eff aifé à prévenir.
L objet de l’éducation domeffique du gibier étant
d’en peupler la campagne, il faut, lorfqu’il eff élev
é , le répandre dans les lieux où l’on veut le fixer.
Nous dirons dans un autre article, comment ces
lieux doivent être difpofés pour chaque efpece, &
ce que l’art peut à cet égard ajoûter à la nature.
Voyt^ Gibier.
On peut donner la liberté aux faifans lorfqu’ils
ont deux mois 6c demi ; 6c on doit la donner aux
perdrix, fur- tout aux rouges ., lorfqu’elles ont atteint
iix femaines. Pour les fixer on tranfporte avec
eux leur caiffe, 6t la poule qui lès a élevés. La né-
ceflité ne leur ayant pas appris les moyens de fe procurer
de la nourriture, il faut encore leur en porter
pendant quelque tems : chaque jour on leur en donne
un peu moins, chaque jour aufli ils s’accoûtument à
en chercher eux-mêmes.
Infenfiblemeht ils perdent de leur familiarité mais
fans jamais perdre la mémoire du lieu où ils ont été
depofes & nourris. On les abandonne enfin, lorf-
quon voit qu’ils n’ont plus befoin de fecours*
F A I
r S ■ Nqus ne devons pas finir cet article fans avertir
qu’on tenteroit inutilement d’avoir des oeufs de perdrix,
fur-tout des rouges , en nourriffant des paires
dans des parquets ; elles ne pondent point, bu du
moins pondent très-peu lorfqu’elles font enfermées';
on,ne peut en plever qu’en faifant.ramaffer des oeufs
dans la campagne. On donne à une poule vingt-
quatre de ces oeufs, 6c elle les couve deux jours de
môms que ceux de faifan. Pour ceux-ci on doit re-
..nouveller les poules dés parquets, lorfqu’elles ont
quatre ans ; à cet âge elles commencent à pondre
(beaucoup moins, 6c les oeufs en font fou vent clairs.
La durée ordinaire de la vie d’un faifan eff de fix à
fept ans ; celle d une perdrix paroît être moins longue
à-peu-près d’une année. Cetarticleejl de M. L E
■ Ro y , lieutenant des chajjes du parc de VerfaiLles,
FAISCEAUX, f. m. pl. (Hijl. rom.i) Les faifeeaux
étoient compotes de branches d’ormes, au milieu
delquellfes il y avoit une hache dont le fer fortoit
par .en-haut ; le tout attaché 6c lié enfemble. Plutarque,
dans fes problèmes, donne des raifons dë cet
arrangement, que je ne crois pas nécefl'aire de trauf-
crire.
Florus, Silius Italicus 6c la plûpart des hiftoriens
nous apprennent que ç ’eft le vieux Tarquin qui ap-
porta le premier de Tofcane à Rome l’ufage des.yâj/?,•
ceaux, avec celui des. anneaux, des chaifes d’iv.ôire
des habits de pourpre, 6c femblables fymboles de la
grandeur de l’Empire. Quelques autres écrivains prétendent
néanmoins que Romulus fut l’auteur de cette
inftitution ; qu’il l’emprunta des Etruriens ; 6c que
le nombre de douze faifeeaux qu’il faifoit porter devant
lu i, répondoit au nombre des oifeaux qui lui
prognoffiquerent fon régné ; ou des douze peuples
d Etrurie q u i, en le créant ro i, lui donnèrent chacun
un officier pour lui fervir de porte-faifeeaux.
Quoi qu’il enToit, cet ufage fubfifta non-feulement
fous les rois, mais aufli fous les confuls & fous
les premiers empereurs. Horace appelle les faifeeaux,
fuperbos, parce qu’ils étoient les marques de la fou-
veraine dignité. Les confuls fe les arrogèrent après
l’expulfion des rois; de-là vient que fumere fafees g
prendr e,les faifeeaux , deponeh fafees,quitter \zs faifeeaux
, font les propres termes dont on fe féryoit
quand on étoit reçu dans la charge de conful, ou
quand on en fortoit. Il y avoit vingt-quatre faifeeaux
portés par autant d’huifîiers devant les dictateurs
6c douze devant les confuls : les préteurs des p rovin-Ë
ces 6c les proconfuls en avoiènt f ix , 6c les préteurs
de v ille , deux ; mais les décemvirs, peu de tems
après être entrés en exercice, prirent chacun douze =
faifeeaux 6c douze M eu r s , avec un faite 6c un orgueil
infupportable. Voye[ D é c e m v i r .
Ceux qui portoient ces faifeeaux, étoient les exécuteurs
de la juftice ; parce que, fuivant les anciennes
lois de Rome, les. coupables étoient battus de
verges avant que d’avoir la tête tranchée , lorfqu’ils
meritoient la mort : de-là vient encore cette formule
: / , liclor, expedi vir-gas. Quand les magiftrats,
qui de droit étoient précédés par des Meurs portant
les faifeeaux, voul.oient marquer de la déférence
pour le peuple, ils renvoyoient leurs Meurs ou
faifoient baiffer devant lui leurs faifeeaux ; ce qu’on
appelloit fafees fubmittere. C ’eft ainfi qu’en ufa Pu-
blius Valérius après êtrereflé feul dans le confulat *
il ordonna, pendant qu’il joiiiffoit de toute l’autorité
, qu’on féparât les haches des faifeeaux que les
Meurs portoient devant les confuls, pour faire entendre
que ces magiftrats n’avoient point le droit de
glaive, fymbole de la fouveraine puiffance; 6c dans
une affemblée publique la multitude apperçut avec
plaifir qu/il avoit fait baiffer les faifeeaux de fes licteurs
, comme un hommage tacite qu’il rendait à la
fouveraineté du peuple romain ; Fafees, dit T itç- '
F A I L iv e , majejlaù populi romani fubmijit. Ce fut cette
fage conduite, que fes fucceffeurs ne fuivirent pas-
toûjours, qui fit donner à eé grand homme le, nom'
de Publicola; niais.ee fut moins pour mériter ce titre,
glorieux que pour attacher plus étroitement le peuple
à la défenfe de la-liberté , qu’il relâcha de^fon
autorité. Nous lifons dans Pline, /. VU. quelorfque,
Pompée entra dans la maifon dé Pofidonius yfafees
litterarumjanud fubmijit, pour faire honneur au phi*
lofophe, aux talens 6c aux fciences.
Ces géiléralités qu’on trouve par-tout > peuvent
ici fuffire ; voye^-en les preuves ou de plus grands
détails dansTite-Live, Dgnys d’Halicarnaffe, lib.
I I I . cap. lxxxjv. Florus, liv. I . c. 5. Silius Italicus,
liv. VIII. v. 486. Plutarque, Çenforin, de die nat.
Rofin, antiq-. rom. lib. VII. cap. iij. 6* x jx . Rhodi-
ginus, lib. X I I . cap. vij. Godwin , anthol. rom. lib,
I I I . e. ij.fecl. z . Céfar Pafchaï, de coronis; Middle*
ton, o f roman, fenate, 6cc. Article de M. le Chevalier
D E J a U C O U R T . ,
FAISCEAUX d’A r m e s ; c’e f t , dans F Art militaire,
un nombre de fufils dreffes la croffe e n -b a s & le.
bout e n -h a u t , rangés en rond autour d’un piquet
pr in c ip a l, fur lequel font des trav erfes p o u r arrêter
le bout du fiifil. O n les garantit de la pluie en les
cou v rant d’un manteau d’armes. Voye^ M a n t e a u
d ’A r m e s .
Lorfque l’infanterie eff campée, chaque compagnie
a fon faifeeau dé armes. Ces faifeeaux doivent
Itre dans le même alignement, & à dix pas de trois
piés, c’eft-à-dire à cinq toifes en-avant du front de
bandiere. Voye^ Fr o n t d e B a n d ie r e . (P')
Fa 1 s c e A u O PT IQ U E , ( Optique. ) affemblage
d’une infinité de rayqns .de lumière^ qui partent de
chaque point d’un objet' éclairé,, & s’étendent en
tout fens. Alors ceux d’entre ces rayons qui tombent
fur la portion de la cornée qui répond à la prunelle,.
feront un cône dont la pointe eft dans l’objet, & la
bafe fur la cornée ; ainfi autant de.points dans l’objet
éclairé , autant de cônes de rayons réfléchis : or
c’eft l’affemblage des différens faifeeaux optiques de
rayons de lumière, qui peint l’image des objets ren*
verfés dans le fond de l’oeil. Voye^ R a y o n , V i s i o n ,
&c. Article de M. le Chevalier d e JAUCOURT.
Fa i s c e a u , (Pharmacie.) eft un terme dont on fe
fert pour exprimer une certaine quantité d’herbes.
Par faifeeau on,entend autant d’herbes qu’un homme
peut en porter fur fon dos , depuis les epâules
jufqu’au fommet des hanches ; d’autres le prennent
pour ce qu’il en peut ferrer fous un feul bras. Au
lieu de faifeeau les Médecins écrivent par abbrévia-
tion, fafe. . ■,
On ne détermine que très-rarement la quantité
des plantes par cette mefure, qui eft fort peu exa&e,
comme on voit. (b)
Fa i s c e a u x , (Jardinage.) font çompofes de plu*
fieurs canaux en forme de réfeaux, fervant à porter
le fuc nourricier dans toutes les parties de l’arbre.
^ * FAISEUR, ou celui qui fait (voye1 Fa i t ) , f. m.
Gramm. Dans notre langue on ajoûte après ce fubf*
tantif la forte d’ouvrage, Iorfqu’on ne peut defigner
par un feul mot l’ouvrage 8t l’ouvrier, Oulorfqu’on
affefte de les féparer par mépris : dans le premier
cas on dit un faifeur d’inftrumens de mufique , un
faifeur d’inftrumens de mathématiques , un faifeur de
métier à bas , un faifeur de bas au metier, &c. &
dans le fécond, un faifeur de vers, un faifeur de phra-
fes, &c. C’eft ainfi que l’incapacité ou l’envie réuflit
à donner un air méchanique à la Poëfie & à l’Art
oratoire, 8t à avilir aux yeux des imbécilles, l’homme
de génie qui s’en occupe.
FAISSËS , f. m. pl. en terme de Vannier; c’eft un
cordon de plufieurs brins d’ofier que l’on fait de dif-
Tome VJ%
F A I i H
tance en diftance dans les ouvrages pleins ou à jour,
pour leur donner plus de force. ■
FAISSER, v .,a â . ehserm.e de Vannerie; c’eft fairé^
un petit cordon d’un ou plufieiirs-brins d’ofier dans*
un ouvrage à jour. ; .
FÀISSERIE, f. F. en ternie de'Vannier} c’eft le nom
de la Vannerie propremêrit dite : elle s’étend à- tous,
les ouvrages à jour qui fe'font de toutes fortes d-’o*
fier.
* FAIT, f. ni. Voilà un de ces terniés qu’il eft difficile
de définir c dire qii’iî s’employe dans toutes les
circonftances connues oii une chofe en général a
paffé de l’étàt de poffibilité à l’état d’exiftenee, ce
n’eft pas fe rendre plus clair.
Oii peut diftribuer les faits en trois claffes ; les
a&es de la divinité, les phénomènes de la nature £
&c les ââions des hommes; LeS premiêrs appartiennent
à là Théologie , les féconds à la Philofophie **
6c les autres à l’Hiftoire proprement dite» Tous font
également fujets à la critiqué. Voye^ fur lés aéles d o
la divinité, les articles C e r t it u d e & M ir a c l e
fur les phénomènes de la nature, lès articles P h é n o m
è n e , O b s e r v a t io n 1, Ex p é r im e n t a l 6* P h y *
SiQUE ; 6c fur les avions des hommes, lés articles-
H i s t o i r e , C r i t iq u e , E r u d i t io n , &ci>
On confidéreroit encore les faits fous deüix points
de vûe très-généraux : ou les faits Font naturels, oit
ils font furnaturels ; ou nous en avons été les témoins
oculaires, ou,ils nous ont été!trarifmis par la tradi-,
tion , par l’hiftoire 8c'fous fes rtionumenS.
Lorfqu’un fait s’eft paffé fous nos yeux , & que
nous avons pris toutes les précautions poflibles pour.,
ne pas nous, tromper, nous-r.n^êmes, & pour n’être.
point trompés par les autres , nous avons toute la
certitude que la nature du fait peut comporter. Mais
cette perfuafion a fa latitude ; fës degrés & fa forcer
correspondent à toute la variété des circonftances
du fait, & des qualités perfonnelles du témoin oculaire.
La certitude alors fort grande en elle-même,'
l’eft cependant d’autant plus que l’homme eft p lus
crédule, ôt leyâ/Vplus fimple6eplus ordinaire; ouf
d’autant moins que I’hofnme eft plus circonfpett, 6ff
le fait plus extraordinaire 6c plus complique. En uit
mot qu’eft-ce qui difpofe les hommes à croire, finoii
leur organifation 8c leurs lumières ? D ’où tireront-;
ils la certitude d’avoir pris toutes les précautions né-,
ceffaires contr’eux-mêmes 6c contre les autres, fi ce
n’eft de la nature du fait?
Les précautions à prendre contre les autres, font
infinies en nombre, comme les faits dont nous avons
à ju^er : celles qui nous concernent perfonnellement,'
fe reduifent à le méfier de fes lumières naturelles &
acquifes, de fes pallions, de fes préjugés 6c de fes
fens.
Si le fait ftbus eft tranfmis par l’hiftoirè ou par l i
tradition, nous n’avons qu’une réglé pouf en juger ; l
l’application peut en être difficile, mais la réglé eft:
sûre ; l’expériénce des fieclespaffés, 6c la nôtre. S’e a
tenir à fon coup-d’oe il, ce feroit s’expofet fouvent à
l’erreut ; car combien de faits qui font vrais ; quoi*
que nous foyons naturellement difpofés à les regarder
comme faux ? 6c Combien d’autres qui font faux,
quoiqu’à ne confulter que le cours ordinaire des éve-
nemens, nous ayons le penchant le plus fort à les
prendre pour vrais?
Pour éviter l’erreur, nous nous repréfentérons
l’hiftoire de tous les tems & la tradition chez tous les
peuples, fous l’emblème de vieillards qui ont été.
exceptés de la loi générale qui a borne notre vie à
un petit nombre d’années,6c que nous allons interroger
fur des tranfaftions dont nous ne pouvons con-
noître la véritéquepar eux.Quelqué refpeft que nous
ayons pour leurs récits > nous nous garderons biet^