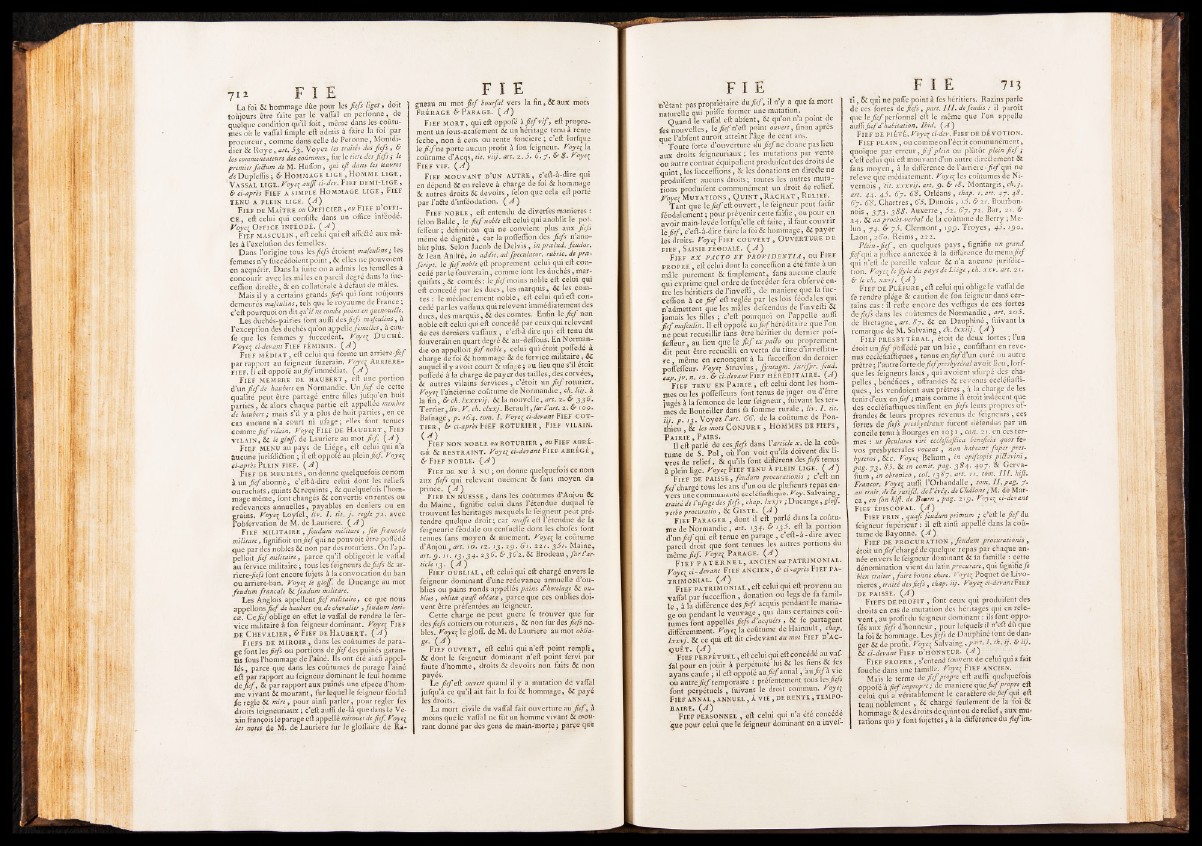
f i i f j
H
La foi & hommage due .pour les fiefi'Çga, doit j
toujours être faite par 'le vaflal en perfonne de j
quelque condition qu’il fo it , meme dans les coutumes
où le vaflal fimple eft admis à faire la foi par
procureur, comme dans celle de Peronne, Montdi-
dier & R o y e , art. S j . Voyez les traites des f ie f s , &
les commentateurs des coutumes, fur le titre des fiefs j le
premier fa^um de M. Huffon, qui eft dans les oeuvres
de Duplelîis ; & Hommage.V lige , Homme lige, assal lige. Voye1 aufti ci-dev. Fief demi-lige ,
€? ci-après FlEF A SIMPLE HOMMAGE LIGE, FlEF
TENU A PLEIN LIGE. (A") , Fief de Maître ou Officier ,0« Fief d offic
e, eft celui qui confifte dans un office inféodé.
Voye{ Office inféodé. ( A') f a Fpef masculin , eft celui qui eft affeété aux males
à l’exclulion des femelles.
Dans l’origine tous les fiefs étoient mafeulins; les
femmes n’y fuccédoient point, & elles ne pouvoient
en acquérir. Dans la fuite on a admis les femelles à
concourir avec les mâles en pareil degré dans la luc-
ceffion direfte, & en collatérale à défaut de mâles.
Mais il y a certains grands fiefs qui font toujours
demeurés mafeulins, tels que le royaume de France ;
c ’eft pourquoi on dit qu'il ne tombe point en quenouille.
Les duchés-pairies font aufti des fiefs mafeulins, à
l’exception dès duchés qu’on appelle femelles, à cau-
fe que les femmes y fuccedent, Voye[ Duché.
Vofie[ ci-devant FlEF FÉMININ. ( ) Fief médiat, eft celui qui forme un arriere-/c/
par rapport au feigneur fuzerain. Voye{ Arriere-
fief. Il eft oppofé au fie f immédiat. {A ) Fief membre de haubert, eft une portion
d’un/«/"de haubert en Normandie. Un fie f de cette
qualité peut être partagé entre filles jufqu’en huit
parties, & alors chaque partie eft appellée membre
de haubert ; mais s’il y a plus de huit parties, en ce
cas aucune n’a court ni ufage ; elles font tenues
comme fie f vilain. V$ye%_ Fief de- Haubert , Fief
vilain, & le glojf. de Lauriere au mot fief. ( A ) Fief menu au pays de Liège, eft celui qui n’a
aucune jurifdiftion ; il eft oppole au plein fief. Voye{
ci-aFprès Plein fief. ( ^ ) ief de meubles , on donne quelquefois ce nom
à un fie f abonné, c’eft-à-dire celui dont les reliefs
ou rachats, quints & requints, & quelquefois l’hommage
même, font changés & convertis en rentes ou
redevances annuelles, payables en deniers ou en
grains. Voye{ Loyfel, liv. J. tit. j . réglé yx. avec
l’obfervation de M. de Lauriere. ( A )
FlEF militaire , feudum militare , feu francale
militare, fignifioit un f ie f qui ne pouvoit être poffédé
que par des nobles & non par des roturiers. On l’ap-
pelloit fie f militaire, parce qu’il obligeoit le vaflal
au fervice militaire ; tous les feigneurs de fiefs & ar-
riere-fiefs font encore fujets à la convocation du ban
ou arriere-ban. Voyeç le glojf. de Ducange au mot
feudum francale & feudum militare.
Les Anglois appellent Jief militaire, ce que nous
appelions}?«/ de haubert ou de chevalier , feudum lori-
coe. Ce f ie f oblige en effet le vaflal de rendre le fer-
vice militaire à fon feigneur dominant. Voye^ Fief
deF Chevalier, & Fief de Haubert. ( A ) iefs de miroir, dans les coutumes de parage
font les fiefs ou portions de fief des puînés garantis
fous l’hommage de l’aîné. Ils ont été ainfî appel-
lé s , parce que dans les coutumes de parage l’aîné eft par rapport au feigneur dominant le féul homme
de fief, & par rapport aux puînés une efpece d’homme
vivant & mourant, fur lequel le feigneur féodal
Te réglé & mire, pour ainfi parler, pour regler fes
droits feigneuriaux ; c’eft aufti de-là que dans le Ve-
xin ffançois le parage eft appellé mirouerdefief. Voye^
Us notes de M. de Lauriere fur le gloftaire de Ragueau
au mot fie f bourfal vers la fin, & aux mots
F r é r a g e & P a r a g e . ( ^ )
F i e f m o r t , qui eft oppofé à/«/v if, eft proprement
un fous-acafement & un heritage tenu à rente
feche, non à cens ou rente foncière ; c’eft lorfque
le fie f ne porte aucun profit à fon feigneur. Voye{ la
coutume d’Acqs, tit. viij. art. x .S . f . y . & 8. Voye{
F i e f v i f . ( A )
F i e f m o u v a n t d ’ u n a u t r e , c’eft-à-dire qui
en dépend & en releve à charge de foi & hommage
& autres droits & devoirs, félon que cela eft porté
par l’aôe d’inféodation. ( A )
F i e f n o b l e , eft entendu de diverfes maniérés :
félon Balde, le fie f noble eft celui qui anoblit le pof-
féffeur ; définition qui ne convient plus aux^ fiefs
même de dignité , car la poffeflion des fiefs n anp-
blit plus. Selon Jacob de D e lv is , inproelud. feudor.
& Jean André, in addit. ad fpeculator. rubric, de proe-
feript. le fie f noble eft proprement celui qui eft concédé
par le fouverai.n, comme font lès duchés, mar-
quifats, & comtés : le fie f moins noble eft celui qui
eft concédé par les ducs, les marquis, & les comtes
: le médiocrement noble, eft celui qui eft concédé
parles vaflaux qui relevent immédiatement des
ducs, des marquis , & des comtes. Enfin 1 e/« / non
noble eft celui qui eft concédé par ceux qui relevent
de ces derniers vaflaux, c ’eft-à dire qui eft tenu du
fouverain en quart degré & au-deffous. En Normandie
on appelloit fie f noble, celui quiétoit pofledé à
charge de foi & hommage & de fervice militaire, &
auquel il y avoit court & ufage ; au lieu que s’il étoit-
pofledé à la charge de payer des tailles, des corvées,
& autres vilains fer vices , c’étoit un/«/roturier.
Voye{ l’ancienne coutume de Normandie, ch. liij. à
la fin, & ch. Ixxxvij. & la nouvelle, art. x. & 33G.
Terrier,/iv. V. ch. clxxj. Hérault, fur l'art. x. & 100.
Bafnagé, p. 1G4. tom. J. Voyeç ci-devant FlEF COTTIER
, & ci-après FlEF ROTURIER , FlEF VILAIN.
{ A )
F i e f n o n n o b l e ou r o t u r i e r , o k F i e f a b r é g
é & r e s t r a i n t . Voyt{ ci-devant F i e f a b r é g é ,
& F i e f n o b l e . ( ^ )
F i e f d e n u à n u ; on donne quelquefois ce nom
aux fiefs qui relevent nuëment & fans moyen du
prince. ( A f .,
Fief en nu esse, dans les coutumes d’Anjou &
du Maine, fignifie celui dans l’étendue duquel fé
trouvent les héritages auxquels le feigneur peut prétendre
quelque droit ; car nuejfe eft l’étendue de la
feimeurie féodale ou cenfuelle dont les chofés font
tenues fans moyen & nuement. Voye^ la coutume
d’Anjou, art. 10. 12. 13 .2 9 . 61. x x i . j S i . Maine,
art.g. 11. 13.34. *36 . &3&X.&C Broàezu, fur l’article
/ j. {A ')
F i e f o u b l i a l , eft celui qui eft chargé envers le
feigneur dominant d’une redevance annuelle d’ou-
blies ou pains ronds appellés pains d?hotelage & oublies
y oblitot quaji oblatce, parce que ces oublies doivent
être préfentées au feigneur.
Cette charge ne peut guere fe trouver que fur
des fiefs cottiers ou roturiers, & non fur des fiefs nobles.
Voyei le glolT. de M. de Lauriere au mot oblia-
ge. (A")
F i e f o u v e r t , eft celui qui n’eft point rempli,
& dont le feigneur dominant n’eft point férvi par
faute d’homme, droits & devoirs non faits & non
payés.
Le fie f eft ouvert quand il y a mutation dô Vaflal
jufqu’à ce qu’il ait fait la foi & hommage, & payé
les droits.
La mort civile du vaflal fait ouverture an fief, à
moins que le vaflal ne fût un homme vivant & mourant
donné par des gens de main-morte ; parce que
m m m
»’ étant pas propriétaire du fa f , il n’y a que fa mort
naturelle qui puiffe former une mutation H
Quand le vaflal eft abfent, & qu’on n a point de
fes nouvelles, le f i t f n’eft point ouvert, finon après .
oue l’abfent aurait atteint l’âge de cent ans.
1 Toute forte d’ouverture du jîe/ne donne pas lieu
aux droits feigneuriaux ; les mutations par vente
ou autre contrat équipollent produifentdes droits de
quint, les fucceflions, & les donations en direâe ne
produifénf aucuns droits; toutes les autres mutations
produifent communément un droit de relief.
/'bye/MUTATIONS , QUINT , RACHAT , RELIEF.
' Tant que le fie f eft ouvert, le feigneur peut faifir
féodalement ; pour prévenir cette faifie , ou pour en
avoir main-levée lorfqu’elle eft faite, il faut couvrir
1 e fie f y c’eft-à-dire faire la foi & hommage, & payer
les droits.- Voye^ F i e f c o u v e r t , O u v e r t u r e d e
f i e f , S a i s i e f é g d a l e . ( A )
F i e f e x p a c t o e t p r o v i d e n t i a , ou F i e f
p r o p r e , eft celui dont la concefîion a ete faite a un
mâle purement & Amplement, fans aucune claufe
qui exprime quel ordre de fuccéder fera obfervé entre
les héritiers de l’invefti, de maniéré que la fuc-
ceflion à ce fie f eft réglée par les lois féodales qui
n’admettent que les mâles defeendus de l’invefti &
jamais les filles ; c’eft pourquoi on l’appelle aufîi
fie f mafeulin. Il eft oppofé au fie f héréditaire que l’on
ne peut recueillir fans être héritier du dernier pof-
feffeur, au lieu que le fie f ex pacto ou proprement
dit peut être recueilli en vertu du titre d’inveftitu-
r e , même en renonçant à la fucceflion du dernier
poflefleur. Voyei Struvius, fyntagm. jurifpr. feud.
cap. jv . n. ix. & ci-devant FlEF HÉRÉDITAIRE. {A)
F i e f t e n u e n P a i r i e , eft celui dont les hommes
ou les poflefleurs font tenus de juger ou d’être
jugés à lafemonce de leur feigneur, fuivant les termes
de Bouteiller dans fa fomme rurale, hv. I . tit.
üj. P- •3 • Voyez l’art. H de la coutume de Pon-
thieu, & les mots C o n j u r e , H o m m e s d e f i e f s ,
P a i r i e , P a i r s . , .
Il eft parlé de ces fiefs dans 1 article x . de la coutume
de S. Pol, où l’on voit qu’ils doivent dix livres
de relief, & qu’ils font différens des fiefs tenus-
à plein lige. Voye^ F i e f t e n u à p l e i n l i g e .^ ( A )
FlEF DE p a i s s e , feudum procurations ; c’eft un
ƒ«ƒ chargé tous les ans d’un ou de plufieurs repas envers
une communauté eccléfiaftique. Voy. Salvaing,
traité de l'ufage des fiefs, chap. Ixxjv ; Ducange, glojf.
yerbo procuratio, & GlSTE. (A ) A
F i e f P a r a g e r , dont il eft parlé dans la coutume
de Normandie , art. 134. 6* /3J. eft là portion
d’un fie f qui eft tenue en parage , c’eft-à-dire avec
pareil droit que font tenues les autres portions du
même/«/. Voye{_ P a r a g e . ( A )
F i e f p a t e r n e l , a n c i e n ou p a t r i m o n i a l .
Voyei ci-devant F i e f a n c i e n , & ci-après F i e f p a t
r i m o n i a l . ( A ) . .
F i e f patrimonial , e f t c e l u i q u i e f t p r o v e n u a u
v a f l a l p a r f u c c e f l i o n , d o n a t i o n o u l e g s d e f a f a m i l l
e à l a d i f f é r e n c e d e s fiefs a c q u i s p e n d a n t l e m a r i a g
e o u p e n d a n t l e v e u v a g e , q u i d a n s - c e r t a in e s c o u -
t u m e s f o n t a p p e l l é s fiefs d’acquêts , & f e p a r t a g e n t
d i f f é r e m m e n t . Voye^l a c o û t u m e d e H a i n a u l t , chap.
Ixxvj. & c e q u i e f t d i t c i - d e v a n t au mot F i e f d a c -
F i e f p e r p é t u e l , eft celui qui eft cohce.de au vaf-
fal pour en jouir à perpétuité lui & les fiens & fes
ayans caufe ; il eft oppofé au/e/annal, au/«/ à vie
ou autre fie f temporaire : préfentement tous les fiefs
font perpétuels , füivant le droit commun. Voyeç
FiÉF ANNAL , ANNUEL , k VIE , DE REN(TE , TEMPORAIRE.
(A ) , , , , ,
F / e f p e r s o n n e l , eft celui qui n a été concédé
que pour celui que le feigneur dominant en a inveft
i , & qui ne paffe point à fes héritiers. Razius parle
de ces fortes de fiefs, part. I I I . defeudis : il paroît
que le/e/perfonnel eft le même que l’on appelle
auflï f ie f d'habitation. Tbid. (A )
F i e f d e p i é t é . Voye^ci-dev. F i e f d e d é v o t i o n .
F i e f p l a i n , ou comme on l’écrit communément,
quoique par erreur, fief plein ou plutôt plein f ie f ;
c’eft celui qui eft mouvant d’un autre dire&ement &
fans moyen , à la différence de l’arriere-/«/* qui ne
releve que médiatement. Voye^ les coûtumes de Ni-
vernois , tit. xxxvif. art. 9 . & 18. Montargis, ch. J.
art, 44. 46. Gy. G8. Orléans , chap. /.art. 47. 48.
Gy. G8. Chartres, Gf>. Dunois , i5. & x i. Bourbon-
nois , 3 y3. 388. Auxerre , Sx. Gy. yx. Bar, x\. &
X4. & au procès-verbal de la coûtume de Berry ; Melun
, y 4. & yS. Clermont, 13$. Troyes , 4S. ic)o.
Laon, xGo. Reims, xxx.
Plein-fief, en quelques pa ys, fignifie un grand
/«/qui a juftice annexée à la différence dumenu/e/
qui n’eft de pareille valeur & n’a aucune jurifdic-
tion. Voye£ le ftyle du pays de Liege , ch. xxv. art. x t •
& le ch. xxvj. (A )
F i e f d e P l é j u r e , eft celui qui oblige le vaflal de
fe rendre piège & caution de fon feigneur dans certains
cas : il refte encore des veftiges de ces fortes
dQ fiefs dans les coûtumes de Normandie, art. xoS.
de Bretagne, art. 8y. &: en Dauphiné, fuivant la
remarque de M. Salvaing, ch. txxiij. ( A )
F i e f p r e s b y t e r a l , étoit de deux fortes ; l’un
étoit un fie f pofledé par un laïc , confiftant en revenus
eedéfiaftiques, tenus en/«/d’un curé ou autre
prêtre ; l’autre forte de fiefpnsbytèral avoit lieu, lorfque
les feigneurs laïcs , qui avoient ufurpe'des chapelles
, bénéfices , offrandes & revenus êccléfiafti-
ques , les vendoient aux prêtres , à la charge de les
tenir d’eux en fief ; mais comme il etpit indecent que
des eedéfiaftiques tinffent en fiefs leurs propres offrandes
& leurs propres revenus de feigneurs , ces
fortes de fiefs presbyteraux furent défendus par un
concile tenu à Bourges en 1031 , °an. x i . en ces termes
: ut feculares viri ecclefiaftica beneficia; quos fe-
Vos presbyteraies vocant , non habeant fuper pres-
byteros , & C . Voye{ Belium , in epifcôpis pictavini ,
pag. 73 . 85. & in comit. pag. 384. 407. &' Gerva-
fium , in obronico y col. i '3 8y. art. 11. tóm. I I I . hift.
Francor. Voye1 aufli l’Orbandalle , tonz. I I . pag. y.
au trait.de la jurifd. de l ’évêq. de Châlôhs; M. de Mar-
ca , en fon hift. de Bearn , pag. 21 f i . Vyye^ ci-devant
F i e f é p i s c o p a l . (A') ,
F i e f p r i n , quafi feudumprirnum ; c’eft le/«/du
feigneur fupérieur : il eft ainfi appellé dans la coûtume
de Bayonne. (A ') . '/ . . .
F i e f d e p r o c u r a t i o n , feudum procurations,
étoit un fie f chargé de quelque repas par chaque année
envers le feigneur dominant & fa famille : cette
dénomination vient du latin procurare, qui fignifie/
bien traiter, faire bonne chere. Vyye{ Poquet de Livo-
nieres, traité des fiefs, chap. iij. Voye{ d-devant F i e f
DE PAISSE^ (A ) -
F i e f s d e p r o f i t , font ceux qui produiient des
droits en cas de mutation des héritages qui en relevent
, au profit du feigneur dominant : ils font oppo-
fés aux fiefs d’honneUr, pour lefquels il n’eft dû que
la foi'& hommage. Les fiefs de Dauphine font de danger
& de profit. Voyei Salvaing, part. I. ch. ij. & iij.
fit ci-devant FlEF D’HONNEUR" (•'O . .
F i e f p r o p r e , s ’ e n t e n d fo u v e n t d e c e l u i q u i a f a i t
f o u c h e d a n s u n e f a m i l l e . Voyt{ F i e f A n c i e n . £
Mais le terme de fie f propre eft auflï quelquefois
oppofé à fie f impropre ; de maniéré que fie f propre eft
celui qui a véritablement le caraôere de/«/qui eft
tenu noblement , & chargé feulement de la foi &
hommage & des droits de quint ou de relief , aux mutations
qui y font fujettes, à la différénee du fie f im