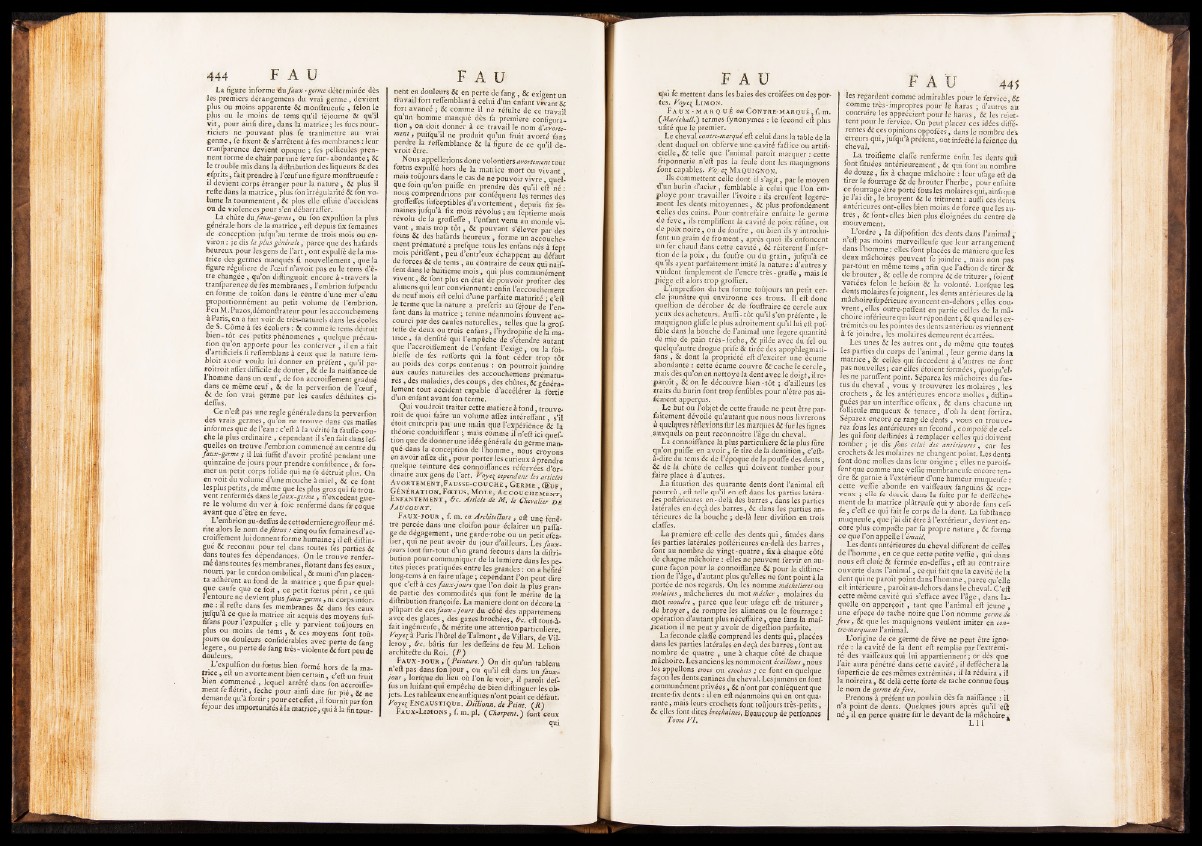
444 F A U
La figure informe tlu faux-germe déterminée dès
fles premiers dérangemens du vrai germe, devient
plus ou moins apparente & monftrueufe , félon le
•plus ou le moins de tems qu’il féjourne & qu’il
v i t , pour ainfi dire, dans la matrice; les fucs nourriciers
ne pouvant plus fe tranfmettre au vrai
germe, fe fixent & s’arrêtent à fes membranes : leur
tranfparence devient opaque ; fes pellicules prennent
forme de chair par une feve fur - abondante ; St
le trouble mis dans la diftribution des liqueurs St des
efprits, fait prendre à l’oeuf une figure monftrueufe :
il devient corps étranger pour la nature, St plus il
relie dans la matrice, plus fon irrégularité St Ion volume
la tourmentent, St plus elle effuie d’accidens
ou de violences pour s’en débarraffer.
La chûte du faux-germe, ou fon expulfion la plus
générale hors de la matrice, eft depuis fix femaines
de conception jufqu’au terme de trois mois ou en*
viron : je dis la plus générale, parce que des hafards
heureux pour les gens de l’art, ont expulfé de la matrice
des germes manqués fi nouvellement, que la
figure régulière de l’oeuf n’avoit pas eu le tems d’être
changée , qu’on diftinguoit encore à-travers la
tranfparence de fes membranes, l’embrion fufpendu
en forme de toifon dans le centre d’une mer d’eau
proportionnément au petit volume de l’embrion.
Feu M. Puzos,démonftrateur pour les accouchemens
a Paris, en a fait voir de très-naturels dans les écoles
III S. Côme à fes écoliers : St comme le tems détruit
bien-tôt ces petits phénomènes , quelque précaution
qu’on apporte pour les conferver , il en a fait
d’artificiels fi reffemblans à ceux que la nature fem-
bloit avoir voulu lui donner en préfent, qu’il pa-
roîtroit aflez difficile de douter, & de la naifl'ance de
l’homme dans un oe uf, de fon accroiffement gradué
dans ce même oe u f , & de la perverfion de l’oe uf,
& de fon vrai germe par les caufes déduites ci-
defîiis.
Ce n eft pas une réglé générale dans la perverfion
des vrais germes, qu’on ne trouve dans ces maffes
informes que de l’eau : c’eft à la vérité la faufle-couche
la plus ordinaire , cependant il s’en fait dans lef-
quelles on trouve l’embrion commencé au centre du
faux-germe ; il lui fuffit d’avoir profité pendant une
quinzaine de jours pour prendre confiftence, & for- j
mer un petit corps folide qui ne fe détruit plus. On
en voit du volume d’une mouche à m iel, St ce font
les plus petits, de même que les plus gros qui fe trouvent
renfermes dans le faux-germe , n’excedent guère
le volume du ver à foie renfermé dans fir coque
avant que d’être en feve.
L embrion au-deffus de cetteidernieregroflëur mérite
alors le nom de foetus : cinq ou fix femaines d’ac-
croiffement luidonnent forme humaine ; il eft diftin-
gué & reconnu pour tel dans toutes fes parties St
dans toutes fes dépendances. On le trouve renfermé
dans toutes fes membranes, flotant dans fes eaux,
nourri par le cordon ombilical, & muni d’un placenta
adhérent au fond de la matrice ; que fi par quelque
caufe que ce fo it , ce petit foetus périt, ce qui
1 entoure ne devient plus faux-germe, ni corps infor-
me : il refte dans fes membranes St dans fes eaux
julqu a ce que la matrice ait acquis des moyens fuf-
nfans pour 1 expulfer ; elle y parvient toujours en
plus ou moins de tems, & Ces moyens font toujours
ou douleurs confidérables avec perte de fang
legere, ou perte de fang très - violente St fort peu de
douleurs.
L ’expulfion du foetus bien formé hors de la matrice
, eft un avortement bien certain, c’eft un fruit
bien commencé , lequel arrêté dans fon accroiffe-
ment le flétrit, feche pour ainfi dire fur pié & ne
demande qu’à fortir ; pour cet effet, il fournit par fon
lejour des importunités à la matrice, qui à la fin tour-
F A U
neftt eti douleurs & en perte de fang , St exigent un
travail fort reffemblant à celui d’un enfant vivant &
fort avancé ; St comme il ne réfulte de ce travail
qu’un homme manqué dès fa première configuration
, on doit donner à ce travail le nom d’avorte-
ment, puifqu’il ne produit qu’un fruit avorté fans
perdre la reffemblance St la figure de ce qu’il devrait
être. 1
Nous appellerions donc volontiers avortement tout
foetus expulfe hors de la matrice mort ou v iv an t,
mais toûjours dans le cas de ne pouvoir vivre, quelque
foin qu’on puiffe en prendre dès qu’il eft né :
nous comprendrions par conféquent les termes des
groileiies lufceptibles d’avortement, depuis fix fe-
maines jufqu’à fix mois révolus ; au feptieme mois
révolu de la groffeffe , l’enfant venu au monde vivant
, mais trop t ô t , St pouvant s’élever par des
foins St des halards heureux, forme un accouchement
prématuré ; prefque tous les enfans nés à lèpt
mois périffent, peu d’entr’eux échappent au défaut
de forces St de tems , au contraire de ceux qui naif-
lent dans le huitième mois, qui filus communément
vivent, & font plus en état de pouvoir profiter des
alimens qui leur conviennent : enfin l’accouchement
de neuf mois eft celui d’une parfaite maturité ; c’eft
le terme que la nature a preferit au féjour de l’enfant
dans la matrice ; terme néanmoins fouvent accourci
par des caufes naturelles, telles que la grof-
lelle de deux ou trois enfans, l’hydropifie delà matrice
, fa denfité qui l’empêche de s’étendre autant
que raccroiflèment de l’enfant l’exige, ou la foi-
bleffe de fes refforts qui la font céder trop tôt
au poids des corps contenus : on pourrait joindre
aux caufes naturelles des accoucheniens prématurés
, des maladies, des coups, des chûtes, & généralement
tout accident capable d’accélérer la fortie
d’un enfant avant fon terme.
Q u i voudrait traiter cette matière à fo n d , trouve*
roit de quoi faire un volume aflez intéreffant s’il
étoit entrepris par une main que l ’expérience St la
théorie conduififfent ; mais comme il n’eft ic i quef-
tion que de donner une idée générale du germe manqué
dans la Conception de l’homme, nous croyons
en a v o ir affez d it , pour porter les curieux à prendre
quelque teinture des connoiflances réfervées d’o rdinaire
au x gens de l’art. Voye^cependant les articles
A v o r t e m e n t ,F au s se -c o u c h e , G e rm e , (E uf
G é n é r a t io n , Foe tu s , Mo l e , A c c o u c h e m e n t *
En f a n t e m e n t , &c. Article de M . le Chevalier d e
J a u c o u r t .
F a u x -jo u r , f. m. en Architecture , eft une fenêtre
percée dans une cloifon pour éclairer un'paffa-
ge de dégagement, une garde-robe ou un petit efea-
lie f, qui ne peut avoir du jour d’ailleurs. Les faux-
jours lont fur-tout d’un grand fecours dans la diftribution
pour communiquer de la lumière dans les petites
pièces pratiquées entre les grandes : on a héfité
long-tems à en faire ufage ; cependant l’on peut dire
que c’eft à ces faux-jours que l’on doit la plus grande
partie des commodités qui font le mérite de la
diftribution françoife. La maniéré dont on décore la
plupart de ces faux-jours du côté des appartemens
avec des glaces, des gazes brochées, &c. eft tout-à-
fait ingénieufe, St mérite une attention particulière.
V oy ei'à . Paris l’hôtel de Talmont, de Villars de Vil-
le ro y , &c. bâtis fur les deffeins de feu M? Lelion
architeéle du Roi. (P )
| Fa u x - j o u r , ( Peinture.) On dit qu’un tableau
n’eft pas dans fon jour , ou qu’il eft dans un faux-
jour , lorfque du lieu oit l’on le v o ir , il paraît def-
fus un luifant qui empêche de bien diilinguer les objets.
Les tableaux encauftiques n’ont point ce défaut.
Voye[ En c a u s t iq u e . Diclionn. de Peint. (R)
F a u x -L im o n s , f. m. pl. ( Charpent. ) font ceux
qui
F A Ü jSfür fe mettent dans les baies des croifées oü des portes.
Voye^ L im o n .
F a u x - m a r q u é ou C o n t r e -m a r q u é , fi m.
(Maréchall.) termes fynonymes : le fécond eft plus
ufité que le premier.
Le cheval contre-marqué eft celui dans la table de la
dent duquel on obferve une cavité faélice ou artificielle
, & telle que l’animal paraît marquer: cette
friponnerie n’eft pas la feule dont les maquignons
font capables, Voye^ Ma q u ig n o n .
I Us commettent celle dont il s’agit, par le moyen
d un burin d’acier, femblable à celui que l’on employé
pour travailler l’ivoire : ils creufent legere-
ment les dents mitoyennes, & plus profondément
celles des coins. Pour contrefaire enfuitë le germe
de fe v e , ils rempliffent la cavité de poix réfine, ou
de poix noire, ou de foufre , ou bien ils y introduiront
un grain de froment, après quoi ils enfoncent
un fer chaud dans cette cavité , St réitèrent l’infer*
tion de la p oix, du foufre ou du grain, jufqu’à ce
qu’ils ayent parfaitement imité la nature : d’autres y
vuident Amplement de l’encre très - graffe , mais le
piège eft alors trop groffier.
L’impreffion du feu forme toujours un petit cercle
jaunâtre qui environne ces trous. Il eft donc
queftion de dérober St de fouftraire ce cercle aux
yeux des acheteurs. Auffi - tôt qu’il s’en préfente, le
maquignon gliffe le plus adroitement qu’il lui eft pof-
fible dans la bouche de l’animal une legere quantité
de mie de pain très - feche, & pilée avec du fel ou
quelqu’autre drogue prife & tirée des apophlegmati-
fians , & dont la propriété eft d’exciter une écume
abondante : cette écume couvre &-cache le cercle,
mais dès qu’on en nettoye la dent avec le doigt, il reparaît
, & on le découvre bien - tôt ; d’ailleurs les
traits du burin font trop fenfibles pour n’être pas ai-
fiément apperçus.
Le but ou l’objet de cette fraude ne peut être parfaitement
dévoilé qu’autant que nous nous livrerons
à quelques réflexions fur les marques & fu r les fignes
,auxquels on peut reconnoître l’âge du cheval.
La connoiflance la plus particulière & la plus fûre
qu’on puiffe en a vo ir , fe tire de la dentition, c’eft-
à-dire du tems St de l’époqiie de la pouffe des dents,
& de là chûte de celles qui doivent tomber pour
faire place à d’autres.
La fituation des quarante dents dont l’animal eft
pourvû, eft telle qu’il en eft dans les parties latérales
poftérieures en-delà des barres , dans les parties
latérales en-deçàdes barres, St dans les parties antérieures
de la bouche ; de-là leur divifion en trois
claffes.
La première eft celle des dents qui, fituées dans
les parties latérales poftérieures en-delà des barres,
font au nombre de vingt-quatre, fix à chaque côté
de chaque mâchoire : elles ne peuvent fervir en aucune
façon pour la connoiflance St pour la diftinc-
tion de l’âge, d’autant plus qu’elles ne font point à la
portée de nos regards. On les nomme mdchelieres on
molaires, mâchelieres du mot mâcher , molaires du
mot moudre , parce que leur ufage eft de triturer,
de broyer, de rompre les alimens ou le fourrage :
opération d’autant plus néceffaire, que fans la maf-
rication il ne peut y avoir de digeftion parfaite.
La fécondé claffe comprend les dents qui, placées
dans les parties latérales endeçà des barres, font au
nombre de quatre , une à chaque côté de chaque
mâchoire. Les anciens les nommoient écaillons, nous
les appelions crocs ou crochets ; ce font en quelque
façon les dents canines du cheval. Les jumens en font
communément privées, St n’ont par conféquent que
trente-fix dents : il en eft néanmoins qui en ont quarante
, mais leurs crochets font toûjours très-petits, •
ôc elles font dites fyreçhaines, Beaucoup de perfonjies
J ’orne VI,
F A Ü 44J
les règàrdènt comme admirables pour le fervice &
comme très-impropres pour le haras ; d’autres*aü
contraire les apprécient pour le haras, St les rejettent
pour le fervice. On peut placer ces idées différentes
& ces opinions oppofées, dans le nombre des
erreurs qui, jufqu’à préfent, ont infeélé la feience du
cheval.
La troifieme claffe renferme enfin les dents quS
fônt fituées antérieurement, & qui font au nombre
de douze, fix à chaque mâchoire : leur ufage eft dé
tirer le fourrage & de brouter l’herbe, pour enfuité
ce fourrage être porté fousles molaires qui, ainfi qué
je 1 ai d it, le broyent & le triturent i auffi ces dents
anterieures ont-elles bien moins de force que les autres
, & font-elles bien plus éloignées du centre de
mouvement.
| L’ordre , la difpofitiôn dés dents dans l’animal 4‘
n eft pas moins merveilleufe que leur arrangement
dans 1 homme : elles font placées de maniéré que leâ
deux mâchoires peuvent fe joindre , mais non pas
par-tout en même tems , afin que l’aétion de tirer St
de brouter, & celle de rompre & de triturer, foxent
variées félon le befoin & la volonté. Lorfque leâ
de^nts molaires fe joignent, les dents antérieures d elà
mâchoire fupérieure avancent en-dehors ; elles cou-
Vre^t, elles outre-paffent en partie celles de la mâchoire
inférieure qui leur répondent ; & quand les extrémités
ou les pointes des dents antérieures viennent
a fe joindre, les molaires demeurent écartées.
Les unes & les autres on t, de même que toutes
les parties du corps de l’animal, leur germe dans la
matrice , & celles qui fuccedent à d’autres ne font
pas nouvelles; car elles étoient formées, quoiqu’elles
ne paruffent point. Séparez les mâchoires du foetus
du ch ev a l, vous y trouverez ies môlaires , les
crochets , & les antérieures encore molles , diftin-
guées par un interftice offeux, & dans chacune un
follicule muqueux & tenace, d’oii la dent fortira.
Séparez encore ce rang de dents , vous en trouverez
fous les antérieures un fécond, compofé de celles
qui font deftinées à remplacer celles qui doivent
tomber ; je dis fous celui des antérieures , car les
crochets & les molaires ne changent point. Les dents
font donc molles dans leur origine ; elles ne paroif-
fent que comme une veffie membraneufe encore tendre
& garnie à l’extérieur d’une humeur muqueufe :
cette veffie abonde en vaiffeaux fanguins & nerveux
; elle fe durcit dans la fuite par le defféche-
mënt de la matrice plâtreufe qui y aborde fans cef-
f e , c’eft ce qui fait le corps de la dent. La fubftance
muqueufe, que j’ai dit être à l’extérieur, devient encore
plus compa&e par fa propre nature , Sc forme
ce que l’on appelle l’émail.
Les dents antérieures du cheval different de celles
de l’homme, en ce que cette petite veffie, qui dans
nous eft clofë & fermée en-deffus , eft âu contraire
ouverte dans l’animal, ce qui fait que la cavité de la
dent qui ne paraît point dans l’homme, parce qu’elle
eft intérieure, paraît au-dehors dans le cheval. C ’eft
cette même cavité qui s’efface avec l’âg e, dans laquelle
on apperçoit , tant que l’animal eft jeune ,
une efpece de tache noire que l’on nomme germe de <
five , & que les maquignons veulent imiter en con-.
tre-marquant l’animal.
L’origine de ce germe de févé ne peut être ignorée
: la cavité de la dent eft remplie par l ’extrémité
des vaiffeaux qui lui appartiennent ; or dès que
l’air aura pénétré dans cette cavité, il defféchera la
fuperficie de ces mêmes extrémités ; il la réduira, il
la noircira, & delà cette forte de tache connue fous
le nom de germe de feve.
Prenons à préfent un poulain dès fa naiffance : il
n’a point de dents. Quelques jours après qu’il eft
n é , il en perce quatre fur le devant de la mâchoire i
t i r m
;