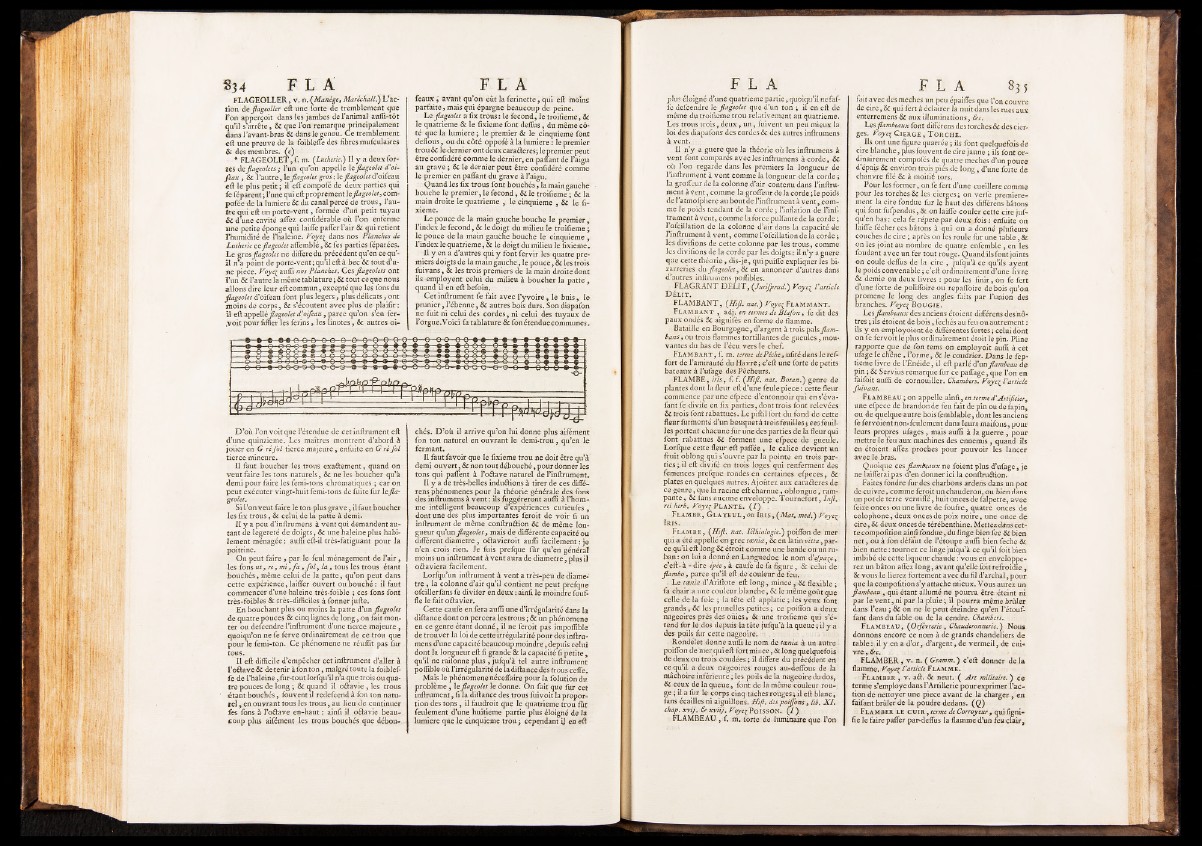
FLAGEOLLER, v. n. {Manège, Maréckall.) L’action
de flageoller esft une forte de tremblement que
l’on apperçoit dans les jambes de l’animal aufli-tôt
qu’il s’arrête, & que l’on remarque principalement
dans l’avant-bras & dans lé genou. Ce tremblement
eft une preuve de la foibleffe des fibres mufculaires
& des membres, (e)
* FLAGEOLET, f. m .(Lutherie.) II y a deux for-
tés de flageolets ; l’un qu’bn appelle le flageolet d ’oifeau
, & l’autre, \e flageolet gros : le flageolet d’oifeau
eft le plus petit ; il eft compofé de deux parties qui
fe féparertt ; l ’une qui efl: proprement le flageolet, com-
pofée de la lumière & du canal percé de trous, l’autre
qui eft un porte-vent, formée d’un petit tuyau
& d’une cavité allez confidérable où l’on enferme
une petite éponge qui laiffe paffer l’air & qui retient
l’humidité de l’haleine. Foye{ dans nos Planches de
Lutherie ce flageolet affemblé, &: fes parties féparées.
Le gros flageolet ne différé du précédent qu’en ce qu’il
n’a point de porte-vent ; qu’il eft à bec & tout d u-
ne piece. Foye^ aufli nos Planches. Ces flageolets ont
l ’un & l’autre la même tablature ; & tout ce que nous
allons dire leur eft commun, excepté que les fons du
flageolet d’oifeau font plus légers , plus délicats, ont
moins de corps, & s’écoutent avec plus de plaifir :
il eft flageolet d ’oifeau, parce qu’on s’en feryoit
pour fiffler les ferins , les linotes, & autres oifeauxavant
qu’on eût la ferinette, qui eft moins
parfaite, mais qui épargne beaucoup de peine.
Le flageolet a fix trous : le fécond, le troifieme, &
le quatrième & le fixieme font deffus, du même côté
que la lumière; le premier & le cinquième font
deffous, ou du côté oppofé à la lumière : le premier
trou& le dernier ont deux carafteres; le premier peut
être confidéré comme le dernier, en paffant de l’aigu
au grave ; & le dernier peut être confidéré comme
le; premier en paffant du grave à l’aigu.
Quand les fix trous font bouchés, la main gauche
bouche le premier, le fécond, & le troifieme ; & la
main droite le quatrième , le cinquième , & le fi-
xième.
Le pouce de la main gauche bouche le premier
l’index le fécond, & le doigt du milieu le troifieme ;
le pouce de la main gauche bouche le cinquième ,
l’index le quatrième, & le doigt du milieu le fixieme.
Il y en a d’autres qui y font fervir les quatre premiers
doigts de la main gauche, le pouce, & les trois
fuivans, & les trois premiers de la main droite dont
ils employent celui du milieu à boucher la patte ,
quand il en eft befoin.
Cet inftrument fe fait avec Pyvoire, le buis, le
prunier, l’ébenne, & autres bois durs. Son diapafon
ne fuit ni celui des cordes, ni celui des tuyaux de
L’orgue.Voici fa tablature & fon étendue communes.
D’où. l’on voit que l’étendue de cet inftrument eft
d’une quinzième. Les maîtres montrent d’abord à
jouer en G r é fo l tierce majeure, enfuite en G ré f o l
tierce mineure.
Il faut boucher les trous exaftement, quand on
veut faire les tons naturels, & ne les boucher qu’à
demi pour faire les femi-tons chromatiques ; car on
peut exécuter vingt-huit femi-tons de fuite fur le fla geolet.
Si l’on veut faire le ton plus grave, il faut boucher
les fix trous, & celui de la patte à demi.
II y a peu d’inftrumens à vent qui demandent autant
ae legereté de doigts, & une haleine plus habilement
ménagée : aufli eft-il très-fatiguant pour la
poitrine.
On peut faire, par le feul ménagement de l’air,
les fons u t , re, m i, f a , f o l , la , tous les trous étant
bouchés, même celui de la patte, qu’on peut dans
cette expérience, laifler ouvert ou bouché : il faut
commencer d’une haleine très-foible ; ces fons font
très-fbibles & irès-difliciles à fonner jufte.
En bouchant plus ou moins la patte d’un flageolet
de quatre pouces & cinq lignes de long, on fait monter
ou defcendre l’inftrument d’une tierce majeure,
quoiqu’on ne fe ferve ordinairement de ce trou que
pour le femi-ton. Ce phénomène ne réuflit pas fur
tous.
Il eft difficile d’empêcher cet inftrument d’aller à
Toôaveôe dé tenir à fon ton, malgré toute la foibleffe
de l’haleine, fur-tout lorfqu’il n’a quetrois ou quatre
pouces de long ; & quand il oâavie, les trous
étant bouchés, fouyent il redefcend à fon ton naturel
, en ouvrant tous les trous, au lieu de continuer
les fons à l’oftave en-haut ; ainfi il oftavie beaucoup
plus aifément les trous bouchés que débou-.
chés. D’où il arrive qu’on lui donne plus aifément
fon ton naturel en ouvrant le demi-trou, qu’en le
fermant.
Il fautfavoir que le fixieme trou ne doit être qu’à
demi ouvert, & non tout débouché, pour donner les
tons qui paffent à l’oâave naturel de l’inftrument.
Il y a de très-belles induûions à tirer de ces diffé-
rens phénomènes pour la théorie générale des fons
des inftrumens à vent : ils fuggéreront aufli à l’homme
intelligent beaucoup d’expériences curieufes ,
dont une des plus importantes feroit de voir fi un
inftrument de même conftruûion & de même longueur
qu’un flageolet, mais de différente capacité ou
différent diamètre , oftavieroit aufli facilement : je
n’en crois rien. Je fuis prefque fûr qu’en général
moins un inftrument à vent aura de diamètre, plus il
oûaviera facilement.
Lorfqu’un inftrument à vent a très-peu de diamètre
, la colonne d’air qu’il contient ne peut prefque
ofcillerfans fe divifer en deux : ainfi le moindre fouf-
fle le fait oftavier.
Cette caufe en fera aufli une d’irrégularité dans la
diftance dont on percera les trous ; & un phénomène
en ce genre étant donné, il ne feroit pas impoflîble
de trouver la loi de cette irrégularité pour des inftrumens
d’une capacité beaucoup moindre, depuis celui
dont la longueur eft fi grande & la capacité fi petite,
qu’il ne raifonneplus ,iufqu’à tel autre inftrument
poflible où l’irrégularité de la diftance dès trous ceffe.
Mais le phénomène néceffaire pour la folution du
problème, le flageolet le donne. On fait que fur cet
inftrument, fi la diftance des trous fuivoit la proportion
des tons , il faudroit que le quatrième trou fût
feulement d’une huitième partie plus éloigné de la
lumière qùe le cinquième trou; cependant if en eft
plus éloigné d’une quatrième partie, quoiqu’il nefaf-
fe defcendre le flageolet que d’un ton ; if en eft de
même du troifieme trou relativement au quatrième.
Les trous trois, deux, un, fuivent un peu mieux la
loi des diapafons des cordes &c des autres inftrumens
à vent. :
Il n’y a guere que la théorie où les inftrumens à
vent font comparés avec les inftrumens à corde, &c
où l’on regarde dans les premiers la longueur de
l’inftrument à vent comme la longueur de la corde ;
la groffeur de la colonne d’air contenu dans l’inftrument
à vent, comme la groffeur de la corde ; le poids
de l ’atmofphere au bout de l’inftrument à vent, comme
le poids tendant de la corde ; l’inflation de l’inftrument
à vent, comme la force pulfantede la corde ;
l’ofcillation de la colonne d’air dans la capacité de
l’inftrument à vent, comme l’ofcillation de la corde ;
les divifions de cette colonne par les trous, comme
les divifions de la corde par les doigts ; il n’y a guere
que cette théorie , dis-je, qui puiffe expliquer les bizarreries
du flageolet, & en annoncer d’autres dans
d’autres inftrumens poflibles.
FLAGRANT DÉLIT, (Jurifprud.) Foye%_ Varticle.
D é l i t .
FLAMBANT, (Hifi.nat.) Foye^F l a m m a n t .
F l a m b a n t , adj; en termes de Blafon , fe dit des
paux ondes & aiguifés en forme de flamme.
Bataille en Bourgogne, d’argent à trois pals flam-
bans, ou trois flammes tortillantes de gueules, mouvantes
du bas de l’écu vers le chef.
F l a m b a r t , f. m. terme de Pêche, ufité dans le r e f-
fort de. l’amirauté du Havre; c’eft une forte de petits
bateaux à l’ufage des Pêcheurs.
FLAMBE, iris, f. f. (H iß . nat. Botan.') genre de
plantes dont la fleur eft d’une feule piece : cette fleur
commence par une efpece d’entonnoir qui ens’éva-
fant fe divife en fix parties, dont trois font relevées
& trois font rabattues. Le piftil fort du fond de cette
fleur furmonté d’un bouquet à trois feuilles; ces feuilles
portent chacune Fur une des parties de la fleur qui
font rabattues & forment une efpece de gueule.
Lorfque cette fleur eft paffée., le calice devient un
fruit oblong qui s’ouvre par la pointe en trois parties;
il eft divifé en trois loges qui renferment des
femences prefque rondes en certaines efpeces, &
plates en quelques autres. Ajoutez aux cara&eres de
ce genre, que la racine eft charnue, oblongué, ram-i
pante, & fans aucune enveloppe. Tournefort, Infi.,
rei herb. Foye{ P l a n t e . ( / ) .
F l a m b e , G l a y e u l , ou I r i s , (Ma t. med.\ Foyer,
I r i s .- il :
F l a m b e , (H iß . nat. Iclkiologie.) poiffon de mer
qui a été appellé en grec taenia, & en latin vitta, parce
qu’il eft long & étroit .comme une bandé ou un ruban
: on lui a donné en Languedoc le nom d’ejpàçe,
c’eft-à.-dire épée, à càufe de fa figure, & celui de
fiambo, parce qu’il eftide couleur de feu. .
- L e taenia d’Ariftote eft long., mince y & flexible •
fa chair a une couleùr.blanche, & le même goût que
celle de la foie ; la tête eft applatie ; les yeux font
grands:* & les prunelles petites ; ce poiffon a deux
nageoires près des onies, & une troifieme qui s’étend
fur lé dos depuis la tête jufqu’à la queue ; il y a
des poils fur cette nageoire. .
- R o n d e l e t d o n n e a u f l i l e n o m d e tamia à u n a u t r e -
p o i f f o n d e "m e r q u i eft f o r t m i n c e , & l o n g q u e l q u e f o i s -
d e d e u x o u t r o i s c o u d é e s ; i l d i f f é r é d u p r é c é d e n t e n
c e q u ’ i l a d e u x n a g e o i r e s r o u g e s a u - d e f f o u s d e l a
m â c h o i r e in f é r i e u r e ; l e s p o i l s d e l a n a g e o i r e d u d o s ,
& c e u x d e l a q u e u e , f o n t d e l a m ê m e c o u l e u r r o u - ,
g e ; i l a f u r l e c o r p s c i n q t à c h e s r o ù g e s ; i l e f t b l a n c ,
f a n s é c a i l l e s n i a i g u i l l o n s . Hiß. des poiffons , lib. X I .
chap.xvij. & x v iij, Foye^P o iS S O N . ( F ) .
FLAMBEAU, f. ni. forte de luminaire que l’on
fait avec des tneches un peu épaiffes que l’on couvre
de cire, & qui fërt à éclairer la nuit dans les rues aux
enterremens & aux illuminations, &c.
Les flambeaux font différens des torches Sc des cierges.
Foye^ C i e r g e , T o r c h e .
Ils ont une figure quarrée ; ils font quelquefois de
cire blanche, plus fouvent de cire jaune ; ils font ordinairement
compofés de quatre meches d’un pouce
d’épais & environ trois piés de long, d’une forte de
chanvre filé & à moitié tors.
Pour les former, on fe fert d’une cueillere comme
pour les torches & les cierges ; on verfe premièrement
la cire fondue fur le haut des différens bâtons
qui font fufpendus, & on laiffe couler cette cire juf-
qu’en bas : cela fe répété par deux /ois : enfuite on
laiffe fécher ces bâtons à qui on a donné plufieurs
couches de cire ; après on les roule fur une table, &
on les joint au nombre de quatre enfemble , en les
foudant avec un fer tout rouge. Quand ils font joints
on coule deffus de la cire , jufqu’à ce qu’ils ayent
le poids convenable ; c’eft ordinairement d’une livre
& demie ou deux livres : pour les finir, on fe fert
d’une forte de poliffoire ou repaffoire de bois qu’on
promene le long des angles faits par l’union des
branches. Foyc{ B o u g i e .
Les flambeaux des anciens étoient différens desnôtres
; ils étoient de bois, fechés au feu ou autrement :
ils y en employoient de différentes fortes ; celui dont
on fe fervoitle plus ordinairement étoit le pin. Pline
rapporte que de fon tems on employoit aufli à cet
ufage le chêne, l’orme, & le coudrier. Dans le fep*
tieme livre de l’Énéide, il eft parlé d’un flambeau de
pin ; & Servius remarque fur ce paffage, que l’on en
faifoit aufli de cornouiller. Chambers. Foye^Varticle
fuivant.
F l a m b e a u ; on appelle ainfi, en terme d'Artificier,
une efpece de brandon de feu fait de pin ou de fapin,
ou de quelque-autre bois femblable, dont les anciens
fe fervoient non-feulement dans leurs maifons, pour
leurs propres ufages, mais aufli à la guerre , pour
mettre le feu aux machines des ennemis, quand ils
en étoient affez proches pour pouvoir les lancer
avec le bras.
Quoique ces flambeaux ne foient plus d’ufage, je
ne laifferài pas d’en donner ici la çonftruâion.
Faites fondre fur des charbons ardens dans un pot
de; cuivre, comme fero.it un chauderon, ou bien dans
un pot de terre verniffé, huit onces de falpetre, avec
feize onces ou une livre de foufre, quatre onces de
colophone, deux onces de poix noire, une once de
cire, & deux onces de térébenthine. Mettez dans cette
compofition ainfi fondue, du linge bien fec & bien
net, ou à fon défaut de l’étoupe aufli bien feche &
bien nette : tournez ce linge jufqu’à ce qu’il foit bien
imbibé de cette liqueur chaude : vous en envelopperez
un bâton affez long, avant qu’elle £oit refroidie ,
& vous le lierez fortement avec du fil d’archal., pour
que la compofition s’y attache mieux. Vous aurez un
flambeau, qui étant allumé ne pourra être; éteint ni
par le vent, ni par la pluie; il pourra même brûler
dans l’eau ; & on ne le peut éteindre qu’en l ’étouffant
dans du fable ou de la cendre. Chambers.
F l a m b e a u , (Orfèvrerie , Chauderonnerie.) Nous
donnons encore ce nom à de grands chandeliers de
table :■ il y en a d’or, d’argent, de vermeil, de cuivre
, &c.
FLAMBER, v. n. ( Gramm. ) c’eft donner de la
ffa.mme..Foye[ l ’article F l a m m e .
F l a m b e r ,- v. aéh & neut. ( A r t militaire. ) ce
terme s’employe dans l’Artillerie pour exprimer l’action
de nettoyer une piece avant de la charger, en
faifant brûler de la poudre dedans. (Q)
fl F l a m b e r l e c u i r , terme de Corroyeur , qui lignifie
le faire paffer par-deffus la flamme d’un feu clair,