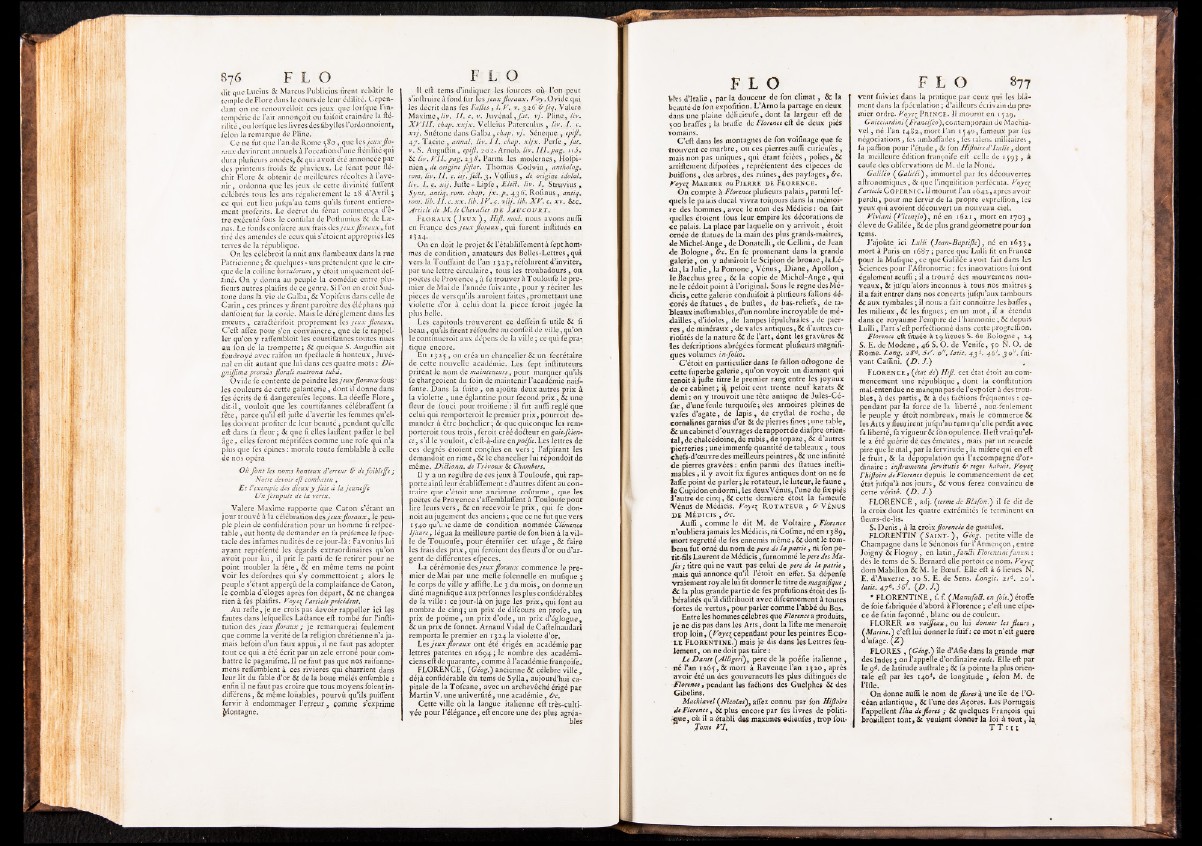
S 76 F L O ilit que Lucius & Marcus Publicius tirent rebâtir le
temple de Flore dans le cours de leur édilité. Cependant
on ne renouvelloit ces jeux que lorl'que l’intempérie
de l’air annonçoit ou faifbit craindre la fté-
rilité, ou lorl'que les livres des fibylles l’ordonnoient,
félon la remarque de Pline.
Ce ne fut que l'an de Rome 580, que 1 ss je u x f lo raux
devinrent annuels à l’occafion d’une ftérilité qui
dura plufieurs années, & qui avoit été annoncée par
des printems froids & pluvieux. Le fénat pour fléchir
Flore & obtenir de meilleures récoltes à l’avenir
, ordonna que les jeux de cette divinité fuflent
célébrés tous les ans régulièrement le 18 d’Avril ;
ce qui eut lieu jufqu’au tenis qu’ils furent entièrement
proferits. Le decret du fenat commença d’être
exécuté fous le confulat de Poftiïmius & de Læ-
nas. Le fonds confacre aux frais des jeux flo rau x , fut
tiré des amendes de ceux qui s’étoient appropriés les
terres de la république.
On les célébroit la nuit aux flambeaux dans la rue
Patricienne ; & quelques - uns prétendent que le cirque
de la colline hortulorum, y étoit uniquement def-
xiné. On y donna au peuple la comédie entre plu-
lieurs autres plaifirs de ce genre. Si l’on en croit Suétone
dans la vie de Galba, & Vopifcus dans celle de
Carin, ces princes y firent paroître des éléphans qui
danfoient fur la corde. Mais le dérèglement dans les
moeurs , cara&érifoit proprement les je u x floraux.
C ’eft affez pour s’en convaincre, que de fe rappel-
ler qu’on y raffembloit les courtifannes toutes nues
au fon de la trompette; & quoique S. Auguftin ait
foudroyé avec raifon un fpeéfacle fi honteux, Juvé-
nal en dit autant que lui dans ces quatre mots : D i -
gniflîma prorsùs florali matrona tubâ.
Ovide fe contente de peindre les jeuxfloraux fous ■
les couleurs de cette galanterie, dont il donne dans
fes écrits de fi dangereufes leçons. La déeffe Flore,
dit-il, vouloit que les courtifannes célébraffent fa
fête, parce qu’il eft jufte d’avertir les femmes qu’elles
doivent profiter de leur beauté, pendant qu’elle
efl dans fa fleur ; 8t que fi elles laiflent paffer le bel
âge , elles feront méprifées comme une rofe qui n’a
plus que fes épines : morale toute femblable à celle
de nos opéra
Où fo n t les noms honteux d'erreur & de foiblejfe ;
Notre devoir efl combattu ,
E t Vexemple des dieux y fa it à la jeuneffe
Un fcrupule de la vertu.
Valere Maxime rapporte que Caton s’étant un
jour trouvé à la célébration des jeu x flo ra u x , le peuple
plein de confidération pour un homme fi reipec-
table, eut honte de demander en fa préfence le fpec-
tacle des infâmes nudités de ce jour-là : Favonius lui
ayant repréfenté les égards extraordinaires qu’on
avoit pour lui, il prit le parti de fe retirer pour ne
point troubler la fête, & en même tems ne point
voir les defordres qui s’y commettoient ; alors le
peuple s’étant apperçû de la complaifance de Caton,
le combla d’éloges après fon départ, & ne changea
rien à fes plaifirs. Voye{ l'article précédent.
Au refie, je ne crois pas devoir rappeller ici les
fautes dans lefquelles Laûance efl tombé fur l’infti-
tution des je u x floraux ; je remarquerai feulement
que comme la vérité de la religion chrétienne n’a jamais
befoin d’un faux appui, il ne faut pas adopter
tout ce qui a été écrit par un zele erroné pour combattre
le paganifme. Il ne faut pas que nos raifonne-
mens reffemblent à ces rivières qui charrient dans
leur lit du fable d’or & de la boue mélés enfemble :
enfin il ne faut pas croire que tous moyens foient in-
différens, & même louables, pourvû qu’ils puiffent
fervir à endommager l’erreur, comme s’exprime
{Montagne.
F L O Il efl'tems d’indiquer les fources où, l’on peut
s’inflruire à fond fur les je u x floraux. Voy. Ovide qui
les décrit dans fes Fades , l .V . v. 3 2 ( 2 Valere
Maxime,liv. I I . c. v. Juvénal,fa t . vj. Pline,. AV.
X V I I I . chap. x x jx . Velleius Paterculus , liv. I . c.
x v j. Suétone dans Galba, chap. vj. Séneque , epifl.
4 7 . Tacite, annal, liv. I I . chap. x l jx . Perfe , ja t .
v. S. Auguftin, epifl. 202. Arnob. liv. I lI .p a g . 11S.
8c liv. V i l . p a g .2 38 . Parmi ,les modernes, Hofpi-
nien, de origine feflor. Thomas Çodwin , antholog.
rom. liv. I I . c. iij.j'ecl. 3.. Vofiius , de origine idolol.
liv. I . g. x i j. Julie - Lipfe , Elecl. liv. I . Struvius ,
Synt. qntiq.rom. chap. j x . ,p . 436'. Rofinus, antiq.
rom. lib. I I . c. x x . lib. IV . ç .y iij. lib. X V . c. x v . ÔCC.
Article de M . le Chevalier D E J A U COU R T .
F l o r a u x ( J e u x ) , Hifl. mod. nous avons auffi
en France des je u x flo ra ux , qui furent inflitués en
On en doit le projet & l’établiffement à fept hommes
de condition, amateurs des Belles-tL.ettres, qui
vers la Touffaint de l’an 13 23-, réfolurent d’inviter,
par une lettre circulaire., tous les troubadours, ou
poètes de Provence, à fe trouver à Touloufe le premier
de Mai de l’année fuivante, pour y réciter les
pièces de vers qu’ils auroient faites, promettant une
violette d’or à celui dont la piece feroit jugée la
plus belle.
Les capitouls trouvèrent ce delfein fi utile 8c fi
beau, qu’ils firent réfoudre au confeil de ville, qu’on
le continueroit aux dépens de la ville ; ce qui fe pratique
encore.
En 1325, on créa un chancelier 8c un fecrétaire
de cette nouvelle académie. Les fept inftituteurs
prirent le nom de mainftneurs, pour marquer qu’ils
fe çhargeoient du foin de maintenir l’académie naif-
fante. Dans la fuite, on ajoûta deux autres prix à
la violette , une églantine pour fécond prix, & une
fleur de fouci pour troifieme : il fut auffi réglé que
celui qui remporteroit le premier prix, pourroit demander
à être bachelier ; & que quiconque les remporteroit
tous trois, feroit créé doéleur en gaie-feien-
ce, s’il le vouloit, c’efl-à-dire enpoéfle. Les lettres de
ces degrés étoient conçues en vers ; l’afpirant les
demandoit en rime, 8c le chancelier lui répondoit de
même. Diclionn. de Trévoux & Chambers.
Il y a un regiftre de ces jeux à Touloufe, qui rapporte
aipfi leur établiffement : d’autres difent au contraire
que c’étoit une ancienne coutume , que les
poètes de Provence s’afTemblaffent à Touloufe pour
lire leurs vers, 6c en recevoir le prix, qui fe don-
noit au jugement des anciens ; que ce ne fut que vers
1540 qu’u .ie dame de condition nommée Clémence
Ifaure, légua la meilleure partie de fon bien à la ville
de Touxoufe, pour éternifer cet ufage , & faire
les frais des prix, qui feroient des fleurs d’or ou d’argent
de différentes efpeces.
La cérémonie des je u x floraux commence le premier
de Mai par une meffe folennelle en mufique ;
le corps de ville y affilie. Le 3 du mois, on donne un
dîné magnifique aux perfonnes les plus confidérables
de la ville : ce jour-là on juge les prix, qui font au
nombre de cinq ; un prix de difeours en profe, un
prix de poème, un prix d’ode, un prix d’églogue ,
& un prix de fonnet. Arnaud Vidal de Cafielnaudari
remporta le premier en 1324 la violette d’or.
Les je u x floraux ont été érigés en académie par
lettres patentes en 1694 ; le nombre des académiciens
efl de quarante, comme à l’académie françoife.1
FLORENCE, (Géog.) ancienne 6c célébré ville,
déjà confidérable du tems de Sylla, aujourd’hui capitale
de la Tofcane, avec un archevêché érigé par
Martin V. une univerfité, une académie, &c.
Cette ville où la langue italienne efl très-culti-
vée pour l’élégance, efl encore une des plus agréables
F L O
Mes d’Italie , par la douceur de fon climat, & la 1
beauté de fon expofition. L’Arno la partage en deux
dans une plaine délicieufe, dont la largeur efl de
çoo braffes ; la braffe de Florence efl de deux piés
romains.
C ’eft dans les montagnes de fon voifinage que fe
trouvent ce marbre, ou ces pierres auffi curicufes ,
mais non pas uniques, qui étant fciées , polies, ÔC
artiftement difpofées , repréfentent des efpeces de
buiffons, des arbres, des ruines, des payfages, &c.
V oy e^ M a r b r e ou P i e r r e d e F l o r e n c e .
On compte à Florence plufieurs palais, parmi lef-
quels le palais ducal vivra toujours dans la mémoire
des hommes, avec le nom des Médicis : on fait
quelles étoient fous leur empire les décorations de
ce palais. La place par laquelle on y arrivoit, étoit
ornée de ftatues de la main des plus grands-maîtres,
de Michel-Ange, de Donatelli, de Cellini, de Jean
de Bologne, &c. En fe promenant dans la grande
galerie, on y admiroit le Scipion de bronze,laLé-
<la, la Julie, la Pomonc, Vénus, Diane, Apollon ,
le Bacchus grec, 8c la copie de Michel-Ange , qui
ne le cédoit point à l’original. Sous le régné des Médicis,
cette galerie conduifoit à plufieurs fallons décorés
de ftatues, de bulles, de bas-reliefs, de tableaux
ineftimables, d’un nombre incroyable de médailles,
d’idoles,,de lampes iépulchrales , de pierres
, de minéraux, de val es antiques, & d’autres cu-
riofités de la nature 8c de l’art, dont les gravures ôc
les deferiptions abrégées forment plufieurs magnifiques
volumes in-folio.
C ’étoit en particulier dans le fallon oétogone de
cette fuperbe galerie , qu’on voyoit un diamant qui
tenoit à jufte titre le premier rang entre les joyaux
de ce cabinet ; if pefoit cent trente neuf karats 6c
demi : on y troiivoit une tête antique de Jules-Cé-
far, d’une feule turquoife ; des armoires pleines de
vafes d’agate, de lapis, de cryftal de roche, de
cornalines garnies d’or & de pierres fines ; une table,
& un cabinet d’ouvrages de rapport de diafpre oriental,
de chalcédoine, de rubis,de topaze, 8c d’autres
pierreries ; uneimmenfe quantité de tableaux, tous
chefs-d’oeuvre des meilleurs peintres, 6c une infinité
de pierres gravées : enfin parmi des ftatues inefti-
anables » il y avoit fix figures antiques dont on ne fe
laffe point de parler ; le rotateur, le luteur, le faune,
le Cupidon endormi, les deuxVénus, l’une de fix piés
l ’autre de cinq, 6c cette derniere étoit la fameufe
{Vénus de Médicis. Voye^ R o t a t e u r , & V é n u s
d e M é d i c i s , &c.
Auffi , comme le dit M. de Voltaire , Florence
n’oubliera jamais les Médicis, ni Cofme, né en 13 89,
mort regretté de fes ennemis même, 6c dont le tombeau
fut orné du nom de pere de la patrie, ni fon petit
fils Laurent de Médicis, furnommé le pere des Mu-
fe s ; titre qui ne vaut pas celui de pere de la patrie,
mais qui annonce qu’il l’étoit en effet. Sa dépenfe
vraiement royale lui fit donner le titre de magnifique ;
& la plus grande partie de fes profiifions étoit des libéralités
qu’il diftribuoit avec difeernement à toutes
-fortes de vertus, pour parler comme l’abbé du Bos.
Entre les hommes célébrés que Florence a produits,
je ne dis pas dans les Arts, dont la lifte me meneroit
trop loin, (Voye^cependant pour les peintres E c o l
e F l o r e n t i n e . ) mais je dis dans les Lettres feulement,
on ne doit pas taire :
Le Dante ( Alligeri), pere de la poéfie italienne ,
né l’an 1165,6c mort à Ravenne l’an 1310, après
avoir été un des gouverneurs les plus diftingués de
Florence, pendant les faétions des Guelphes 6c des
Gibelins.
Machiavel (Nicolas), affez connu par fon Hifloire
de Florence, 6c plus encore par fes livres de politi-
■ cue, où il a établi des maximes «dieufes, trop fou-
Jomt VU
F L O 877
vent fuivies dans ment dans la pratique par ceux qui les blâla
fpéculation ; d’ailleurs écrivain du premier
ordre. Voye-i Prince. 11 mourut en 1529.
Guicciardini (Francifcofl contemporain de Machiavel
, né l’an 1482, mort l ’an 1540, fameux par fes
négociations, fes ambaffades, les talens militaires,
fa paftion pour l’étude, & fon Hifloire d'Ita lie, dont
la meilleure édition françoife cft celle de 1593 , à
çaufè des obfervations de Mi de la Noué.
Galiléo ( Galiléi ) , immortel par fes découvertes
aftronomiques, 6c que l’inquifition perfécuta. Voyeç
l ’article Copernic. Il mourut l’an 1642,après avoir
perdu, pour me fervir de fa propre expreffion, fes
yeux qui avoient découvert un nouveau ciel.
Viviani (Vicenflo), né en 1621, mort en 1703 ,
élève de Galilée, 6c de plus grand géomètre pour fon
tpms.
J’ajoute ici Lulli (Jean-Baptiflc), né en 16.33,
mort à Paris en 1687 ; parce que Lulli fit en France
pour la Mufique, ce que Galilée avoit fait dans les
Sciences pour I’Aftronomie : fes innovations lui ont
également seufli ; il a trouvé des mouvemens nouveaux,
6c jufqu’alors inconnus à tous nos maîtres >
il a fait entrer dans nos concerts jufqu’aux tambours
6c aux tymbales ; il nous a fait connoîrre les baffes,
les milieux, 6c les fugues; en un mot, il a étendu
dans ce royaume l’empire de l’harmonie ; 6c depuis
Lulli, l’art s’eftperfectionné dans cette progre/fion.
Florence cft ûtucc à 19 lieues S. de Bologne , 2.4
S. E. de Modene, 46 S. O. de Venife, 50 N. O. de
Rome. Long. x 8 A. SV . o " . lotit. 43 d. 4 6 '. 3 0 " . fui-
vant Caffini. (Z?. /.)
Florence, (état de) Hifl. cet état étoit au commencement
une république, dont la conftitution
mal-entendue ne manqua pas de l’expofer à des troubles
, à des partis, ôc à des faôions fréquentes : ce--
pendant par la force de la liberté , nondeulement
le peuple y étoit nombreux, mais le commerce 6c
les Arts y fleurirent jufqu’au tems qu’elle perdit avec
fa liberté, fa vigueur 6c fôn opulence. Il efl vrai qu’elle
a été guérie dè ces émeutes , mais par un remede
pire que le mal, par la fervitude, la mifere qui en eft
le fruit, 8c la dépopulation qui l’accompagne d’ordinaire
: inflrumenta ferviïutis & reges habuit. Voye{
T hifloire de Florence depuis le commencement de cet
état jufqu’à nos jours, 8c vous ferez convaincu de
cette vérité. (D . /.)
FLORENCÉ , adj. (terme de Blafon.) il fe dit de
la croix dont les quatre extrémités fe terminent en
fleurs-de-lis.
S. Denis, à la croix florencée de gueules.
FLORENTIN (S aint- ) , Géog. petite ville dé
Champagne dans le Sénonois fur l’Armençon, entre
Joigny & Flogny, en latin 9fâncli Florentini fanum :
dès le tems de S. Bernard elle portoit ce nom. Voye£
dom Mabillon 8c M. le Boeuf. Elle eft à 6 lieues N.
E. d’Auxerre, 10 S. E. de Sens. Longit. z i d. 20'.
latit. 4 7 A. S U . (D . J . j
* FLORENTINE, f. f. (ManufaB. en foie.) étoffe
de foie fabriquée d’abord à Florence ; c’eft une efpe*
ce de fatin façonné, blanc ou de couleur.
FLORER un vaijfeau, ou lui donner les fleurs ,
Marine.) c’eft lui donner le fuif : ce mot n’cil guere
’ufage. ( Z )
FLORES , (Géog.) île d’Afie dans la grande mer
des Indes ; on l’appelle d’ordinaire eude. Elle eft pair
le 9d. de latitude auftrale ; & fa pointe la plus orientale
eft par les I40d» de longitude , félon M. de
l’Ifle.
On donne auffi le nom de flores à une île de l’Océan
atlantique, & l’une des Açores. Les Portugais
l’appellent Ilha de flores ; & quelques François qui
brouillent tout, 8c veulent donner la loi à tout, la
T T t t t