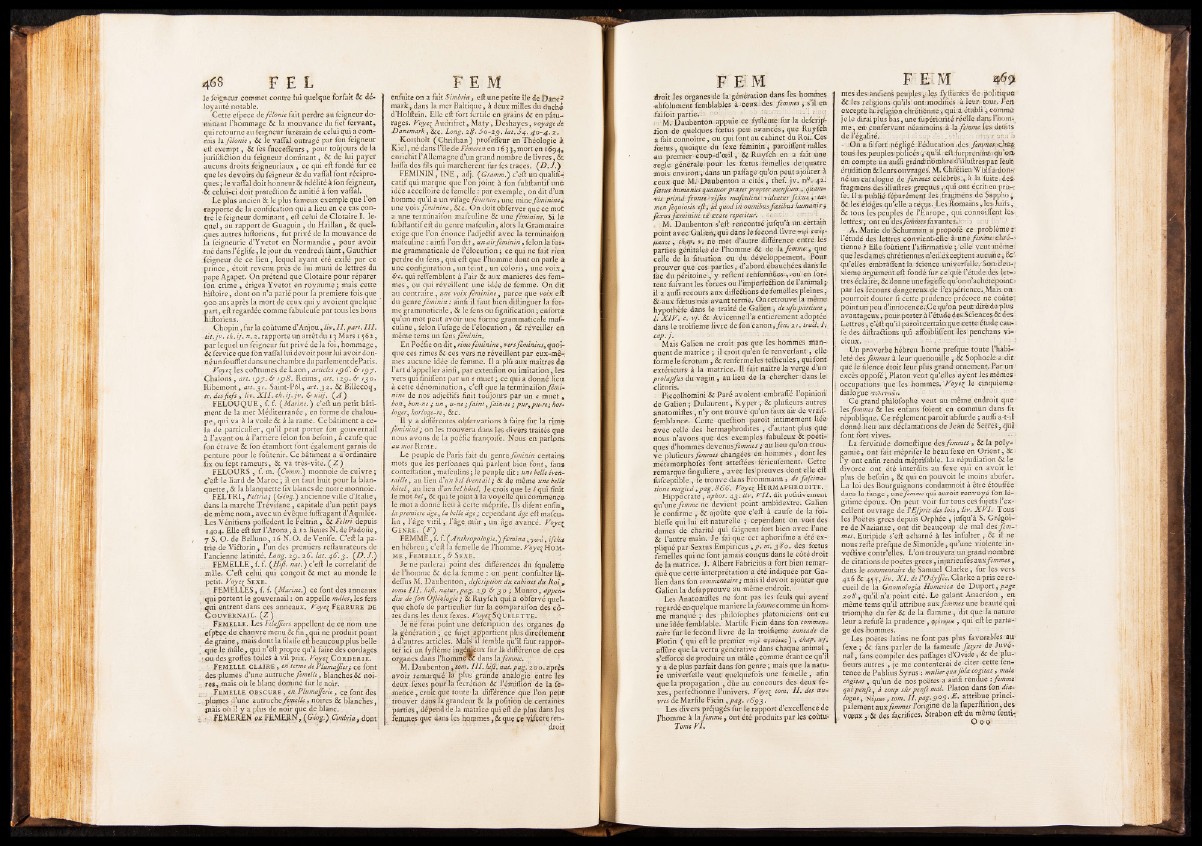
le feigneur commet contre hii quelque Forfait 8c déloyauté
notable.
Cette efpece de. félonie fait perdre ait feigneur dominant
l’hommage 8c la mouvance du fief fervant,
qui retourne au feigneur fuzerain de celui qui a commis
la félonie, -8c le vaffal outragé par fon feigneur
eft exempt, 8c fés FuccefTeurs, pour toujours de la
.jurifdiâion du feigneur dominant, 8c de lui payer
aucuns droits feigneuriaux , ce qui eft fondé fur ce
que les devoirs du feigneur 8c du vaffal font réciproques
; le vaffal doit honneur 8c fidélité à fon feigneur,
■ & celui-ci doit proteélion 8c amitié à fon vaffal.
Le plus ancien & le plus fameux exemple que ton
rapporte de la confifcation qui a lieu en ce cas contre
le feigneur dominant, efl celui de Clotaire I. lequel
, au rapport de Guaguin , du Haillan, 8c quelques
autres hiftoriens, fut privé de la mouvance de
la feigneurie d’Yvetot en Normandie , pour avoir
•tué dans l’églife, le jour du vendredi faint, Gauthier
feigneur de ce lieu , lequel ayant été exilé par ce
prince, étoit revenu près de lui muni de lettres du
pape Àgapet. On prétend que Clotaire pour réparer
fon crime , érigea Yvetot en royaume ; mais cette
hiftoire, dont on n’a parlé pour la première fois que
-ooo ans après la mort de ceux qui y avoient quelque ’
part, eft regardée comme fabuleufe par tous les bons
hiftoriens.
Chopin, fur la coutume d’Anjou, liv. 11. part. III.
tit.jv. ch. ij. n. 2. rapporte un arrêt du 13 Mars 1562,
par lequel un feigneur fut privé de la foi, hommage,
8c fervice que fon vaffal lui devoit pour lui avoir donné
un foufflet dans une chambre du parlement deParis.
Voye^ les cofttumes de Laon, articles 196. & 19 y.
Chalons , art. igy. & 198. Reims, art, 129. & 130.
Ribemont, art. 31. Saint-Pôl, art. 32. 8c Billecoq,
tr. des fiefs , liv. X I I . ch. ij.jv . & xiij. (.A )
FELOUQUE, f. f. (Marine.') c’eft un petit bâtiment
de la mer Méditerranée, en forme de chaloupe,
qui va à la voile & à la rame. Ce bâtiment a cela
de particulier, qu’il peut porter fon gouvernail
à l’avant ou à l’arriéré félon fon befoin, à caufe que
fon étrave 8c fon étambort font également garnis de
penture pour le foûtenir. Ce bâtiment a d’ordinaire
îix ou fept rameurs, 8c va très-vite. ( Z )
FELOURS , f. m. (Comm.) monnoie de cuivre ; .
c’eft le liard de Maroc ; il en faut huit pour la blanquette
, & la blanquette fix blancs de notre monnoie.
FELTRI, Feltria; (Geog.) ancienne ville d’Italie,
dans la marche Trévifane, capitale d’un petit pays
de même nom, avec un évêque fuffragant d’Aquilëe.
Les Vénitiens poffedent le Feltrin, 8c Feltri depuis
1404. Elle eft fur l’Arona, à 12 lieues N. de Padoiie,
7 S. O. de Belluno, 16 N.O. de Venife. C’eft la patrie
de Viétorin, l’un des premiers reftaurateurs de
l’ancienne latinité. Long. 29.26 . lat. 46'. 3 . (D .J .) ;
FEMELLE, f. F. (Hifi. nat. ) c ’e f t l e c o r r é la t i f d e
m â le . C ’e ft c e lu i q u i c o n ç o i t 8c m e t a u m o n d e le \
p e t it . Voye^ SEXE.
; I FEMELLES, f. f. (Marine.) ce font des anneaux
qui portent le gouvernail : on appelle mâles, les fers
qui entrent dans ces anneaux. Voye^ F e r r u r e d e
G o u v e r n a i l . (Z )
F e m e l l e . Les Fïlaffiers appellent de ce nom une
efpfcce de chanvre menu 8c fin, qui ne produit point
de graine, mais dont la filaffe eft beaucoup plus belle
que le riiâle, qui n’eft propre qu’à faire des cordages
[ ou des groffes toiles à vil prix. Voye^ C o r d e r i e .
• F e m e l l e CL AIR E , en terme de Plumaffieri cé font !
des plumes d’une autruche femelle, blanchésôc noi-,
res, mais oit le blanc domine fur le noir. ,.
• F e m e l l e o b s c u r e , en.PlumaJferie, ç e fo n t d è s
p lum e s d ’u n e a u t ru c h tfemelle, n o i r e s 8 c b la n c h e s , !
tn à is oit il y a p lu s d e n o i r q u e d é b la n c . ,
■ FEMEREN 9U FEMERN, (Géog.) Cimbr\a, dont*
enfiute on a fait Simbria, eft une petite île de Üanë3
mark, dans la mer Baltique, à deux milles du duch©
d’Holftein. Elle eft fort fertile en grains 8c en pâturages.
Foyer Audrifret, Maty, Deshayes, voyage de
Danemark, &c. Long. 28• 60-29. ^at- ^4- 40-4. 2.
Kortholt (Chriftian ) profeffeur en Théologie k
K ie l, né dans l’ile de Ferneren en 163 3, mort en 1694,'
enrichit F Allemagne d’un grand nombre de livres, 8t
laiffa des fils qui marchèrent fur fes traces. (D . J.'y
FEMININ, INE, adj. (Gramm.) c’eft un qualifi-»
catif qui marque que l’on joint à fon fubftantif une
idée acceifoire de femelle : par exemple, on dit d’un
homme qu’il a un vifage féminin, une mine féminineV
une voix féminine, 8ce. On doit obferver que ce mot
a une terminaifon mafculine 8c une féminine. Si le
fubftantif eft du genre mafculin, alors la Grammaire
exige que l’on énonce i’adjeûif avec la terminaifoii
mafculine : ainfi l’on dit, un air féminin, félon la forme
grammaticale de l’élocution ; ce qui ne fait rien
perdre du fens, qui eft que l’homme dont on parle a
une configuration, un teint, un coloris, une voix
&c. qui reffemblent à l’air & aux manières dès femmes
, ou qui réveillent une idée de femme. On dit
au contraire, une voix féminine, parce que voix eft:
du genre féminin : ainfi il faut bien diftinguer la forme
grammaticale, & le fens ou lignification ; enfort®
qu’un mot peut avoir une forme grammaticale masculine,
félon l’ufage de l’élocution, 8c réveiller en
même tems un fens féminin.
En Poéfie on dit, rime féminine, vers féminins, quoique
ces rimes 8c ces vers ne réveillent par eux-mê-'
mes aucune idée de femme. Il a plû aux maîtres de
l’art d’appeller ainfi, par extenfion ou imitation, les
vers qui finifient par un e muet ; ce qui à donné lieu
à cette dénomination, c’eft que la terminaifon féminine
de nos adjeûifs finit toujours par un e muet ,
bon, bon-ne , un, u-ne ; faint , fain-te j pur,pu-re; horloger
9 horloge-re, &c.
Il y a différentes obfervations à faire fur la rime
fémininê; on les trouvera dans les divers traités que
nous avons de la poéfie françoife. Nous en parlons
au mot R i m e .
Le peuple de Paris fait du gyenx'e,-féminin certains
mots que les perfonnes qui parlent bien font, fans
conteftation, mafculins ; le peuple dit : une belle éveii-
taille, au lieu d*un bel éventail,• & de même une belle
hôtel, au lieu d'un bel hôtel. Je crois que le l qui finit
le mot bel, 8c qui fe joint à la voyelle qui.commence
le mot a donne lieïi à cette méprife. Ils difent enfin,
la première âge, la belle âge ; cependant âge eft mafculin
, l’âge v ir il, J ’âge mûr , un âge avancé. Voyez
G e n r e . ( F )
FEMME, f. f. (.Anthropologie.) feemina, yw», ifcka.
e n h é b r e u ; c ’ e ft la fem e lle d e l ’h om m e . Voye^H o m m
e , F e m e l l e , & S e x e .
Je ne parlerai point des différences du fquelette
de l’homme 8c delà femme : on peut confulter là-
• deffus M. Daubentön , defcriptïon du cabinet du Roi ,
tome I I I . hifi. natur.pag. 29 & 30 ; Monro, appert-
, dix de fon Ofiéçlogie ; & Ruyfch qui .à obfervé quelque
chofe de particulier fur la corn par aifon des côtes,
dans-les deux fexes. Voye^S q u e l e t t e .
Jé rie ferai point une defcriptïon des organes de
la génération ; ce fujet appartient plus direâemeht
à d’au„tres articles. Mais il femble qu’il faut rapporter
ici un fyftème jngémèùx für là différence de ces
organes dans l’homme^ dans la femme. ,1, ‘
M. Daubentoii ; }dm. I lI . hifi. “nat. pdg. 20 0. aprps
avoir remarqué la' plus grande analogie entre lès
deûx féxes pour là Tecrétion 8c Félnifliôn de la ferne
nce ,' croit que toute la différence que' l’on pept
trouver dâfis la grandeur & la pofitiofi dè certairiès
parties, dépend de la matrice qui éft de plus dans les
femmets que dans fes hommes, 8c que ce vifeere rendroit
les organesfdé la'géiïéraùon dans Tes hommes !
-abfolument femblables k.ceüX-des femmes ÿ^s’il en
dfeifoit partie. : J : v.> înorrsc î;j j .* e*jjq :
/ rM. Daubènton appuie ce fytftgmeTurla deferipr
lion de quelques Foetus peu> avances’, que Ruy.fch
a fait connoître, ou qui font au cabinet du Roi.. Ces j
foetus , quoique du lexe féminin:,' paroiffent hiâles
au premier coup-d’oe i l ,' 8c R.uyfch en a fait ùne
réglé générale ^pour les foetus ■ féinelles de:qiratre
mois environ ;'daiîs un paffage qiffdn peut ajouter à
ceux quC M:.l;Paubenton a .cités ; thef. jv , ni?. 42!
foetus huma nus quatuor proeter propter >mcnjium.î\qùanv*
vis primâ fronûïvjfus 'mafbuümtyttUatur fexu\ i l ta-
men fequiorh 'efi, td qtiod in omnibüs fcetibus humahÿs9
fèxus faminïnueâ'oetate reperitufc ( ficn.ci-: • .n i ' ;^
, ■ M. Daubenton s’eft rencontpé jufqu’à un certain
point avec Galien,'qui danstfefécond
fxctToç, çhan. vi né met d^autre différence entré-leà
parties génitales de l’homme*^ &C de ■.’la femme: ÿ que
celle de la fituation ou du développement^. Poiiu
prouver que. ces^ parties ; d’ abord :ébauchées dihsde
lac du péritoine v y reftent renfennêe»v,vou' en Ford
tent fuivant lès forces o u l’imperfeéBon deEanimalp
il a aufli recours aux différions defemëlles, pleines ?
& aux fdetusnés avant ternie.’ On retrouve- la meme
hypothèfe dans le traité de Galien^ dcjifupârtiumy
l. X IV . c. vjé&c Avicennôil’a entièrement adoptée
dans le troifieme livre deLon'êanon jfèn ï^i. tfucl. h
cap.j. > 'j ' ■ ..t
Mais Galien ne croit pas que les hommes man-j
quent de matrice ; il croit qu’en fe rènverfaht , elle’
forme le-fcrotum, 8c renferme les tefticulës, qui font
extérieurs- à la matrice.-îl fâir naître la verge d’un
prolapfus du v agin, au lieu d e là - chercher : dans le-
clitoris; ‘ ! r,: 1 t:_ " / „
. Piccolhomini 8c Paré avoiènt embraffe l’opinion:
de Galien ; Dulaürent, Kÿperj; 8c plufieurs autres^
anatomilles, n’y ont trouvé qu’un faux air de v-ràif-
femblançe. Cette queftion paroît intimemènt liée
avec ceile des hermaphroditês , d’autant plus que
nous n’avons que 'des exemples fabuleux & poétiques
d’hommes d even u sfem m es / airlieu qu’on trou-
v e iphiûeurs fem m es changéês èn hommes , ’ dont les
niétamoxphofes 'font atteftées-’ ferieufement. Cette
remarque finguliere., avèC'lêS'preuves dont elle eft
fufceptiblei^fe trouve dans Frômmann, de fu fe in a -
tione m ugicâ, pag. 8 6 6 . Voye£ H e r m a p h r o d i t e .
Hippdcratc , nphor. 4gVliv\ VII. dit pofitivèment
qu’une femme ne devient point ambidextre* Galien
le confirme ajoute que c’eft à caufe de la foi-
bleffe qui lui éft naturelle ; cependant on voit des
dames de charité qui faignent fort bien avec l’une
& l’autre main. -Je fai que cet aphorifme a ete expliqué
par Sextùs Empiriçus ,p . m. 380. des foetus
femelles qui ne font jamais conçus dans le côté droit
de la matrice. J. Albert Fabricius a fort bien remarqué
que cette interprétation a été indiquée par Galien
dans fon commentaire ; mais il devoit ajoûtef que
Galien la defapprouve au même endroit. -
Les Anatomiftes ne font pas les feuls qui ayent
regardé èn-quelque maniéré la femme comme fin homme
manque ; des philofophes platoniciens ont eu
une idéefemblable. Marfile Ficin^dans (on commen-
taire fur le fecônd livre de la troifième énneade de
Plotin ( qui eft le premier vripi 4rporôiaef , chap. )cj.
affûre que la vertu générative dans chaque animal ;
s’efforcé de produire un mâle,-comme étant ce qu’ii
y a dé plus parfait dans fon genre ; mais que la nature
univerfelle veut quelquefois une femelle, afin
que la propagation , dûe au concours des deux fexes,
perfectionne l’univers. Voye^ tom. II. des oeuvres
de Marfile Ficin ,pag. 1693.
Les divers préjugés fur le rapport d’excellence de
l’homme à \a femme} ont été produits par les çoûtu-
Tome VI*
mes desianciens peuples:,clçs lyftèm'es 'de-ipofitique 8c :les religions-qu’ils-ont:modifiés ;-à leur. tp.ur. J’en
excepté bui'çligipnchrëtiënné^fquicà-établi^ comme
ï je le dirai plus bas, une fiipéfiarité ré é lle .d ^ l?hom-
me ; .eib confervant nëarimains:à-la^/®w:fès;drctits
de l’égaîité.i: îamfî sup i h t , sîlij: ■ - un97 or.ss'b
- ;O n a filfori négligé '.Héducation'i des. ferqmespçh&jt
tous. les. peupl es: policés q qu’nl 1 eft .fur pr énàîntri qü ’on>
ém compte un aufli grinftn6mbreixi’iUuftrësjpac Feuo
éniditicm &2eursouvrages. M. GhSltien Wblfardonw
né .un catalogué, de femmes célébrés^, à Aa !ftiite sde»
fragmens; desiHuftreis grequ!es:;cqiii ont écritieu pro-r
fe.; Il a piibliéc-feparémei^ âefe. ifitagmén&dô Çapphô ;
Ôcffesiéiôgès: qu’elle a réçps.jLes RxDmains les» Juifs ,
j 8c tous les peuples de l’Europe, qui connoiuent lès.
j lettfes:;:ont'eu desyè/rèzheïjfiivantesiiof'o oriu ib ‘
. A.-Marie de\Schurman àipropofé ce problème r
! l’étude' des lettres cbnvient^elle' ài ur\e<feinmaxét^è-'
j tienne? Ellefoûtientl’àffirmativie;/elle: veut même:
; que les dames çhrétienn;es;n’enlèieeptentaucuüey8£'.
| qu’elles embrâffent la fcience uniyerfellè.rSqrüdeu-;
xieme argûment-eft fondéi fur-ce Iqiièi’étude ides letr-j
■ très édairè; 8c donne une fâgéffe:qu’on ri’achdte'paint)
| par les ifecriUrs) dangerexoc-'pe Fqxpériencé;„Màis on ;
j-pourroit douter fi cette prudence précoce ne coûtéj
j pôihrampeu d’ipnocence£:jCeqvi;,on peittd&édeplüs
; avantageux ypour-porter-àL?étude 4«s5 cience^8cd e s .
i Lettres:; c’éft qu’il paroîtçertaiague cette ëiudecaun:
i fe des diftraélion5 qiii affoibliffent fèsipenchans v i-
j cieux.. .
: .Un proverbe hébreu- -borne prefque toute l’hàbij
leté des femmes à leur quenouille , 8c Sophocle-a: dit
; que léfiléncè étoit leur-plus grand-ornement. Par un
. excès oppofe ; Platon vent quelles ayent les mêmes -
j Qccupatiohsr que les hommes. 'Vôyt^ le cinquième^
■ dialogue
Ce grand phitbfophe veut au même, endroit que *
• les femmes 8c les enfans foient en commun dans fa
république * Ce-réglement paroît abfurde ; aufli a-t-il
donné-liéU' aüx déclamations de Jean de Serres , qui-
font fort vives.
La fervitude domeftique des femmes , 8c la p o ly - 1
garnie, ont fait méprifer le beaufexe en Orient, 8c
l’y ont enfin rendu méprifable. La répudiation 8c le
divorce ont été interdits au fexe qui en-avoir l e -
plus de befoin , 8c qui en pouvoit le moins abufer.
La loi des Bourguignons condamnoit à être étouffée
dans la fange, unefèmmequi auroit renvoyé fon lé-'
gitime époux. On peut voir fur tous ces ni jets l’ex-:
cellent ouvrage de VEfpritdes lois, liv. X V I . Tous»
les Poètes grecs depuis Orphée , jufqu’à S. Grégbi-'
re de Nazianze, ont dit- bèaucoup de mal dès fem-\
mes. Euripide s’eft acharné à les infulteq, 8c il ne
nous refte prèfque de Simonide, qu’une violente in-
veftive contr’elles. L’on trouvera uii grand nombre
de citations de poètes grecs, injurieufés auxfemmes ,
dans le commentaire de Samuel Clarke, fur les vers
426 8c 45 5 ,liv . X I . de VOdyffée. Clarke a pris cere--
cueil de la Gnomoiogia Homerica de Duport, page
20 8 , qu’il n’a point cité. Le galant Anacréon , en
mêmetems qu’il attribue aux femmes une beauté qui-
triomphe du fer 8c de la flamme, dit que; la nature
leur a refufé la prudence, tppôvnpa. , qui eft lè parta-:
ge des-hommes.
Les poètes latins ne font pas plus favorables au*
fexe ; 8c: fans parler de la fameufe fatyre de Juvé-
n al, fans compiler des paffages d’Ovide, 8c de plu-*
fleurs autres , je me contenterai de citer .cette fen-
tence de Publius Syrus : mulier quafola cogitât, male
cogitât , qu’un de nos poètes a ainfi rendue : femme
quipenfe, à coup sur penfe mal. Platon dans fon dialogue,
N o '^ , tom. II.pag.90 9 -E- »««bue principalement
aux femmes l’origine de la fuperftition, des
voeux •- 8c des facrifîcès. Strabon eft du meme fenti*
O 0 0;