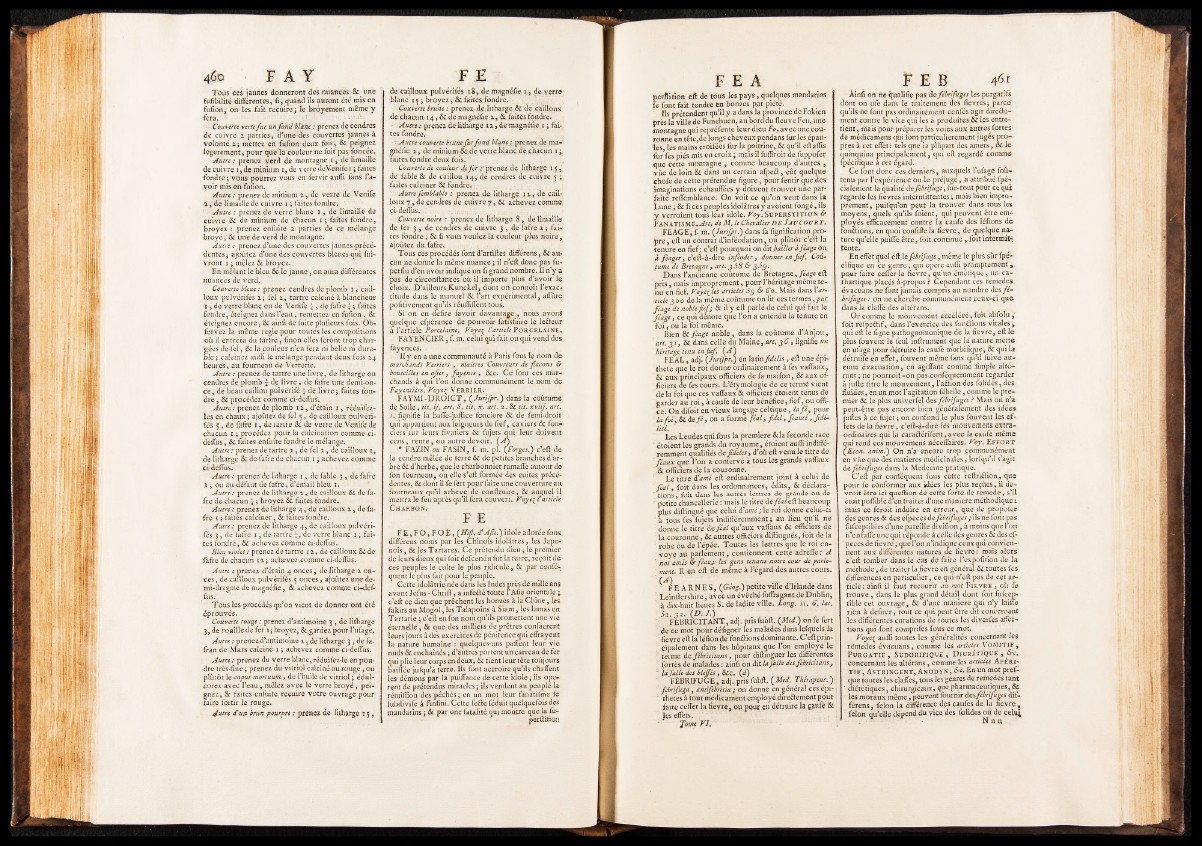
Tous ces jaunes donneront des nuances & une
fufibilité différentes * fi , quand ils auront été mis en
fufion, on les fait recuire ; le broyement même y
fêirà. ‘ '"'V
Couverte verte fur un,fond blàhc : prenez de cendres
de cuivre z parties, d’une des couvertes jaunes à
volonté z ; mettez en fufion'deux fois* ôc-peignez
legerement, pour qùè la couleur ne foit pas foncée.
Autre : prenez verd dé montagne i j de limaille
de cuivre i,d c minium i , de verre de Venife i ; faites
■ fondre; vbiis pourrez votfsenfervir auffi fan sl’a-
,voir mis en fufion.
Autre : prenez de minium 2^ de verre de Vehife
2 , de limaille de cuivre i ; faites fondre. \
Autre : prenez de verre blanc i , de limaille de
cuivre' & de minium de chacun i ; ’faites fbndre,
broyez : prenez enfuite z parties de ce mélange
•broyé, & une de verd de montagne.
Autre : prenez d’une des couvertes jaunes précédentes,
ajoutez d’une des’ Couvertes bleues qui fui-
vront i ; mêlez & broyez.
En mêlant le bleu & le jaune, on aura différentes
nuances de verd.
Couverte bleue : prenez cendres de plomb i , ’cailloux
pulvérifés z ; fel z , tartre calciné à blancheur
ï , de verre blanc ou de Venife { , de fafre f ; faites
fondre, éteignez dans l’eau , remettez en fufion, &
éteignez encore, ainfi de fuite plufieurs fois. Ob-
fervez la même réglé pour toutes les compofitions
oit il entrera du tartre, finon elles feront trop chargées
de fel, &c la couleur n’en fera ni belle ni durable
; calcinez auffi le mélange pendant deux fois Z4
heures, au fourneau de Verrerie.
Autre : prenez de tartre une livre, de litharge ou
cendres de plomb \ de liv re , de fafre une demi-onc
e , de beau caillou pulvérifé 7 de livre ; faites fondre
, & procédez comme ci-deffus.
Autre: prenez de plomb i z , d’étain 1 , réduifez-
les en chaux ; ajoûtez de fel' 5, de cailloux pulvérifés
5 , de fafre 1 , de tartre & de verre de Venife de
chacun 1 ; procédez pour la calcination comme ci-
deffus , & faites enfuite fondre le mélange.
Autre: prenez de tartre 2 , de fel 2 , de Gailloux 1,
de litharge & de fafre de chacun 1 ; achevez comme
ci-deffus.
Autre : prenez de litharge 1 , de fable 3 , de fafre
1 , ou au défaut de fafre, d’émail bleu 1.
Autre : prenez de litharge z , de cailloux & de fa*
fre de chacun 7 ; broyez & faites fondre.
Autre : prenez de litharge 4 , de cailloux z , de fafre
1 ; faites calciner, & faites fondre.
Autre: prenez de litharge 4, de cailloux pulvérifés
3 , de fàfie 1 , de tartre 7 , de verre blanc 1 ; faites
fondrè, & achevez comme ei-deffuS.
Bleu violet : prenez de tartre 1 z , de cailloux & de
-fafre de chacun i z ; achevez comme ci-deffus.
Autre : prenez d’étain 4 onces, de litharge z on-
' ce s , de cailloux pulvérifés 5 onces, ajoûtez une de-
mi-dragme de magnéfie, & achevez comme ci-deffus
.T
ous les procédés qu’on vient de donner ont été
éprouvés.
Couverte rouge : prenez d’antimoine 3 , de litharge
3, de rouille de fer 1; broyez, & gardez pour l’ufage.
Autre : prenez d’antimoine z , de litharge 3 , de fa-
Han de Mars calciné 1 ; achevez comme ci-deffus.
Autre : prenez du verre blanc, réduifez-le en poudre
très-fine ; prenez du vitriql calciné ou rouge , ou
plutôt le caput mortuum, de l’huile de vitriol ; édulcorez
avec l’eau, mêlez avec le verre broyé, peignez,
& faites enfuite recuire votre ouvrage pour
faire fortir le rouge.
dutre d'un brun pourpre : prenez de litharge 1 5 ,
de: cailloux pulvérifés 18, de magnéfie 1 ; de Verre
blanc 15 ; broyez,. & feitesrfondre. -
Couverte brune ; prenez. de.litharge & de cailloux
de chacun^ 14 , & de magnéfie z , & faites 'fondre.. - Autre : prenez de’ litharge 12 > de magnéfie, .1 j faite:
s fondre. Autre couverte bruhefurfond blanc p r e n e z de magnéfie;
2,. de minium: &r deVerre blanc de chacun 1 ;
faites fondre deux fois. ’
Couverte de couleur defer;’nx<enez de litharge 15,'
de fiable & de caillou .14, de cendres de cuivre 5 ;
faites calciner & fondre.
Autre femblable : prenez .de litharge 12 , de cail*
loux 7 , dé: cendres de cuiyre 7 , & achevez comme
ei-deffus.'d -
de Cfoeur,v erte noire : prenez-de litharge 8 , de limaille 3 ., de cendres dç cuivre 3 , de fafre z ; faites
fondre ; & fi vous voulçz la couleur plus noire ,
ajoûtez du fafre.
Tous ces procédés font d’artiftes différens, & aucun
ne donne la même nuance ; il n’eft donc pas fu-
perflu d’en avoir indiqué un fi grand nombre. Il n’y a
pas de cirèonftances où il importe plus d’avoir le
choix. D ’ailleurs Kunckel, dont on connoît l’exactitude
dans le manuel & l’art expérimèntal, affûre
politivement qu’ils réuffiffent tous. .,. queSliq ouen eefnp édreafnircee fdaey opior udvaoviar nftaatgisef a,i rne olue sl.eafvtoenusr à l’article Porcelaine. Voye%_ l'article PoRCEjLAiNE.
FAYENCIER, f. m. celui qui fait ou qui vend des
fayences.
Il y en a une communauté à Paris fous le nom de
marchands Verriers , maîtres Couvreurs de flacons &
bouteilles en ojier, fayence , & c . Ce font ces marchands
à qui l’on donne communément le nom de
Fay entiers, Voye{ VERRIER.
FA YMI-D ROICT , ( J u r i fp r dans.la coûtume
de Solle, tit. if. art. 8. tit. x . art. z . & tit. xviij. art.
/. fignifie la baffe-juftice foncière & de femi-droit
qui appartient aux feigneurs de fief, caviers & fonciers
lur leurs fivatiers &c fujets qui leur doivent
cens, rente, ou autre devoir. (A )
* FAZIN ou FASIN, f. m. pl. (Forges.) c’eft de
la cendre mêlée de terre & de petites branches d’arbre
& d’herbe, que le charbonnier ramaffe autour de
fon fourneau, où elle s’eff formée des cuites précédentes,
& dont il fe fert pour faire une couverture au
fourneaux qu’il achevé de conftruire, & auquel il
mettra le feu après qu’il fera couvert. Voye^ l'article
C h a r b o n .
F E
F E ,F O ,F O É , (Hift. <T Afie.) idole adorée fous
différens noms par les Chinois idolâtres, les Japo-
nois, & les Tartares. Ce prétendu dieu, le premier
de leurs dieux qui foit defcendu fur la terre, reçoit de
ces peuples le culte le plus ridicule, & par confc-»
quent le plus fait pour le peuple.
Cette idolâtrie née dans les Indes près de mille ans
avant Jefus - Chrift, a infeâé toute l’Àfie orientale ;
c’eft ce dieu que prêchent les bonzes à la Chine, les
fakirs au Mogol, les Talapoins à Siam, les lamas en
Tartarie ; c’eft en fon nom qu’ils promettent une vie
éternelle, & que des milliers de prêtres confacrent
leurs jours à des exercices de pénitence qui effrayent
la nature humaine : quelques-uns paffent leur vie
nuds & enchaînés ; d’autres portent un carreau de fer
qui plie leur corps en deux, & tient leur tête toûjours
baiffée jufqu’à terre. Ils font accroire qu’ils chaffent
les démons par la puiffance de cette idole ; ils oper
rent de prétendus miracles ; ils vendent au peuple la
rémiffion des péchés ; en un mot leur fanatifme fe
fubdivife à l’infini. Cette feéte féduit quelquefois des
mandarins ; & par une fatalité qui montre que la fu-
perftition
perdition eft de tous les pays, quelques mandarins
fe font fait tondre fcn bonzes par piété.
Ils prétendent qu’il y a dans la province de Fokien
près la ville de Funchuen, au bord du fleuve Feu, unë
montagne qui repréfente leur dieu Fo, avec une couronne
en tête,de longs cheveux pendans fur les épaules,
les mains crôifées fur la poitrine, & qu’il eft afîis
fur fes piés mis en croix ; mais il fuffiroit de fuppôfer
que cette montagne , comme beaucoup d’autres *
vûe de loin & dans un certain afp e â , eût quelque
choie de cette prétendue figure, pour fentir que des
imaginations échauffées y doivent trouver une parfaite
reffemblance. On voit ce qu’on veut dans là
Lune ; & fi cés peuples idolâtres y avoient fongé, ils
y verroient tous leur idole. Voy. Su p e r s t it io n &
Fa n a t i sm e . A r t . de M . le Chevalier D i s J a u c o u r t .
FEAGE, f. m. ( Jurifpr.) dans fa lignification propre
, eft un contrat d’inféodation, ou plûtôt c’e’ft la
tenure en fief: c’eft pourquoi on dit bailler à feage ou
à fèager, c’eft-à-dire inféoder , donner en fief. Coâ-
tume de Bretagne , art. $58 & 3.^9. ' 1
Dans l’ancienne coûtume de Bretagne, féage eft
pris, mais improprement, pour l’héritage même tenu
en fief. Voyelles articles 5ÿ 6* Co. Mais dans 1 article
$ 00 de la mêmé coûtume on lit ces termes , pûr
féage de noble fief; & il y eft parlé de Celui qui fait le
féage, ce qui dénote que l’on a entendu la tenure en
fo i , ou la foi même.
Bien & féage noble, dans la coûtume d’Anjou,
art. $ 1 , & dans celle du Maine, are. $ G , fignifie un
héritage tenu en fief. (A } 1
FÉAL, adj. f Jurifpr.) en latin fidelis, eft une épithète
que le roi donne ordinairement à fes vaffaüx, !
& aux principaux officiers de fa maifon, & aux of- i
liciers de fes cours. L’étymologie de ce terme vient
de la foi que ces vaffaux & officiers étoient tenus dé |
garder au ro i, à caufe de leur bénéfice, fief, ou office.
On difoit en vieux langage celtique, la f l , pour
la fo i, & d e/é, on a formé féal, fidel, feauté, fidélité
.L
es Leudesqui fous la première &la fécondé race
' étoient les grands du royaume, étoient auffi indifféremment
qualifiés de fidèles , d’où eft venu le titre de
féaux que l ’on a confervé à tous les grands vaffaux I
’ & officiers de la couronne.
Le titre à'amé eft ordinairement joint à celui de
fé a l, foit dans les ordonnances, édits, & déclara-
' lions, foit d'ans les autres lettrés de grande ou de
; petite chancellerie : mais le titre deféal eft beaucoup
plus diftingué que celui à'amé; le roi donne celui-ci
' à tous fes fujets indifféremment ; au lieu qu’il ne
donne le titre de féal qu’aux vaffaux & officiers de
la couronne, & autres officiers diftingués, foit de la
robe pu de l’épée. Toutes les lettres que le roi envo
y é au parlement, contiennent cette adreffe : A
' nos amés Qr féaüjc les gens tenans notre cour de parle-
' ment. Il en eft de même à l’égard des autres cours.
(A ) ......................
F E A R N E S , ( Géog.) petite ville d’Irlande dans
Leinftershire, avec un évêché fuffragant de Dublin,
à dix-huit lieues S. de ladite ville. Long. 11. G.lat. awwmMii mm ■ ■ v '•
FÉBRICITANT, adj. pris fubft. (Med.) on fe fert
de ce mot pour défigner les malades dans lefquels la
fie vre eft la léfion de fondions dominante. C ’eft principalement
dans les hôpitaux que l’on employé le
' terme de fébricitans , pour diftinguer les différentes
fortès dé malades : ainfi on dit la falle des febricitans ,
“ là faite dés blèjfés , &C. (d)
FÉBRIFUGE, adj. pris fubft. ( Med. Thérapeut: )
1 febrifiiga, antifebritia ; on donne en général ces epi-
theteS à tout médicament employé direttement pour
faire çeffer la fievre, ou pour en détruire la çaufe &
■ Jes effets.
J o int F I ,
Ainfi oh ne qualifie pas de fébrifuges les purgatifs
dont on ufe dans le traitement des fievrës; parcé
qu’ils ne font pas ordinairement cènfés agir directement
contre ie v ice qui les à produites & les entretient
, mais poiir préparer lés voies aux autres fortes
de médicaniens qui font particulièrement jugés propres
à cet effet : tels que la plûpart des amers, & le
quinquina principalement, qui eft regardé comme
lpécinque a eët égard.
Ce font donc ces derniers, auxquels l’ulkge foû»
tenu par l’expérience ôu le préjugé, a attribué fpé-*
cialement la qualité de fébrifuge, fur-tout pour ce qui
regarde les fievres intermittentes ; mais bien improprement
, puifqu’bn peut la trouver dans tous les
moyens, quels qu’ils foient, qui peuvent être employés
efficacement contre la caufe des léfions de
fondions^ en quoi confifte la fievre, de quelque nature
qu’elle puiffe être f foit continue, foit intermittente.
En effet quel eft le fébrifuge, même le plus sûr fpé*
cifique én ce genre, qui opéré auffi promptement %
pour faire ceffer la fievre, qu’un émétique, un cathartique
placés à-propos ? Cependant ces remedës
évacuans ne font jamais compris aii nombre des^«-
brifuges : On nè cherche communément ceux-ci que
dans la claffé des altérans^
O r comme le mouvement a c c é lé r é , foit abfolu
foit r e fp e â if , dans l’e x ercice des fond ions v itale s »
qui eft le ligne pathognomonique de la fie v r e , eft lé
plus fouVént lé feul infiniment qüe la nature mette
en üfagé pour détruire la caüfe morbifique, & qui là
détruife en effe t, fouVent même fans qu’i l fuive au-
eune é va cu a tion , en agiffattt comme fimple alté^*
fa u t ; ne po u r ro it-o n pas coriféqUeniment regarder
à jufte titre le mouvement, l’â&ion des fo lid es , des
fluides, en un m ot l’agitatioii fé b r ile , comme le premier
ôc le plus univerfel des fébrifuges ? Mais On n’à
peut-être pas encore bien généralement des idées
juftes à ce fujet ; on confond le plus fôuVent les e f fets
de la fie v r e , c’eft-à-dire les mouvemens extraordinaires
qui la Caradérifeflt, à v e c la caufe même
qui rend ces mOuvernens néceffaifes. Voy. E f f o r t
(Econ. anim.) On n’a encore trop communément
en vû e que des matières médicinales, lorsqu’il s’agi't
de fébrifuges dans là Medecine pratique.
C ’eft par conféquent fous cette reftridion, que
poiir fe conformer aux idées les plus reçûes, il de-
vrôit être ici queftion de cette forte de remede, s’il
étoit poffible d’en traiter d’une maniéré méthodique':
mais ce feroit induire en erreur, que de propofer
des genres & des efpeces de fébrifuges ; ils ne font pas
fufceptibles d’une pareille divifion, à moins que l’on
n’ert faffe une qui réponde à celle des genres & des ef*
' peces de fievre ; que l ’on n ’indique ceux qui conviennent
alix différentes natures de fiev re: mais alo rs
c ’eft tomber dans le cas dé faire l’expofition de la
méthode, de traiter la fievre en général toutes fes
différences ert particulier, ce qui n’eft pas de cet article
S ainfi i l faut recourir au mot F ie v r e , où fe
t r o u v e , dans le plus grand détail dont foit fufcep-
tiblé cet o u v ra g e , & d’une manière qui n’y laiffe
rien à defirer, tout ce qui peut être dit concernant
les différentes curations de toutes les diverfes affections
qui font comprifés fous ce mot.
Voye{ auffi toutes les- généralités,-concernant les
remedes é v a cu a n s , comme les articles^ V o m i t i f ,
P u r g a t i ? , Su d o r i f iq u e , D iu r é t iq u e , &c.
concernant les alté rans , comme les articles A p é r i t
i f , A s t r in g e n t , A n o d y n , En un mot prefque
toutes les claffes, tous les genres de remçdes tant
' d ié tétiques, chirurgicaux, que pharmaceutiques, ôc
les moraux même, peuvent fournir dèsfebrifuges difi.
fé r en s , .félon la différence des caùfes de la f ie y r e ,
félon qu’elle dépend du v ic e des folides o u de celu^
N n xk