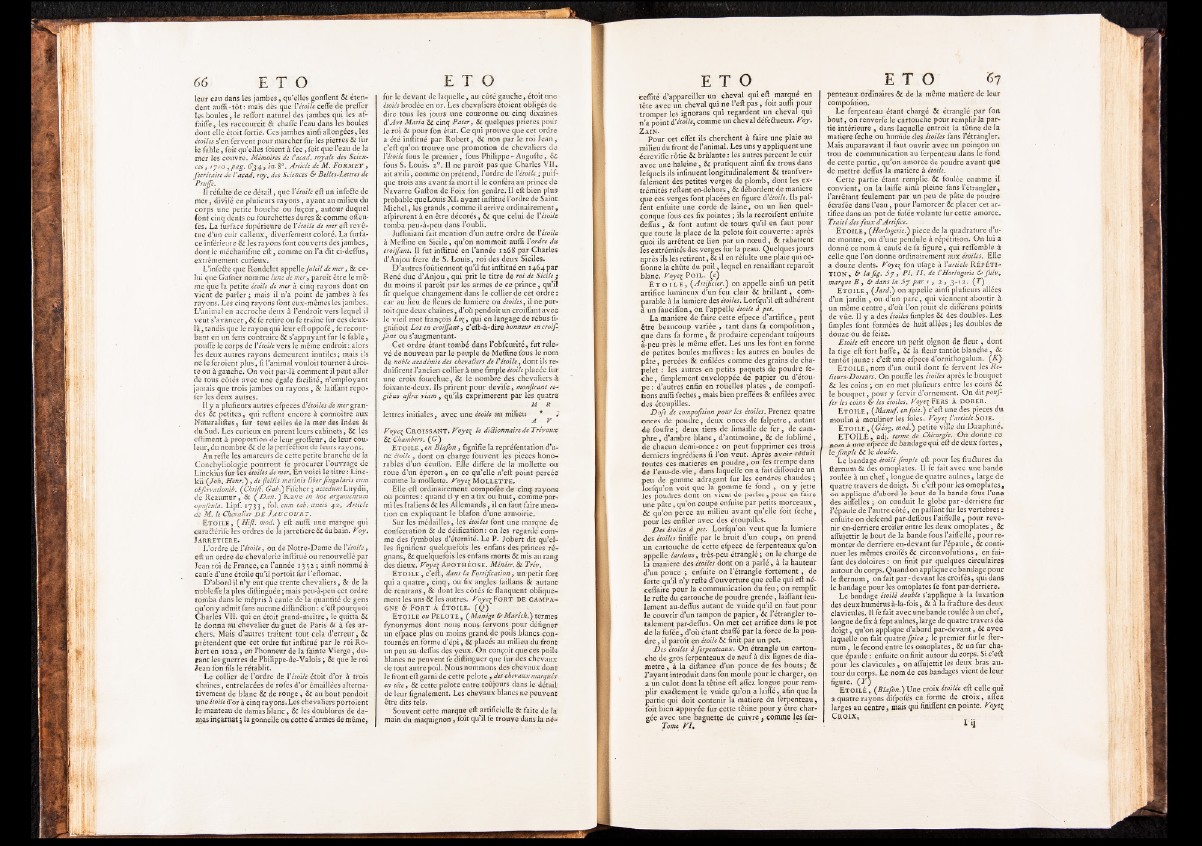
I
leur eau dans les jambes, qu’elles gonflent 8c étendent
auffi-tôt: mais dès que l'étoile ceffe de preffer
les boules, le reffort naturel des jambes qui les af-
faiffe, les raccourcit & chaffe l’eau dans les boules
dont elle étoit fortie. Ces jambes ainfi allongées, les
étoiles s’en fervent pour marcher fur les pierres & fur
le fable, foit qu’elles foient à fe c , foit que l’eau de la
mer les couvre. Mémoires de l'acad. royale des Sciences
y lÿio , füg* 4 , in- 8°. Article de M. FO RM E Y ,
fccrétaire de Vacad. roy. des Sciences & Belles-Lettres de
Prüfe.
Il réfulte de ce détail, que Vétoile eft un infede de
mer, divifé en plufieurs rayons, ayant au milieu du
corps une petite bouche ou fuçoir, autour duquel
font cinq dents ou fourchettes dures & comme oflèu-
fes. La furface fupérieure de Vétoile de mer eft revêtue
d’un cuir calleux, diverfement coloré. La furface
inférieure 6c les rayons font couverts des jambes,
dont le méchanifme e ft , comme on l’a dit ci-deffus,
extrêmement curieux.
L’infede que Rondelet appelle Joleil de mer, 8c. celui
que Gafner nomme lime de mer, paroît être le même
que la petite étoile de mer à cinq rayons dont on
vient de parler ; mais il n’a point de jambes à fes
rayons. Les cinq rayons font eux-mêmes les jambes..
L’animal en accroche deux à l’endroit vers lequel il
veut s’avancer, 8c fe retire ou fe traîne fur ces deux-
là , tandis que le rayon qui leur eft oppofé, fe recourbant
en un fens contraire 8c s’appuyant fur le fable,
pouffe le corps de Vétoile vers le même endroit : alors
les deux autres rayons demeurent inutiles; mais iis
ne le feroient plus, fi l’animal vouloit tourner à droite
ou à gauche. On voit par-là comment il peut aller
de tous côtés avec une égale facilité, n’employant
jamais que trois jambes ou rayons, & laiffànt repo-
fer les deux autres.
Il y a plufieurs autres efpeces d'étoiles de mer grandes
8c petites, qui reftent encore à conriôître aux
Naturaliftes, fur-tout celles de la mer dès Indes &
du Sud. Les curieux en parent leurs cabinets, 6c les
eftiment à proportion de leur groffeur, de leur1 couleur,
du nombre Sc de la perfection de leurs rayons.
- Au refte les amateurs de cette petite branche de' la
Conchyliologie pourront fe procurer l’ouvrage de
Linckius fur les étoiles de mtr. En voici le titre-t Linc-
kii (Joh. Henr.) , de flellis metrinis liberfingulàris cum
obfervationib. (Chriß. Gab.')Fifcher ; acceduntlAiydïi,
de Reaumur, & (D a n .) Ka ve in hoc argumentum
cpufcula. Lipf. 1733, fol. cum tab. ceneis 42. Article
de M. le Chevalier D E J A V C O U R T . Etoile , ( Hiß. mod. ) eft auffi une marque qui
caradérife les ordres de la jarretière & du bain. Voy. JARRETIERE;
L’ordre de l'étoile, ou de Notre-Dame de Vétoile,
eft un ordre de-chevalerie inftitué ou renouvellé par
Jean roi de France, en l’année 13 5 1 ; ainfi nommé à
caufe d?une étoile qu’il portoit fur l ’eftomac.
D ’abord il n’y eut que trente chevaliers, 8c de la
nobîeffe la plus diftinguée ; mais-peu-à-peu cet ordre
tomba dans le mépris à caufe de la quantité de gens
qu’on y admit fans aucune diftindion-: c’eft pourquoi
Charles VII. qui en étoit grand-maître, le quitta 8c
le donna au chevalier du guet de Paris 8c à fes archers.
Mais d’autres traitent tout cela d’erreur, 8c
prétendent que cet ordre fut inftitué par le roi Robert
en 1022, en l’honneur de la fainte Vierge, durant
les guerres de Philippe-de-Valois ; 8c que le roi
Jean fon fils le rétablit.
Le collier de l’ordre de l’étoile étoit d’or à trois
chaînes, entrelacées de rofes d’or émaillées alternativement
de blanc 8c de rouge , 8c au bout pendoit
une étoile d’or à cinq rayons. Les chevaliers portaient
le manteau de damas blanc, 8c les doublures de damas
ingarnat 4 lagonnelle ou cotte d’armes de même,
fur le devant de laquelle, au côté gauche, étoit une
étoile brodée en or. Les chevaliers étaient obligés de
dire tous les jours une couronne ou cinq dixainea
d’Ave Maria 8c cinq Pater, & quelques prières pour
le-roi 8c pour fon état. Ce qui prouve que cet ordre
a été inftitué par Robert, 8c non par le roi Jean,
c’eft qu’on trouve une promotion de chevaliers de
l’étoile fous le premier, fous Philippe - Augufte, 8c
fous S. Louis. 20. Il ne paroît pas que Charles VII.
ait a vili, comme on prétend, l’ordre de l'étoile.; puif-
que trois ans avant fa mort il le conféra au prince de
Navarre Gafton de Foix fon gendre. Il eft bien plus
probable que Louis XI. ayant inftitué l’ordre de Saint
Michel, les grands, comme il arrive ordinairement,
afpirerent à en être décorés, 8c que celui de l’étoile
tomba peu-à-peu dans l’oubli.
Juftiniani fait mention d’un autre ordre de l’étoile
à Mefline en Sicile , qu’on nommoit auffi Mordre du
croifant. Il fut inftitué en l’année 1268 par Charles
d’Anjou frerè de S. Louis, roi des deux Siciles.
D ’autres foûtiennent qu’il fut inftitué en 1464 par
René duc d’Anjou , qui prit le titre de roi de Sicile $
du moins il paroît par les armes de ce prince, qu’il
fit quelque changement dans lé collier de cet ordre ;
car au lieu de fleurs de lumière ou étoiles, il ne portoit
que deux chaînes, d’où pendoit un croiffant avec
le vieil mot françois qui en langage de rébus fi-
gnifioit Los en croifant, c’eft-à-dire honneur en croif-
J'ant ou s’augmentant.
Cet ordre étant tombé dans l’obfcurité, fut relevé
de nouveau par le peuple de Mefline fous le nom
de noble académie des chevaliers de l 'étoile, dont ils re-
duifirent l’ancien collier à une fimple étoile placée fur
une croix fourchue, 8c le nombre deS chevaliers à
foixante-deux. Ils prirent- pour devife, monflrant regibus
ajlra viam, qu’ils exprimèrent par les quatre
M R
lettres initiales, avec une étoile au milieu * 1
A V
Voyeç CROISSANT. Voye£ le dictionnaire de Trévoux
& Chambers. (G) Etoile , en Blafon, lignifie la repréfentation d’une
étoile , dont on charge fouvent les pièces honorables
d’un écuflon. Elle différé de là mollette ou
roue d’un éperon , en ce qu’elle n?eft point percée
comme la mollette. Voye^ Mollette.
Elle eft ordinairement compofée de cinq- rayons
ou pointes : quand il y en a fix ou huit, comme parmi
les Italiens 8c les Allemands, il en faut faire mention
en expliquant le blafon d’une armoirie.
Sur les médailles, les étoiles font une marque de
confécration & de déification : on les regarde comme
des fymboles d’éternité. Le P. Jobert dit qu’elles
lignifient quelquefois les erifans des princes ré-
gnans, 8c quelquefois les enfans morts 8c mis au rang
des dieux. Voye^ APOTHÉOSE. Minier. & Trév.- Etoile , c’eft , dans qui a quatre, cinq, ou lfaix F’aorntgifliecsa tfiaoinll*a, nusu p&e taiut tfaonrtt
dmee nretn ltersa urtnSs, 6&c ledso anut tlreess .c ôtés fe flanquent obliqueVoyeç
Fort de campagne
& Fort à étoile. (Q ) Étoile ou Pelote, (Manège & Maréch.) termes'
fynonymes dont nous noüs- fervons pour défigner
un efpace plus ou moins grand de poils blancs contournés
en forme d’ép i, 8c placés au milieu du front
un peu au-deffus des yeux. On conçoit que ces poil»
blancs ne peuvent fe diftinguer que fur des chevaux
de tout autre poil. Nous nommons des chevaux dont?
le front eft garni de cette pelote , des chevaux marqué#
en tête, ôt cette pelote entre toujours dans le détail
de leur fignalement. Les chevaux blancs ne peuvent
être dits tels.
Souvent cette marque eft artificielle 8z faite de la
main du-maquignon * foit qu’il fe trouve dans-la né-
Z.AIN.
Pour cet effet ils cherchent à faire une plaie au
milieu du front de l’animal. Les uns y appliquent une
écreviffe rôtie 6c brillante : les autres percent le cuir
avec une haleine, 6c pratiquent ainfi fix trous dans ,
lefquels ils infinuent longitudinalement 6c tranfver-
falement des petites verges de plomb, dont les extrémités
reftent en-dehors, 6c débordent de maniéré
que ces verges font placées en figure d'étoile. Ils paf-
fent enfuite une corde de laine, ou un lien quelconque
fous ces fix pointes ; ils la recroifent enfuite
deffus , 8c font autant de tours qu’il en faut pour
que toute la place de la pelote foit couverte : après
quoi ils arrêtent ce lien par un noeud, & rabattent
les extrémités des verges fur la peau. Quelques jours
après ils les retirent, 6c il en réfulte une plaie qui oc-
fionne la chute du poil, lequel en tenaillant reparoit
blanc. Foyei Poil, (e) E t o il e , (Artificier.) on appelle ainfi un petit
artifice lumineux d’un feu clair 6c brillant, comparable
à la lumière des étoiles. Lorfqu’il eft adhérent
à un fauciffon, on l’appelle étoile à pet.
La maniéré de faire cette efpece d’artifice, peut
être beaucoup variée , tant dans fa compofition,
que dans fa forme, 8c produire cependant toujours
à-peu près le même effet. LeS uns les font en forme
de petites boules maflives : les autres en boules de
pâte, percées & enfilées comme des grains de chapelet
: les autres en petits paquets de poudre fe-
che, Amplement enveloppée de papier ou d’étoupe
: d’autres enfin en rouelles plates , de comportions
auffi feches, mais bien preffées & enfilées avec
des étoupilles.
Dofe de compofition pour les étoiles. Prenez quatre
onces de poudre, deux onces de falpetre, autant
de foufre ; deux tiers de limaille de fer, de camphre
, d’ambre blanc, d’antimoine, 6c de fublimé,
de chacun demi-once; on peut fupprimer ces trois
derniers ingrédiens fi l’on veut. Après avoir réduit
toutes ces matières en poudre, on les trempe dans
de l’eau-de-vie, dans laquelle on a fait diffoudre un
peu de gomme adragant fur les cendres chaudes ;
lorfqu’on voit que la gomme fe fond , on y jette
les poudres dont on vient de parler, pour en faire
une pâte, qu’on coupe enfuite par petits morceaux,
6c qu’on perce au milieu avant qu’elle foit feche,
pour les enfiler avec des étoupilles.
Des étoiles à pet. Lorfqu’on veut que la lumière
des étoiles finiffe par le bruit d’un coup, on prend
un cartouche de cette efpece de ferpenteaux qu’on
appelle lardons, très-peu étranglé ; on le charge de
la maniéré des étoiles dont on a parlé, à la hauteur
d’un pouce ; enfuite on l’étrangle fortement, de
forte qu’il n’y refte d’ouverture que celle qui eft né-
ceffaire pour la communication du feu ; on remplit
le refte du cartouche de poudre grenée, laiflànt feulement
au-deffus autant de vuide qu’il en faut pour
le couvrir d’un tampon de papier, 6c l’étrangler totalement
par-deffus. On met cet artifice dans le pot
de la fufée, d’où étant chafle par la force de la poudre
, il paroît en étoile 6c finit par im pet.
Des étoiles d ferpenteaux. On étrangle un cartouche
de gros ferpenteaux de neuf à dix lignes de diamètre
, à la diftance d’un pouce de fes bouts ; 6c
l’ayant introduit dans fon moule pour le charger, on
a un culot dont la tétine eft affez longue pour remplir
exadement le vuide qu’on a laiffé, afin que la
partie qui doit contenir la matière du ferpenteau,
foit bien appuyée fur cette tétine pour y être chargée
avec une baguette de çuiYte} comme les fer-
Tome V l%
penteaux ordinaires 6c de la même matière de leur
compofition.
boLuet, foenrp reenntveearuf eé ltea nCta rcthoaurcghée &po uértr raenmglpél irp laar pfaorn
tmiea tiinètréer ifeeucrhee ,o ud ahnusm-laidqeu edleles entroit la tétine de la Mais auparavant il faut ouvriért oaivleesc f aunns pEoéitnrâçnognl eurn. trou de communication au ferpenteau .dans le fond
ddee cmeetttetr ep adretfifeu,s q lua’ omna atimèroer càe de poudre avant que étoile.
Cette partie étant remplie. 6c foulée comme il
convient, on la laiffe ainfi pleine fans l’étrangler,
l’arrêtant feulement par un peu de pâte de poudre
écrafée dans l’eau, pour l’-amorcer 6c placer cet artifice
dans un pot de fufée volante fur cette amorce.
Traité Etoile,des feux d’Artifice. - piece de la quadrature d’une
montre, ou (Horlogerie?)d’une pendule à répétition. On lui a
cdeolnlen éq ucee nl’oomn dào ncanuef eo rddei nfaai freigmuernet, aquuxi reffemble à a TION,douze dents. Voyeç fon ufage à étoiles. Elle M article RÉPÉTI&
Infig. 6y , PL II. de VHorlogerie & fuiv,
marque B , & dans la S y par 1 , 2 , 3-/2.. (T) Etoile, (Jard.) on appelle ainfi plufieurs allées
d’un jardin , ou. d’un parc , qui viennent aboutir à
un même centre, d’où l’on joiiit de differens points
de vue. Il y a des étoiles Amples 6c des doubles.: Les
Amples font formées de huit allées ; les doubles de
douze ou de feize.
Etoile eft encore un petit oignon de fleur , dont
la tige eft fort baffe, 6c la fleur tantôt blanche, 8c
tantôt jaune ; c’eft une efpece d’ornithogalum. (K )
E t o i l e , nom d’un outil dont fe fervent les Relieurs
Doreurs. On pouffe les étoiles après le bouquet
6c les coins ; on en met plufieurs entre les coins 8c
le bouquet, pour y fervir d’ornement. On dit pouffer
les coins & les étoiles. Voye[ F e r s À DORER. Etoile, (Manuf. enfoie.) c’eft une des pièces du
moEulin à mouliner les foies- Voye^ l'article Soie. toile , (Géog. mod.) petite ville du Dauphine*
ÉTO ILÉ, adj. terme de Chirurgie. On donne ce
nom à une efpece de bandage qui eft de deux fortes ,
le fimple 8c le double..
Le bandage étoilé fimple eft pour les fradures du
fternum 8t des omoplates. Il fe fait avec une bande
roulée à un ch ef, longue de quatre aulnes, large de
quatre travers de doigt. Si c’eft pour les omoplates,
on applique d’abord le bout de la bande fous l’une
des aiffelles on conduit le globe par-derrière fur
l’épaule de l’autre côté, en paffant fur les vertebres :
enfuite on defeend par-deffous l’aiffelle, pour revenir
en-derriere croifer entre les deux omoplates, 8c
affujettir le bout de la bande fous l’aiffelle, pour remonter
de derrière en-devant fur l’épaule, 6c continuer
les mêmes croifés 6c circonvolutions, en fai-
fant des doloires : on finit par quelques circulaires
autour du corps. Quand on applique ce bandage pour
le fternum, on fait par - devant les croifés, qui dans
le bandage pour les omoplates fe font par-derriere.
Le bandage étoilé double s’applique à la luxation
des deux humérus à-la-fois, & à la fradure des deux
clavicules. Il fe fait avec une bande roulée à un chef,
longue de fix à fept aulnes, large de quatre travers de
doigt, qu’on applique d’abord par-devant, 6c avec
laquelle on fait quatre fpica ; le premier fur le fternum
, le fécond entre les omoplates, 6c un fur chaque
épaule : enfuite on finit autour du corps. Si c’eft
pour les clavicules, onaffujettitles deux bras autour
du corps. Le nom de ces bandages vient de leur
figure. ( T ) . # Etoilé , (Blafon.) Une croix ctoilee eft celle qui
a quatre rayons difpofés en forme de cro ix, allez
larges au centre, mais qui finiffent en pointe. Voye^
Croix,
Ï ’J