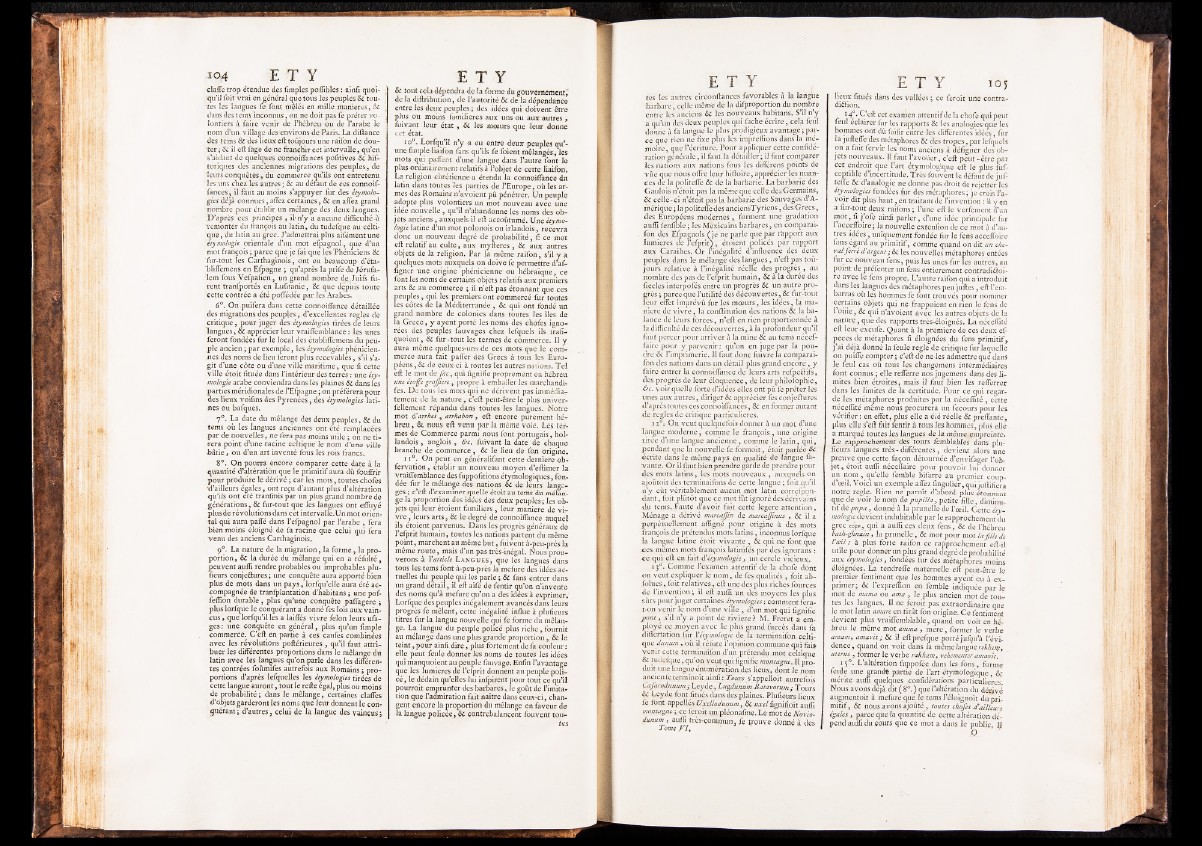
claffe trop étendue des {impies polîibks : ainfi quoiqu’il
foit vrai en généra l que tous les .-peuples ôc toute
s les langues fe font mêlés en mille maniérés., Ôc
dans des tems inconnus, on ne-doit pas fe prêter volontiers
à faire venir de l'hébreu ou de l ’arabe le
nom d’un village des-environsde Paris. La diftance
des tems & des lieux eft toujours une raifon de douter
; Ôc il eft fage de ne franchir cet intervalle, qu’en
s’aidant de quelques connoïffances pofitives ôc historiques
des anciennes migrations des peuples., de
Teurs -conquêtes, du commerce qu’ils ont entretenu
les'uns chez les autres ; ôc au défaut de ces connoif-
fances, il faut au moins s’appuyer fur des étymologies
déjà connues, allez certaines, ôc en affez grand
nombre pour établir un mélange des deux langues.
D ’après ces principes , il- n’y a aucune difficulté à
"remonter du françois au latin, du tudefque au ce’lti-
que,"du latin au grec. J’admettrai plus aifément une
étymologie orientale d’un mot efpagndL, que d’un
mot françois ; parce que je fai que les 'Phéniciens &
fur-tout les Carthaginois, ont eu beaucoup d’éta-
bliflémens en Efpagne ; qu’après la prife de Jérufa-
"lçm fous Vefpàfien, un grand nombre de Juifs furent
transportés en Lüfitanie, ôc que depuis toute
cette contrée a été poffédée par les Arabes.
6°. On.puifera dans cette connoifîance détaillée
des migrations des peuples, d’excellentes réglés de
critique, pour juger des étymologies tirées de leurs
langues, ôc apprécier leur vraiffemblance : les unes
feront fondées fur le local des établiffemens du peuple
ancien ; par exemple, les étymologies phéniciennes
des noms de lieu feront plus recevables, s’il s’agit
d’une côte ou d’une ville maritime, que fi cette
ville étoit fituée dans l’intérieur des terres : une étymologie
arabe conviendra dans lés plaines ôc dans les
parties méridionales de l’Efpagne ; on préférera pour
des lieux voifins des Pyrénées, des étymologies latines
ou bafques.
7°. La date du mélange des deux peuples, & du
tems où les langues anciennes ont été remplacées
par de nouvelles, ne fera pas moins utile ; on ne tirera
point d’une racine celtique le nom d’une ville
bâtie , ou d’un art inventé fous les rois francs.
8°. On pourra encore comparer cette date à la
quantité d’altératiôn que le primitif aura dû fouffrir
pour produire le dérivé ; car les mots, toutes chofes
•d’ailleurs égales, ont reçu d’autant plus d’altération
qii’ils ont été tranfmis par un plus grand nombre de
générations, ôc fur-tout que les langues ont efliiyé
plus de révolutions dans cet intervalle.Un mot oriental
qui aura paffé dans l’efpagnol par l’arabe , fera
bien moins éloigné de fa racine que celui qui fera
venu des anciens Carthaginois.
9°. La nature de la migration, la forme, la proportion
, & la durée du mélange qui en a réfulté,
peuvent aufli rendre probables ou improbables plu-
fieurs conje&ures ; une conquête aura apporté bien
plus de mots dans un pays, lorfqu’elle aura été accompagnée
de tranfplantation d’habitans ; une pof-
feflion durable, plus qu’une conquête paffagere ;
plus lorfqiie le conquérant à donné fes lois aux vaincus
, que lorfqu’il les a laifles vivre félon leurs ufa-
ges : une conquête en général, plus qu’un fimple
commerce. C’eft en partie à ces caufes combinées
avec les révolutions poftérieures , qu’il faut attribuer
les différentes proportions dans le mélange du
latin avec les langues qu’on parle dans les differentes
contrées foumifes autrefois aux Romains ; proportions
d’après lefquelles les étymologies tirées de
cette langue auront, tout le refte égal, plus ou moins
de probabilité ; dans le mélange, certaines claffes
d’objets garderont les noms que leur donnent le conquérant
j d’autres, celui de la langue des vaincus;
& tout cela dépendra de la forme du gouvernement^'
de la diftribution, de l’autorité & de la dépendance
entre les deux peuples ; des idées qui doivent être
plus ou moins familières aux -uns ou aux autres ,
lui-vant leur é ta t , ôc les moeurs que leur donné
cet état.
îo°. Lorfqu’il n’y a eu entre deux peuples qu’une
fimple liaifon fans qu’ils fe foient mélangés, les
mots qui paffen t d’une langue dans l’autre font le
plus ordinairement relatifs à 1-objet de cette liaifon.
La religion chrétienne-a étendu la connoiffance du
latin dans toutes les parties de l’Europe, où les armes
des Romains n’avoient pû pénétrer. Un peuple
•adopte plus volontiers un mot nouveau avec une
idee nouvelle, qu’il n’abandonne les noms des objets
anciens, auxquels il eft accoutumé. Une étymologie
latine d’un mot polonois ou irlandois, recevra
donc un nouveau degré de probabilité, fi ce mot
eft relatif au culte, aux myfteres , Ôc aux autres
objets de la religion. Par la même raifon, s’il y a
quelques mots auxquels on doive fe permettre d’af-
figner une origine phénicienne1 ou hébraïque, ce
font les noms de certains objets relatifs aux premiers
arts ôc au commerce ; il n’eft pas étonnant que ces
peuples, qui les premiers ont commercé fur toutes
les cotes de la Mediterranée , ôc qui ont fondé un
grand nombre de colonies dans toutes les îles de
la Grece, y ayent porté les noms des chofes ignorées
des peuples fauvages chez lefquels ils trafi-
quoient, ôc fur-tout les termes de commerce. Il y
aura même quelques-uns de ces mots que le commerce
aura fait paffer des Grecs à tous les Européens
, ôc de ceux-ci à toutes les autres nations. Te!
eft le mot de fa c , qui fignifïe proprement en hébreu
une étoffe größere, propre à emballer les marchandi-
fes. De tous les mots qui ne dérivent pas immédiar
tement de la nature, c’eft peut-être le plus univer-
fellement répandu dans toutes les langues. Notre
mot à!arrhes , arrhabon , eft encore purement hébreu
, ôc nous eft venu par la même voie. Les termes
de Commerce parmi nous font portugais, hol-
landois , anglois , &c. fuivant la date de chaque
branche de commerce, & le lieu de fou origine.
11°. On peut en généralifant cette derniere ob-
fervation, établir un nouveau moyen d’eftimer la
vraiffemblance des fuppofitions étymologiques, fondée
fur le mélange des nations ôc de leurs langages
; c’eft d’examiner quelle étoit au tems du mélange
la proportion des idées des deux peuples; les objets
qui leur étoient familiers, leur maniéré de viv
r e , leurs arts, ôc le degré de connoiffance auquel
ils étoient parvenus. Dans les progrès généraux de
l’efprit humain, toutes les nations partent du même
point, marchent au même bu t, fuivent à-peu-près la
même route, mais d’un pas très-inégal. Nous prouverons
à l’article Langues, que les langues dans
tous les tems font à-peu-près la mefure des idées actuelles
du peuple qui les parle ; & fans entrer dans
un grand detail, il eft aife de fentir qu’on n’invente
des noms qu’à mefure qu’on a des idées à exprimer.
Lorfque des peuples inégalement avancés dans leurs
progrès fe mêlent, cette inégalité influe à plufieurs
titres fur la langue nouvelle qui fe forme du mélange.
La langue du peuple policé plus riche, fournit
au mélange dans une plus grande proportion, & le
teint, pour ainfi dire, plus fortement de fa couleur:
elle peut feule donner les noms de toutes les idées
qui manquoient au peuple fauvage. Enfin l’avantage
que les lumières de l’efprit donnent au peuple poncé
, le dédain qu’elles lui infpirent pour tout ce qu’il
pourroit emprunter des barbares, le goût de l’imitation
que l’admiration fait naître dans ceux-ci, changent
encore la proportion du mélange en faveur de
la langue policée, ôc contrebalancent fouvent toutes
tes les autres circonftances favorables à la langue
barbare; celle même de la difproportion du nombre
entre lès anciens ôc lés nouveaux habitans. S’il n’y
a qu’un des deux peuples qui fâche écrire, cela feul
donne à fâ langue le plus prodigieux avantage; parce
que rien ne fixe plus les impreflïons dans la mémoire,
que l’écriture. Pour appliquer cette confidé-
ration generale, il fàiit là détailler; il faut comparer
les nations aux nations fous les differens points de
vue que nous offre leur hiftoirc, apprécier les nuances
de la politeffe & de la barbarie. La barbarie des
Gaulois n’étoit pas la même que celle des Germains,
ôc celle-ci n’étoit pas la barbarie des Sauvages d’Amérique
; la politeffe des anciensTyriens, des Grecs,
des Européens modernes , forment une gradation
aufli fenfible ; les Mexicains barbares, en comparai-
fon des Efpagnols / je ne parle que par rapport aux
lumières de l’efprit), étoient policés par rapport
aux' Caraïbes. Or l’inégalité d’influence des deux
peuples, dans le mélange des langues, n’eft pas tôû-
j ours relative à l’inégalité réelle des progrès , au
nombre des pas de l’efprit humain, & à la durée des
fiecles interpo.fés entre un progrès ôc un autre progrès
; parce que l’utilité des découvertes , & fur-tout
leur effet imprévu fur les moeurs, les idées, la maniéré
de v iv r e , la conftitution des nations ôc la balance
de leurs forces, n’eft en rien proportionnée à
la difficulté de ces découvertes, à la profondeur qu’il
faut percer pour arriver à la mine & au tems nécefr
faire pour y parvenir : qu’on en juge par la poudre
Ôc l’imprimerie. Il faut donc fuivre la çomparai-
fon des nations dans .un détail plus grand encore, y
faire entrer la connoifîance de leurs arts refpeôifs.,
des progrès de leur éloquence, de leur philofophie,
&c. voir quelle forte d’idées elles ont pû fe prêter les
unes aux autres, diriger ôc apprécier fes conje&ures
d’après toutes cesçonnoiffances, ôc en former autant
<de réglés de critique particulières.
i z°. On veut quelquefois .donner à un mot d’une
Tangue moderne, comme le françois, une origine
•tiree d’une langue ancienne, comme le latin, qui,
pendant que la nouvelle fe formoit, étoit parlée &
.écrite dans le même pays en qualité de langue fa-
vante. O r il faut bien prendre garde-de prendre pour
des mots latins, les mots nouveaux , auxquels on
ajoutoit des terminaifons de .cette langue ; loit.qu’il
n’y eût véritablement aucun mot latin correfpon-
.dant, foit plûtôt que ce mot fût ignoré des écrivains
du tems. Faute d’avoir fait cette legere attention,
Ménage a dérivé marcaffin de marcajjimts , & il a
perpétuellement affigné pour origine à des mots
françois de prétendus mots latins, inconnus lorfque
la langue latine étoit vivante , ôc qui ne font que
,ces mêmes mots françois latinifés par des ignorans :
ce qui eft en fait 8 étymologie , .un cercle vicieux.
1 3°. Comme l’examen .attentif de la chofe dont
on veut,expliquer le nom, de fes qualités , foit absolues
, foit refatives, eft une des plus riches fources
de l’invention ; il eft aufli .un des moyens les plus
surs pour juger certaines étymologies : comment fera-
t-on venir le nom d’une ville , d’un mot qui lignifie
pont a s’il n’y a point de riviere ? M. Freret a employé
ce moyen avec le plus grand fuccès dans fa
.differtatiqn fur l’étymologie de la terminaifon celti-
que dunum, où il réfute l’opinion commune qui fai&
venir cette terminaifon d’un prétendu mot.celtique
ôc tudefque, qu’on veut qui lignifie montagne. Il produit
une longue énumération des lieux, dont le nom
ancieixfeterminoit.ainfi.: Tours s’appelloit autrefois
Çoefarodunum ; Leyde, Lugdunum Batavorum; Tours
ôc Leyde font fitués dans des plaines. Plufieurs lieux
fe font appelles Uxellodunum, ÔC uxel fignifioit aufli
montagne ; ce feroit un pléonafme. Le mot de Novio-
dunum, aufli très-çonlmun, fe trouve donné à des
Tome VI,
lieux fitués dans des vallées ; ce feroit une contrar
diftion.
I4°* C ’eft çet examen attentif de la chofe qui peut
feul eclairer fur les rapports ôc les analogies'que les
hommes ont dû faifir entre les différentes idées, fur
la jufteffe des métaphores ôc des tropes, par lefquels
on a fait fervir les noms anciens à défigije.r des ob-
i jets nouveaux. Il faut l’avoiier, c’eft peut - être par
çet endroit que l’art étymologique eft le plus fùf-
ceptible d’incertitude. Très-fouvent le défaut de jufteffe
& d’analogie ne donne, pas droit de rejetter les
étymologies fondées fur des métaphores; je crois l’avoir
dit plus haut, en traitant de l’invention : il y en
a fur-tout deux raifons ; l’une eft le verfement d’un
mot, fi j’ofe ainfi parler, d’une idée principale fur
1 accefloire; la nouvelle extenfion de ce mot à d’autres
idee$, uniquement fondée fur le fens accefloire
fans egard au primitif, comme quand on dit un cheval
ferre d'argent ; ôc les nouvelles métaphores entées
fur ce nouveau fens, puis les unes fur les autres, au
point de prefenter un fens entièrement contradi&oi-
re avec le fens propre. L’autre raifon qui a introduit
dans les langues des métaphores peu juftes, eft l’embarras
où lés hommes fe font trouvés pour nommer
c,e^f.a^ objets qui ne frappoient en rien le fens de
1 oiiie, ôc qui n’avoient avec les autres objets de la
nature, que des rapports très-éloignés. La neceffité
eft leur exeufe. Quant à la première de ces deux eC-
peces de métaphores fi éloignées du fens primitif,
j’ai déjà donné la feule réglé de critique fur laquelle
on puiffe compter ; c’eft de ne-les admettre que dans
le feul cas où tous les changemens intermédiaires
font connus ; elle refferre nos jugemens dans des limites
bien étroites, mais il faut bien les refferrer
dans les limites de la certitude. Pour ce qui regarr
de les métaphores produites par la néceflité , cette
neceffité même nous procurera un fecours pour les
vérifier : en effet, plus elle a été réelle ôc preffante,
plus elle s’eft fait fentir à tous les hommes, plus elle
a marqué toutes les langues de la même.empreinte.
Le rapprochement des tours femblables dans plu-
fieufs langues très - differentes, devient alors une
preuve que cette façon détournée d’envifager l’objet
, étoit aufli néceffaire pour pouvoir lui donner
un nom, qu’elle femble bifarré au premier coup-
.d’oeil. Voici un exemple allez fingulier, qui juftifiera
notre réglé. Rien ne paroît d’abord plus étonnant
que de voir le nom de pupilla, petite fille, diminut
if de pupa, donné à la prunelle de l’oeil. Cette étymologie
devient indubitable par le rapprochement du
grec rdp», qui a aufli ces deux fens, ôc de l’hébreu
bath-ghnain, la prunelle, & mot pour mot la fille de
P oeil : à plus forte raifon ce rapprochement eft-il
utile pour donner un plus grand degré de probabilité
aux étymologies, fondées lùr des métaphores moins
éloignées. La tepdreffe maternelle eft peut-être le
premier fentiment que les hommes ayent eu à exprimer;
ôc l’expreffiqn en femble indiquée par le
mot de marna ou ama , le plus ancien mot de toutes
les langues. Il ne feroit pas extraordinaire que
le mot latin arnare en tirât fon origine. C e fentiment
devient plus vraiffemblable, quand on voit en hé-
bi eu le .morne mot amma , mere, former le verbe
amam, amavit ; ÔC il eftprefque porté jiifqii’à l’èvi-
dençe, quand on voit dans la même langue rek/ien?t
utérus, former le verbe rakham, vehementer amavit.
1 5°- L’altération fuppofée dans les fons, forme
feule une grande partie de l’art étymologique, Sç
mérite aulü quelques confidérations particulières
Nous avons déjà ait ( 8°. ) que l’altération du dérivé
augmentoit à mefure que le tems l’éloignoit du primitif
, ÔC nous avons ajouté, toutes chofes (Tailleurs
égales , parce que la quantité de cette altération dépend
aufli du cours que ce mot a dans le public, U