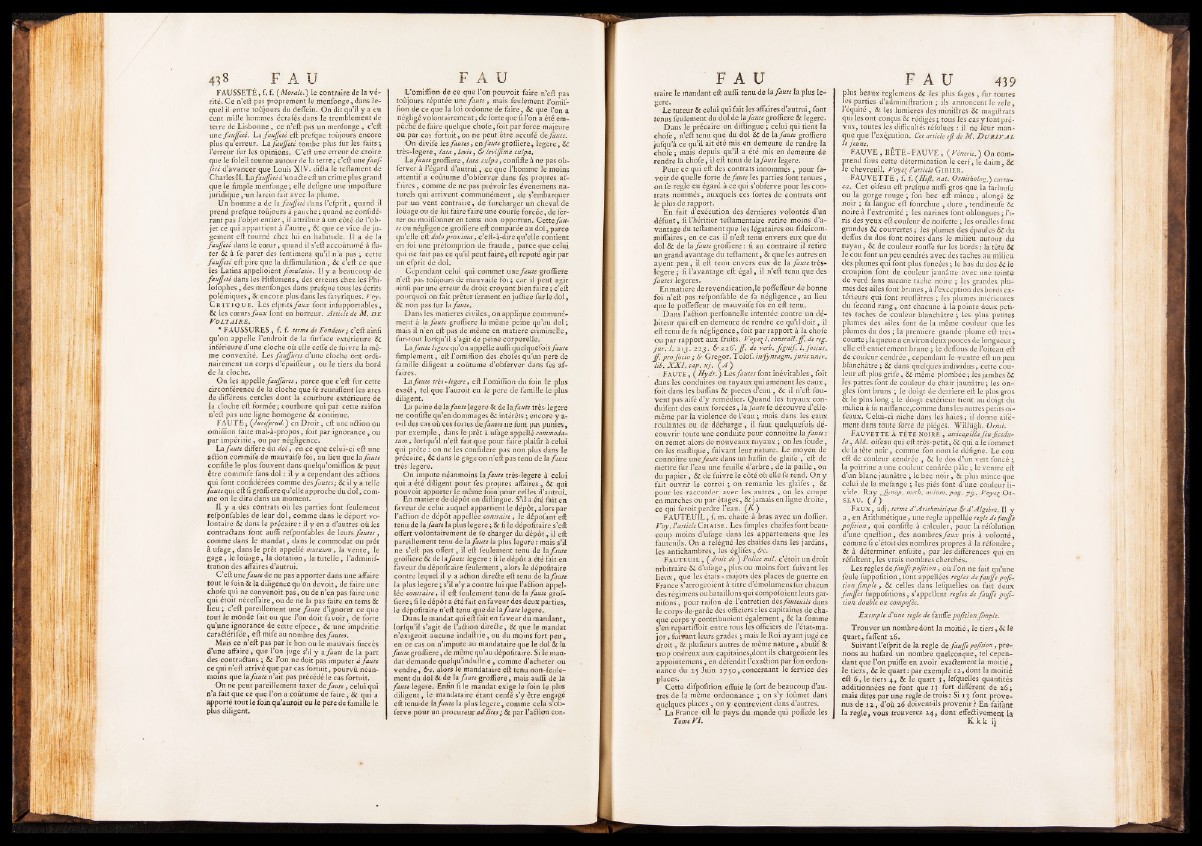
FAUSSETÉ, f. f. ( Morale.) le contraire de la vérité
» C e n’eft pas proprement le menfonge, dans lequel
il entre toûjours du deffein. On dit qu’il y a eu
cent mille hommes écrafés dans le tremblement de
terre de Lisbonne, ce n’eft pas un menfonge, c’eft
une fauffeté. La fauffeté eft prefque toûjours encore
plus qu’erreur. La fauffeté tombe plus fur les faits ;
l’erreur fur les opinions. C ’eft une erreur de croire
que le foleil tourne autour de la terre; c’eft une fauffeté
d’avancer que Louis XIV. diâa le teftament de
Charles II. La fauffeté d’un afte eft un crime plus grand
que le fimple menfonge ; elle defigne une impofture
juridique,*un larcin fait avec la plume.
Un homme a de la fa u f ilé dans l’efprit, quand il
prend prefque toûjours à gauche; quand ne confide-
rant pas l’objet entier, il attribue à un côté de l’objet
ce qui appartient à l’autre, St que ce vice de jugement
eft tourné chez lui en habitude. Il a de la
fauffeté dans le coeur, quand il s’eft accoûtumé à dater
& à fe parer des fentimens qu’il n’a pas ; cette
fauffeté eft pire que la diflimulation, & c’eft ce que
les Latins appelloient fimulatio. Il y a beaucoup de
fauffeté dans les Hiftonens, des erreurs chez les Phi-
lofophes, des menfonges dans prefque tous les écrits
polémiques , & encore plus dans les fatyriques. Vcy.
CR i t i q uE. Les efprits faux font infùpportables,
St les coeurs faux font en horreur. Art 'u le d e M. d e
V o l t a i r e .
* FAUSSURES , f. f. terme de Fondeur; c’eft ainli
qu’on appelle l’endroit de la furface extérieure St
inférieure d’une cloche où elle ceffe de fuivre la même
convexité. Les fauffures d’une cloche ont ordinairement
un corps d’épaiffeur, ou le tiers du bord
de la cloche.
On les appelle fauffures, parce que c ’eft fur cette
circonférence de la cloche que fe réunifient les arcs
de différens cercles dont la courbure extérieure de
la cloche eft formée ; courbure qui par cette raifon
n’eft pas une ligne homogène St continue.
FAUTE, ( Jurifprud.) en D roit, eft une aôion ou
omiffion faite mal-à-propos, foit par ignorance, ou
par impéritie, ou par négligence.
La faute différé du doL, en ce que celui-ci eft une
aâion commife de mauvaife foi, au lieu que la faute
confifte le plus fouvent dans quelqu’omiflion & peut
être commife fans dol : il y a cependant des aâions
qui font confidérées comme des fautes; & il y a telle
faute qui eft fi groffiere qu’elle approche du dol, comme
on le dira dans un moment.
Il y a des contrats où les parties font feulement
refponfables de leur dol, comme dans le déport volontaire
St dans le précaire : il y en a d’autres où les
contra élans font atifli refponfables de leurs fautes,
comme dans le mandat, dans le commodat ou prêt
à ufage, dans le prêt appelié mutuum, la vente, le
gage, le louage, la dotation, la tutelle, l’adminif-
tration des affaires d’autrui.
C’ eft une faute de ne pas apporter dans une affaire
tout le foin & la diligence qu’on devoit, de faire une
chofe qui ne convenoit pas, ou de n’en pas faire une
qui étoit néceffaire, ou de ne la pas faire en tems &
lieu ; c’eft pareillement une faute d’ignorer ce que
tout le monde fait ou que l’on doit fa voir, de forte
qu’une ignorance de cette efpece, St une impéritie
cara&érifée, eft mife au nombre des fautes.
Mais ce n’eft pas par le bon ou le mauvais fuccès
d’une affaire, que l’on juge s’il y a faute de la part
des contra élans ; St l’on ne doit pas imputer à faute
ce qui n’eft arrivé que par cas fortuit, pourvû néanmoins
que la faute n’ait pas précédé le cas fortuit.
On ne peut pareillement taxer de f a u t e , celui qui
n’a fait que ce que l’on a coûtume de faire, & qui a
apporté tout le foin qu’auroit eu le pere de famille le
plus diligent.
L’omiffion de ce que l’on pouvoit faire n’eft pas
toûjours réputée une faute, mais feulement l’omiffion
de ce que la loi ordonne de faire, St que l’on a
négligé volontairement ; de forte que fi l’on a été empêche
de faire quelque chofe, foit par force majeure
ou par cas fortuit, on ne peut être accufé de faute.
On divife les fautes, en faute groffiere, legere, St
très-Iegere, lata, Levis, & leviffima culpa.
La faute groffiere, lata culpa, confifte à ne pas ob-
ferver à l ’égard d’autrui, ce que l’homme le moins
attentif a coûtume d’obferver dans fes propres a ffaires
, comme de ne pas prévoir les évenemens naturels
qui arrivent communément, de s’embarquer
par un vent contraire, de furcharger un cheval de
louage ou de lui faire faire une courfe forcée, de ferrer
ou moiffonner en tems non opportun. Cette faute
ou négligence groffiere eft comparée au dol, parce
qu’elle eft dolo proxima, c’eft-à-dire qu’elle contient
en foi une préfomption de fraude, parce que celui
qui ne fait pas ce qu’il peut faire, eft réputé agir par
un efprit de dol.
Cependant celui qui commet une faute groffiere
n’eft pas toûjours de mauvaife foi ; car il peut agir
-ainfi par une erreur de droit croyant bien faire ; c ’eft
pourquoi on fait prêter ferment en juftice furie dol,
St non pas fur la faute.
Dans les matières civiles,.on applique communément
à la faute groffiere la même peine qu’au dol ;
mais il n’en eft pas de même en matière criminelle,
fur-tout lorlqu’il s’agit de peine corporelle.
La faute legere qu’on appelle auffi quelquefois faute
Amplement, eft l’omiffion des choies qu’un perô de
famille diligent a coûtume d’obferver dans fes affaires.
La faute très-legere, eft l’omiffion du foin le plus
exaél, tel que l’auroit eu le pere de famille le plus
diligent.
La peine de la faute legere & de la faute très- legere
ne confifte qu’en dommages St intérêts ; encore y a-
t—il des cas où ces fortes de fautes ne font pas punies,
par exemple, dans le prêt à ufage appelle commoda-
tum, lorfqu’il n’eft fait que pour faire plaifir à celui
qui prête : on ne les confidere pas non plus dans le
précaire, St dans le gage on n’eft pas tenu de la faute
très-Iegere.
On impute néanmoins la faute très-Iegere à celui
qui a été diligent pour fes propres affaires, St qui
pouvoit apporter le même foin pour celles d’autrui.
En matière de dépôt on diftingue. S’il a été fait en
faveur de celui auquel appartient le dépôt, alors par
l’aélion de dépôt appellée contraire, le dépofant eft
tenu de la faute la plus legere ; & fi le dépofitaire s’eft
offert volontairement de té charger du dépôt, il eft
pareillement tenu de la faute la plus legere : mais s’il
ne s’eft pas offert, il eft feulement tenu de la faute
groffiere & de la faute legere : fi le dépôt a été fait en
faveur du dépofitaire feulement, alors le dépofitaire
contre lequel il y a aftion direâe eft tenu de la faute
la plus legere ; s’il n’y a contre lui que l’a&ion appellée
contraire, il eft leulement tenu de la faute groffiere
; fi le dépôt a été fait en faveur des deux parties,
le dépofitaire n’eft tenu que de la faute legere.
Dans le mandat qui eft fait en faveur du mandant,
lorfqu’il s’agit de l’adion directe, St que le mandat
n’exigeoit aucune induftrie, ou du moins fort peu ,
en ce cas on n’impute au mandataire que le dol & la
faute groffiere, de même qu’au dépofitaire. Si le mandat
demande quelqu’induftrie, comme d’acheter ou
vendre, mk alors le mandataire eft tenu non-feulement
du dol & de la faute groffiere, mais auffi de la
faute legere. Enfin fi le mandat exige le foin le plus
diligent, le mandataire étant cenfé s’y être engagé
eft ténu-de la faute la plus legere, comme cela s’ob-
ferve pour un procureur ud iàtts; & par l’aftion contraire
le mandant eft auffi tenu de la fa u te la plus légère.
JH H
Le tuteur & celui qui fait les affaires d’autrui, font
tenus feulement du dol de la faute groffiere & legere.
Dans le précaire on diftingue ; celui qui tient la
chofe, n’eft tenu que du dol St de la faute groffiere
jufqu’à ce qu’il ait été mis en demeure de rendre la
chofe ; mais depuis qu’il a été mis en demeure de
rendre la chofe, il eft tenu de la faute legere.
Pour ce qui eft des contrats innommés, pour fa-
voir de quelle forte do faute les parties font tenues,
on fe réglé eu égard à ce qui s’obferve pour les contrats
nommés, auxquels ces fortes de contrats ont
le plus de rapport.
En fait d’exécution des dernières volontés d’un
défunt, fi l’héritier teftamentaire retire moins d’avantage
du teftament que les légataires ou fideicom-
miffaires, en ce cas il n’eft tenu envers eux que du
dol St de la faute groffiere : fi au contraire il retire
un grand avantage du teftament, & que les autres en
ayent peu, il eft tenu envers eux de la faute très-
Iegere ; fi l’avantage eft égal, il n’eft tenu que des
fautes légères.
En matière de revendication,le pofleffeur de bonne
foi n’eft pas refponfable de fa négligence, au lieu
que le pofleffeur de mauvaife foi en eft tenu.
Dans l’attion perfonnelle intentée contre un débiteur
qui eft en demeure de rendre ce qu’il doit, il
eft tenu de fa négligence, foit par rapport à la chofe
ou par rapport aux fruits. Voye^ l. contracl.jf. de reg.
jur. I. z i3 . z 23. & 226. ff. de verb. fignif. L.focius.
Jf. pro focio ; & Gregor. Tolof. infyntagm.juris un'tv.
iib. X X I . cap. x j. { A )
Fa u t e , ( Hydr. ) Les fautes font inévitables, foit
dans les conduites ou tuyaux qui amènent les eaux,
foit dans les baffins St pièces d’eau, St il n’eft fou-
vent pas aifé d’y remédier. Quand les tuyaux con-
duifent des eaux forcées, la faute fe découvre d’elle-
même par la violence de l’eau ; mais dans les eaux
roulantes ou de décharge , il faut quelquefois découvrir
toute une conduite pour connoître la faute :
on remet alors de nouveaux tuyaux ; on les foude,
on les maftique, fuivant leur nature. Le moyen de
connoître une faute dans un baffin de glaife , eft de
mettre fur l’eau une feuille d’arbre, de la paille, ou
du papier, & de fuivre le côté où elle fe rend. On y
fait ouvrir le corroi ; on remanie les glaifes , St
pour les raccorder avec les autres , on les coupe
en marches ou par étages, & jamais en ligne d roite,
ce qui feroit perdre l’eau. (K )
FAUTEUIL, f. m. chaife à bras avec un doffier.
Voy. Varticle C h a is e . Les Amples chaifes font beaucoup
moins d’ufage dans les appartenons que les
fauteuils. On a relégué les chaifes dans les jardins,
les antichambres, les églife's, &c.
Fa u t e u i l , ( droit de ) Police mil. c’étoit un droit
arbitraire 8t d’ufage, plus ou moins fort fuivant les
lieux, que les états - majors des places de guerre en
France s’arrogeoient à titre d’émolumens fur chacun
des régimens ou bataillons qui compofoient leurs gar-
nifons, pour raifon de l’entretien dos fauteuils dans
le corps-de-garde des officiers : les capitaines de chaque
corps y contribuoient également, St la fomme
s’en repartiffoit entre tous les officiers de l’état-major
, fuivant leurs grades ; mais le Roi ayant jugé ce
droit, & plufieurs autres de même nature, abufif &
trop onéreux aux capitaines,dont ils chargeoient les
appointemens, en défendit l’exaftion par Ion ordonnance
du 25 Juin 1750, concernant le fervice des
places.
Cette difpofition effuie le fort de beaucoup d’autres
de la même ordonnance ; on s’y foûmet dans
quelques places , on y contrevient dans d’autres.
La France eft le pays du monde qui poffede les
Tome VI»
plus beaux feglemens St les plus fages , fur toutes
les parties d’adminiftration ; ils annoncent le zele,
l’équité , & les lumières des miniftres St magiftrats
qui les ont conçus St rédigés ; tous les cas y font prévus,
toutes les difficultés réfolues ; il ne leur manque
que l’exqcution. C e t a r t ic le e fi d e M . D u R I V A L
l e j e u n e .
FAUVE , BÊTE- FAUVE , { V é n e r i e . ) On comprend
fous cette détermination le c e r f, le d aim , St
le chevreuil. V o y e ^ l ’a r t ic le G i b ie r .
FAUVETTE , f. f. (Hijl. nat. Ornitholog.) ctirru-
ca. Cet oifeau eft prefque auffi gros que la farloufe
ou la gorge rouge ; fon bec eft mince , alongé St
noir ; fa langue eft fourchue , dure , tendineufe 8t
noire à l’extrémité ; les narines font oblongues ; l’iris
des yeux eft couleur de noifette ; les oreilles font
grandes St couvertes ; les plumes des épaules St du
deffus du dos font noires dans le milieu autour du
tuyau, St de couleur rouffe fur les bords : la tête &
le cou font un peu cendrés avec des taches au milieu
des plumes qui font plus foncées ; le bas du dos St le
croupion font de couleur jaunâtre avec une teinte
de verd fans aucune tache noire ; les grandes plumes
des aîles font brunes, à l’exception des bords extérieurs
qui font rouffâtres ; les plumes intérieures
du fécond rang, ont chacune à la pointe deux petites
taches de couleur blanchâtre ; les plus petites
plumes des aîles font de la même couleur que les
plumes du dos ; la première grande plume eft très-
courte ; la queue a environ deux pouces de longueur ;
elle eft entièrement brune ; le deffous de l’oileau eft
de couleur cendrée, cependant le -yentre eft un peu
blanchâtre ; St dans quelques individus, cette couleur
eft plus grife, St même plombée *; les jambes St
les pattes font de couleur de chair jaunâtre ; les ongles
font bruns ; le doigt de derrière eft le plus gros
& le plus long ; le doigt extérieur tient au doigt du
milieu à fa naiffance,comme dans les autres petits oi-
feaux. Celui-ci niche dans les haies ; il donne aifé-
ment dans toute forte de pièges. "Willugb. Omit.
Fa u v e t t e à tê te noire , atricapillafeuficedu-
l a , Aid. oifeau qui eft très-petit, St qui a le fommet
de la tête noir, comme fon. nom le défigne. Le cou
eft de couleur cendrée , St le dos d’un vert foncé ;
la poitrine a une couleur cendrée pâle ; le ventre eft
d’un blanc jaunâtre ; le bec n o i r & plus mince que
celui de la mefange ; les piés font d’une couleur livide.
Ray Jynop. meth. avium. pag. yc). Voye^ O I SEAU.
( / )
Fa u x , adj. term e d ’A r ith m é t iq u e & d ’A lg è b r e . Il y
a , en Arithmétique , une réglé appellée réglé d e f a u j f c
p o f i t i o n , qui confifte à calculer, pour la réfolution
d’une queftion, des nombres f a u x pris à volonté,
comme fi c ’étoit des nombres propres à la ré foudre,
& à déterminer enfuite, par les différences qui en
réfultent, les vrais nombres cherchés.
Les réglés de fa u f f e p o f i t io n , où l’on ne fait qu’une
feule fuppofition, font appellées r é g lé s d e fa u f f e p o f i t
io n f im p l e , St celles dans lefquelles on fait deux
fa u f f e s fuppofitions, s’appellent r églé s d e fa u f f e p o f i t
i o n d o u b le o u com p o fé e .
E x em p le d ’u n e r églé d e fauffe p o f it io n f im p le .
Trouver un nombre dont la moitié, le tiers, St le
quart, faffent 26.
Suivant l’efprit de la réglé de fa u f f e p o f it io n , prenons
au hafard un nombre quelconque, tel cependant
que l’on puiffe en avoir exaftement la moitié,
le tiers, St le quart: par exemple 12, dont la moitié
eft 6 , le tiers 4 , 8c le quart 3, lefquelles quantités
additionnées ne font que 13 fort différent de 16;
mais dites par une réglé de trois : Si 13 font provenus
de 12 , d’où 26 doivent-ils provenir ? En faifant
la réglé, vous trouverez 24, dont effe&ivement la
K k k ij